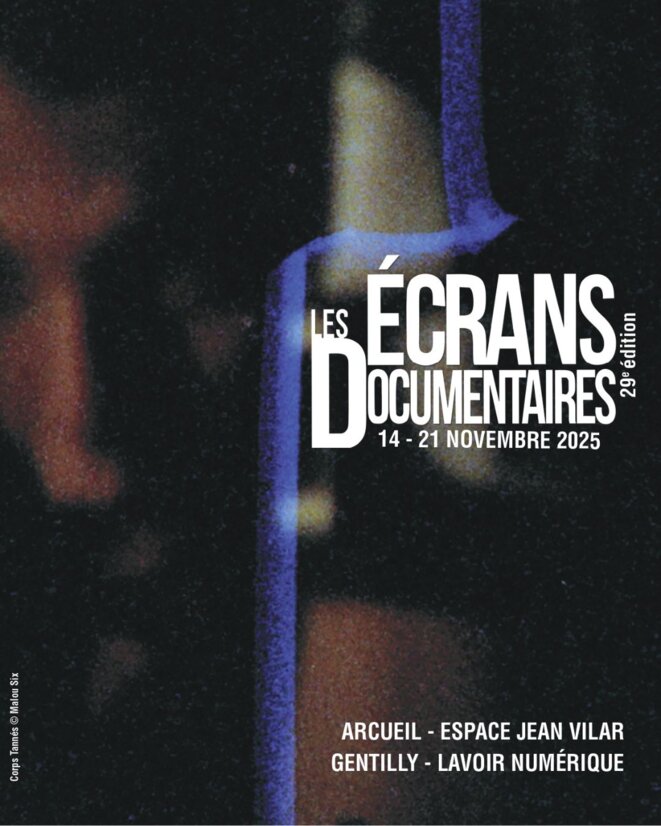Agrandissement : Illustration 1

Votre documentaire donne à voir un ghetto de migrants en Italie, près d’un lieu qui vous est familier. Pourquoi avoir choisi d’aborder ce sujet en particulier?
Eté 2014. Je pars en tant que photographe de plateau avec une troupe de comédiens dans le sud de l’Italie : ils préparent un spectacle mis en scène par un jeune artiste italien, Pietro Marullo, désireux d’explorer l'univers des saisonniers immigrés venus d'Afrique pour travailler en Europe. Le dernier jour de cette résidence d’écriture, les responsables d’une ONG locale nous emmènent à Rignano, un petit village perdu dans les campagnes, à quelques kilomètres de la ville où j’ai grandi : alors que le crépuscule s’installe, nous visitons une communauté d’environ 3000 Africains qui vit rassemblée dans un bidonville caché par une légère dépression du terrain et arrangé selon un schéma urbain labyrinthique. Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, tous les pays de l’Afrique nord-occidentale y sont réunis pendant la saison de la récolte des tomates. Cet endroit, c’est le « Ghetto ». Sa découverte est sidérante : accompagnés par les volontaires de l’ONG, on traverse un village en bois et en carton où tout semble éphémère. Les baraques précaires se succèdent, organisées selon un schéma urbain d'une géométrie primitive : on y retrouve des restaurants, des magasins de fortune, des bordels, une mosquée, tous entassés les uns à la suite des autres. Soudain, aux couleurs changeantes du crépuscule se mêlent les cris de joie des enfants du Ghetto qui nous ont vus arriver au loin. Pendant un court instant, je ne vois plus la misère de ce lieu perdu dans les campagnes. Pourquoi n’ai-je jamais vu d’images de ce lieu auparavant, alors que j'ai moi-même vécu dans les Pouilles jusqu’à mes 19 ans ? Sans tarder, la réponse nous est donnée par les quelques migrants que nous rencontrons: la plupart d’entre eux se disent sidérés à l’idée que leurs familles puissent un jour les voir dans des conditions qui n’ont rien de digne. Tous les journalistes qui tentent de pénétrer entre les baraques pour prendre des photos sont systématiquement reconduits aux portes du bidonville. Cette vision surgie un après-midi à la fin de l'été, sous le soleil étouffant du sud de l’Italie, a commencé à me hanter. Pendant un an, j’ai senti le besoin profond d’y retourner pour garder une trace de ce monde, si proche du mien et pourtant invisible.
Vous mentionnez la difficulté de vous faire accepter avec votre caméra et la complexité à capturer l’image qui en découle. Pourriez-vous nous expliquer votre processus d’intégration à cette communauté, le temps passé au sein de celle-ci, les problèmes et obstacles rencontrés?
En juillet 2015, je suis retourné au Ghetto sur un coup de tête, avec ma caméra Super 8 et un appareil photo : je ne savais pas combien de temps j’allais y rester, mais je savais que je voulais absolument garder une trace des rencontres que j’aurais faites là-bas. Pour introduire l’image au Ghetto, il fallait créer un lien «sur la durée» avec les migrants pour qu'ils puissent apprivoiser ma présence et mon regard. Finalement, j’ai vécu là-bas un mois et demi, en partageant avec ses habitants tous les moments du quotidien: les journées interminables passées sous une cape de chaleur étouffante, les longues nuits d'insomnie, la recherche d'eau et de nourriture, la préparation de repas de fortune, les trajets jusqu’à la ville... Durant les trois premières semaines de ma permanence au bidonville, je ne filmais ni ne prenais de photos, en attendant qu’un lien se crée. C’est dans l’attente que les choses se sont nouées. Les migrants espéraient que le travail commence dans les champs de tomates, et moi j’attendais que quelque chose se passe, quelque chose qui me dise qu’ils étaient à l’aise pour qu’on fasse des images. Quand les travailleurs ont vu ma persévérance à rester sur place malgré les difficultés, ils ont compris que je ne voulais pas "esthétiser" leur misère. Durant ces moments où je n’avais rien à offrir à part ma présence et mon écoute, l'inattendu se produisait: certaines personnes avec lesquelles je passais du temps me demandaient spontanément de les prendre en photo. « Tu montreras nos images à tes frères de Belgique ».
Votre film est principalement constitué de photos et de courtes séquences animées sur pellicule noire et blanche, lui conférant une esthétique strictement minimaliste. Votre contrainte de discrétion explique-t-elle le choix de la photo? Pourquoi avoir choisi de travailler avec de la pellicule noire et blanche ?
“Notre territoire” est l'histoire de ma rencontre avec un lieu où le rapport au visuel est extrêmement difficile. A une époque où les flux d'images numériques se démultiplient, le choix du Super 8 et de la photo argentique était celui qui correspondait le mieux au « fond » de ce projet : à l’instar du monde de ces migrants, dont les identités sont soumises à la menace de l'effacement, l'image pellicule transmet elle aussi un sentiment de précarité, hantée comme elle l'est par une disparition concrète et inévitable du support. Je savais que de ce choix de supports découlerait une narration tout à fait particulière, composée d’images noires, de clichés ratés, de moments pris sur le vif et d'instants figés : leur brièveté et leur amalgame évoquent à mes yeux les contours d'un souvenir dont on n’aurait gardé que quelques images et sur lesquelles la mémoire aurait décidé de s’arrêter. C’est une réflexion sur la mémoire et sur sa mise en forme que j’avais déjà travaillée dans mon film de fin d’études “Il segreto del serpente”, où plusieurs formats se mélangeaient pour représenter une mémoire qui recherche une image absente sur plusieurs strates temporelles. Comme tu l’évoques aussi dans ta question, le choix de la photo a été capital pour la réussite du projet. En effet, au début, il m’était difficile, voire impossible, de tourner en Super 8 à l’intérieur du bidonville : l’image filmée m’exposait «sur la longueur» aux regards des habitants du Ghetto qui ne souhaitaient pas que je filme ou avec lesquels je n’avais pas eu l’occasion d’avoir une discussion au sujet de ma présence parmi eux. C’était beaucoup plus simple pour moi de prendre un cliché au détour d’un moment marquant, toujours avec la permission préalable des migrants avec lesquels je me trouvais. Il y avait quelque chose de rassurant pour les migrants, dont certains en condition irrégulière, que de voir que je travaillais en argentique : ils étaient sûrs que leur image n’allait pas se retrouver du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou sur Youtube. La plupart du temps, en effet, lorsqu’ils voyaient ma caméra Super 8 et mon appareil photo, ils avaient des réactions amusées et me demandaient eux-mêmes de leur montrer comment marchait ce genre d’appareil. En partant au bidonville, j’avais aussi pris le soin de choisir une pellicule en noir et blanc très sensible, à 3200 ASA, parce que je savais que j’allais me retrouver dans des conditions de lumière très difficiles, sans possibilités d’éclairer, surtout dans les baraques des travailleurs : avec d’autres pellicules couleur, je n’aurais jamais pu photographier la nuit par exemple. Le « défaut » de cette pellicule est son grain très présent, mais, encore une fois, je trouvais que cette esthétique correspondait bien à l’intention de base du projet, c’est-à-dire garder une trace d’un monde très précaire, qui risque de disparaître. Ce dispositif de prise de vue basé sur la prise de photos a changé progressivement en fonction de mon intégration : au plus je gagnais la confiance des habitants du Ghetto, au plus je pouvais me permettre de tourner en Super 8 dans les rues du bidonville. C’est quelque chose qu’on peut voir dans le montage du film ou, finalement, les images Super 8 prennent le pas sur l’argentique.
Votre premier documentaire, “Il segreto del serpente”, prend également le schéma d’une réflexion introspective sous forme de commentaire en voix off. Pourquoi cet attrait particulier pour ce format ?
J’adore les films qui utilisent une voix off parce que, souvent, cette voix raconte l’expérience singulière qu’il y a eu derrière la prise d’image, comme dans “Lettres d’amour en Somalie” de Frédéric Mitterrand ou dans beaucoup de films de Chris Marker. Très concrètement, en termes de montage, la voix permet aussi de lier des types d’images très différents entre eux et de créer des liens, du sens... En quelque sorte elle permet d’aller au-delà de l’image et de révéler un questionnement intime, qui tend à l’universel. Tout est possible avec une voix off, comme dans une séquence géniale de “Lettre de Sibérie” où Chris Marker nous dit que les mots peuvent faire dire tout ce qu'on veut aux images ! Pour en revenir à “Notre territoire”, le « liant » de ces différents matériaux est une voix off en « Je » et en français, qui coule, douce et poétique, en mêlant les impressions de mon expérience de vie au Ghetto aux histoires des migrants, avec en toile de fond un questionnement universel sur les images comme traces de vie. Cette narration à la première personne, basée sur ma prise de notes journalière au Ghetto, décrit mon intégration «en train de se faire ». Elle organise donc les images selon la progression chronologique de mon immersion, comme si on suivait les annotations prises par un voyageur qui évolue dans un monde inconnu, mais qui lui devient de plus en plus familier. En termes d’écriture, lorsqu’on travaille avec une voix off, le plus compliqué c’est d’éviter la redite par rapport à ce que l’on voit à l’image. Le processus d’écriture est souvent très long parce qu’on a tendance à répéter dans la voix ce qu’on voit à l’image... et il faut absolument gommer ça. En travaillant avec Pauline Piris-Nury, une monteuse géniale (et surtout très patiente !), nous sommes arrivés à écrire une voix qui travaille souvent en contrepoint : à plusieurs reprises, elle parle d’une image absente, tandis que du noir ou d’autres images s’affichent à l’écran, permettant à cette image absente d’exister malgré tout. Ecrire une voix off a toujours été pour moi une expérience laborieuse, parfois douloureuse, mais aussi très riche et intense parce qu’il faut toujours faire preuve de créativité et d’inventivité. Pour le moment, je travaille avec Juanita Onzaga, une amie réalisatrice colombienne, sur le montage d’un court métrage qu’on a co-réalisé cet été : c’est encore une narration en voix off... Je sens qu’on va y passer les nuits !