Entretien avec Hans Bryan Patrick Olivier Ahogny à propos de son film 21 septembre 2024 préfecture Versailles délivrance titre de séjour 10 ans au festival Les Écrans Documentaires
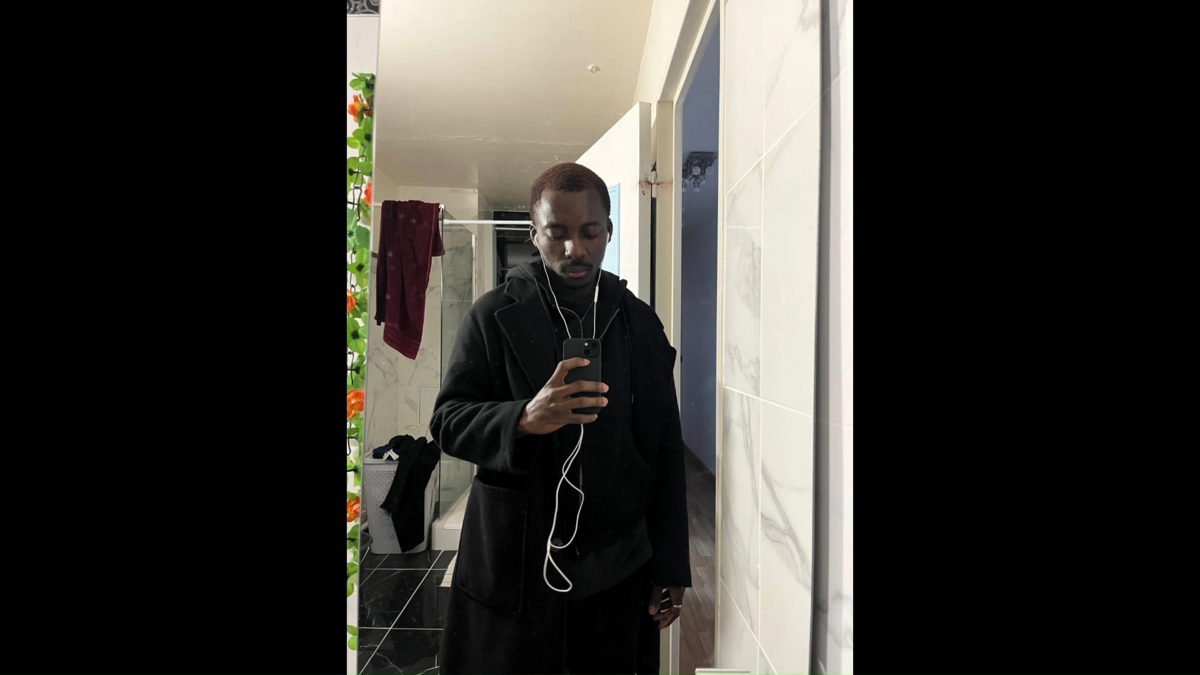
Agrandissement : Illustration 1
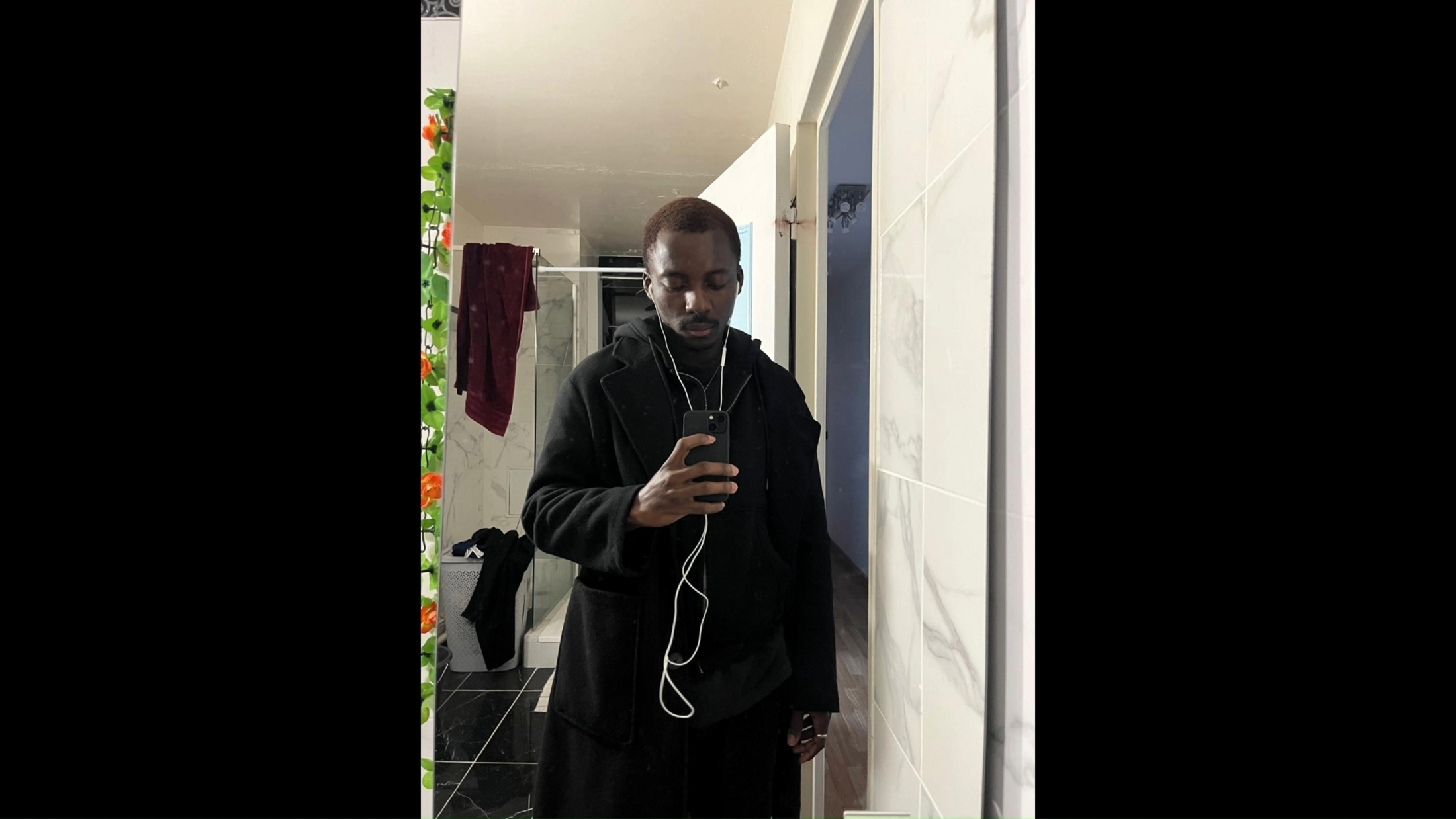
Pour commencer, pouvez-vous revenir sur votre parcours et nous expliquer comment vous en êtes venu à réaliser des films documentaires ?
Mon attrait pour le cinéma documentaire vient plutôt de mon père, quand on vivait en Côte d'Ivoire à Abidjan. De base, j'étais passionné par l’animation. Quand j’ai eu 7/8 ans, il m'a dit d'arrêter de regarder des films d'animation et de me concentrer sur des films « d'adultes », c’est-à-dire du cinéma d'auteur, des documentaires, etc. Donc, au début, je n’aimais pas du tout. Mais après, j'ai commencé à prendre du plaisir pour ça et quand j'ai grandi, j’ai commencé à savoir ce que je voulais faire. Quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais que je voulais faire des études dans le cinéma parce que je voulais fabriquer mes propres films avec mes propres émotions. Mais, il fallait savoir comment j’allais m’y prendre. Alors, il a fallu que je trouve moi-même mon propre moyen de faire du cinéma ou de propager mon cinéma. Après le bac, ma mère est venue en France pour les vacances et je suis parti avec elle. Et au moment du départ vers Abidjan, je lui ai dit que je n’y retournerai plus. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, en France. Je trouvais que les parcours classiques des jeunes africains, qui venaient, étaient trop pareils, c'est-à-dire qu’ils vont faire un CAP, qu’ils vont avoir un appartement et c’est tout, leur vie se finit comme ça. Et je me suis dit non, pourquoi pas me reconnecter avec le cinéma documentaire, avec ce que mon père m'a conseillé de faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, que j’en suis venu au cinéma.
Dans le documentaire, on vous entend dire que vous ne savez pas encore ce que vous allez faire de ce titre de séjour de 10 ans. Depuis la sortie du documentaire, avez-vous trouvé une réponse à cette question ?
Pas réellement, non. Je sais ce que je pourrais en faire, mais je ne sais pas si c’est vraiment utile pour le moment. Je pars du principe qu’un titre de séjour, il faut le rentabiliser, c’est-à-dire pouvoir en tirer le maximum, faire un maximum de choses avec. Est-ce que c’est difficile ? Oui, un peu. Ce que je fais aujourd’hui, c’est du cinéma. Je passe mon temps, ma nouvelle vie, à faire ça. Mais, je n’ai pas encore vu le bout du tunnel qui me permettrait de dire : « Oui, c’était le bon choix. » ou « C’est vraiment ça que je dois faire de ce titre de séjour. ». Pour l’instant, je n’ai pas encore eu cette gratification, ce sentiment de mérite. Et d’un point de vue un peu capitaliste, c’est comme si on disait qu’il faut forcément apporter quelque chose à la société pour justifier son titre de séjour, comme si c’est ça qui le « rentabilisait ». Et à partir du moment où on s’écarte de cette idée, de ce qu’on est censé « faire » avec ce titre, on commence un peu à douter. Donc voilà, ce n’est pas encore tout à fait clair pour moi. Surtout qu’à une période, j’avais envie de retourner en Côte d’Ivoire. Je connais la France et son fonctionnement et je n’arrive pas à me retrouver dans la vie active et sociale. Mais j’ai l’impression que si je retourne en Côte d’Ivoire, ce serait comme si j'abandonnais le cinéma.
Vous nous plongez dans votre galerie de téléphone, comme dans une mémoire vivante de votre parcours après l’obtention de votre titre de séjour. Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir cet espace si personnel au regard du public ?
Déjà, il y a plusieurs volets. Il y avait le volet, on va dire, « documentaire », c’est-à-dire dans l’univers du documentaire. J’appelle ça le doc d’immigration, c’est-à-dire tous les documentaires qui parlent souvent de situations de personnes immigrées ou en exil. On peut prendre l’exemple de Nous, d’Alice Diop. Il y a une partie, par exemple, où elle filme un sans-papiers et en fait, la seule fois où on le voit, c’est dans des moments où il parle de souffrance, de séparation. On ne le voit pas dans son quotidien, on ne sait pas ce qu’il aime, qui il est vraiment. On sait juste qu’il est venu en France et que ça fait onze ans qu’il n’est pas retourné chez lui. Et si vous remarquez bien, dans les documentaires sur l’immigration, il y a toujours un moment où la personne parle du manque, de la famille laissée derrière. Il y a une sorte d’uniformisation dans ce type de documentaire. Donc, la première chose que je voulais faire, c’était justement de sortir de ce cadre-là, de proposer un nouveau regard sur ce genre de film. Ce sont des sujets tellement sérieux que même les formes utilisées le sont aussi, très sérieuses, très codifiées. Et du coup, ça crée une uniformité, presque un ennui. Dès le début d’un documentaire, on sait qu’on va interviewer quelqu’un qui n’a pas les papiers, et vers la fin, quelqu’un qui est peut-être en train de les obtenir. C’est un peu toujours la même structure. Comme dans L’histoire de Souleymane : le film commence avec le livreur et à la fin on le voit lors de son entretien pour la demande d’asile. On ne voit jamais « l’après ». Alors je me suis dit : il faut que je parle de l’après. Déjà pour apporter un regard neuf, mais aussi pour changer la forme, la manière de raconter.
Je me suis posé la question : quelle forme adopter ? Et finalement, le manque d’argent m’a poussé à me concentrer sur ce que j’avais. J’avais une idée assez claire de ce que je voulais faire, mais comme je n’avais pas de moyens, je me suis dit : “ok, je vais faire avec ce que j’ai”. J’avais mon téléphone, mon dictaphone et mon ordinateur. Donc j’ai pris mon téléphone, que je venais d’ailleurs de changer, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à prendre des photos et à raconter. Le fait de raconter à travers mon téléphone me permettait aussi de faire un documentaire qui ne se concentre pas uniquement sur l’obtention des papiers, mais sur ma vie quotidienne après, contrairement à la plupart des documentaires qui s’arrêtent une fois que la personne a obtenu ce fameux papier. L’idée, c’était vraiment d’apporter au public une nouvelle vision du documentaire d’immigration, de montrer quelque chose de différent, à travers une personne qui est venue en France mais qu’on découvre autrement, pas seulement à travers la galère, mais aussi à travers le vécu, les émotions, la normalité du quotidien.
À plusieurs moments du documentaire, des vidéos issues de Tiktok ou Instagram (Reels) s’invitent dans le récit pendant que vous parlez, celles-ci vous coupant la parole. Pourquoi avoir fait ce choix de mise en scène ? Qu’apporte ces vidéos à votre narration ?
C’était un choix très volontaire. Le documentaire est tellement personnel qu’il y a certains aspects de ma vie dont je n’avais pas forcément envie de parler directement. En fait, j’ai fait le montage complet avant même d’enregistrer la voix off. Donc à certains moments, je me retrouvais face à des séquences où j’étais un peu obligé d’aborder des sujets dont je n’avais pas forcément envie de parler. Et comme je voulais aussi changer la manière dont les documentaires sur l’immigration sont perçus, je me suis dit : pourquoi ne pas casser un peu ce rythme-là, ce côté trop sérieux ? C’est là que m’est venue l’idée d’intégrer des petites vidéos de ma galerie. Ces vidéos servent à déconcentrer un peu le spectateur, à créer une respiration. D’une certaine manière, c’était aussi une façon pour moi d’échapper à certains sujets trop intimes. Quand je sens que je rentre dans quelque chose de lourd, de sensible, je glisse une vidéo drôle, complètement décalée, qui n’a parfois rien à voir avec le reste du film. Ça permet au spectateur de souffler, de se détacher un peu de la gravité du propos, mais aussi à moi, de ne pas trop me livrer sur certains points, comme mes relations familiales, mes difficultés avec le cinéma, ou encore les problèmes d’argent. C’est une sorte de jeu d’équilibre entre ce que je dis, ce que je tais, et ce que je laisse passer autrement, à travers ces images qui viennent bousculer le récit.
Toujours en lien avec votre galerie photo, on remarque que vous décrivez certaines images de manière très directe et sans filtres. Était-ce une manière délibérée d’assumer une forme de sincérité ou de vulnérabilité ?
C’était un peu comme un album photo. Il y a un documentaire que je n’ai pas encore terminé, Bye Bye Tibériade, où dans certains passages on voit l’actrice ou sa grand-mère, je ne me souviens plus exactement, en train de feuilleter des images, et elles les commentent d’une manière assez poétique, presque symbolique. Moi, je ne voulais pas aller dans cette direction-là. Je voulais quelque chose de plus direct, de moins filtré. Je ne voulais pas « embellir » les choses, ni les raconter sous une forme poétique ou métaphorique. Je voulais dire les choses telles qu’elles sont, de manière frontale, presque brute. Parce que je me suis dit : si je parle de façon directe, les gens vont être plus captivés, plus surpris aussi, parce qu’ils ne sont pas habitués à ce ton-là dans un documentaire. Je voulais qu’on ait parfois l’impression de ne pas regarder un documentaire, mais plutôt d’écouter quelqu’un qui parle vraiment, simplement, sans mise en scène. Et pour moi, un bon documentaire ou un bon film, c’est justement celui où, à un moment, on oublie qu’on regarde un film. Donc je me suis dit que si je parlais au spectateur comme je parlerais à un ami, ou même comme je me parlerais à moi-même, ça créerait une proximité, une forme d’intimité sincère. C’est un peu ça l’idée : être vrai, sans filtre, comme quand on tourne les pages d’un album photo personnel.
Vous évoquez une différence marquante entre la manière dont on perçoit ou traite la « différence » en France par rapport à la Côte d’Ivoire, où cela semble être moins problématique. Avec le recul, quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette distinction ?
En fait, la Côte d’Ivoire et la France c’est différent, mais en même temps pas tant que ça. La Côte d’Ivoire, c’est un pays très métissé. Il y a beaucoup de Maliens, de Burkinabés, de Camerounais, etc… On vit dans une certaine harmonie, une diversité qui fait un peu partie du quotidien. Moi, par exemple, j’ai grandi en Côte d’Ivoire entourée de femmes voilées, de femmes noires, de cultures différentes, mais je n’ai jamais ressenti cette idée de « différence » comme ici. C’est vraiment en arrivant en France que j’ai commencé à me rendre compte qu’on me percevait comme « autre », comme un « homme noir », comme « étranger ». En Côte d’Ivoire, je peux dire : « ah voilà, telle femme sénégalaise, telle femme burkinabé que j’ai rencontrée », mais c’est juste une manière de situer la personne, pas une étiquette. Ici, en France, j’ai remarqué qu’on met l’accent là-dessus, et parfois de façon assez dure, voire méchante. Alors bien sûr, en Côte d’Ivoire aussi il y a des discriminations et des tensions. Mais ce n’est pas vécu ni exprimé de la même manière. En Côte d’Ivoire, j’ai l’impression que ça touche surtout les personnes plus âgées, ou certaines catégories sociales. En France, au contraire, j’ai l’impression que ça touche tout le monde, à tous les niveaux. Parfois, ça crée des malentendus. Par exemple, je peux faire une blague à une femme, et elle ne comprend pas, elle se dit « Pourquoi tu me parles comme ça ? » ou « Pourquoi tu dis ça sur telle femme ? ». Et je dois expliquer que je n’ai pas grandi dans un environnement où on mettait autant de barrières entre les gens. Quand je dis « cette personne est méchante », pour moi c’est juste ça : une personne méchante. Mais ici, certains vont l’interpréter comme : « Ah, il dit que cette femme noire est méchante, donc il pense que les femmes noires sont méchantes. ». Et là, tu comprends qu’il y a une vraie différence de perception. Donc oui, il y a beaucoup de différences entre les deux pays, dans la façon de voir « l’autre ». Mais moi, de mon point de vue, ma manière à moi de voir les gens, elle n’a pas changé.
Vous mentionnez à plusieurs reprises le monteur, Jean-Luc, dans le documentaire. Comment cette collaboration est-elle née et comment avez-vous travaillé ensemble sur la construction du film ?
Jean-Luc, en fait, c’est un ami. Quand j’ai commencé à vouloir faire du cinéma, on vivait dans le même quartier, à Abidjan. C’est à cette époque-là que j’ai eu mes premières envies de faire des films et il a été la première personne à me soutenir, même quand d’autres ont un peu laissé tomber. Moi, je suis quelqu’un qui croit beaucoup en la vie, donc même quand ça semblait compliqué, je lui disais toujours : je vais faire du cinéma. Et lui, il m’a cru. Il a voulu m’accompagner dans cette aventure. C’est aussi la première personne à avoir monté un de mes films. Je l’avais envoyé dans un festival de cinéma, je ne sais même plus s’il avait été sélectionné ou pas, mais c’était important. Jean-Luc, c’est quelqu’un qui a toujours regardé mes films avant tout le monde. Il a vu tous mes courts, mes débuts, mes documentaires… Il connaît mes idées, mes projets, même ceux que je n’ai pas encore réalisés. C’était un peu ma jauge, celui à qui je demandais : « Est-ce que je continue ou pas ? ». Donc le mentionner dans le film, c’était une manière de rendre hommage à cette complicité, à ce lien de confiance qu’on a depuis mes débuts. Mais pour ce documentaire-là, il n’a pas participé directement au montage. Il n’a pas touché au film. Il a simplement été la première personne à le regarder, comme il l’a toujours fait, et à me donner son avis, avec toute la sincérité que je lui connais.
Vers la fin du documentaire, lors du plan séquence où vous êtes dans le métro, apparaît cette phrase : « la peur n’a pas de place chez nous ». Que signifie-t-elle pour vous ? Que vouliez-vous transmettre à ce moment-là ?
C’était un message que je voulais transmettre à toutes les personnes africaines qui veulent faire du cinéma. Un message très précis, presque comme un appel. Parce que, d’une certaine manière, le cinéma a toujours laissé entendre que c’était très difficile pour les jeunes Africains d’y trouver leur place. Et c’est vrai qu’en Afrique, on est encore beaucoup influencé par une manière très « européenne » de faire du cinéma. On ne prend pas assez de risques. On explore peu, on ose rarement sortir des codes. Souvent, on essaie de copier le plus possible le cinéma d’auteur occidental, dans l’espoir d’être « sélectionnés » dans des festivals ou reconnus à l’étranger.
Donc quand j’écris : « La peur n’a pas de place chez nous. », c’est une manière de dire qu’il faut oser faire les choses différemment, qu’il faut prendre des risques si on veut vraiment avancer. Les jeunes Africains qui veulent réussir doivent, malheureusement, travailler deux fois plus, oser deux fois plus, parfois même risquer leur vie ou leur âme pour faire ce qu’ils aiment. Parce qu’ils n’ont pas toujours les mêmes moyens, les mêmes chances, les mêmes soutiens. Et dans la vie, c’est comme ça : selon l’endroit où tu es né, tu dois te battre encore plus fort pour obtenir ce que tu veux. Alors cette phrase, à la fin du film, c’est une manière de leur dire : il faut arrêter d’avoir peur, si on veut faire évoluer le cinéma africain et le ramener à la force qu’il avait dans les années 60, 70 ou 80. Il faut qu’on enlève cette peur-là. Il faut oser créer nos propres films, oser raconter nos histoires, oser exister. Et même quand on veut venir en France, ou tenter ailleurs, il ne faut pas avoir peur, ni de l’échec, ni du regard des autres, ni même de décevoir nos parents. Parce qu’à force d’avoir peur, on perd énormément de talents. Et moi, à ce moment du film, je voulais justement dire qu’on ne peut plus se permettre d’avoir peur.
Durant cette même scène, on entend en fond Pray for me de OG Mahilet. Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir ce morceau pour accompagner ce moment du film ?
C’est un morceau que j’ai découvert pendant la période où je travaillais sur ce film. Dans le documentaire de base que j’avais prévu, j’avais terminé le montage vers la fête de la musique. Je voulais inclure des scènes montrant des gens en train de travailler ou de s’amuser, mais je n’avais pas les moyens de tourner toutes ces séquences avec la musique que je voulais au départ. Je suis tombé malade à ce moment-là, mais j’avais déjà acheté ce morceau pour le film. Alors je me suis dit : ok, j’ai déjà acheté (les droits) de la musique, comment je peux l’utiliser ? Quand j’écoute Pray for Me d’OG Mahilet, je pense à ces scènes de voyage, à l’idée du déplacement, du mouvement. Je me suis dit que je pouvais l’utiliser pour accompagner mon voyage, le trajet en train vers Paris, et faire que cette musique devienne le fil conducteur de ce moment. C’est comme ça que j’ai choisi ce morceau. Il me semblait assez mélancolique, assez fort, mais aussi porteur d’une certaine émotion qui accompagne le voyage et le passage du temps dans le film.
Nous pouvons voir que votre sœur est une présence récurrente et essentielle dans le documentaire. Quelle place occupe-t-elle dans votre parcours et que représente pour vous le fait de la faire apparaître à l’écran ?
Ma grande sœur a été l’une des premières personnes à comprendre que j’étais vraiment différent. Quand j’ai décidé de venir en France et que je lui ai dit que je partais, elle ne m’a jamais jugé ni dit non. Elle m’a laissé la liberté de faire mes choix, sans conditions. Elle m’a donné le temps de m’installer, de trouver mon chemin, et pour ça, je lui devais de lui rendre hommage. Ma sœur s’est installée en France très tôt, en 2015, alors que j’avais 15 ans. Dieu merci, tout s’est bien passé pour elle, elle n’a jamais rencontré de grandes difficultés sociales, et son parcours a été plutôt fluide. Moi, mon parcours est différent, plus compliqué. Mais, elle fait partie des personnes qui me soutiennent, même si elle ne comprend pas toujours tout, parce que ma réalité n’est pas la même que celle des personnes qui viennent ici et qui rencontrent beaucoup d’obstacles. Dans le film, elle apparaît beaucoup parce que nous avons beaucoup parlé à cette période. On discutait de nos vies, de ce que je voulais faire en France, de mes choix de formation, du cinéma, de l’avenir… Et elle, de son côté, se posait aussi des questions sur son parcours de femme en France, sur un éventuel retour ou sur ses choix professionnels. Elle représente, pour moi, un modèle de réussite, quelqu’un qui est arrivé en France, qui a trouvé sa voie, et qui, d’une certaine manière, aide aussi les jeunes Africains à réaliser leur art. Pas forcément en donnant de l’argent, mais en donnant du temps, des conseils, un soutien moral. Dans le film, elle incarne donc la force, le soutien et l’exemple, tout en restant réelle : nos parcours sont différents, nos visions de la vie et du capitalisme ne sont pas les mêmes, ce qui crée parfois des divergences. Mais sa présence était essentielle. Si elle n’avait pas accepté d’être là, ou si elle n’avait pas soutenu le projet, le documentaire aurait été beaucoup plus compliqué à réaliser. Et je voulais aussi qu’elle serve de référence pour toutes les femmes qui regardent ce film : montrer qu’on peut trouver sa place, réussir, et soutenir les autres sur leur chemin.
Lors de la dernière scène, ou vous remerciez votre sœur et votre mère, vous affirmez : « Vous êtes le plus grand artiste de tous les temps. ». Est-ce une manière d’affirmer votre légitimité en tant que racisé en France ?
On peut dire que cette phrase, « Vous êtes le plus grand artiste de tous les temps. », je l’ai surtout dite par rapport à mes idées de films, à ce que je voulais réaliser. J’ai vraiment beaucoup d’idées, beaucoup de projets, et à ce moment-là, c’était une manière de me motiver, de me rappeler que ce que je crée a de la valeur. Dans tout le milieu des cinéastes africains en France, ou plus largement, je n’ai pas encore vu beaucoup de personnes qui font des films comme je les conçois. Alors cette phrase, c’était aussi pour me dire : j’arrive, et quand je serai là, je prendrai ma place. C’est une manière de m’installer, de ne pas rester dans la position de spectateur ou de personne qui subit, contrairement à certains documentaires où la personne filmée est souvent montrée dans une posture de soumission ou de pitié. C’est aussi une provocation, à la fois envers les cinéastes et envers un système qui ne facilite pas toujours la réussite ou la visibilité des jeunes Africains dans le cinéma. C’était un moyen de dire que je suis là, je crée, et je refuse de rester dans l’ombre ou de me limiter.
PROPOS RECUEILLIS PAR ROKIA BAMBA



