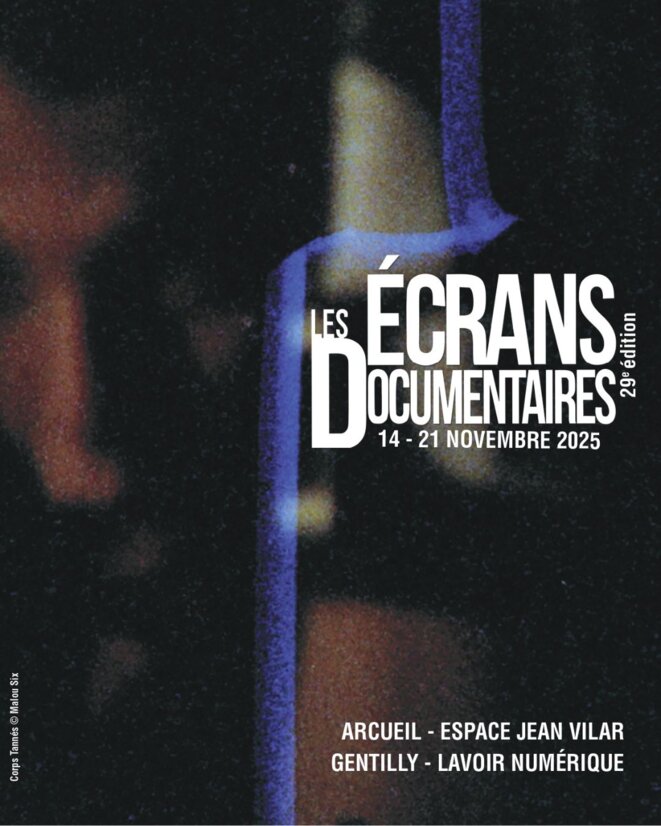Entretien avec Pauline Roth à propos de son film Vara Nu Dorm (L’été, je ne dors pas), sélectionné à la 29ème édition du festival Les Ecrans Documentaires.

Agrandissement : Illustration 1

Est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours et sur ce qui t’a menée à la forme documentaire ?
J’ai étudié en hypokhâgne & khâgne option cinéma, puis à l’Université Paris 3, la littérature et le cinéma. Là, j’ai découvert le cinéma d’Agnès Varda et sa manière de documenter de manière personnelle et créative. Ça m’a plu et donné envie d’aller chercher de ce côté-là. Un été, j’ai entendu parler du festival de Lussas à la radio et j’ai décidé d’y aller, seule avec ma tente sur le dos. Ça a été ma découverte du documentaire de création et de la manière de raconter des histoires poétiques dans le réel, avec des personnes avec qui on créait une confiance et une vraie relation. L’année d’après, j’ai postulé à des cursus de réalisation documentaire et j’ai étudié au Master Image & Société d’Évry. J’y ai découvert à la fois le documentaire de création et la Roumanie. Mes premiers gestes documentaires sont très liés à ce pays.
En 2016, tu as réalisé Casa familie, tourné dans un foyer pour enfants à Bucarest. Tu as choisi d’y revenir pour Vara Nu Dorm. Qu’est-ce qui te rattache à ce lieu et à ce pays ?
La Roumanie, c’est une longue histoire d’amitié qui m’y relie. La première fois que j’y suis allée, c’était avec mon ami d’enfance Louis, qui a grandi en orphelinat là-bas jusqu’à ses 7 ans, où il a été adopté par un couple français. J’ai été sa première amie lorsqu’il est arrivé à Strasbourg et nous avons noué des liens très forts. En grandissant, il m’a embarquée dans sa quête identitaire d’enfant adopté qui souhaitait retrouver son pays et sa mère biologique. Nous avons vécu cela ensemble. Ensuite il n’y est plus retourné, et moi, je n’ai eu de cesse d’y aller. En 2015, lors d’un séjour de théâtre franco-roumain, j’ai rencontré ces jeunes plus ou moins en situation d’abandon, qui vivaient à Bucarest dans une maison pour enfants, élevés par une Soeur gréco-catholique. Avec mon film de fin d’études Casa familie, j’ai voulu montrer l’atmosphère de cette maison où petits et grands s’entraident dans une solidarité. Je n’avais pas eu le temps de connaître leurs histoires personnelles. Certains jeunes m’interpellaient très fortement par leur manière d’être au monde et je sentais que je n’avais qu'effleurer les choses. C’est ainsi que j’y suis retournée dès 2018 avec une caméra.
J’avais envie de faire un film au plus près d’eux, qui raconte la turbulence de leur enfance, leur vitalité aussi. Ce qui m'interrogeait, c’était de savoir comment on se construit avec une enfance chaotique, blessée ou avec l’abandon ?
Le titre du film, Vara Nu Dorm (L’été, je ne dors pas) évoque un état suspendu. D’où vient-il et que signifie-t-il pour toi ?
À l’écriture, le projet s’intitulait Jouer sa vie, dans l’idée que dans leur façon de se mettre en scène au regard de l’autre se jouait pour ces jeunes quelque chose de leur vie, de leur enfance abandonnée. C’était une idée un peu théorique (et un titre un peu chiant m’a-t-on soufflé !). Au fil du montage, le film devenait autre chose que cette idée d’écriture. La monteuse Mélanie Braux m’a suggéré de trouver un titre qui soit plus à l’image du film et donc aussi en langue roumaine. Vara nu dorm, c’est d’abord le titre d’une musique mainstream en Roumanie qu’on entend pendant la scène du feu et sur laquelle Vali danse avec frénésie.
J’aime beaucoup cette musique, mais, au début, cela me posait problème de réutiliser le titre de la chanson qui est hyper commerciale et répandue là-bas ! Finalement, en le traduisant en français, on a trouvé ça très poétique et très juste. Vara nu dorm, “L’été, je ne dors pas”, raconte beaucoup l’exaltation de l’été et surtout la fougue de Vali, l’adolescence, la négation, une énergie, un feu qui ne s'éteint pas... L’été, je ne dors pas, raconte bien - je crois - l’intensité de ces jeunes, que je voulais transmettre.
Le personnage principal de Vara Nu Dorm est un jeune adolescent Vali. Comment s’est faite la rencontre, et qu’est-ce qui t’a donné envie de le filmer ?
J’ai rencontré Vali l’été 2018 au séjour de théâtre. Il débarquait pour la première fois, il avait 14 ans, il était toujours “à côté”, un peu sauvage, pas dans les codes. Il avait grandi en foyer, livré à lui-même, et Soeur Maria avait décidé de l’accueillir dans sa maison pour lui donner plus de chances. Au séjour de théâtre, il faisait tout pour se faire remarquer, y compris des choses incongrues. J’étais intriguée par sa manière de se mettre en scène constamment. Vali était fascinant à observer et à filmer, tant il était expressif avec son corps et dans les expressions de son visage. Il y avait une énergie, des émotions débordantes. J’avais envie de saisir l’intensité de ses émotions et d’aller creuser les enjeux de son histoire. D’où venait ce feu et cette mise en scène de soi ? Ce qui m’a donné envie de filmer c’est justement cet élan, ce mouvement en lui qui laissait entrevoir aussi la possibilité d’une transformation ou d'une évolution.
Les exercices de théâtre ont été des outils dans son apprentissage : apprendre à mettre des mots sur ce qu’il ressentait, plutôt que de s’exprimer par le corps ou de se laisser déborder. Lorsqu’il a commencé le théâtre, il arrivait à peine à lire le texte, mais il se concentrait et essayait d’y mettre son énergie. Ça le canalisait et ça lui donnait aussi un rôle, une place dans le groupe, une manière d’exister aux yeux des autres. Et Mihai, qui était plus grand que lui et s’investissait fortement sur scène, a aussi joué un rôle dans son intérêt pour le théâtre. Vali l’écoutait et le regardait avec respect. Cet été-là, Mihai a aidé et “coaché” Vali dans ses premiers pas sur scène. Je filmais déjà Mihai, alors qu’il y ait une rencontre entre ces deux-là était formidable pour moi !
Tu filmes pendant un atelier de théâtre franco-roumain. Le théâtre permet de rejouer, de mettre à distance ses émotions. Est-ce que, d’une certaine manière, ton film prolonge ce travail de mise en jeu et de mise en scène de soi?
Complètement, c’est ce qui a accroché mon regard dès le départ quand je regardais et filmais les jeunes : la manière dont ils se mettent en scène dans un immense besoin d’être regardé, pas seulement sur la scène théâtrale, mais dans la vie et devant l’objectif de la caméra bien sûr.
L’élan que je recevais en étant derrière la caméra me troublait. Mais, je n’avais pas compris de quoi il s’agissait, au début. C’est en rencontrant le grand Mihai, au cours d’un entretien en 2018, que j’ai compris ce qui se jouait. Lui qui était déjà jeune adulte et qui avait fait un travail introspectif, mettait les mots sur son histoire. Il m’a raconté son enfance, l’abandon, le besoin d’être regardé et d’être aimé et assumait un narcissisme fort qu’il déployait sur la scène de théâtre. C’est donc quelque chose de leur histoire personnelle, de leur manque de regard au plus jeune âge, qui se jouait en eux. Et donc, quand je filmais ces jeunes, l'objectif de la caméra était un regard de plus dont ils se saisissaient, et en particulier Vali, qui en a joué dès le début. Néanmoins, il pouvait aussi bien chercher ce regard que le refuser et se replier. Cela a été comme un apprivoisement. J’ai filmé longtemps pour qu’il accepte que je m’introduise avec ma caméra dans des situations personnelles ou délicates de sa vie.
Au cours du tournage, quels étaient tes liens avec les jeunes ? Comment as-tu introduit la caméra dans vos rapports ?
J’ai introduit la caméra dès le départ. J’ai filmé pour la première fois l’été 2015 lors du séjour de théâtre en Roumanie, où j’étais aussi animatrice - ce qui était un jonglage un peu complexe ! J’ai ainsi réalisé mon premier geste documentaire, Micul Cyrano. Les années d’après, j’y retournais avec la caméra mais sans la responsabilité d’animatrice. Mon rôle était de filmer pour mon projet de film, et en parallèle de faire des montages avec les images du théâtre pour enrichir nos spectacles d’extraits vidéos. Voir leur image projetée, ça a sûrement aussi été déterminant pour les jeunes. Chacun pouvait se voir à l’image, valorisé dans son rôle de théâtre et ce à différents âges, sur plusieurs années.
Et puis, en vivant ensemble chaque été pendant 15 jours à la campagne, ce qui était à la fois un temps de vacances plein de libertés et un travail intense de préparation du spectacle, on a créé des liens forts. On était comme une troupe, il y avait une promiscuité qui se créait très vite. Puis, j’étais aussi une jeune, plus adulte qu’eux certes, mais étant donné que je parle roumain, j’ai pu échanger et tisser des liens facilement. Ils se sont très vite habitués à la caméra, vu que j’étais quasi tout le temps avec. À un moment donné, ils l’acceptent ou l’oublient.
On ressent la présence du temps qui passe, par la succession des répétitions qui mène au spectacle, par les ados qui ont soudain des problématiques d’adultes. Les jeux d’enfants restent présents, mais on sent ce tiraillement entre l’enfance et l’âge adulte propre à l’adolescence. On ressent les évolutions. Combien de temps es-tu restée sur place ? Et comment as-tu appréhendé cette dimension du temps, celui du tournage, des répétitions, des transformations de l’adolescence ?
Les séjours de théâtre l’été duraient environ deux semaines. Pour ce projet, j’ai filmé de 2018 à 2020, à raison de deux à trois fois par an. L’enjeu du montage avec Mélanie Braux était de déterminer si le film allait exploiter cette matière espacée dans le temps et dans laquelle on les voit évoluer et grandir. Finalement le film se tient lors du séjour de théâtre de l’été 2020 – à l’exception d’une scène tournée en 2018 – parce que c’est cet été-là que les enjeux autour de Vali, de sa vie adulte, d’une nécessité de changement, se sont déployés dans le réel et qu’il m’a été permis de les saisir, par la confiance acquise au fil du temps.
Par ailleurs, la question de l’évolution de l’enfance à l’adolescence, je l’avais imaginée mise en perspective d’une autre manière. Au départ, le projet s’attachait à trois protagonistes : la petite Maria (5 ans) – que je filmais depuis 2015 – Vali adolescent de 15 ans et Mihai (18 ans). Pour moi, ils représentaient chacun un âge et une étape différente de la construction de soi. Je voulais interroger la construction et la mise en scène de soi, propre à chaque âge : la petite enfance qui invente des sketches pour attirer le regard, Vali, adolescent qui dans une certaine turbulence sortait du cadre pour se faire remarquer, et Mihai qui déployait son énergie pour briller au théâtre, et qui avait déjà un regard introspectif sur son histoire. À l’écriture, je trouvais que leurs trajectoires différentes mises en perspective, ça racontait aussi ce que c’est que grandir. Finalement, au montage, il n’y avait pas la place pour déployer trois personnages dans la narration. Il a fallu choisir et Vali était, de fait, celui qui prenait le plus de place, de lumière et pour qui la problématique de construction de soi était la plus forte et en mouvement.
Enfin, le séjour de théâtre avait sa propre temporalité et finalité : le spectacle, qui donne une ligne de mire au film. Au montage, on devait respecter une certaine chronologie des événements : la préparation du spectacle et la problématique de Vali qui surgit et se résout. Mais évidemment on a un peu réarrangé et renforcé la dramaturgie.
Tes choix de mise en scène, caméra épaule, zooms, immergent les spectateurs dans le quotidien des jeunes. On a l’impression de voir avec toi, d’y être. Peux-tu revenir sur cette grammaire ?
Dans le précédent film, j’avais posé mon regard avec une caméra fixe. Avec Vara nu dorm, j’ai immédiatement eu envie de filmer en caméra épaule et en mouvement pour raconter l’intensité de ces jeunes, de leur vie et leur devenir. Je voulais faire un documentaire sur le vif, le vif de l’adolescence, le vif de leurs enfances abîmées aussi. Et je voulais aussi être au plus proche, et comme ils bougent, se meuvent beaucoup dans la vie et au théâtre, il fallait que je sois mobile pour me déplacer au gré de leurs mouvements corporels et intérieurs. J’ai adoré vivre cette intensité derrière la caméra, et être pleinement dedans avec mon corps filmant – c’était physique à vivre, surtout que je filme beaucoup et dans la durée.
Dans le documentaire, les jeunes regardent à plusieurs reprises la caméra. Certains s’écrient à un moment donné : « Elle a tout filmé ! ». Aussi, tu réunis Vali et un de ses amis pour les interviewer. On entend ta voix mais on l’oublie presque. Comment as-tu trouvé ta place entre présence et discrétion, entre regard et participation ?
Cela s’est fait naturellement au fil du temps passé avec eux, avec et sans caméra. De la même manière qu’ils m'alpaguent spontanément à certains moments, parce que je suis présente, ils ne l’oublient pas complètement. Mais pour revenir sur la scène de Vali et Mihai dont tu parles : dans le film, c’est la seule séquence d’entretien posée, face caméra et qui est initiée par moi réalisatrice – et où l’on sort du cinéma d’immersion. J’aime les documentaires de cinéma direct où le réel fait récit sous nos yeux, même si cela est forcément construit pour le film. Mais pour creuser le personnage de Vali, aller au-delà des facettes qu’il donne à voir, je voulais qu’il s’exprime, sur lui et sur son histoire. Je ne la connaissais pas car il n’en parle jamais, et connaissant sa propension à parler et sa réticence à “être dirigé”, je savais qu’il n’accepterait pas l’idée d’un entretien seul face caméra. J’ai eu l’intuition qu’ il accepterait peut-être de parler s’il entendait Mihai se prendre au jeu de l’entretien et que les mettre tous les deux ensemble pourrait ouvrir sur un vrai dialogue. J’avais envie que Mihai raconte son histoire à Vali – qu’il ne connaissait pas et qui fait écho à la sienne – que Vali entende Mihai mettre des mots sur son abandon et son cheminement. Et j’avais espéré ainsi que Vali se prête au jeu en racontant lui aussi quelque chose de lui à Mihai. Et cela a pris. La manière dont cette scène d’entretien s’est déroulée a été un moment de grâce. C’est donc la seule scène où on m’entend m’adresser à eux, leur poser des questions pour ouvrir l’entretien et ce jusqu’à ce qu’ils dialoguent entre eux, oubliant ma présence.
Tu as filmé seule et alors que tu es monteuse, tu as délégué cette étape à Mélanie Braux. Est-ce que cette collaboration a changé ton regard, jusqu’alors unique, sur le projet ?
La collaboration a été essentielle même ! Monter seule ses propres images sur un projet aussi vaste et sur un premier film n’était pas fructueux. Et justement, étant monteuse, j’étais convaincue de la nécessité d’un.e monteur.euse pour trouver le fil de ce documentaire de création. On m’a recommandé la monteuse Mélanie Braux avec qui j’ai pu travailler - grâce à la bourse Forte de la Région Île de France. Nous avons cherché ensemble le film au montage dans un dialogue fluide et tout en confiance. Cela a été une superbe expérience de bénéficier de son regard sur les images, qui était en harmonie avec ce que je voulais raconter de ces jeunes, et avec la sensibilité avec laquelle je voulais le faire. Le film a évidemment beaucoup gagné et son regard m’a aidée à me délester de certaines intentions un peu théoriques du film – issues du dossier d’écriture – et à me rapprocher plus du réel, de qui ils sont, et à faire confiance aux images. Ensuite elle a aidé avec sa finesse humaine aussi, à façonner la trajectoire de Vali dans sa complexité, sans l’enfermer dans certaines facettes violentes ou insolentes. Et pour moi, cela a été riche aussi en tant que monteuse, de vivre ce déplacement de regard, d’un montage de création qui essaye d’être au plus juste de ce qu’il raconte, quitte à assumer des défauts techniques qu’on veut masquer quand on est réalisateurice. Et aussi d’aller au plus simple – sans effets ou idées de réalisation – d’un film qui se raconte dans le réel. Alors bien sûr, pour aller au plus juste et au plus simple, il a fallu pas mal chercher et essayer. On l’a construit ensemble au montage.
Quelle a été la réception du film à Bucarest parmi les jeunes ?
Les jeunes ont vu la première version de montage qui a existé – avant qu’on reprenne le montage avec Mélanie Braux – mais malheureusement pas la dernière. Ils ont grandi depuis, construisent leur vie d’adulte. J’aimerais qu’ils découvrent Vara nu dorm sur grand écran à Bucarest – j’y travaille. Lors de la première projection, c’était pour Vali, je pense, un moment intense : il était mis en valeur comme protagoniste principal et aussi mis à nu dans ses facettes plus sombres. Revoir les scènes d’éclat de nerf ou de violence n’a pas été si facile, d’autant qu’il n’y avait pas tant de temps qui s’était passé entre l’été du tournage et la projection. Il a tout de même accepté le film et constaté que sa trajectoire dans le film le mettait en lumière, surtout grâce au regard de ses camarades. Mais faire face à son image, à soi dans tous ses états si je puis dire, demande un sacré recul. J’aimerais que Vali (et les jeunes) voit le film aujourd’hui, après avoir grandi, et avec un public pour renvoyer ce en quoi il nous touche.
Quels sont tes prochains projets ? Souhaites-tu poursuivre cette exploration de l’adolescence, de ce terrain qu’est le foyer de Soeur Maria, ou aller vers d’autres formes, d’autres espaces ?
Avec mes trois premiers films avec les jeunes de la Casa et Soeur Maria, (Micul Cyrano, puis Casa familie et Vara nu dorm) je suis allée au bout de ce que je voulais raconter avec eux. On m’a souvent demandé quand je ferai des films sur autre chose que la Roumanie… Ce n’est peut-être pas le dernier ! Je réfléchis à un projet avec mon ami d’enfance Louis, né en Roumanie, pour faire retour sur cette histoire d’amitié qui a été à l’origine de mes films là-bas. J’ai d’autres projets qui ne se passent pas en Roumanie, mais ici en France dans des espaces queer et minoritaires. J’ai toujours envie de faire du documentaire, de faire récit à partir du réel, mais j’expérimente aussi des formes différentes : des films de mashup réalisés avec des GIFs, des images animées d’internet.
PROPOS RECUEILLIS PAR COLINE PHILIBERT