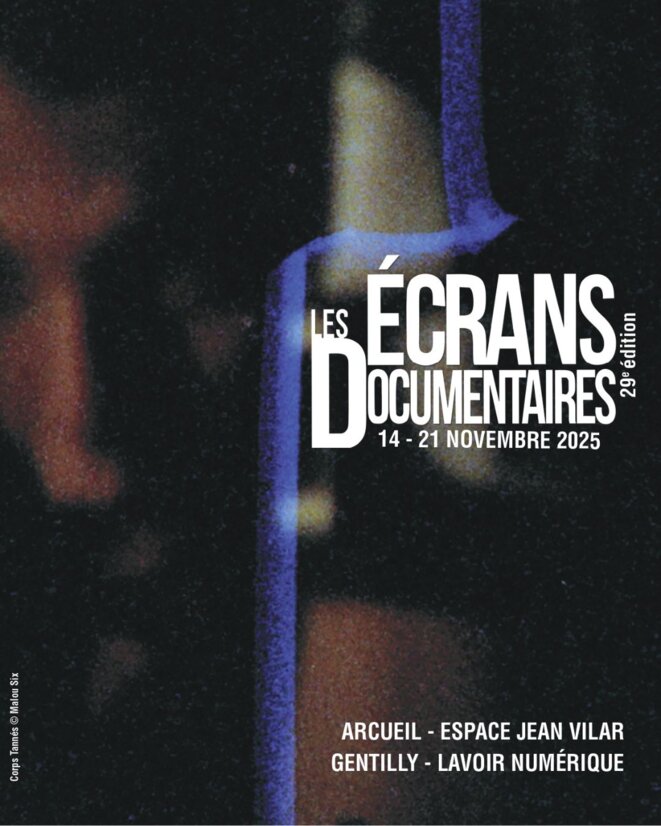ASTRAL WEEKS
En 1968, Van Morrison, jeune homme de vingt ans trois, sortait un album lumineux, intense et habité : le bien nommé « Astral Weeks ». Empruntant un chemin de traverse, le chanteur ne visait pas la reconnaissance publique ou mercantile, pas plus qu’il ne cherchait, selon l’anglicisme, à être « mainstream ». Autrement dit, dans le courant dominant. Comme le souligne justement le critique rock Philippe Robert : « [Van Morrison] transcendait la réalité, sondait l’être et écrivait là des cantiques à sa gloire, dans lesquels il s’agissait d’aimer les autres jusque dans leur malheur (...) ».
En résonance avec ces propos, ce sont des parcours de musiciens singuliers que cette programmation se propose d’arpenter. Il ne s’agit pas tant de nous intéresser seulement aux musiques dites amplifiées avec, souvent, leurs dérives spectaculairement surexposées. Alan Vega, les Stooges ou, dans un tout autre registre, Jacques Thollot, sont tout à fait capables d’orchestrer un boucan de tous les diables, comme de créer le chaos sur scène ou dans leur vie personnelle. Nos choix n’ont pas plus été guidés par une fascination pour ces vies fracassées, consumées par des excès en tous genres. Car si Thollot, Vega ou Fela ne sont tristement plus de ce monde, Iggy Pop, et c’est tant mieux, se porte comme un charme… En témoigne « Gimme Danger », le film de Jim Jarmush sur les Stooges que nous montrerons en avant-première. Nos intérêts et nos goûts se sont portés naturellement vers des artistes qui ne se sont pas laissés enfermés dans une boite. Des musiciens qui, à l’instar du nigérian Fela Anikulapo Kuti par exemple, ont œuvré à la fois sur le champ artistique (en inventant l’afro-beat, véhicule chaud-bouillant de ses textes acerbes) et politique (en luttant au péril de sa vie contre les régimes militaires pillant sans vergogne les ressources du pays). Une aventure humaine plus qu’un plan marketing donc, où le cinéma dans ses diverses formes tient toute sa place.
Le cinéma documentaire, notamment, entretient des affinités pour le moins éclectiques avec la musique. Dans cet univers aussi formaté et balisé par le monde marchand, certains accidents adviennent encore et le cinéma se trouve parfois en phase ou simplement présent pour recueillir ce qui est en train d’émerger. Si le film de Lech Kowalski sur l’unique tournée des Sex Pistols aux Etats-Unis en 1978 reste l’une des pierres angulaires du genre, d’autres formes tout aussi passionnantes rendent hommage, avec moins de furie, de rage et de sueur (!), à des personnalités iconoclastes.
Free at last, Free at last... !
Ce cri poignant, immense vibration sonore, que lançait le pasteur Martin Luther King à l’issue de ses interventions publiques contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, Fela le reprend à son compte et à sa manière dans l’incroyable document enregistré à Lagos en 1982 par Stéphane Tchajgadjieff et Jean Jacques Flori. Le film le montre clairement à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur des ancêtres, où l’icône des mouvements de libération, image épinglée sur un mur, cohabite avec l’effigie, moins mythique celle-là, de Malcom X ou de Kwame Nkrumah, père du panafricanisme auquel Fela fut initié par sa mère. Fragmenté, disséminé par petits bouts aux quatre vents de la toile, sur YouTube notamment, « Musique au poing » un est document exceptionnel sur l’engagement, quand on a pour seule arme la musique et les mots (ce pidgin ironique et ravageur qui tord la langue anglaise dans tous les sens). Au cœur du « Shrine », maison familiale et temple de l’afro-beat situé dans la banlieue de Lagos, entouré par ses nombreuses Queens et autres forces vaudous (Shango, Ogun), sur scène jusqu’au bout de la nuit ou encore dans la rue face à la foule, jetant des imprécations contre le régime militaire en place : c’est la voix et le chant d’un homme non réconcilié qui s’exprime dans des séquences tranchantes. Et parfois comiques comme quand Fela, un énorme joint à la main,suit à la télévision l’arrivée du Pape dans la capitale nigériane. L’occasion, ici, de noter au générique de fin la présence d’Antenne 2 et du Ministère de la Culture de l’époque : un autre monde...
Cette puissance du refus traverse également le documentaire d’Agnès Varda et le montage d’archives photographiques de Jean Gabriel Périot, tous les deux sur les Blacks Panthers. Mais si ce dernier emprunte à la forme du clip pour illustrer leur lutte, la musique n’étant pas captée « live » mais fabriquée en studio pour le film puis posée sur les images, la démarche de Varda est tout autre. Si elle enregistre en effet l’entrainement très militarisé des troupes et les meetings des Black Panthers, elle n’oublie pas de filmer un élément essentiel qui cimente idées, corps et revendications : les danses et les chants, scandés avec un indéniable « groove ». Une situation politique qui n’est pas sans évoquer le racisme et les violences policières qui sévissent à nouveau aux Etats-Unis à l’encontre des Noirs.
Insoumission aux normes de vie dominantes, contestation des formats musicaux : Alan Vega, les Stooges ou Jacques Thollot ont représenté, chacun avec leur style, une forme de rébellion, même si ce mot nous paraît aujourd’hui galvaudé. A cet égard, rompant avec l’mage léchée de l’entretien, la rencontre déjantée de Blick avec l’astéroïde Vega saisit bien cette idée d’indiscipline sauvage. Montage chaotique, ruptures rythmiques, disjonctions sonores, images striées, lumières et couleurs trafiquées : c’est le portrait d’un artiste sans concession, en colère contre toute espèce d’asservissement aux modèles institués auquel le film rend hommage. Un musicien qui ne le serait jamais devenu « s’il n’avait vu un jour les Stooges en concert ». Disparu cette année, cet « essai » sonique impertinent est aussi l’occasion pour nous de rendre justice au leader de Suicide, autre groupe essentiel de la galaxie minimaliste électro-pop, et dont les hululements nous manquent déjà.
Search and destroy… Pour reprendre à notre compte un titre des Stooges, s’il est un programme que Jacques Thollot, l’un des plus grands batteurs de l’histoire du jazz dans toutes ses dimensions improvisées, a tenu jusqu’au bout de tous les excès, c’est bien celui-là. Du désordre et des sons, en effet. Un véritable art de la fuite aussi, tant le musicien hors norme, sur le plan artistique s’entend, aux titres de compositions si poétiques (Même si l’état mine, garde le style haut), s’évertue à jouer à cache-cache avec le réalisateur. D’une patience infinie avec son « personnage » qui ne cesse de lui filer entre les doigts, doté d’une admiration tout aussi intense à son égard mais qui n’entrave jamais le film, bien au contraire, Stéphane Sinde se voit dans l’obligation d’inventer un récit cinématographique à la hauteur de cet grand inventeur de formes musicales. De ruminations solitaires en forêt ou en balade au marché du coin, occasion d’une séquence magnifique de raccords et jeux sonores ; de soliloques dépités en coup de téléphone avortés : tout le monde attend Thollot. Jusqu’à la scène finale, bizarrement bancale et poignante à la fois, où son apparition lunaire réactive soudain une phrase lâchée par le réalisateur plus en amont et qui semble contenir à elle seule la recherche de toute une vie : jouer pour les oiseaux.
Cette proposition pas si saugrenue pour un musicien (Olivier Messiaen n’a-t-ilpas collecté et transcrit des chants d’oiseaux ?), pourrait tout à fait être reprise par la percussionniste Robyn Schulkowsky. Le beau film que lui a consacré l’artiste Manon de Boer rappelle, s’il le fallait, les potentialités sonores de tout objet, du monde même. A l’image de ce bol qui, dès l’ouverture, ne cesse de vibrer avant de se stabiliser et de s’éteindre sur le plan sonore. N’apparaissant jamais à l’écran, on ne voit en effet que ses mains frapper ou caresser des instruments et divers ustensiles, le travail de captation des sons traduit la poésie légère de Schulkowsky, à l’instar de ces feuilles qui tremblent dans le vent. Ou ces lents panoramiques sur des murs délavés et des espaces urbains indéterminés. Pour une fois, et c’est assez rare pour le souligner, c’est le son qui est ici sur un même pied d’égalité avec les images. Voire même qui donne le tempo. Un parti pris esthétique de fait radicalqui évoque autant son propre parcours de vie (la guerre au Vietnam) que de musicienne (le départ pour Cologne, épicentre alors de la musique contemporaine dans les années 70), tout en offrant une expérience sensorielle d’une rare profondeur.
Eric Vidal