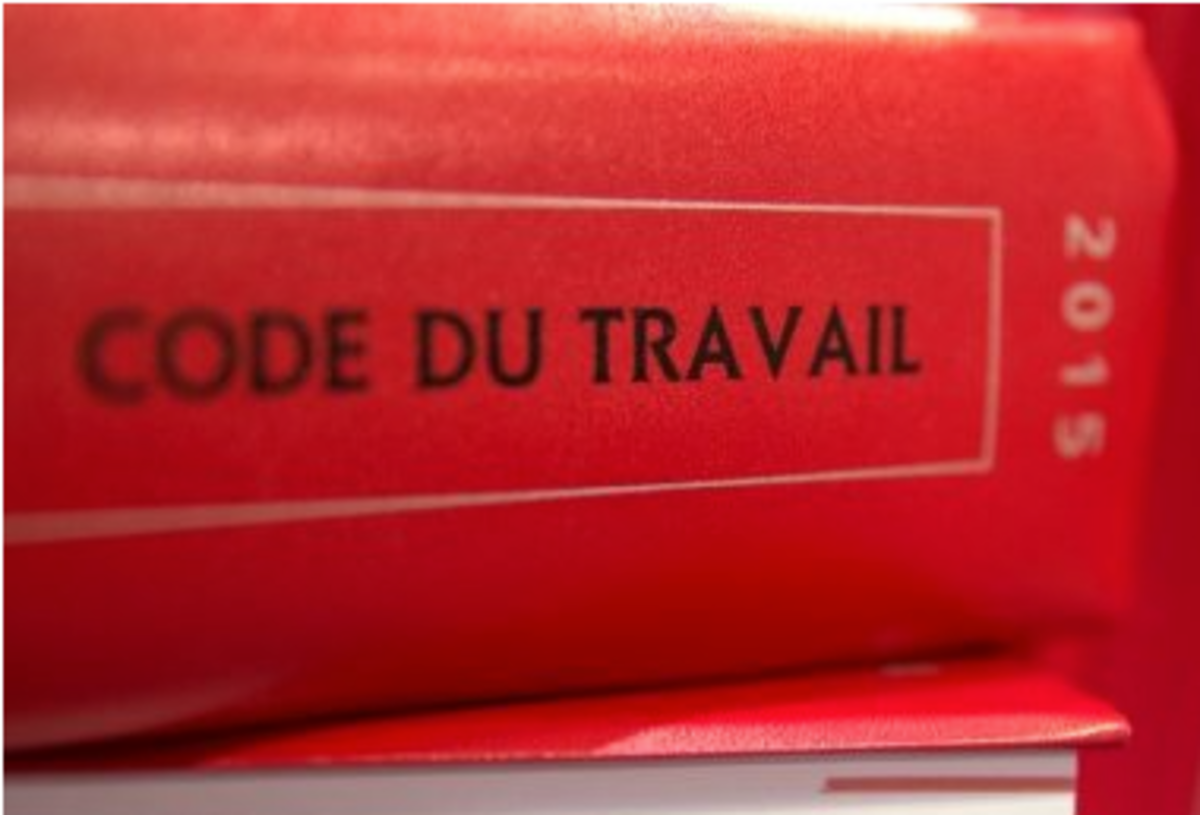
Ce que j’ai voulu dire En direct de Mediapart le 10 mars dernier...
Par Liêm Hoang Ngoc (Economiste, fondateur de la Nouvelle Gauche Socialiste)
La loi travail est un nouveau coup de marteau sur le clou planté par François Hollande dans le chantier de la politique de l’offre inaugurée dès la publication du rapport Gallois.
La politique de l’offre a pour but principal de déplacer le partage du gâteau en faveur des profits. Elle est incarnée par les pactes de compétitivité (Crédit d’impôt Emploi Compétitivité de 20 milliards) et de responsabilité (nouvelle baisse de cotisations sociales de 20 milliards), ainsi que par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) impulsé par le gouvernement dans le but de promouvoir la « flexicurité ». Cette politique met à l’évidence en œuvre l’agenda du MEDEF. Elle évite cependant de heurter frontalement les salariés français, attachés à une certaine protection de l’emploi. C’est pourquoi lors de la négociation précédant la conclusion de l’ANI, le MEDEF n’a tant mis l’accent sur la mise en cause du CDI, que monnayé sa signature contre la garantie d’un pacte de compétitivité sans conditionnalité, dont on connaît le coût pour les finances publiques. Il s’est contenté de planter quelques clous, dans le chantier de la flexibilité de l’emploi, qu’il resterait à enfoncer peu à peu – ce que fera la loi travail -, en ne concédant rien en matière de financement de la sécurisation des parcours professionnels, ce qui explique que le volet « sécurité » reste si pauvre. Celui-ci est tellement coûteux au Danemark - où le taux de prélèvements obligatoires est de 49% et où l’indemnisation des chômeurs envoyés en formation était jusque 2010 de 90% du salaire antérieur pendant quatre ans -, que le pays a réduit à deux ans la durée d’indemnisation des chômeurs. Au Danemark même, placer les chômeurs en formation ne leur garantit aucunement un emploi et s’avère d’autant plus coûteux pour les finances publiques, dès lors que l’économie n’engendre ni la croissance, ni les emplois, ni les recettes fiscales induites annoncés par les promoteurs de la flexicurité…
En France, la loi Travail détricote donc le CDI, au prétexte fallacieux de le préserver en le rendant accessible aux jeunes. Elle ne produira pas d’effet bénéfique sur l’emploi. Il n’y a pas de relation avérée entre la législation protectrice de l’emploi et les performances macroéconomiques. Les pays où la législation protectrice de l’emploi est la plus faible en Europe (Espagne, Irlande) sont d’ailleurs ceux où l’emploi s’est le plus dégradé lors de la crise de 2008. Le chômage s’est accru de 150% en Irlande et de 130 % en Espagne, où le déficit d’emplois par rapport au niveau de l’emploi avant la crise est encore de trois millions de postes ! L’Allemagne elle-même n’a pas répondu à la crise par la flexibilité externe, mais a tout fait pour conserver les compétences au sein des entreprises en promouvant massivement le chômage partiel.
Le véritable « mobile du crime », le véritable objectif de la loi Travail est en réalité de maintenir constant le taux de profit des entreprises en toute circonstance, qui s’était réduit de 3 points en France après la crise de 2008. Cette baisse n’est en aucun cas liée à une quelconque tension sur les salaires, gelés dans le secteur public comme dans le secteur privé, ni dans un relèvement intempestif des cotisations patronales. Elle est liée à… une chute de la demande, entraînant une baisse du chiffre d’affaire des entreprises. A masse salariale inchangée, le taux de marge baisse dans ce cas mécaniquement parce que la productivité se détériore à court terme. Il se redresse automatiquement lorsque l’activité des entreprises redémarre. Ce phénomène est désigné en macroéconomie par le terme de cycle de productivité. Il est possible de réduire, voire de supprimer ce cycle au cours duquel le taux de marge fluctue, en « adaptant la main d’œuvre effective à la main d’œuvre désirée », dit-on, autrement dit en favorisant le divorce lorsque l’argent ne rentre plus, en bas du cycle économique. Tel est le véritable mobile des mesures réclamées par le MEDEF : maintenir constante, en toute circonstance, la part des profits dans la valeur ajoutée. Comme si le CICE, grâce auquel la part des profits a retrouvé son niveau d’avant la crise, ne suffisait pas…
La nouvelle définition du licenciement économique que devront prendre en compte les juges en cas de « baisse durable de l’activité de l’entreprise », illustre ce motif de la loi Travail. Le plafonnement des indemnités prud’homales avait pour but de décomplexer les employeurs de se séparer de leurs « moutons noirs » en période de mauvaise conjoncture. Enfin, la baisse de la majoration des heures supplémentaires (de 25 à 10%), rendue possible par la négociation d’entreprise, réduira le coût du travail au-delà de 35 heures. La loi Travail confirme la volonté de l’exécutif de saper le principe de faveur hiérarchique, pilier de notre système de relations professionnelles, par lequel un accord d’entreprise doit nécessairement être plus favorable au salarié que la norme fixée par la loi ou à l’échelon supérieur.
Le seul résultat tangible de la politique de l’offre est la baisse de la part affectée à la rémunération de la force de travail. Rien ne dit qu’elle engendrera une reprise dans le cycle et l’inversion attendue de la courbe du chômage... Il faudrait pour cela que « les profits d’aujourd’hui soient les investissements de demain et les emplois d’après-demain » !
Le théorème Schmidt se heurte malheureusement à un paradoxe redoutable en France : en longue période, le redressement tendanciel du taux de profit observé depuis 1983 s’est accompagné d’une baisse du taux d’accumulation du capital et d’une augmentation de la part des bénéfices consacrés aux dividendes…
Les chiffres sont définitivement têtus !



