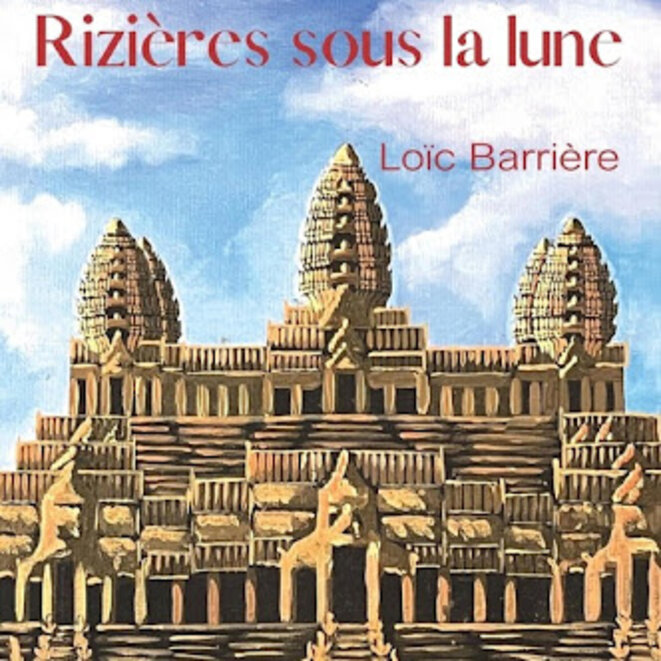Des 400 films cambodgiens réalisés entre 1960 et 1975 il ne reste quasiment plus rien. Dans Le Sommeil d'Or qui sort le 19 septembre, Davy Chou part à la recherche de ces films fantômes. Le pari de ce magnifique documentaire est de rendre compte de ce cinéma invisible. Prouver que les émotions perdurent par-delà la destruction des images.
Le cinéma fut un art florissant au Cambodge durant quinze ans, de 1960 à 1975. Près de quatre cents films tournés dans le seul pays au monde dirigé par un roi-cinéaste. Des salles de cinéma pleines à craquer. Des affiches chatoyantes présentant les stars de l’époque. Le cinéma était un art populaire, notamment à Phnom Penh qui comptait des salles qui n’avaient rien à envier aux salles parisiennes. Réalisateurs, producteurs, acteurs et chanteurs ont fait vibrer tout un peuple jusqu’à ce que la guerre accouche d’un monstre, les Khmers rouges, qui non seulement assassinèrent le tiers de la population mais détruisirent les films, les photos et les livres. Le Cambodge a ceci de particulier qu’il est aussi l’un des seuls pays au monde à être orphelin de son cinéma. Près de quarante ans après la prise de Phnom Penh, il ne reste quasiment plus rien de la production cambodgienne, si ce n’est quelques pellicules sauvées de l’autodafé et copiées sur des bandes vidéo de piètre qualité. C’est la mémoire de toute une génération que les Khmers rouges ont tenté d’effacer. Le pari de Davy Chou, dont le magnifique Sommeil d’or sort en salle le 19 septembre, c’est de rendre compte de ce cinéma invisible. Prouver que les émotions perdurent par-delà la destruction des images.
La caméra de Davy Chou explore le Cambodge d’aujourd’hui pour nous parler de cet hier tragique. Des jeunes s’amusent dans cette salle de jeu, ce café karoke, dans une apparente insouciance. Dans une grande pauvreté, les habitants d’un vaste squat en ruine apparaissent sur l’écran. Ils vivent dans ce qui fut le cinéma Hemakcheat qui pouvait accueillir un millier de spectateurs. Il ne reste plus rien de cette époque, que les murs lépreux.
Vestiges d'un monde englouti
Pour peu qu’on habite une maison un peu ancienne, on s’est tous plu à imaginer ceux qui nous y ont précédé. Mais la quête de Davy Chou dépasse la seule nostalgie. Ces murs sont les seuls vestiges d’un monde englouti. Il y avait une trentaine de cinéma à Phnom Penh jusqu’à l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges. L’un des témoins du Sommeil d’Or affirme que plus la guerre avançait, plus les habitants avaient besoin de cinéma. Malgré les bombes. Ou peut-être à cause des bombes. A Phnom Penh comme à Paris ou à Londres, à Delhi, au Caire ou à Hong-Kong, le cinéma était un lieu de vie, un lieu d’apprentissage. La magie du grand écran. La jeunesse venait pour y rêver, pour y draguer. Les films puisaient leurs histoires dans le fonds populaire khmer. Mais les réalisateurs ne dédaignaient pas la description d’une bourgeoisie occidentalisée de fiction. Oubliant la guerre froide sur les plateaux de cinéma, Norodom Sihanouk était l’un de ces réalisateurs ; il dirigeait sa femme et ses enfants dans des romances ou des comédies qui avaient pour titres Apsara, La forêt enchantée, Ombre sur Angkor. Les cinéastes à succès proposaient des histoires où des princesses se transformaient en serpents, où tout, de toute façon, comme à Bollywood, se terminait par des chansons.
Les spectateurs n’imaginaient pas que tout cela serait anéanti brutalement. Il n’existait souvent qu’une copie unique de ces films. Les Khmers rouges ordonnèrent leur destruction. Et même après la guerre, lorsqu’une famille investissait la maison d’un cinéaste assassiné, elle jetait les bobines, ne sachant pas à quoi cela pourrait servir. Si peu a été sauvé ! Certains films seront même détruits avant même d’avoir été montré au public. Le cinéma, est une des nombreuses victimes collatérales d’un génocide qui n’a épargné aucune famille. Ainsi donc, les films cambodgiens n’existent plus. Et ceux qui les ont créés, à quelques exceptions près, ont été assassinés. Acteurs, actrices, réalisateurs, décorateurs, maquilleuses, preneurs de sons, producteurs. Non pas morts parce que le temps a fait son œuvre mais parce que la barbarie a voulu faire table rase de tout un peuple. Et pourtant… Et pourtant, et c’est ce qui fait que la quête de Davy Chou n’a rien de morbide, le cinéma cambodgien a été plus fort que les Khmers rouges, il a réussi à survivre dans le cœur des spectateurs, et de leurs enfants, alors même que sa matérialité est absente.
Dy Saveth, la Brigitte Bardot khmère
L’empathie de Davy Chou pour les rescapés à qui il donne la parole permet, par touches impressionnistes, de se figurer ce que fut cet âge d’or. On aime par exemple Dy Saveth, contemporaine de Brigitte Bardot et aussi adulée qu’elle jusqu’en 1975. Elle est l’une des rares stars de l’époque à avoir survécu. Aujourd’hui entourée des photos des acteurs disparus avec qui elle partagea l’affiche (on apprend qu’il y avait une Kim Nova – sans k), elle enseigne chez elle le cha-cha-cha et le chant à de jeunes Khmers. Davy Chou l’emmène dans un village où Dy Saveth tourna jadis une scène mythique (où elle était censée être lapidée). On est ému de voir les paysans la reconnaître, se rappeler de la scène. L’ancienne actrice plaisante même avec l’un des figurants qui lui avait jeté des pierres tandis qu’elle brûlait sur un bûcher. Et on lit la fierté de la survivante lorsqu’elle découvre enfin, après tant d’année, la colline à laquelle les paysans ont donné son nom. La colline Dy Saveth.
La vérité, c’est qu’on aime tous les personnages de ce film. Tout spécialement Yvon Hem, réalisateur décédé en août dernier. Face à la caméra de Davy Chou, et en présence de ses enfants et de sa femme, il explique ce que fut sa vie de cinéaste. Un témoignage qui lui a coûté. Parce que parler de sa vie d’avant, c’est évoquer sa première famille, entièrement décimée par le régime de Pol Pot. Il emmène Davy Chou et ses enfants sur les lieux de son ancien studio, L’Oiseau de Paradis, nommé ainsi en hommage au film de Marcel Camus (le fameux réalisateur d’Orfeu Negro), dans lequel joua la sœur d’Yvon Hem et qui décida de sa vocation de cinéaste. Le regard attentif de ses enfants serre le cœur. On est reconnaissant à Davy Chou de leur avoir permis, grâce au Sommeil d’Or, de partager ces souvenirs avec leur père.
Récréer la scène culte de l'Etang Sacré
Et puis il y a le truculent Ly Bun Yim, le maître des effets spéciaux, qui fut l’un des cinéastes les plus populaires du Cambodge. On l’écoute raconter, l’œil vif, sourire en coin, le pitch de ses films disparus. Intarissable sur les animaux mythologiques qui peuplent ses films, en particulier un hippocampe qui aurait dû marquer l’Histoire du cinéma. Avec la complicité de Davy Chou, il se livre aussi à des démonstrations de son savoir faire en matière de truquage. Le septuagénaire tiré à quatre épingles a une imagination sans limite et on se plait à imaginer que la jeune génération de cinéastes cambodgiens le remette en scelle et qu’il devienne, tels les papis du Buena Vista Social Club, un cinéaste d’aujourd’hui et non plus seulement un artiste d’hier.
L’une des scènes les plus marquantes du Sommeil d’Or est celle où s’exprime Ly You Sreang, dont la vie est un roman qu’il nous raconte, au bord des larmes. Cinéaste contraint de fuir le Cambodge, travailleur précaire en France qui réussit à force de courage et de volonté à créer des sociétés de taxi, il finit par decider de s’installer au Cambodge pour y passer ses vieux jours. On est plein d’admiration pour cet homme qui a connu la gloire puis l’anonymat, qui a fait de sa femme une star et la retrouve mariée à un autre parce qu’elle l’avait cru mort, comme dans un roman de Duong Thu Hong. Le regard de Davy Chou, toujours bienveillant, l’aide à retisser le fil de sa vie devant nous, sans impudeur.
Malgré la gravité de son sujet, Le Sommeil d’Or est aussi fidèle à l’humour cambodgien. Le réalisateur Ly You Sreang, évoque ainsi son film culte des années 70, L’Etang sacré. Pourquoi le film est-il resté dans les mémoires ? Parce que l'acteur le plus connu, Kong Sam Oeun, sortait de l’étang entièrement nu. Malicieux, le cineaste ne cache pas tout l’intérêt commercial d’une telle scène. Le Alain Delon khmer émoustillait toutes les femmes de l’époque. A peine s’est-on figuré la scène, devant l’étang sacré en question, qui existe toujours aujourd’hui, que Davy Chou entreprend de retourner la scène mythique avec des acteurs contemporains. Pour d’évidentes questions d’ordre commercial, on laissera la surprise aux spectateurs du Sommeil d’Or de découvrir cette scène reconstituée. L’idée nous traverse soudain qu’un remake du film entier serait le bienvenu.
A ces personnages, il faut ajouter aussi la tante de Davy Chou, Sohong Stehlin, qui apparaît au début du film. Elle a joué un rôle central dans sa découverte du sujet puisque c’est elle qui a expliqué à Davy Chou en quoi consistait le travail de son grand-père, Van Chann qui fut un des principaux producteurs de cinéma au Cambodge dans les années 60 et 70 (Il a produit une quarantaine de films, soit 10 % de l’ensemble des films réalisés au Cambodge, jusqu’à son décès en 1969). Cette filiation, on l’a compris, est le point de départ du film mais l’enquête dépasse largement la quête familiale même si l’on se doute que le nom de Van Chann a dû ouvrir quelques portes lorsqu’il s’est agi de rencontrer les témoins de cette époque.
Rendre justice aux cinéastes
Le Sommeil d’Or est l’aboutissement d’une belle histoire. En 2008, à 24 ans, Davy Chou part au Cambodge pour la première fois. L’année suivante, il s’installe quelque temps à Phnom Penh pour apprendre le khmer et approfondir sa connaissance du pays. Il anime un atelier avec des étudiants qui aboutit à la réalisation du film Twin Diamonds et fonde en même temps un collectif avec ces jeunes, le Kon Khmer Koun Khmer qui a depuis produit plusieurs films au Cambodge, dont l’ambitieux Boyfriend et est très actif sur la scène artistique cambodgienne. (Les membres du collectif font d’ailleurs une apparition joyeuse dans le remake de L’Etang Sacré) Davy Chou s’est documenté, a multiplié les rencontres. Accompagné de Rotha Moeng, un acteur cambodgien qui a grandi en France et dont j’ai raconté l’enfance dans Le Chœur des Enfants Khmers, il fait ainsi la connaissance à Paris du cinéaste Biv Chhay Leang qui ne figure pas dans le film (mais apparaîtra peut-être dans les bonus du DVD). J’ai eu la chance de le rencontrer moi aussi, grâce à Rotha Moeng et son ami Vannak et je l’ai évoqué dans mon roman. Comme les autres réalisateurs, Biv Chhay Leang, qui est aujourd’hui âgé et malade, ne se remet pas de la perte de ses films. Dans les années 80 et 90, il a tenté de leur redonner vie en écrivant des romans à compte d’auteur inspirés de ses longs métrages. Ses murs sont couverts de tableaux représentant les affiches de ses films disparus et qui ont été executés de mémoire par ses proches. Je me rappelle son amertume quand il découvrait, dans des DVD de karaoke importés du Cambodge, que ses histoires avaient été reprises, pour ne pas dire pillées, sans que personne ne mentionne qu’il en était l’auteur. Et c’est tout le mérite de Davy Chou que de rendre justice à ces créateurs qui furent au coeur de la vie culturelle du Cambodge dans les années précédant la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. Espérons qu’ils soient un jour honorés officiellement par les autorités cambodgiennes d’une manière ou d’une autre.
Le casting ne serait pas complet sans les deux cinéphiles, qui ne se connaissaient pas avant le Sommeil d’Or et qui se remémorent sous nos yeux leurs films préférés, les acteurs, les actrices, les décors, les répliques cultes et toutes les chansons qui ont traversé le temps. L’un d’eux dira même qu’il a oublié les visages de ses proches disparus sous Pol Pot mais qu’il se remémore encore parfaitement les traits des acteurs qu’il aimait. Ils sont la mémoire du cinéma cambodgien et l’on imagine le plaisir des vieux réalisateurs en regardant les yeux émerveillés de ces deux cinéphiles. Malgré les pellicules brûlées et le meurtre des principaux cinéastes et acteurs, le cinéma de ces années-là n’a jamais quitté le cœur des Cambodgiens durant les années de guerre. Sohong Stehlin, la tante de Davy Chou, raconte comment les Khmers, malgré la peur, chantaient dès qu’ils n’étaient pas surveillés par leurs geôliers. Quand le Cambodge a enfin pu se débarrasser des génocidaires, les films fantômes ont continué de vivre dans les familles. Notamment dans les camps de réfugiés en Thaïlande où tant de jeunes Cambodgiens osèrent interroger pour la première fois leurs parents sur la vie d’avant. Miracle de la parole, de la transmission : certains jeunes d’aujourd’hui se souviennent de films qu’ils n’ont jamais vu.
On voudrait aussi évoquer les longs travelings qui rythment Le Sommeil d’Or, et qui nous montrent une jeunesse khmère tournée vers l’avenir, la bande son prodigieuse qui met en relief des pépites musicales qu’on souhaiterait écouter en boucle, on aimerait décrire aussi ce dernier plan qui nous scotche à nos fauteuils : images du passé projetées sur un mur de cinéma décati. Ce sera d’ailleurs la seule bribe de film offerte aux spectateurs car Davy Chou a pris le parti de ne pas les exhumer dans le Sommeil d’Or.
Que nous dit le beau titre choisi par Davy Chou pour résumer sa quête ? Que le cinéma cambodgien n’est pas mort mais seulement endormi ? Qu’il est sur le point de se réveiller ? Ce superbe documentaire, assurément, réveille des fantômes.
Ce cinéma cambodgien de l’âge d’or est peut-être aussi un rappel des temps heureux. Si les B52 de l’armée américaine avaient déjà répandu la mort dans les campagnes cambodgiennes, si les Khmers rouges avaient déjà commencé à actionner leur machine de mort dans certaines régions, ces années 60 et 70 ne laissaient pas deviner que les Cambodgiens allaient subir un enfer long de trois ans, huit mois et vingt jours, entre avril 75 et janvier 79. Le cinéma, pour les jeunes de cette époque, correspond à une forme d’insouciance malgré la guerre pourtant bien présente. Sin Sisamouth, le crooner cambodgien dont le répertoire est connu de Ratanakiri à Svay Rieng et qui fut assassiné en pleine gloire par les Khmers rouges, était à son apogée. Les acteurs vivaient. Les films vivaient. Les Cambodgiens vivaient. Un tiers d’entre eux vivait encore…
La génération qui a vu ces films a aujourd’hui une soixantaine d’années. Les plus jeunes ont cinquante ans. On imagine l’émotion des spectateurs d’hier à l’évocation de ces films populaires, cousins des films indiens et hong-kongais. C’est toute la réussite du Sommeil d’Or : sans jamais montrer d’extrait de film (à l’exception de la scène finale) il parvient à recréer la magie de cet âge d’or. Les souvenirs se croisent, se superposent aux images du présent, l’imaginaire du spectateur se met en marche.
Que l’auteur d’une telle enquête, Davy Chou, n’ait que 28 ans, apporte une belle promesse. L’âge d’or revient toujours, du moins chaque époque connaît son âge d’or. Rendre hommage aux derniers survivants de cette époque, reconnaître leur rôle dans ce qui a fécondé l’imagination de tout un peuple, est une étape nécessaire. Le Cambodge d’aujourd’hui vit, chante et danse. Sa mémoire se vivifie grâce à ses artistes, de la diaspora ou de l’intérieur. Rithy Panh qui tout en poursuivant son œuvre encourage les vocations. Le dessinateur Sera qui d’album en album raconte l’irracontable. Les projets franco-khmers se multiplient. De beaux projets. Cambodge, me voici, la très belle pièce créée à Paris par Jean-Baptiste Phou vient d’être jouée pour la première fois en khmer à Phnom Penh. Avec Dy Saveth, la diva khmère. Vingt-six ans après sa création par Ariane Mnouchkine, L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, chef-d’œuvre d’Hélène Cixoux, a pris une nouvelles dimension dans son interprétation en langue khmère par la troupe Phare Ponleu Selpak venue de Battambang (avec un roi Sihanouk magistralement interprété par une jeune femme, Maradi San).
Et on rêve aujourd’hui aux films de demain.
Loïc Barrière
Le Sommeil d’Or de Davy Chou. Sortie nationale le 19 septembre.