
Agrandissement : Illustration 1

Jaune(s): dans le vocabulaire syndical, le terme reste employé de manière péjorative, dépréciative. Le jaune est une marque apposée par les adversaires comme marque de compromission à l'égard de l'adversaire «de classe» que constitue le patronat ou qu'incarnent les pouvoirs publics. La marque jaune n'est pas de la nature de celle qu'évoquait l'inoubliable auteur de la série Blake et Mortimer, Edgar P. Jacobs: Ce n'est pas le geste affirmé d'un méchant de bande dessinée contre lequel le ou les héros s'élèvent: c'est une marque d'infamie, plus précisément de soumission et de complicité stipendiée avec les forces dominantes.
Le terme a une histoire et une origine encore indécise, mais en tout cas attestée dans le dernier quart du XIXe siècle.
Jean-Baptiste Séverac (Le mouvement syndical, collection «Encyclopédie socialiste, syndicale et coopérative de l'Internationale ouvrière» sous la direction de Compère-Morel, éd. Quillet, 1913, p. 286-287) relève en note que l'origine du terme reste «obscure», mais avance cette explication:
«Des syndicats catholiques avaient été créés dans le département du Nord, surtout chez les mineurs et les tisseurs, puis dans l'Ouest et le Centre. Quelques congrès avaient réuni ces groupements et une Fédération s'était même constituée. Le plus actif de ces syndicats était celui des tisseurs de Tourcoing qui avait pour organe Le Petit Jaune.
À côté de ces syndicats catholiques, des organisations ouvrières non confessionnelles, mais adversaires des syndicats «rouges», s'étaient constitués en 1899 au Creusot et à Montceau[-les-Mines], avec l'aide de M. Schneider et de la direction des mines en lutte contre leurs ouvriers. La double origine du mouvement jaune est donc bien nette: elle est catholique et patronale.
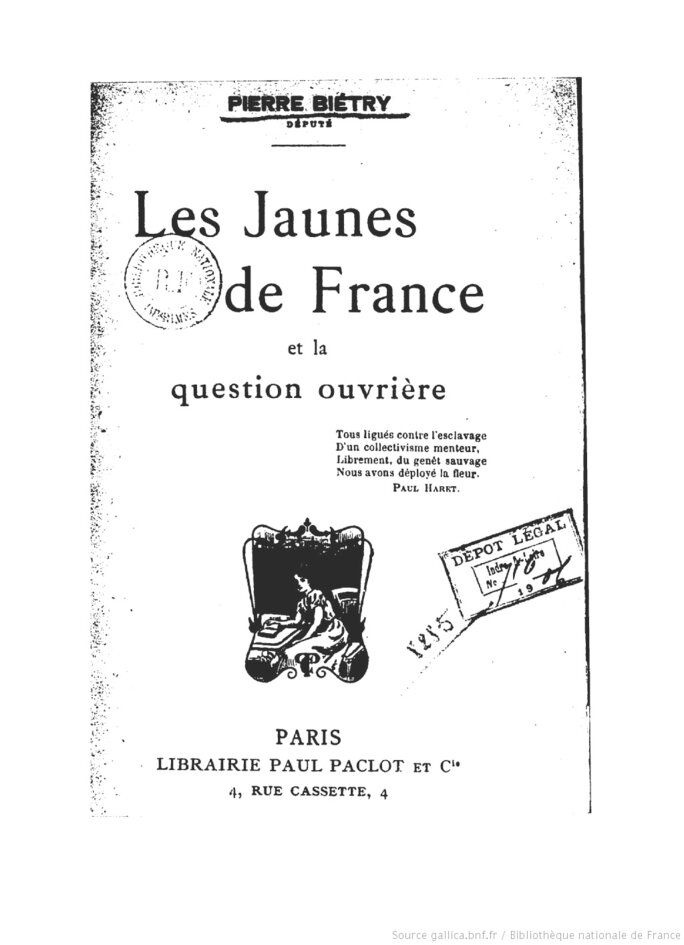
Agrandissement : Illustration 2

Entre 1902 et 1909 (date de son dernier congrès), la Fédération des jaunes de France a connu des heurs et des malheurs, sans pouvoir percer malgré l'appui patronal qui ne fit pas défaut à un mouvement «syndical» hostile aux «rouges» de la CGT (le drapeau rouge est apparu comme symbole politique et social de la classe ouvrière en 1848, et plus encore au moment de la Commune de Paris), à la lutte de classes et, bien entendu à la grève générale. Le premier initiateur du syndicalisme «jaune», Paul Lanoir, avait été boulangiste; son ancien adjoint Paul Biétry, ancien guesdiste retourné, qui l'avait évincé en créant sa petite entreprise, avait la même hostilité envers la CGT et le mouvement socialiste (il fut député, élu comme «antisocialiste» face à un «socialiste unifié» de 1906 à 1910).
Les Jaunes d'avant 1914 avaient pour devise «Patrie, Famille, Patrie»... qui a inspiré Vichy. Leur lien avec l'idéologie nationaliste, telle qu'elle s'est manifestée sous la IIIe République, est patent. S'il y a une continuité indirecte après la Libération, bien qu'ils aient repoussé le fascisme, c'est avec des organisations directement dans l'orbite patronale comme la Confédération générale des syndicats indépendants (CGSI) créée après la Libération, ou la Confédération française du travail (CFT), devenue Confédération des syndicats libres, accusée dencadrer les travailleurs, notamment dans l'automobile (chez Citroën en particulier), voire d'alimenter des «milices patronales».
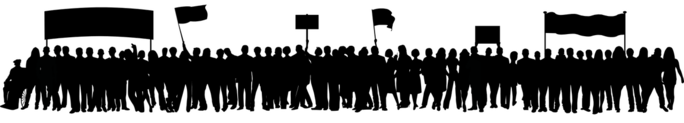
Agrandissement : Illustration 3

Si, de manière générale, le terme «jaunes» a été utilisé, en France comme dans d'autres pays, pour désigner des briseurs de grève dans la deuxième moitié du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, c'était aussi dans des contextes d'affrontements souvent violents (sans parler du recours à la troupe). Cela donc n'a rien à voir avec ce qui avait fondé — sur des principes qui étaient ceux de la doctrine sociale de l'Église depuis l'encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII en 1891 et l'émergence du catholicisme social à l'origine de la constitution de la CFTC en 1919.
Mais, contexte ou pas contexte, jaune a été «cristallisé» dans le vocabulaire syndical. L'injure est facile, à laquelle on résiste parfois difficilement en cas de confrontation intersyndicale. De l'injure, les jaunes du début du XXe siècle ont fait une affirmation identitaire (voir l'article de Maurice Tournier mentionné en fin de billet). Il n'empêche, pour ceux qui en ont usé «en négatif», ce n'était pas la marque d'Olrik, mais bien une marque de flétrissure. Passé de génération en génération militante, l'usage du terme, socialisé et incorporé, permet de mettre en avant la pureté revendicative et le caractère supposé résolu de qui l'emploie en abaissant ses adversaires comme la «marque» stigmatisait jadis les condamnés de l'Ancien Régime ou les forçats que le Code criminel de 1810 condamnait à cette peine afflictive et infamante.
Cela justifie-t-il pour autant un excès de langage qui gauchit l'histoire sociale en la déformant?
Luc Bentz
Voir aussi : Tournier (Maurice), «Les jaunes: un mot-fantasme à la fin du 19e siècle», in: Mots, n°8, mars 1984, numéro spécial («L'Autre, l'Etranger, présence et exclusion dans le discours»), sous la direction de Gilles Seidel, p. 125-146.
Manifeste des jaunes (1908) in: J.-B. Séverac, «Le mouvement syndical» (Encyclopédie socialiste, Quillet, 1913).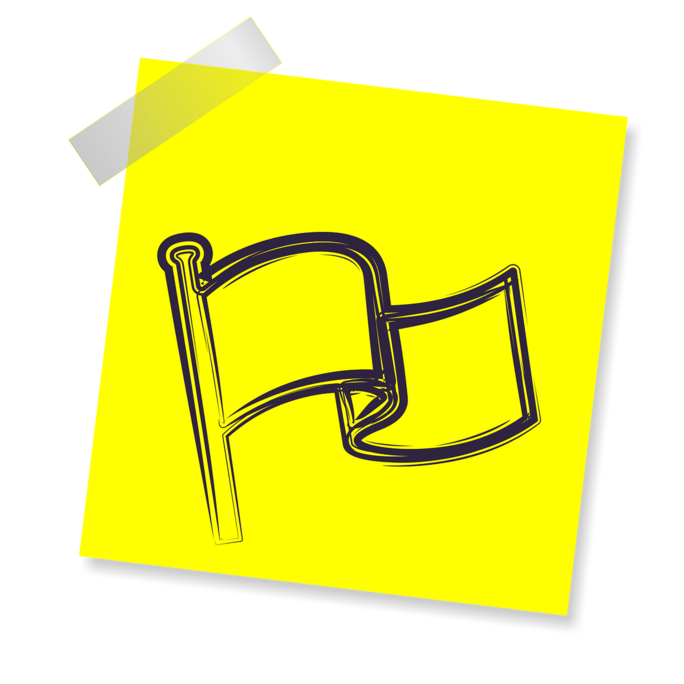
Agrandissement : Illustration 5




