Télécharger au format PDF.
Les renvois vers ou depuis les notes rouvrent une fenêtre vers l'article, contrairement à la version PDF mise en forme.
[MAJ le 4/11/19: intégration du corps de la note dans l'article.]
Synthèse
«“Listes communautaires”: le pouvoir s’empêtre dans un nouveau débat insensé», écrit à juste titre Ellen Salvi dans Mediapart (22/10/19). Ainsi évoque-t-elle la proposition, portée par le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, d’interdire les « listes communautaires » aux prochaines élections municipales. La discussion philosophique est une chose, la possibilité d’une qualification juridique en est une autre.
Outre qu’il y a d’autres expressions « communautaires » en politique (Parti animaliste, formation « régionalistes », voire autonomistes ou indépendantistes), l’expression de sensibilités particulières est très ancienne en politique, même en ne remontant pas au-delà de la IIIe République. Elle a connu des approches sociales spécifiques, des partis ouvriers à l’UDCA de Pierre Poujade. S’agissant des approches « religieuses », et plus spécifiquement de l’Église catholique, l’histoire d’une démocratie chrétienne qui s’est voulue assez rapidement ouverte à d’autres, même si elle se fondait sur une certaine approche de valeurs, montre les limites d’une approche étroite. En témoignent aussi les parcours de prêtres engagés un temps (l’abbé Pierre) ou plus durablement (l’abbé Lemire, le chanoine Kir) qui ne se sont pas eux-mêmes durablement inscrits dans les partis de la démocratie chrétienne. C’est ce qui rend difficile l’hypothèse d’une qualification juridique, traitée ici au travers d’une hypothèse d’école. C’est ce que vient « compliquer », d’une certaine manière, le fait que le plus souvent (sauf dans les petites ou très petites communes) les listes ou les candidatures individuelles font l’objet d’une investiture (et d’un investissement) de la part de formations politiques.
Or les « partis et groupements politiques » ont une existence constitutionnelle depuis 1958. Les intentions étaient particulières, l’inscription dans la Constitution est restée et emporte des effets de droit. La seule manière dont l’État ait règlementé les partis a été de définir leurs règles de financement comme celle du financement des campagnes électorales. Le seul élément de modification constitutionnelle a résidé dans l’ajout d’une mention à « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » (1999) qui a joué à la fois sur les élections multiples (binômes aux élections départementales ; listes dans les communes de plus de 1 000 habitants et aux élections régionales). Les limites « nationales » sont accentuées par les engagements internationaux de la France. Même la question de l’unicité du peuple français, détenteur de la souveraineté nationale, ne fait pas obstacle à l’expression de sensibilités particulières, dès lors qu’elles ne prétendent pas à l’exclusivité.
Les oppositions « religieuses » binaires (chrétien, et de préférence chrétien-catholique contre musulman) sont marquées par des biais et des limites. Que fait-on des athées, des agnostiques et des indifférents, de cette majorité pour qui la religion n’est pas un critère premier, voire un critère de choix tout court ? L’auteur pointe d’ailleurs d’autres communautarismes (les ghettos du Gotha). S’il s’agit, dans les « quartiers » (mais évidemment pas Neuilly-Auteuil-Passy) de combattre les causes de désaffiliation et de dépolitisation qui amène parfois à l’illusoire repli communautaire ou identitaire, la réponse passe moins par des prohibitions contre-productives que par des politiques publiques plus audacieuses. La réponse n’est pas dans l’interdiction, elle est politique. Le reste ne sert que des entrepreneurs de ségrégation.

Agrandissement : Illustration 2

Sommaire

Agrandissement : Illustration 3

Une expression ancienne des sensibilités « en » politique
Quelle qualification juridique ?
Les partis, la Constitution et la loi
L’histoire d’une constitutionnalisation
Constitution et unicité du peuple français
Les règles de financement des partis et des campagnes
En guise de conclusion
Interdire les « listes communautaires» aux élections ? Évoquons une histoire politique et parlementaire qui s’est fondée aussi sur l'expression de sensibilités de conviction. Dans un État de droit, quelles perspectives peuvent être celles d’un projet de prohibition à la lecture de la Constitution ou de la législation qui encadre l’activité politique et électorale ?
«“Listes communautaires”: le pouvoir s’empêtre dans un nouveau débat insensé», écrit à juste titre Ellen Salvi dans Mediapart (22/10/19). Elle y déconstruit certains fantasmes, comme celui du poids électoral dans certains bureaux de vote, alors que le nombre de voix «brutes» est réduit[1]. Mais, dans la compétition qui voit « Les Républicains » chercher à marquer son territoire en courant derrière le Rassemblement national, tandis que le Gouvernement — non sans dissensions ou maladresses — veut assumer une fermeté «républicaine », il est de bon ton de dénoncer la menace que font planer les «listes communautaires» ou « communautaristes », et surtout d’en faire un argument anxiogène dans une communication politique.

On est très loin, ici, d’un débat académique, philosophique ou théologique sur la signification de ce qu’est le voile, sur ce qu’il représente pour les femmes qui le portent ou sur ce qu’il représente de la relation patriarcale aux femmes, ou même de sa pertinence par rapport au Coran. L’approche est ici purement politique. La question des listes que nous appellerons plus simplement, par commodité mais avec des guillemets, « communautaristes » s'inscrit dans un processus accusatoire ou victimaire dont ne profitent vraiment que certains entrepreneurs politiques ou certains entrepreneurs de cause. Les uns recherchent la stigmatisation systématique d'une partie de la population ; les autres souhaitent, pour des motivations apparemment contraires, provoquer un enfermement identitaire de cette même partie de la population. Dans les deux cas, il s'agit de provoquer une mise à l’écart collective, contrainte ou revendiquée. Dans les deux cas, elle procède d'une essentialisation coupable, mais assumée, d'une assignation à résidence « communautaire » où l’on ne se définirait que par rapport à une ou des religions[3]. Dans les deux cas, ces entreprises apparemment antagoniques se confortent respectivement.
Mais la distinction religieuse est bien plus complexe que la distinction « musulmans/non musulmans», si l’on veut bien prendre en considération l’ensemble des courants et subdivisions qui marquent nombre de religions, notamment les trois religions du Livre dont aucune n’est unifiée. Entre « libéraux », « orthodoxes », « ultra-orthodoxes » eux-mêmes subdivisés, les israélites sont eux-mêmes ramifiés en plusieurs branches. Et que fait-on alors des agnostiques, des athées ou des indifférents que l’on oublie bien vite dans un tel schéma ?
On aura d’ailleurs relevé, ces dernières années, des candidatures très particularistes sur d’autres bases que confessionnelles, telle celle du Parti animaliste. Aux élections législatives de juin 2007, il a présenté des candidatures dans 142 circonscriptions. Elles ont recueilli au moins 1 % des suffrages au premier tour dans cinquante d’entre elles (ou plus), ce qui montre les limites des vidéos de chaton, mais lui assure tout de même le bénéfice d’un financement public de plusieurs dizaines de milliers d’euros jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale[4], en 2022 (et en principe). Tel n’est, au demeurant, le cas d’aucune formation ayant une étiquette confessionnelle: Parti chrétien-démocrate, fondé par Christine Boutin en 2010 et dirigé actuellement par Jean-Frédéric Poisson[5] ; Union des démocrates musulmans français de Nagib Azergui — et j’en oublie, aux résultats électoraux encore plus modestes[6].

Agrandissement : Illustration 5

Considérons cependant — hypothèse d’école — qu’on puisse considérer par principe, et sans le moins du monde cautionner l’extrême droite, qu’il n’est pas sain que l’électorat, fût-ce à l’échelle d’une commune, se fractionnât selon de redoutables logiques « communautaires. » Quels peuvent être les fondements d’une telle prohibition dans un État de droit ?

Agrandissement : Illustration 6

Débat philosophique et qualification juridique
On peut toujours émettre une condamnation morale, philosophique et, surtout, politique sur l'existence de listes ségréguées sinon ou à visée ségrégationniste (même si c’est présenté comme de l’autoségrégation), car il faut bien appeler les choses par leur nom. Je considère personnellement que les affaires de la Cité doivent s’envisager de manière aussi globale et cohérente que possible (ce n’est pas toujours aisé, je sais), le vote étant l’enjeu et l’objet de la confrontation entre les thèses et les candidats (ou les équipes) en présence. Je reconnais que c’est ma vision des choses et que, d’un certain point de vue, elle est idéalisée.
Mais la question posée aujourd'hui n'est pas tant celle de l'opinion qu'on peut avoir sur les expressions religieuses, même dans le champ ou la compétition politiques, que la portée en droit de mesures prohibitives les visant (car à l’évidence Bruno Retailleau ne songe guère à s’attaquer aux listes de boulistes en colère contre le maire sortant). C'est là que les choses se compliquent. Si l'État est séparé des « cultes » (la loi de 1905 est de portée générale), les religions elles-mêmes ne sont plus dépendantes de l'État (à quelques « exceptions » près, comme les départements concordataires d'Alsace-Moselle et certaines collectivités d’Outre-mer).
Veut-on invoquer des limites d'«ordre public» (au sens de règle impérative à laquelle on ne saurait déroger) ? Elles doivent être justifiées, proportionnées, conformes à la hiérarchie des normes (Constitution et textes assimilés > traités > lois nationales > textes règlementaires) et naturellement, eu égard au principe d’égalité résultant de ce qui précède, ne pas être discriminatoires. Or un groupement ou un parti politique se forme «librement», comme l'indique l'article 4 de la Constitution. Rien ne lui interdit, sauf à vouloir prétendre à l'exclusivité de la représentation nationale, de porter l'expression d'une philosophie, d’une sensibilité (au sens large), voire d’une catégorie sociale données.
Une expression ancienne des sensibilités « en » politique
Les partis de gauche étaient dénommés «partis ouvriers»; les États d'Europe centrale et orientale de l'entre-deux-guerres avaient (et ont encore parfois, depuis la chute du mur) des «partis paysans» ou «agrarien». En 1956, le «papetier de Saint-Céré», Pierre Poujade (dont le patronyme a servi à former poujadisme et poujadiste), a fait élire cinquante-deux députés (dont Jean-Marie Le Pen) sur des listes «Union et fraternité françaises», qui ne sont que le paravent de l'«Union de défense des commerçants et artisans» (UDCA), le syndicat professionnel créé par Poujade. Ce courant ne survécut d'ailleurs pas à la IVe République… et à la suppression du scrutin proportionnel.

Agrandissement : Illustration 7

On notera que si l’inspiration chrétienne est reconnue ou parfois invoquée pour ces mouvements, ils ne se sont pas déclarés comme confessionnels. Ce fut également le choix du Mouvement républicain populaire (MRP), issu initialement de la Résistance mais ne se reconnaissant pas dans les partis « ouvriers » (PCF et Parti socialiste SFIO). Le MRP joua un rôle central sous la IVe République (il était le premier parti de France aux élections à la deuxième Assemblée constituante avec 28 % des voix en 1946, avant de décliner[8]).
On rappellera d’ailleurs, sans remonter à des temps anciens, que l’Assemblée nationale (Chambre des députés jusqu’en 1940) a connu des députés ensoutanés sans que cela fût autrement remarqué par des laïques « patentés », peu suspects de sympathie avec les « cléricaux »[9]. Certes, l’abbé Pierre (nom de Résistance d’Henri Grouès, ancien du Vercors) est moins connu comme député (1945-1951) que pour son action en faveur des sans-logis[10]. Mais, par exemple, l’abbé Jules-Auguste Lemire (1853-1928) n’a pas vécu la vie politique comme une époque « obscure » de sa vie.

On ne saurait enfin omettre cette figure parlementaire, célèbre par son verbe, sa faconde et le nom qui reste attaché à un apéritif populaire : Félix Kir, plus connu sous l’appellation de « chanoine Kir » qui fut pratiquement député-maire de Dijon de la Libération à son décès en avril 1968[13].

Que tirer de ces exemples, sinon, en des temps pour l’autorité de l’Église était peu discutée, que les assignations ont décidément leurs limites, et que les trajectoires personnelles sont plus complexes, moins linéaires et, surtout moins unidimensionnelles qu’on ne pourrait le penser spontanément ? Même chez des croyants ayant été ordonnés, les modalités de participation à la vie politique n’ont pas dépendu seulement du système de croyances. Autrement dit, un croyant, même prêtre quand prêtrise il y a, peut formuler dans la vie de la Cité des choix variés et éventuellement variables, que son engagement soit relativement bref, et finalement secondaire au prisme de ses engagements ultérieurs (l’abbé Pierre), ou qu’il se doit durablement impliqué, au contraire, dans la vie politique. L’étiquette présupposée a ses limites.
Encore s’agit-il d’engagements individuels, rétorquera-t-on peut-être, et de surcroît dans des formations politiques qui étaient ouvertes, MRP compris. À l’évidence, ces élus ont fait un choix « non communautaire » ou « non communautariste », comme l’avait fait aussi à certains égards, jusqu’au point de rallier l’OAS, le bachaga Saïd Boulam (parfois écrit Boualem), député « Algérie française » entre 1958 et 1962, élu de surcroît quatre fois à la vice-présidence de l’Assemblée nationale[16]. Admettons, cela implique qu’il faille « identifier » les listes « communautaristes ». Mais autant on peut engager des luttes de définitions dans le débat philosophique, sociologique et politique, autant on est contraint, puisque l’intention affichée est d’aboutir à des procédures prohibitives, à définir le terme pour justifier et qualifier préciser ce qui serait une mesure en droit.
Quelle qualification juridique ?
Communautaire ou communautariste renvoie à communauté. Mais ce terme même revêt plusieurs acceptions. Si l’on retient celle du Dictionnaire de l’Académie française (après tout, c’est une institution officielle, quand bien même elle n’a pas de pouvoir sur la langue), on trouve ceci (c’est moi qui souligne) :
Groupe humain dont les membres sont unis par un lien social. Communauté familiale, villageoise. Vivre en communauté. La communauté française, nationale. La communauté internationale. Se dévouer pour la communauté. Par extension. Groupe humain dont les membres ont en commun une langue, une religion, etc. La communauté francophone. La communauté musulmane. La communauté chinoise. Religion. Société dont les membres vivent ensemble en obéissant à certaines règles. Une communauté de religieux, de religieuses. Par métonymie. Les membres d’une telle société ; la maison religieuse où ils vivent. L’évêque visita la communauté. Le jardin, le réfectoire de la communauté.
On le voit, le terme est polysémique. L’Académie ne connaît pas les dérivés communautarisme et communautariste. Ces mots peuvent être convoqués de manières très différenciées (péjoratives, identitaires, revendicatives…), ce qui génère naturellement du flou et de la contradiction. Or, pour donner une qualification juridique, il faut une définition précise.
Toujours dans notre hypothèse d’école, pourrait être définie, non pas comme illégitime (ce qui est un jugement de valeur), mais comme irrecevable (ce qui a une portée juridique) une candidature (individuelle ou collective) qui, cumulativement ou non cas :
- « ne s’adresse qu’à une partie de la communauté nationale par opposition au reste de celle-ci » ;
- « réfute le caractère général, abstrait (impersonnel) et permanent de la loi[17], et en particulier revendique des adaptations différenciées sur des fondements ethniques ou religieux».
Encore faudrait-il définir qui peut invoquer cette qualification à l'encontre d'une candidature (individuelle ou collective). D’autres candidats ? Bonjour les accumulations de procédures et les risques d’effet boomerang ! Un représentant de la puissance publique, mais lequel ? Si l’on était dans le champ judiciaire, il y aurait le parquet, sauf que le juge judiciaire n’est compétent qu’en matière d’inscriptions sur les listes électorales, pas des élections.

Agrandissement : Illustration 10

Le domaine du contentieux électoral relève du Conseil constitutionnel pour les élections nationales (président de la République, parlementaires). Pour les élections locales, c’est le juge administratif qui est compétent : tribunal administratif (et Conseil d’État en appel) pour les élections municipales et départementales (ex-cantonales) ; Conseil d’État en premier et dernier recours pour les élections régionales.
Peut-on imaginer qu’un représentant de l’État puisse saisir le juge administratif, comme il peut le faire, par exemple, dans le contrôle de légalité des décisions des collectivités territoriales? Ce serait donc le préfet ; préfet du département pour les niveaux infrarégionaux ; préfet de région pour les élections régionales. Il est vrai que les préfectures vérifient la conformité des candidatures ou des listes, mais c’est une vérification administrative des documents requis (signatures sur les déclarations de candidature, formulations, copie des documents d’identité…), et le refus de récépissé administratif est susceptible de recours rapide devant le juge administratif.
Cette vérification, destinée à limiter les contentieux postélectoraux en inéligibilité ne concernent ni l’intitulé (sauf contestation en usurpation ou détournement d’une investiture partisane ou emploi fallacieux d’un sigle ou d’un logo), ni le contenu de la profession de foi. Si l’on étendait la vérification préalable à une « irrecevabilité » telle que je l’ai présentée dans l’hypothèse d’école, même en la limitant à la saisine du juge administratif compétent, on voit bien combien les victimes de telles saisines pourraient crier à la manipulation politique, et l’on verrait ressurgir bien vite les termes de « candidature officielle » abandonnés depuis la fin du Second Empire — parallèlement, bien entendu, à tous les procédés de « victimisation ».

Agrandissement : Illustration 11

Il faudrait de surcroît imaginer que les candidats (ou les têtes de liste, dans un scrutin de liste) fussent suffisamment obtus et benêts pour offrir pleinement prise à une définition légale. On le voit déjà quand il faut « décoder » les messages lénifiants de certaines listes ou candidatures « communautaristes ».[19]
Les candidatures peuvent être purement individuelles. De Marcel Barbu à Ferdinand Lop ou Aguigui Mouna, on en a connu maints exemples fantaisistes, et la plupart du temps moins pittoresques que les deux précitées — ou celle encore de Marcel Barbu à l’élection présidentielle de 1965. Quand il s’agit d’élire une assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional) appelée ensuite à désigner son exécutif par vote interne (maire et adjoint, présidents et vice-présidents des autres collectivités ou intercommunalités), les listes peuvent être «apolitiques».
C’est assez souvent le cas dans les petites communes rurales. Il arrive certes qu’une liste «de défense des intérêts communaux» (appellation traditionnelle) s’oppose à une liste d’action communale. Les raisons en sont purement locales, voire interpersonnelles… et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, ne figent pas la situation[20].
Dans des communes plus importantes, des listes peuvent se situer «hors partis», qu’elles se réclament de la « défense des intérêts communaux » ou de la société civile (les civils qui la composent faisant société). Mais le plus souvent, en tout cas dès que la commune revêt une certaine importance numérique, elles sont présentées par des partis ou coalitions de partis («listes d'union») et leurs maires sont «étiquetés» par les préfets, selon une pratique aussi ancienne que l’élection des maires depuis 1884. Il est d’ailleurs significatif que, pour évoquer des listes supposées « communautaristes » ou « communautaires », les chaînes d’information en continu soient allées solliciter un responsable de parti supposé s’inscrire dans cette dimension (l’UDFM), plutôt que tel ou tel candidat, fût-ce une tête de liste.

Agrandissement : Illustration 12

J’ai relevé la difficulté à pouvoir qualifier une liste de « communautariste » ou « communautaire ». La chose serait plus délicate encore dans la mesure où cette liste serait investie ou patronnée par un « parti » ou un « groupement politique », les deux termes étant ici équivalents. L’irrecevabilité supposée d’une liste partisane mettrait en cause le parti. Or les partis, quelle que soit leur appellation (parti, mouvement, ligue, union, etc.), ont une existence structurante dans les démocraties modernes, quelques turbulences ou tempêtes qu’ils peuvent traverser ou avoir traversées.
Constructions historiques, ils ont une existence, et donc une reconnaissance, inscrite dans la Constitution. En outre, ils font l’objet d’une législation et d’une règlementation financières spécifiques (en France, depuis 1988). La question de l’irrecevabilité des candidatures serait alors liée à leur capacité d’entreprise politique investissant des candidats en investissant sur eux pour développer leur audience et propager plus largement leur(s) point(s) de vue. Vouloir interdire les listes supposées « communautaires » conduirait à invalider les partis qui, dans tous les sens du terme, les investissent, autrement dit, qui, en leur conférant leur investiture comptent en retour tirer les dividendes de leur investissement en termes d’élus et de notoriété, fût-elle très locale et très éclatée. Il y aurait même un autre effet : on déclarant des candidatures aux élections législatives irrecevables (pour « communautarisme » supposé), on exclurait ces formations, non seulement de la compétition électorale, mais du financement politique public institué par la loi du 11 mars 1988.

Agrandissement : Illustration 13

Les partis, la Constitution et la loi
Il ne suffit pas de refuser l'appellation de «parti» ou ses formes «classiques» de fonctionnement formel (congrès, comités, élection théorique des dirigeants) pour ne pas en être un.
LREM ou LFi se veulent mouvements, mais c’était aussi le cas — en critiquant les partis anciens — du Mouvement républicain populaire (MRP) à sa création, à l’automne 1944, ou les formations gaullistes de la IVe République et des débuts de la Ve, à commencer par le Rassemblement du peuple français (RPF, 1947)[21]. Même en reprenant la définition canonique traditionnelle des partis politiques formulée par les Américains LaPalombara et Weiner en 1966[22], ces mouvements, gazeux ou pas, sont bel et bien des partis politiques ou du moins, pour reprendre la plus englobante formulation de la loi fondamentale, «des partis ou groupements politiques».
L’histoire d’une constitutionnalisation
Contrairement à la Constitution de 1946 et aux textes constitutionnels antérieurs, la Ve République a officialisé, et même « constitutionnalisé » l’existence des « partis et groupements politiques ». Cette insertion dans le texte juridique suprême avait, dans le contexte de l’époque, des arrière-pensées très politiques. Elle en a fait cependant des « objets constitutionnels ». Cette disposition ne figurait pas dans l'avant-projet élaboré par le Gouvernement de Gaulle (alors président du Conseil, le dernier, de la IVe République finissante). Saisi pour avis, le Comité consultatif constitutionnel que présidait Paul Reynaud[23] avait proposé l'adjonction d'un article numéroté «2 bis» et ainsi rédigé[24]:
Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes démocratiques contenus dans la Constitution. Une loi organique fixera les modalités d'application du présent article.
Dans son avis officiel du 14 août 1958, le Comité consultatif constitutionnel, sans reprendre sa rédaction précise, en justifiait l’idée ainsi sous un chapeau « De la souveraineté » suivant ses remarques sur le préambule :
La majorité du comité a pensé que la prochaine Constitution devait contenir une disposition imposant aux partis et groupements politiques le respect des principes démocratiques. Il est, en effet, convaincu que la rénovation des institutions de la République doit s’accompagner d’un assainissement de sa vie politique. Celle-ci ne peut, en particulier, s’accommoder des agissements antinationaux et antirépublicains de partis soumis à une obédience étrangère[25].
Sans faire référence à une loi organique d'application, le projet de Constitution arrêté souverainement par le Gouvernement[26] et adopté par référendum contenait un article 4 ainsi libellé:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

On a voulu voir dans l'article qui traite des partis politiques une dangereuse machine de guerre. Où en sommes-nous arrivés qu'une affirmation telle que « les partis doivent respecter le principe de la souveraineté nationale et la démocratie » fasse crier à l'arbitraire ? Nous vivons dans un monde où la fourberie est reine. De quel droit ceux qui ont pour mission de fortifier la France et de consolider la République pourraient-ils accepter d'ouvrir à deux battants les institutions de l'État à des formations qui ne respecteraient point le principe sans lequel il n'y a ni France ni République ? Le silence de la Constitution eût été grave et les critiques alors auraient été justifiées ! Il n'a pas été assez dit que cette affirmation est la conséquence d'une autre. Le projet déclare : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». Ces deux phrases sont capitales. Elles sont, du point de vue constitutionnel, la négation de tout système totalitaire qui postule un seul parti. De la manière la plus catégorique, et en même temps la plus solennelle, notre future Constitution proclame sa foi démocratique et fonde les institutions sur cette expression fondamentale de la liberté politique qui est la pluralité des partis.
Cet article 4 n’a pas bougé entre 1958 et 1999. Il a alors été complété par un second alinéa ainsi rédigé:
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Cette référence était également nouvelle, et introduite par la même loi constitutionnelle du 8 juillet 1999:
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
La révision constitutionnelle « Sarkozy » du 23 juillet 2008, ayant déplacé la mention à l'égalité femmes/hommes à l'article 1er (en y ajoutant «ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales»), l'article 4 a été actualisé et complété par un alinéa complémentaire. Sa rédaction en vigueur (depuis 2008) est donc la suivante, avec un premier alinéa inchangé depuis 1958:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
L’article 4 est longtemps resté en jachère. Les ajouts intervenus en 1999 (les suivants ont été des ajustements techniques d’écriture sur ce point) ont donné une base constitutionnelle nécessaire aux mesures contraignantes (les alternances homme/femme ou femme/homme au scrutin de liste, d’où, par référence à la musique du célèbre film de Claude Lelouch, les « listes Chabada »), mais aussi aux mesures-sanctions comme la réduction des financements publics en cas de déséquilibre des candidatures aux élections législatives.
Au reste, jamais l’article 4 de la Constitution n’a été invoqué lors de dissolutions de mouvements politiques ou assimilés sous la Ve République. De telles mesures n’ont été prises — sous le contrôle du juge administratif — que sur le fondement des décrets-lois de 1936 sur la dissolution des groupements armés ou, par voie de conséquence, la reconstitution de ligues dissoutes. Et l’on sait que la dissolution de la Ligue communiste dans la foulée de mai 1968 a été annulée par le Conseil d’État… tandis que d’autres mouvements se reconstituaient avec d’autres appellations, à l’extrême gauche comme à l’extrême droite.

Agrandissement : Illustration 15

Il faut y ajouter depuis lors la valeur désormais contraignante de la Charte des droits fondamentaux (de l’Union européenne)… qui renvoie, elle aussi, à cette Convention. En outre, L’article 11, 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que :
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique[29], syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

Agrandissement : Illustration 16

Constitution et unicité du peuple français
Si l’on ne peut attaquer les partis frontalement, peut-on constitutionnellement fonder une décision d’irrecevabilité de candidature(s) sur une référence constitutionnelle à l’unicité du peuple français ? L’article 4 fait en effet référence à la « souveraineté nationale » à laquelle est consacré l'article 3 de la Constitution. Ses deux premiers alinéas disposent que :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
C'est une formulation classique[30]. On en trouve l'analogue dans la Constitution de 1791 ou celle de 1848. Sa logique même est le refus de la captation de la souveraineté par un ordre (comme la noblesse, dans la période révolutionnaire) ou un groupe donné, ou par un individu. En 1791, il y avait un roi constitutionnel, mais qui n'était plus souverain. La formulation de 1958 est quasiment la reprise de l'article 3 de la Constitution du 27 octobre 1946 (IVe République), à cela près que l'exercice référendaire de la souveraineté nationale ne pouvait s'y exercer qu'en matière constitutionnelle. Celle de 1946 résultait d'un compromis proposé par le député MRP Paul Coste-Floret[31], rapporteur du second projet de Constitution, alors qu'un débat animait la Constituante entre «souveraineté populaire» et «souveraineté nationale».
On peut certes considérer que serait hors des clous un groupe politique désireux de confisquer la souveraineté nationale à son profit — ou à celui d’un groupe prédéterminé quel qu’il soit (social ; élitaire, comme l’ancienne noblesse ou la noblesse d’argent ; religieux). Mais un tel motif n'a jamais été invoqué, même à l'encontre des formations prônant la dictature du prolétariat en un temps donné. Et il ne me paraît pas pouvoir fonder l’expression d’une quête de représentation au sein de la représentation nationale comme au sein de l’assemblée délibérante d’une collectivité.

Agrandissement : Illustration 17

Autrement dit, la Constitution elle-même offre peu de prise. Il faudrait un parti (ou assimilé) affichant sa volonté de conquérir le pouvoir à des fins exclusives, c’est-à-dire à la fois d’usage exclusif du pouvoir et d’exclusion de la vie nationale de ceux qu’il entend mettre à l’index. Or, précisément, Il n’a pas davantage été invoqué lorsque Marion Maréchal-Le Pen, alors députée Front national du Vaucluse, déclarait au quotidien d’extrême droite Présent (21/11/14)[32] :
Il faut accepter de définir et de revendiquer quel est notre héritage et quelle est notre identité. Ça passe par l'affirmation de notre héritage gréco-romain et chrétien. Il faut dire que la France est une terre culturellement et très longtemps spirituellement chrétienne. Et dans ces conditions, si des Français peuvent être musulmans et exercer leur foi, il faut qu'ils acceptent de le faire sur une terre qui est culturellement chrétienne. Ça implique aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas avoir exactement le même rang que la religion catholique, ne serait-ce que parce que nous avons des traditions populaires qui ont des connotations spirituelles qui peuvent s’exercer dans le cadre public, ce qui aujourd’hui ne peut pas être le cas de l’islam.
Comme le montre Sofia Aram, les «communautaristes»
ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Mais tant qu’on ne prévoit pas d’exclure des droits politiques cette minorité qu’on entend laisser littéralement en marge, on ne prétend pas confisquer la souveraineté nationale au nom d’une « section du peuple » (les autres), même s’il s’agissait d’une dictature de la majorité. En d’autres termes l’expression politique d’une sensibilité quelconque est possible, dès lors qu’elle ne revendique pas ou ne traduit pas en actes une démarche totalitaire ou discriminatoire pouvant viser d’autres citoyennes ou citoyens en raison de leur genre, de leur identité réelle ou supposée (« communautaire » supposée, y compris d’orientation sexuelle).
Le débat sur ces sensibilités reste politique, philosophique et moral. Comme le soulignait à juste titre l’humoriste Sofia Aram, les communautaristes ne sont pas forcément ceux auxquels on pense[33].
Les règles de financement des partis et des campagnes
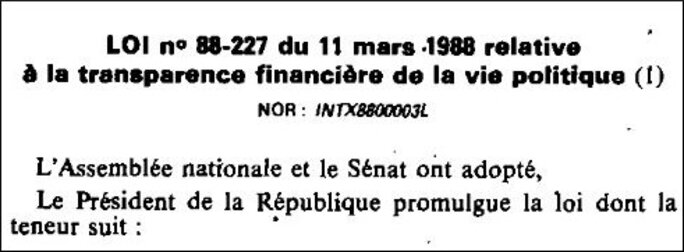
Le 11 mars 1988 deux lois ont été promulguées : une loi organique nº 88-226 « relative à la transparence financière de la vie politique »[36] et une loi « ordinaire » nº 88-227 avec le même intitulé. Cette dernière, la seule que nous évoquions ici, considère comme partis les personnes morales de droit privé qui ont bénéficié du financement public[37] et qui ont déposé des comptes certifiés. La formulation ne figure pas explicitement dans la loi de 1988, mais a été dégagée par une jurisprudence concordante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État[38]. La Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique (CNCCFP) a elle-même été instituée par la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990[39].
D’autres dispositions législatives ont suivi, la dernière en date étant la loi du 11 octobre 2013 « relative à la transparence de la vie publique »[40]. Elles ont précisé ou accentué les contraintes pesant sur le financement des partis, celui des campagnes ou les obligations personnelles de « transparence » des personnages publics, notamment pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour autant, elles n’ont pas modifié l’économie générale de la loi de 1988[41]. C’est dans ce cadre qu’est née l’obligation d’un mandataire financier unique pour le candidat ou la tête de liste. Ce peut être une personne physique ou une association de financement, dont ni le candidat (le binôme aux élections départementales), ni le suppléant (législatives), ni les colistiers (élections municipales, régionales européennes) ne peuvent être membres, pas plus que l’expert comptable obligatoire. De surcroît, cette association doit être dissoute six mois au plus après la reddition des comptes de campagne[42].
On notera que les règles applicables — qui ne s’imposent aux élections municipales que pour les communes de 9 000 habitants et plus — sont particulières complexes et astreignantes. On en trouve des indications à la page « Documents applicables aux comptes de campagne des candidats aux prochaines élections générales et partielles, à l'exception de l'élection présidentielle et de l'élection des représentants au Parlement européen » du site de la CNCCFP[43]. Le Guide du candidat et du mandataire (doc PDF), accessible depuis cette page, fait 97 pages et ne se lit pas aussi aisément qu’un numéro de Spirou de la grande époque. De fait, hormis un candidat « local » disposant pour lui-même d’une structure forte, l’appui, a minima technique, d’un parti (ou d’un microparti) apparaît indispensable… ce qui nous renvoie au sujet précédent.
Cette règlementation (lato sensu) financière est très contraignante, mais dans les seules limites de son objet. Aucune règle d’exclusion financière (par exemple pour la déductibilité des dons) ne peut intervenir que du chef du non-respect des obligations administratives, comptables et financières, notamment vis-à-vis de la CNCCFP. Le seul élément « de fond » qui peut être sanctionné, par ce qu’il est prévu par la loi elle-même conforme à la Constitution, est l’écart du nombre de candidatures entre les femmes et les hommes.
En guise de conclusion
J’évoquais plus haut le raisonnement binaire[44] de celle qui fut l’élève de la « très traditionaliste » (soyons gentils) institution Saint-Pie X dans la ZEP de Saint-Cloud conduit à séparer selon les religions, réelles ou supposées, au mépris du caractère laïque de l’État… et de la réalité du rapport à la religion. Je renvoie en particulier à l’Étude sur l’expression et la visibilité religieuse dans l’espace public aujourd’hui en France, publiée en juillet 2019 par l’Observatoire de la laïcité (ODLL)[45]. Précisions également que, selon un sondage pour l’ODLL (février 2019), « à titre personnel », 37 % des personnes interrogées se déclaraient croyantes (quelle que soit la religion — mais avec 14 % seulement ayant une pratique religieuse au moins mensuelle), 31 % athées, 15 % agnostiques et 10 % « indifférentes ». Encore faudrait-il de surcroît — ce qui est très loin d’être le cas — que l’approche religieuse, pour ceux qui la revendiquent ou l’assument, fût le premier élément déterminant d’un choix politique, social ou sociétal. Comme si, dans ses choix sociaux ou au sein de la Cité, toute personne d’une confession quelconque devait formuler ses choix d'abord et «essentiellement» en tant que membre d'une religion… sans qu’on sache trop d’ailleurs, répétons-le, comment devraient se positionner les athées, agnostiques et autres indifférents — car il y en a.
Dans la période présente, d’assez nombreux observateurs ont fait remarquer que, si l’échec de la promesse républicaine conduisait à des replis communautaires (auxquels n’échappent pas, à leur manière, les ghettos du Gotha chers aux Pinçon-Charlot[46]), alors il ne s’agit pas de se focaliser sur les entrepreneurs de causes réputées « séparatistes », mais de faire en sorte que leurs approches ne trouvent pas d’écho significatif parce que des réponses auront été apportées sur des questions telles que l’insertion économique, les droits sociaux, l’éducation et, avant tout, la citoyenneté. Or, de ce point de vue, force est de constater que le poids relatif d’« activistes » peut être accentué en raison d’une abstention massive — ce cens caché selon la formule de Daniel Gaxie.
Car la priorité n’est pas d’envisager des dispositifs de prohibition à la constitutionnalité éminemment discutable et, de surcroit, contre-productifs dans la mesure où, par effet de victimisation, ils renforceraient les positions des entrepreneurs de cause identitaire. Combattre les causes de désaffiliation et de dépolitisation passe par des politiques publiques, notamment dans les champs économique, social, éducatif, etc., beaucoup plus audacieuses. C’est évidemment plus compliqué à mettre en œuvre que de se borner à asséner des slogans. Le reste ne fait l’affaire que des entrepreneurs de ségrégation, quelle qu’en soit l’optique.
Luc Bentz
Notes
[1] Une «désinfox» de LCI (pour une fois) démontre comment l'instrumentalisation du choix des données mise en avant est fonction du message voulu. Sous le titre «Une liste communautaire a-t-elle récolté 40 % des voix à Maubeuge lors des dernières européennes?» (18/10/19), Thomas Deszpot rappelle que la liste en question (celle de l'UDMF: Union des musulmans démocrates français) n'a obtenu que 6,1 % dans la commune, à l'occasion d'un scrutin qui y a connu 60 % d'abstentions… pour 0,13 % à l'échelle nationale.
[2] Romain Herreros, «Julien Odoul ordonne à une femme d'ôter son voile, au mépris du droit», Le Huffington Post, (12/10/19).
[3] Dans cette focalisation construite sur des bases ou des fantasmes d’exclusivité religieuse, on oublie d’autres types de séparatisme, comme cette « sécession » qu’évoquait une note de Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean-Jaurès : « 1985-2017 : quand les classes favorisées ont fait sécession », 21/2/18.
[4] La loi du 11 mars 1988 sur laquelle je reviens plus bas prévoit un financement public pour les partis ou groupements politiques enregistrés auprès d’elle qui ont présenté des candidates et candidats aux élections législatives ayant obtenu au premier tour au moins 1 % des suffrages dans au moins cinquante circonscriptions différentes. Cette répartition s’applique à la moitié des financements publics, l’autre relevant d’une affectation, révisable annuellement, par les parlementaire en fonction (députés et sénateurs), soit un peu plus de 37 000 € par élu.. Des règles de pénalisation sont prévues en cas d’inégalité du nombre de candidatures entre les femmes et les hommes. Des adaptations sont également prévues pour les partis spécifiques aux Outre-mer. Le Parti animaliste recevra en 2019 une dotation de 67 24,10 € (décret n° 2019-111 du 19/2/2019).
[5] Le Parti chrétien-démocrate est l’appellation prise par le « Forum des républicains sociaux » créé en 2001 par Christine Boutin, qui reprenait une étiquette (républicains sociaux) qui avait été celle de groupements gaullistes sous la IVe République après la mise en sommeil du RPF par le général de Gaulle en 1955. Le changement d’étiquette correspondait à un choix de positionnement (nouvelle dénomination pour une même entreprise politique). Jean-Frédéric Poisson, sous la bannière de l’UMP et de ses formations associées (dont le PCD), avait succédé à Christine Boutin comme député des Yvelines de 2002 à 2017 (sauf une interruption entre 2010 et 2012). Aux élections législatives de 2017, il a été battu par la candidate LREM Aurore Bergé.
[6] Ce dernier, qui avait sombré dans l’oubli de ses 0,13 % des suffrages aux élections européennes de mai 2019, aura bénéficié par contrecoup d’une publicité inespérée et d’invitations sur les plateaux de télévision après une mise en lumière très orientée du Rassemblement national (voir plus haut la note, p. 2).
[7] Mais ici ou à, la question d’une structuration locale de l’islam politique peut préoccuper, d’autant plus que ses résultats sont amplifiés par des phénomènes de forte absention. Mais ce n’est pas parce qu’une candidature politique «musulmane » s’affiche en banlieue qu’elle est couronnée de succcès, ni non plus que l’échec soit général. Dans la Revue du Mauss permanente, Philippe Velilla (« Vote ethnique, vote idéologique et vote de classe aux élections de 2017 », 30/6/17) écrit notamment, dans une partie relation « l’échec des partis confessionnels » : Dans cette France du XXIe siècle où les partis confessionnels ne sont guère prisés, l’islamisme ne reste cependant pas sans influence, comme devait le prouver un candidat sans parti, mais doté d’une grande notoriété : Samy Debbah. Ancien prédicateur du Tabligh et organisateur de tournées de conférences de Tariq Ramadan, Samy Debbah avait fondé, dans la mouvance des Frères musulmans, le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) en 2003. Samy Debbah a réussi une percée spectaculaire en se hissant au deuxième tour des élections législatives dans la 8e circonscription du Val-d’Oise face au maire PS de Sarcelles, François Pupponi. Il a en partie bénéficié de l’abstention massive (67,9 %) et de l’absence de candidature LREM pour atteindre au premier tour 13,9 % des suffrages, soit 2 352 voix. Au second tour, il devait être battu, avec 34,2 % des voix, mais recueillit 55 % des voix dans sa ville de Garges-lès-Gonesse, score exceptionnel pour un candidat sans étiquette. En revanche, dans la même circonscription, une candidate du « Parti Égalité-Justice » n’obtenait que 0,19 % des voix. Ce parti, qu’on peut qualifier au vu de ses positions d’« islamo-conservateur », peut être surtout considéré comme le relais de l’AKP turc du président Erdogan. Nationalement, il n’a obtenu plus de 1 % que dans sept circonscriptions, ce qui ne le rend pas éligible au financement public.
[8] Aux élections législatives de 1956, il « pesait » plus de 10 % des voix (83 députés dans son groupe). À celles de novembre 1958, non plus à la proportionnelle, mais au scrutin majoritaire, il obtenait encore 9 % des voix (57 députés) Le MRP participa jusqu’en 1962 au gouvernement Debré (1959-avril 1962), puis au gouvernement Pompidou jusqu’en mai 1962 où les ministres MRP, en désaccord avec les orientations hostiles à l’Europe du président de la République, démissionnèrent collectivement. L’annonce du référendum d’octobre 1962 sur l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct les ancra dans l’opposition (toujours à 9 %, mais avec 37 députés « seulement »). En 1965, la candidature de Jean Lecanuet connut un relatif succès (3e au premier tour). Il transforma le MRP en « Centre démocrate » qui connut une vie plus complexe et plusieurs turbulences jusqu’à son dernier avatar direct, le Centre des démocrates sociaux (CDS, 1976-1995). On peut considérer à certains égards que l’actuel Modem de François Bayrou en est, sans exclusivité toutefois, une lointaine continuation. — On relèvera que, quoique officiellement « non confessionnelle », cette famille politique, depuis la IVe République, a toujours défendu l’enseignement privé, essentiellement catholique, de la loi Marie-Barangé de 1951 à la loi Bourg-Broc (sous le ministère de l’Éducation nationale de François Bayrou) en 1993.
[9] Penser que l’abbé Lemire fut contemporain, à la Chambre de Jaurès, Briand, Clemenceau, Édouard Herriot, sans oublier Ferdinand Buisson !
[10] En 1945, il est élu député MRP à la première Constituante, à la seconde, puis à la première Assemblée nationale (1946-1951). L’abbé Pierre rompt vers 1950 avec un MRP qui s’est sensiblement droitisé (il semble que ce soit une loi d’airain pour les partis qui revendiquent le dépassement du clivage gauche/droite, du gaulliste RPF/UNR à LREM). À la tête d’une liste d’inconnus, sans soutien de l’Église et du MRP, il est battu en 1951 et quitte la vie politique.
[11] Partisans, après l’effondrement du Second Empire, de la restauration (du trône) en faveur du comte de Chambord, héritier de Charles X. Elle aurait pu se réaliser si le comte de Chambord ne s’était accroché au drapeau blanc, mais c’est une autre histoire qui a abouti non à une troisième restauration (après 1814 et 1815), mais à l’instauration de la IIIe République.
[12] La gauche républicaine des débuts de la IIIe République (opposée aux monarchistes légitimistes ou orléanistes comme aux bonapartistes) fut déportée vers la droite, selon un mouvement de translation classique, avec l’émergence des radicaux et radicaux-socialistes, puis des partis « ouvriers » issus du socialisme « unifié » de Jaurès, Guesde et Vaillant.
[13] Il avait été réélu en 1962 au Parlement, en 1965 à la mairie. En 1967 ; il avait été battu aux élections législatives, alors que déjà, en 1962, il n’avait dû son élection face à un candidat gaulliste que grâce au désistement communiste, motivé sans doute par le fait que cet « anticommuniste pro-bolcheviks » avait jumelé Dijon avec Volgograd (ex-Stalingrad) et qu’il avait rencontré Khroutchev). Le chanoine Kir a été deux fois président comme doyen d’âge de la nouvelle Assemblée nationale élue, en 1958 et en 1962.
[14]J ’ai narré cet épisode dans une note au format PDF (29/5/17), accessible depuis un ancien blog et qui revenait en détail sur l’année 1962 (https://blogs.lexpress.fr/etudiant-sur-le-tard/quelle-majorite-pour-macron/). Les Indépendants, Paul Reynaud en tête, avaient majoritairement voté la censure du gouvernement Pompidou en octobre (au prix de la scission des amis de Valéry Giscard d’Estaing, alliés aux gaullistes). La censure du Gouvernement ayant été suivie d’une dissolution, les élections de 1962 eurent lieu après le référendum gagné par de Gaulle. Elles finirent de laminer la droite « non gaulliste ». Or, le PCF, le Parti socialiste SFIO avaient trouvé la voie de la raison par des désistements qui permirent au PCF de retrouver un groupe à l’Assemblée nationale et au groupe SFIO de gonfler ses effectifs.
[15] Il fallait alors trente députés pour constituer un groupe à l’Assemblée nationale. Le Rassemblement démocratique en comptait 39, dont 4 apparentés. Voir le Journal officiel des débats parlementaires. Assemblée nationale, nº 3 du 12/12/62, p. 26 (déclaration politique) et 27 (composition). Ce groupe était l’avant-dernier avant les Républicains indépendants de Valéry Giscard d’Estaing. Il était majoritairement composé de radicaux (son président était Maurice Faure). Le chanoine Kir y voisinait avec François Mitterrand.
[16] Il est mis fin au mandat des députés des départements d’Algérie par une ordonnance du 3 juillet 1962, faisant suite à la reconnaissance officielle de l’indépendance de l’Algérie après le référendum d’autodétermination en Algérie et le référendum français (loi référendaire du 13 avril 1962) qui l’autorisait à en tirer les conséquences par voie d’ordonnances.
[17] Voir l’article « Loi », I, 6 in : Gérard Cornu, association René-Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 10e éd., 2014.
[18] Pour aller jusqu’au bout de notre hypothèse d’école, il faudrait que ces modifications législatives s’inscrivissent dans les chapitres adéquats du Code électoral.
[19] On évoquait (note, p. 4) le Parti Égalité et Justice, à l’évidence doublement communautaire puisqu’il vise de facto la « communauté turque » sir des bases religieuses conservatrices (avec une petite couche sur la « théorie du genre »). Ses déclarations laissent bien comprendre ce qu’elles veulent faire comprendre, mais c’est avec une finesse de rédaction qui conduit à l’interprétation de ce qui est littéralement écrit. Le juge, qui doit se fonder essentiellement sur l’explicite, aurait du mal à démêler le message orientation de la libre expression, d’autant plus que les sujets qui pourraient être analysés comme « communautaristes » sont noyés dans d’autres thématiques. De même l’UDMF s’affiche non confessionnelle, voire laïque, quand bien même elle assume, comme les formations démocrates chrétiennes d’avant et d’après guerre, une inspiration philosophique. Il n’est pas de casuistes que chez les jésuites.
[20] L’article L252 du Code électoral dispose que les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours, mais, contrairement aux autres, ne prohibe pas le panachage. Au reste, l’article L255-3 autorise les listes incomplètes et les candidatures individuelles. Depuis 2013 a disparu la possibilité d’élire un non-candidat. En revanche, en cas de second tour, des candidatures nouvelles peuvent être présentées pour les sièges restants à pourvoir (liste complète ou non, candidatures individuelles).
[21] Les partis gaullistes ont de ce point de vue longtemps usé d’appellations spécifiques (« Mouvement », même si le terme ne figurait pas dans leur appellation ; « compagnons »)… tout en singeant la structuration du Parti communiste, notamment avec un « comité central ».
[22] Dans une approche classique qui recoupe le fonctionnement des démocraties libérales des xixe et xxe siècles, les critères de définition des partis retenus par ces auteurs classiques de la science politique américaine sont : 1º une organisation nationale en lien avec des organisations locales ; 2º la volonté de conquérir et exercer le pouvoir, seul ou avec d'autres : 3º la recherche d'un soutien populaire aux élections ou en dehors de celles-ci. Les politistes contemporains préfèrent une définition antérieure de Max Weber (il faut savoir revenir aux classiques), qui élargit encore le champ de la définition : On doit entendre par partis des sociations reposant sur un engagement (formellement) libre ayant pour but de procurer à leurs chefs le pouvoir au sein d'un groupement et à leurs militants actifs des chances — idéales ou matérielle — de poursuivre des buts objectifs, d'obtenir des avantages personnels, ou de réaliser les deux ensemble (Économie et société, tome I, « Les catégories de la société », traduction française de Julien Freund & alii, Plon éd. «Pocket», collection Agora, p. 371).
[23] Dernier président du Conseil « républicain » de la IIIe République avant Pétain, c’est Paul Reynaud qui avait fait entrer au Gouvernement Charles de Gaulle, général de brigade à titre temporaire, comme sous-secrétaire d’État à la Défense nationale et l’avait envoyé à Londres. En 1958, il était député « Indépendant et Paysan », formation de droite. S’estimant trahi par le projet de référendum de 1962, en dépit des engagements pris devant le Comité consultatif constitutionnel sur la non-élection du chef de l’État au suffrage universel, il avait été, lors du vote de censure du gouvernement Pompidou, l’un des plus virulents dénonciateurs du projet.
[24] Ce « 2 bis » correspondait à l’article 4 du projet définitif. La genèse en est narrée dans les Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 (La Documentation française, 1991) que j'avais consulté, jadis ou naguère, à la bibliothèque universitaire de Nanterre. Il me semble de mémoire — mais la mémoire peut-être trompeuse, et je ne puis vérifier dans l’instant sur place — que c'est le témoignage de Michel Aurillac, alors au Conseil d'État, qui l'avait évoqué en un temps où il s'effrayait de certains «ultras» qui défendaient l'idée du Parti unique. D’un autre côté, le Parti communiste — «pas à gauche, mais à l'Est», selon une formule empruntée au député MRP Alfred Coste-Floret, que la SFIO avait faite sienne (via Édouard Depreux, semble-t-il) — pesait électoralement 20 % des suffrages à lui seul. Cela explique le libellé de l'époque. Aurillac (si c'est bien lui) avait évoqué, me semble-t-il aussi, le parallèle de l'interdiction par le tribunal constitutionnel allemand du Parti communiste en Allemagne «de l'Ouest».
[25] Souligné par nous. L’avis du 14 août 1958 a été publié au Journal officiel du 20/8/58 (p. 7739 et suiv.).
[26] Voir la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Le gouvernement de Gaulle est resté en fonction jusqu’à l’investiture de Charles de Gaulle lui-même à la présidence de la République, le 8 janvier 1959. Michel Debré est alors devenu Premier ministre, premier chef d’un gouvernement « régulier » au sens de la Constitution du 4 octobre 1958. Il y eut, rappelons-le, une grande période transitoire durant laquelle le gouvernement de Gaulle, dernier président du conseil de la IVe république investi le 2 juin 1958, resta chef du gouvernement de la Ve république en bénéficiant de pouvoirs spéciaux résultant, d’une part, de la loi 58-520 du 3 juin 1958 « relative aux pleins pouvoirs accordés au gouvernement du général de Gaulle » et, d’autre part, de l’article 92 de la nouvelle Constitution (devenu depuis sans objet et formellement abrogé en 1995). Les institutions nationales furent définitivement mises en place avec l’élection de la nouvelle Assemblée nationale (au scrutin majoritaire, décidé par ordonnance) en novembre 1958 et au Sénat en avril 1959.
[27] La France y a adhéré en 1974 et a autorisé ses ressortissants (faculté qu’il lui appartenait d’ouvrir) à recourir à la Cour européenne des droits de l’homme en 1981. On notera qu’Éric Zemmour, qui milite officiellement pour le retrait de la France, se prépare à y recourir. En toute bonne conscience, naturellement.
[28] L’article 11 est ainsi libellé : 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.
[29] C’est nous qui soulignons. Le texte a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 18/12/2000. Il n’avait alors qu’une valeur « incitative ». La construction européenne a permis de dépasser ce stade.
[30] On en trouve la source dans le serment du Jeu de paume du 20 juin 1789. Pour la première fois en effet, les députés du Tiers aux états généraux, en s’affirmant « Assemblée nationale » établissent une distinction politique, et de fait constitutionnelle, entre la « souveraineté » qu’ils s’arrogent implicitement et la monarchie. Le premier paragraphe du texte est fondateur : L’Assemblée nationale, considérant qu’appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l’ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu’elle continue ses délibérations dans quelque lieu qu’elle soit forcée de s’établir, et qu’enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l’Assemblée nationale.
[31] Frère du précédent.
[32] Cette déclaration de Marion Maréchal Le Pen avait fait quelque bruit à l’époque. L’intéressée était alors en campagne comme tête de liste FN aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le Huffington Post rapportait ses propos (21/11/15) sous le titre « Marion Maréchal-Le Pen estime que les musulmans “ne peuvent avoir exactement le même rang” que les chrétiens. » Et, quelques jours plus tard, il signalait la reprise de cette thématique dans un meeting à Toulon sous le titre « Pour Marion Maréchal-Le Pen, les musulmans ne peuvent être français que sous condition » (2/12/15).
[33] Billet de Sofia Aram sur France Inter : « Le fléau du communautarisme » (14/10/19).
[34] Michel Offerlé, op. cit., p. 10.
[35] De ce point de vue, ils peuvent être dissous (hors décision interne) par voie judiciaire ou par décret en Conseil des ministres dans les cas prévus par la loi. Dans le cas d’une dissolution administrative (décret), les voies de recours devant le juge administratif sont évidemment ouvertes. Pour plus de détails, voire par exemple Service-public.fr ou le site «démarches» du ministère de l’Intérieur.
[36] La loi « organique » traitait des déclarations de patrimoine et du financement des campagnes présidentielles et législatives. Rappelons que les lois dites « organiques », sous l’empire de la Constitution de 1958, sont expressément mentionnées par celle-ci (art. 46 de la Constitution). Elles sont soumises à des conditions d’adoption plus restrictives et, de surcroît, doivent être systématiquement soumises au Conseil constitutionnel. Quand ce document évoque la loi du 11 mars 1988, c’est de la loi ordinaire nº 88-227 qu’il s’agit : elle continue à s’appliquer hors dispositions modifiant directement le Code électoral dont on pourra consulter les différentes versions des articles sur Legifrance.fr. Ces deux lois ont été adoptées en période de cohabitation (François Mitterrand, président de la République ; Jacques Chirac, Premier ministre)… qui allaient s’affronter deux mois plus tard à la présidentielle (réélection de François Mitterrand).
[37] Le financement public, distinct du remboursement des frais électoraux — est fondé sur les élections à l’Assemblée nationale. Il en est fait deux parts égales. La première est attribuée aux organisations politiques ayant présenté des candidats dans un nombre minimal de circonscriptions, en fonction des voix obtenues ; la seconde est un droit de tirage subordonné au rattachement d’un parlementaire à un parti (indépendamment de son groupe éventuel).
[38] Voir par exemple, pour l’année 2017, l’« Avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2017 » publié par la CNCCFP au Journal officiel du 11/1/19. Il rappelle l’état de la règlementation (document PDF en ligne).
[39] Loi 90-55 du 15 janvier 1990 « relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ». Elle est mentionnée à l’article L52-14 du Code électoral.
[40] On en trouvera les références sur cette page Wikipedia : « Financement de la vie politique et électorale en France » (URL consultée le 29/10/19).
[41] Toujours pour ceux que cette question intéresse, signalons la parution relativement récente, sous la signature d’Éric Phélippeau, de L'argent de la politique, Les Presses de Sciences Po (2018). L’auteur y analyse la dialectique des différents acteurs (politiques — partis compris, mais aussi médias) et leur rôle dans l’émergence de nouveaux dispositifs, leur instrumentalisation… et leurs contournements.
[42] Cela explique le développement des «micro-partis», qui peuvent agir comme structures permanentes. En 2017, on comptait 493 «partis» enregistrés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Sur l’ensemble, il y a au maximum d’une quinzaine de partis nationaux dont on entend parler plus ou moins régulièrement, des partis spécifiques aux collectivités d’Outre-mer, et les «micropartis». Le dernier rapport complet de la CNCCFP concerne l’année 2017. Le document (de 1027 pages!) a été publié au Journal officiel — Documents administratifs nº 1 du 9 janvier 2019 (accès direct en PDF). Par curiosité, j’ai fait une recherche sur le mot Jeanne qui permet, en plusieurs occurrences, d’établir les relations entre ce microparti (choisi purement au hasard, ça va de soi) et le Rassemblement national. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la question du financement politique, je renvoie (entre autres) à Abel François et Éric Phélippeau, Le financement de la vie politique : règlementations, pratiques et effets politiques (A. Colin éd., coll. « U, sciences politiques », 2015).
[43] La législation pouvant toujours évoluer, précisons que l’URL de la page a été consultée le 2/11/19.
[44] Cette rhétorique est systématique, en février 2018, au congrès des « conservateurs » américains (CPAC), elle « décrivait » encore la France, fille aînée de l’Église catholique, en train de devenir la petite nièce de l’islam (Lucie Soullier, « Aux États-Unis, Marion Maréchal-Le Pen veut “make France great again” », LeMonde.fr, 22/2/18).
[45] L’Observatoire de la laïcité est placé auprès du Premier ministre. Pour l’étude, voir ce document PDF en ligne.
[46] Voir aussi, plus haut, la note 3, p. 3.



