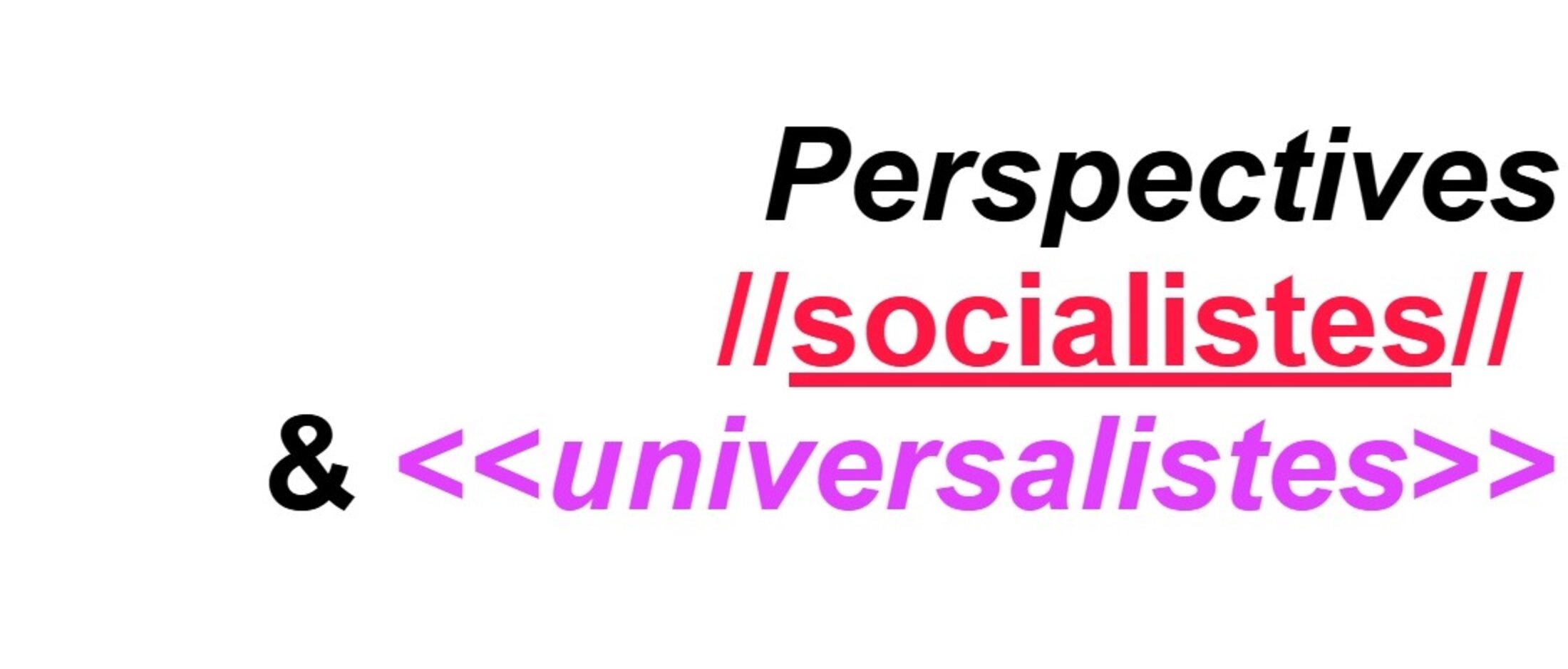Actuellement, la radicalité dans les discours de gauche repose sur une analyse intersectionnelle des oppressions et des discriminations. En s’appropriant des outils de la recherche (critique), des militant’es pour l’émancipation des catégories dominées veulent donner des clés de compréhension des dynamiques d’oppression qui traversent notre société.
Diffusé à la fin des années 1980 par la juriste étasunienne Kimberlé W. Crenshaw, le concept d’intersectionnalité (qui existait déjà sous d’autres noms mais n’était pas théorisé définitivement) est avant tout pensé comme une grille de lecture. Il est néanmoins critique puisqu’il s’axe sur l’analyse du carrefour où se trouvent les individus afin de comprendre leurs parcours et leurs difficultés sociales (relégation économique et politique, subordination sociale, faible représentation…), en particulier chez les femmes noires étasuniennes. L’intersectionnalité a aussi un pendant de transformation sociale : ce concept a vocation à comprendre les imbrications des systèmes de domination, mais aussi à les dépasser. Toutefois, le concept est extensif et sa transformation en outil d’analyse permet de percevoir une multitude de « handicaps » qui peuvent en partie expliquer la marginalisation d’individus ou de groupes sociaux dans la société. Ainsi, la classe, le genre, le sexe, et la « race » sont compris comme des éléments ayant un impact direct dans la trajectoire des individus. Mais aussi l’âge ou la non-validité du corps. Ces rapports ne sont perçus que comme des rapports de pouvoir par certains intellectuels, et non comme des rapports sociaux contradictoires (à l’idée de l’antagonisme Capital/Travail, ouvriers/patrons). Crenshaw écrit d’ailleurs que « La race et le genre sont parmi les tout premiers facteurs responsables de cette distribution particulière des ressources sociales qui aboutissent aux différences de classe observables ». Les tensions de classe ne sont alors que secondaires dans la production des dominations. D’ailleurs, dans son article « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur »1 publié en français en 2005, les termes de « classe sociale » ne sont qu’une seule fois cités. Pour venir à bout de cet effacement de la classe, des sociologues critiques et des militant’es entendent redéfinir les termes de leurs luttes et de leurs aspirations, afin d’ouvrir un espace de coalition prometteur, ou plus fertile que celui qui nous est aujourd’hui présenté : un espace militant très scindé selon les dominations vécues et revendiquées, qui s’attache aux discours, mais qui rend secondaire la dimension de classe. Le sociologue Fabien Granjon apporte que « les approches intersectionnelles font en principe des composants de la triade classe-race-genre des éléments distincts à considérer à parts égales dans les analyses des phénomènes de domination. Et dans une perspective non réifiante (logique de cumul), elles s’efforcent de considérer les phénomènes de domination comme des procès dynamiques »2. En reprenant l’analyse de Danièle Kergoat, il explique aussi que les analyses intersectionnelles ne prennent pas la classe comme une variable déterminante dans la production des inégalités structurelles. Alors, comment équilibrer une critique socialiste des dominations, sans réifer aucune d’entre elle, et cloisonner les « groupes dominés » entre eux ? Quelle place pour la lutte des classes ?
De la complexité dans les dominations, avec Danièle Kergoat.
Danièle Kergoat, née en 1942, est sociologue. Elle est féministe et se distingue par son analyse matérialiste des rapports entre les sexes. Elle fonde sa recherche sur le prisme de la « division sexuelle du travail », ouvrier comme domestique. Dans son article « Penser la complexité : des catégories aux rapports sociaux »3, elle invite à envisager non pas les « carrefours de dominations » mais les processus de fabrication de celles-ci.
Kergoat propose de différencier ce qui relève des rapports de pouvoir de ce qui relève des rapports sociaux. Selon elle, un rapport social se distingue par sa force d’exploiter, de dominer et d’oppresser, sur des bases matérielles. C’est donc aussi un rapport de pouvoir, mais tous les rapports de pouvoirs ne seraient pas des rapports sociaux. Elle explique que les rapports sociaux construisent des groupes antagoniques qui tissent un lien de contradiction entre eux : les femmes et les hommes, les ouvriers et les employeurs… En réalité, le rapport social produit des groupes contradictoires et ne s’appuie pas sur des groupes aux identités préexistantes. Par cela, Kergoat prend le contre-pied d’une tendance à l’essentialisation (« dominé’es parce que… ») et cible la production des tensions sociales qui traversent la société.
Le renouvellement qu’elle apporte réside surtout dans la notion de consubstantialité qu’elle utilise afin de comprendre les rapports sociaux dans leur entièreté. Elle souhaite par là se distinguer de la tendance à éclipser la classe, sans pour autant en faire la variable suprême dans les rapports sociaux. Elle conçoit néanmoins la classe comme un rapport social (donc produisant des groupes antagoniques) et non plus seulement comme un rapport de pouvoir comme un autre. Mais elle ne rejette pas pour autant l’analyse intersectionnelle puisqu’elle invoque ses aspirations et ses méthodes pour former son concept de consubstantialité : comprendre les imbrications des dominations ; penser le changement dans une visée de progrès social ; détruire les systèmes oppressifs. Elle rejette néanmoins le sujet intersectionnel : « [l’intersectionnalité] s’attache à détricoter les « méta récits » (le marxisme, l’universalisme, la sororité, etc.) en insistant non plus sur les rapports sociaux mais bien davantage sur les identités, les individus concrets, les « personnes » qui revendiquent leurs libertés. Elle se focalise sur les catégories qui subissent l’oppression plus que sur les structures qui les oppriment ». Pour autant, l’intersectionnalité reste pour elle une « boîte à outil » utile, en particulier pour les sciences juridiques, mais dont la sociologie et les militant’es doivent se garder d’utiliser dans la seule visée de construire des identités immuables qui ne reposent pas sur la matérialité. En clair, la consubstantialité, terme de parenté chrétienne, signifie l’unité de substance entre trois entités distinctes. Ainsi, ce concept engage que dans un seul mouvement « les rapports sociaux, bien que distincts, possèdent des propriétés communes – d’où l’emprunt du concept marxien de rapport social avec son contenu dialectique et matérialiste pour penser le sexe et la race; [et que] les rapports sociaux, bien que distincts, ne peuvent être compris séparément, sous peine de les réifier. »4 Mais la consubstantialité ne vient pas remplacer ni concurrencer l’intersectionnalité. Kergoat aspire surtout à ne pas réduire les rapports sociaux à une unique variable de la trinité classe-sexe-race, mais à faire dialoguer chacune d’elle afin de les comparer, puisque la classe, la « race » et le genre produisent de la domination matérielle et symbolique. Par exemple, la classe crée un rapport qui nourrit la domination de sexe. Pour Kergoat, les relations entre ces trois éléments se construisent mutuellement et se réarrangent continuellement. Il s’agit alors de comprendre les arrangements et les productions opérées, là où l’intersectionnalité préfère questionner les identités produites a posteriori chez les dominé’es.
Voilà ici un outil intéressant pour adresser une critique socialiste des dominations, sans occulter aucun élément, et surtout pas la classe qui a été éclipsée. Néanmoins la question de la stratégie reste en suspend. Florian Gulli propose lui un antiracisme socialiste, et c’est que nous allons aborder dès maintenant.
Défendre l’universel par un antiracisme socialiste, avec Florian Gulli.

La critique du glissement essentialiste que couvent certains discours se disant « intersectionnels » se prolonge chez le philosophe Florian Gulli, qui dans son livre « L’antiracisme trahi. Défense de l’universel » (PUF, 2023) détricote l’opposition (selon lui factice) entre luttes antiracistes, socialistes et universalistes. Professeur agrégé de philosophie dans le secondaire, militant au Parti communiste français (et soutien officiel de Fabien Roussel pour la présidentielle de 2022), Gulli souhaite prendre le contre-pied de ce qu’il nomme « l’antiracisme libéral » afin de s’orienter vers un « antiracisme socialiste ». Son titre provocateur (qui évoque la trahison, alors que son ouvrage souhaite rejeter ces discours de trahison sous-jacente) et son soutien à Fabien Roussel peuvent laisser penser que Florian Gulli est conservateur, mais son analyse et son attachement aux luttes antiracistes et socialistes dans un sens radical viennent infirmer ce préjugé. La colonne vertébrale de son livre se fonde dans son refus du « réductionnisme racial » et dans les liens qu’il tisse entre lutte antiraciste et lutte des classes.
Nous nous attarderons ici sur la troisième partie de son livre, qui interroge et esquisse la possibilité d’un antiracisme socialiste. Ces derniers chapitres reprennent le constat qu’il opère dans les deux précédentes parties du livre, ce qui nous permet alors de croiser ces éléments.
Contre la séparation des combats antiraciste et socialiste, Florian Gulli souhaite une jonction stratégique, et surtout coalisée en faveur d’un but commun : l’émancipation générale de tous et toutes. Il s’appuie sur les statuts de la Première internationale socialiste, qui en 1864 faisait son objectif celui de l’émancipation des travailleurs par eux-mêmes. Le terme d’émancipation a certes un sens économique, mais aussi politique – Gulli met en garde contre « l’économicisme » en citant Lénine, qui rappelait que le combat socialiste ne lutte pas contre réarrangement économique mais aussi institutionnel. En clair, « la lutte des classes est donc bien une lutte pour l’émancipation générale. La lutte contre « l’oppression policière » en est une dimension » (p.305). On devine donc que la lutte des classe n‘est pas pour Gulli qu’une question de travail, ou qu’un combat centré sur l’usine : il est global, général et s’inscrit dans des domaines divers. Il n’y aurait donc ni lutte première, ni lutte secondaire (contrairement à ce que des marxistes orthodoxes clamaient au siècle dernier). Néanmoins, Florian Gulli esquisse la possibilité d’une lutte antiraciste socialiste, seulement si l’antiracisme n’est pas cantonné qu’au seul rôle pédagogique ou éducatif. Pour lui, réclamer plus de représentation dans des structures, au cinéma, en politique, dans les entreprises, n’est pas à rejeter. Mais cela ne pose pas la question des structures et des institutions et de leur fonctionnement : ainsi l’antiracisme socialiste propose des réformes profondes des structures sociales plutôt que d'en appeler seulement à la conscientisation des individus (qui au lieu d’être renvoyés chacuns dans un camp d’oppresseurs deviennent aussi un moteur de la lutte, puisque rassemblés dans des coalitions, les individus voient dans la lutte socialiste un moyen d’anéantir le racisme). L’antiracisme socialiste est donc politique et pas seulement moral. Il se veut aussi populaire, Gulli souhaitant aller plus loin que les politiques de diversity management qui ne profitent qu’à des catégories réduites (les cadres, classes moyennes-supérieures…).
Alors, un horizon doit être tracé clairement pour que les couches populaires épousent cette « évolution révolutionnaire » antiraciste de la société. L’horizon d’une stricte égalité de tous et toutes devant la loi, et donc de l’égalité des droits et des devoirs entre chacun’e, est une piste. Ainsi, le cadre universaliste s’étend à ceux et celles qui sont exclus de celui-ci. Selon l’auteur, ce combat doit donc s’orienter vers l’extension de l’universalisme, qu’il voit comme un moyen d’être un individu égal d’un autre – au contraire des détracteurs de cette idée qui le qualifient « d’universalisme abstrait ». C’est dans son huitième chapitre qu’il loue la vertu abstraite de l’universalisme, comme conceptualisé pendant les Révolutions française (de 1789 ou 1848), ou encore celle de Saint-Domingue. Certes, à la Révolution française, l’égalité n’était pas accessible aux femmes ni aux Noirs. Mais il rappelle justement que concernant les Noirs des colonies, la bourgeoisie maritime a refusé d’appliquer les nouveaux droits et de garantir les droits du citoyen dans une visée qui manquait d’abstraction, et dans son seul intérêt (garder le pouvoir économique). De plus, Gulli refuse la relativisation des grands textes émancipateurs, qui ont été les moteurs mêmes de révolutions, notamment celle de Saint-Domingue (après 1791), où les esclaves se sont soulevés et ont aboli l’esclavage, en s’appuyant sur les idées révolutionnaires des droits de l’homme. En prolongement, si des entorses ont été fait à l'universalisme, c'est aussi dans l'intérêt matériel de groupes dominants, et contre des groupes qui y voyaient un dévoiement de l'égalité universelle. Néanmoins, Gulli concède que l’universalisme abstrait ne protège pas des discriminations, mais permet d’en faire leur critique, puisque les atteintes racistes sont un coup porté à l’idée même d’universalisme et d’universalité des droits et devoirs ; Il cite en exemple l’arbitraire policier : « L’arbitraire policier est un refus de faire abstraction des différences non pertinentes » (p.236), ici le phénotype, ce qui produit une catégorisation raciale. On le voit, pour Gulli l’antiracisme socialiste aspire à l’égalisation des droits de tous et toutes, et cela, indépendamment de la classe sociale, ou du phénotype, et de la catégorisation raciale. Dans une société de transition, les institutions ne devraient pas être perméables à la catégorisation raciale qui a lieu dans la société raciste, qui peu à peu est amenée à se déliter. Il pense que l’horizon universaliste et socialiste est une force pour se coaliser, à condition que les forces qui s’allient aspirent aussi à cet objectif d’égalité légale stricte. Il trace donc une limite avec certains courants religieux-militants qui certes, luttent contre leur stigmatisation, mais ne partagent pas un objectif d’égalité des droits pour toutes et tous (pour les femmes, les droits des personnes Lgbtq+…).
Florian Gulli appelle à redécouvrir les communs entre les classes populaires et les personnes qui sont catégorisées racialement. Ces dernières étant très représentées dans les couches populaires, pourquoi ne pas mettre la focale sur les similitudes sociales, en particulier celle de la domination du capital, les difficultés pour se loger, se nourrir, accéder au statut protecteur de salarié… ? Gulli n’efface pas la stigmatisation que peut vivre un ouvrier racisé, par le racisme institutionnel et routinier, mais il en appelle à la solidarité de classe, puisqu’elle est le moteur de la lutte contre les inégalités, et de reconnaissance mutuelle entre des personnes dominées objectivement. Il questionne : « Qui est plus proche de qui ? Qui est plus proche de l’ouvrier non blanc ? Le cadre non blanc ou l’ouvrier blanc ? » (p.310). Il existe une proximité indéniable entre les vécus stigmatisants des personnes racisées, mais la proximité entre ouvriers est sûrement plus forte, ne serait-ce que sur les plans des rapports à l’école, à la nourriture, au travail, ou à son corps. Dans le troisième chapitre de l’ouvrage il explique de manière plus détaillée cette idée. Il y distingue le groupe social et la classe sociale au travers du rapport subjectif ou objectif qu’ils entretiennent avec les individus : le groupe est davantage subjectif, la classe est davantage objective. La classe est aussi imbriquée dans une hiérarchie : plus on a de pouvoir-propriété (capitaux, terres, pouvoir matériel) et de pouvoir-savoir (diplômes, pouvoir de surveiller, d’organiser, de juger, de coordonner, de punir ou de guérir…) plus on a un rapport de pouvoir et de domination avec les moins pourvus. Alors, la hiérarchie de classe est-elle transposable sur celle des groupes sociaux ? – y a-t-il une classe des Blancs et des Non-Blancs ? Gulli note que dans la société esclavagiste étasunienne cette superposition aurait pu être sensée, mais que de nos jours, cela est plus complexe, notamment car les discriminations légales racistes ont été abolies. Aussi, en France les trajectoires des enfants d’immigrés ouvriers est proche de celle des enfants d’ouvriers natifs, selon l’enquête Trajectoire et Origine de 2008-2009. Aux États-Unis, une dynamique de départ des classes moyennes noires des centres-villes tend à rendre de nouveau pauvres ces territoires. Florian Gulli invite à ne pas fondre dans une supposée classe subalterne tous les non-Blancs, puisque des fractions des populations immigrées et leurs enfants, comme des personnes racisées sont bien intégrées dans la petite-bourgeoisie. Gulli conclut son chapitre en esquissant la problématique d’un « biais métropolitain », qui orienterait les conclusions sur des phénomènes sociaux. Les villes mondialisées et les métropoles sont en effet des concentrés d’inégalités et de tensions sociales, là où les périphéries et les marges sont autrement dessinées. Ainsi, la métropole ne peut être le reflet d’un contexte national, même si des éléments semblables se démarquent – encore faut-il comparer les similitudes selon l’espace.
Passé ce constat, en luttant pour des politiques universelles, en particulier liées à l’emploi, au logement, au « bien-vivre », toutes les personnes des couches populaires pourront en profiter. Gulli ajoute néanmoins que des revendications spécifiques sont nécessaires, ne serait-ce que pour rendre compte de la complexité des dominations. Toutefois, il insiste sur le besoin de s’appuyer aussi sur les dominations économiques afin de ne pas naturaliser les effets du système capitaliste (il cite le besoin de lutter contre les discriminations à l’embauche, mais aussi celui de lutter pour la création d‘emplois dignes). Cela, pour en finir avec la mise en concurrence des différentes fractions des classes populaires sur les plans moraux et symboliques (« beaufs » ; « immigrés » ;…). A l’inverse, Gulli propose de « ne pas considérer comme seulement spécifiques certains problèmes qui ne le sont que partiellement » (p.315). Il illustre son propos au travers de l’épineuse question des meurtres policiers perpétrés aux USA. En s’appuyant sur la base de données du Washington Post5, il tient à rappeler qu’être blanc n’immunise pas contre les balles de la police : aux USA, la moitié des personnes tuées ces dernières années par la police étaient blanches. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue la surreprésentation des Afro-américains dans le nombre des victimes de ces meurtres, malgré leur part relativement moindre dans la population totale. Toutefois, on peut recouper des variables intéressantes pour voir du commun dans ces expériences avec la police, puisque ce sont avant tout des personnes des classes populaires, en particulier des hommes (à 95%) qui ont entre 20 et 40 ans et/ou ayant des troubles psychologiques qui sont victimes. Cette réalité du contact meurtrier et violent avec la police mérite d’être politisée pour les classes populaires en général, avec ses spécificités, notamment celles qui découlent des catégorisations raciales. Par cet énoncé, Gulli accorde aux revendications communes un poids au moins équivalent aux revendications spécifiques, afin de créer des ponts de coalition - c'est pour lui le fondement de l'antiracisme socialiste.
Ces ponts se construisent par l’éducation, grand vecteur de changement. L’auteur promeut une « éducation socialiste à l’antiracisme », qui, par devoir de rationalité ne doit pas idéaliser l’histoire du pays (de la Nation, du peuple), et ne doit pas non plus polariser le monde entre l’Occident et les Autres, les personnes racisées et les Blancs… Cela afin de pas désunir les militant’es mais aussi pour, produire des repères mémoriels et historique communs, et complexes. En développant des mémoires simplistes, i y a surtout un risque de laisser les nationalistes produire un contre-discours aussi unilatéral et binaire, dans le but de créer une fierté à base raciste (p.317). Cette éducation passe aussi par un rejet du « racisme de l’intelligence » comme décrit par Bourdieu, soit les manifestations d’un mépris social contre ceux et celles qui sont éloigné'es de ces luttes – l’ouverture est donc de mise, malgré les difficultés de l'urgence. Cette ouverture se prolonge même dans l’idée internationaliste, puisque Gulli abonde que les organisations qui se réclament de l’antiracisme socialiste devraient se lier avec les organisations d’autres pays, en particulier ceux de la "Périphérie", en proie à l’impérialisme et aux désastres causés par des multinationales avides. En n’oubliant évidemment pas la défense de la liberté de circulation, à laquelle la question internationaliste ne peut néanmoins être réduite, au risque de faire l’impasse sur les conséquences politiques et économiques de l’impérialisme. Toutefois, cette ouverture conserve des limites, idéologiques et stratégiques. En particulier auprès des religieux militants, puisque l’auteur exclut à la fois le rejet en général de la religion et le soutien a-critique à l’une d’elle car stigmatisée (p.322). Il souhaite en réalité que les organisations aient des standards de soutien et qu’elles s’extraient d’une appréhension en bloc et essentialisante : il en appelle à l’établissement d’indications et de critères afin de valider des soutiens actifs (cette organisation souhaite-t-elle l’égalité entre les femmes et les hommes ? Combat-t-elle dans une visée uniquement religieuse ? A t-elle eu des discours ambiguës sur quelque sujet antiraciste, sur le combat contre l'antisémitisme ou le sexisme ?)
Son ouvrage se conclut sur la volonté de créer des organisations mixtes, et promouvant un « contact permanent » entre les militant’es, qu’importe leur couleur, leur origine et la catégorisation raciale vécue. Florian Gulli prend clairement position contre la non-mixité « raciale » dans les organisations, même si ces espaces sont temporaires (il semble pourtant accepter dans le cas de la non-mixité de genre). Il distingue en fait la stratégie féministe de non-mixité de la stratégie antiraciste – l’histoire de ces dominations et des mobilisations respectives n’étant pas les mêmes. Gulli espère surtout en finir avec le réductionnisme racial, comme il l’explique plus tôt dans son livre. Il avance ne pas comprendre le mouvement de segmentation les luttes et des organisations, qui se fondent sur la catégorisation raciale afin d'ouvrir des espaces (réduits) de mobilisation, puisque des rapports de domination peuvent être rejoués dans ces espaces, cette fois sur le fondement de la classe ou du pouvoir-savoir. Il propose à l’inverse une éthique du dialogue et une politique de formation active des militant’es, en particulier ceux et celles se sentant intimidé’es ou n’arrivant pas à parler en public. Cela, en se mettant un temps à l’écart des plus doté’es culturellement afin de ne pas reproduire l’écrasement précédent. Tout cela doit amener à une parité de participation plutôt qu’à un repli dans un groupe, qui n’a pas forcément de fondement démocratique dans une organisation politique, et qui pourrait faire pression sans aucun mandat interne. Néanmoins, Gulli ne rejette pas la non-mixité dans son acception de groupe de parole (mais ici ce serait plus un groupe de soutien voire thérapeutique qu'un collectif foncièrement politique).
Si la dernière partie de l’ouvrage de Florian Gulli est intéressante – en ce qu’elle donne des conseils stratégiques pour un antiracisme socialiste – elle n'est en revanche pas représentative de son livre en entier. Les deux premières parties retracent la généalogie de l’antiracisme politique et viennent mettre en discussion des concepts actuels, tels que le racisme institutionnel. Le titre de ce livre m’a interrogé puisque d’apparence conservatrice ou « anti-gauche » (l’auteur ayant été interviewé par des médias de droite à la parution de son livre). Certes, le titre est tapageur mais le livre est complet et très fourni. Il pousse à la complexité et à la discussion, ce qui semble nécessaire alors que des tensions se font de plus en plus ressentir, en particulier sur les thèmes du « privilège blanc » ou de la « race » dans les sciences sociales et le débat public. J’y ai surtout trouvé une remise en question très revendicative et argumentée de l’effacement de la classe chez des camarades antiracistes, remise en question qui s'appuie principalement sur des sources et des figures antiracistes. On peut en conclure que Florian Gulli en appelle à une réforme socialiste de l'antiracisme, et réciproquement, à une réforme antiraciste du socialisme, pour bâtir des coalitions populaires, portant à la fois des revendications communes aux couches populaires et des revendications spécifiques aux groupes minorisés de ces mêmes couches.
1Crenshaw, Kimberlé W. « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, vol. 39, no. 2, 2005, pp. 51-82.
2Granjon, Fabien. « Intersectionnalité, consubstantialité, dialectique », La Pensée, vol. 413, no. 1, 2023, pp. 97-108.
3Kergoat, Danièle. « Penser la complexité : des catégories aux rapports sociaux », La Pensée, vol. 407, no. 3, 2021, pp. 127-139.
4Galerand, Elsa et Danièle Kergoat. « Consubstantialité vs intersectionnalité? À propos de l’imbrication des rapports sociaux. » Nouvelles pratiques sociales, volume 26, numéro 2, printemps 2014, p. 44–61.
5Joe Fox, Adrian Blanco, Jennifer Jenkins, Julie Tate, Wesley Lowery, « What we’ve learned about police shootings 5 years after Ferguson », Washington Post, 9 août 2019. URL :https://www.washingtonpost.com/nation/2019/08/09/what-weve-learned-about-police-shootings-years-after-ferguson/?itid=sr

Agrandissement : Illustration 2