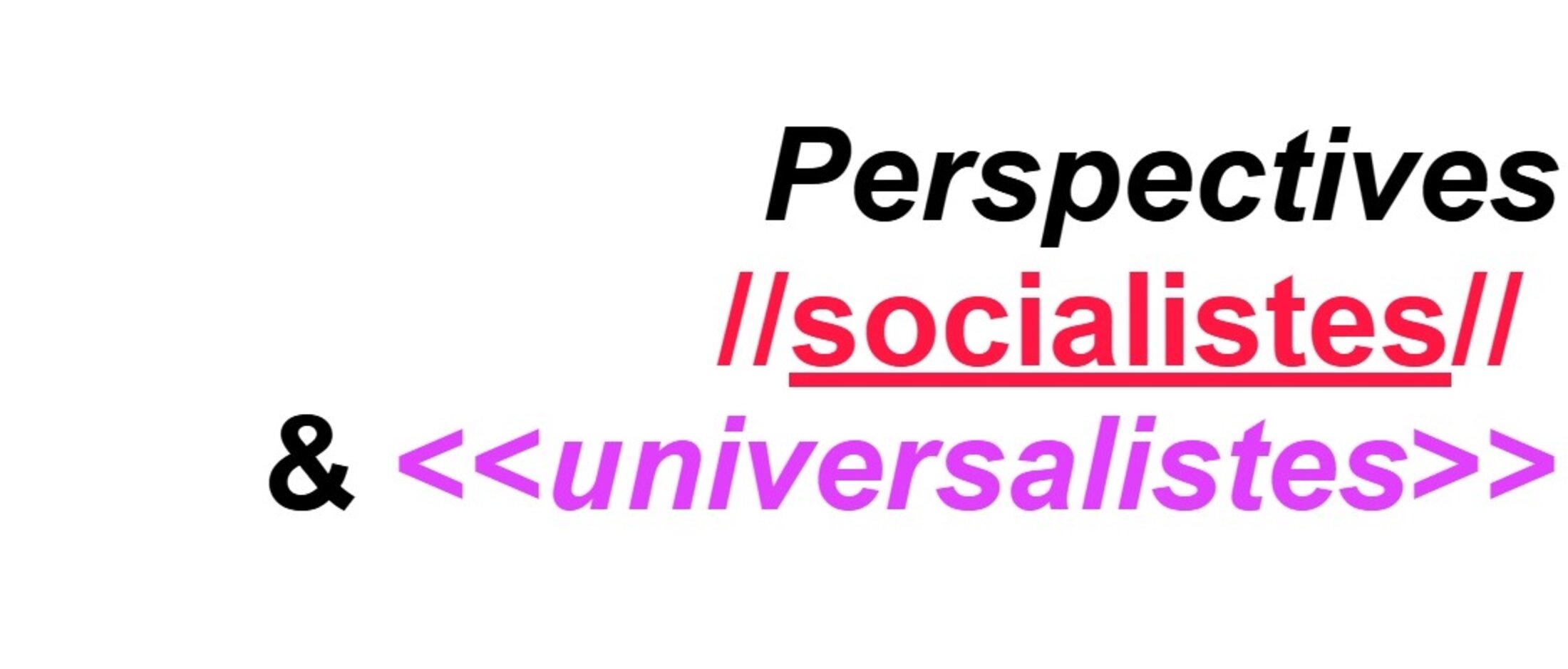I. La politique des affects, avec Eva Illouz.
Eva Illouz est sociologue, directrice de recherche à l’EHESS, et spécialiste des émotions, de leur instrumentalisation et de leur marchandisation. Elle est de gauche. Dans son livre « Les émotions contre la démocratie » (Premiers Parallèles,2022), elle revient sur la force du populisme (nationaliste) en Israël, et sur sa puissance d’occultation de la réalité. Elle décrit le « recodage » opéré par l’extrême droite israélienne pour que les électeurs assimilent la gauche (en particulier les travaillistes), les universitaires et des journalistes à une élite unifiée, qui ne se soucie pas de son pays et de son intégrité, mais qui se vend à l’international – et aux Arabes.
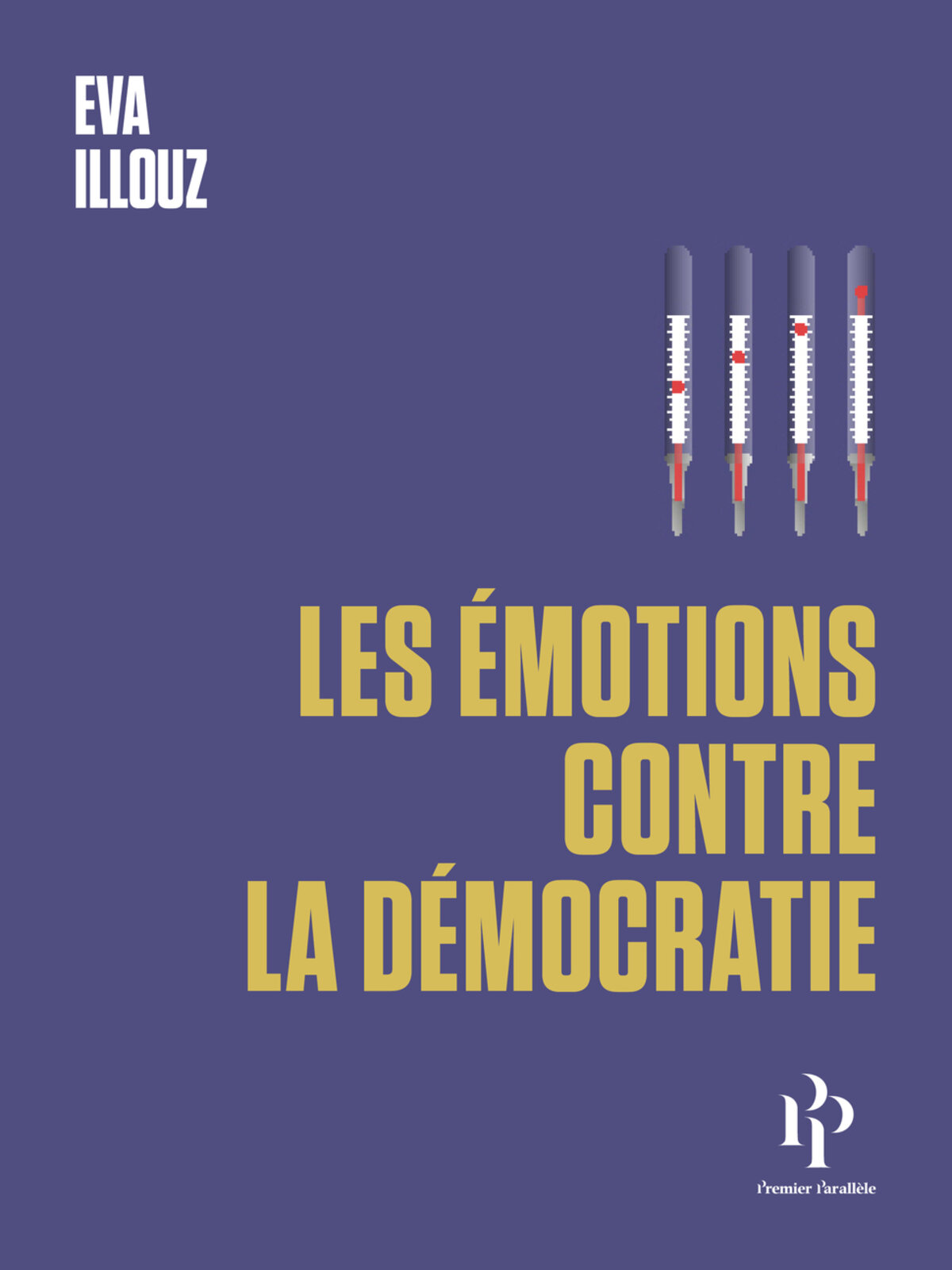
Agrandissement : Illustration 1
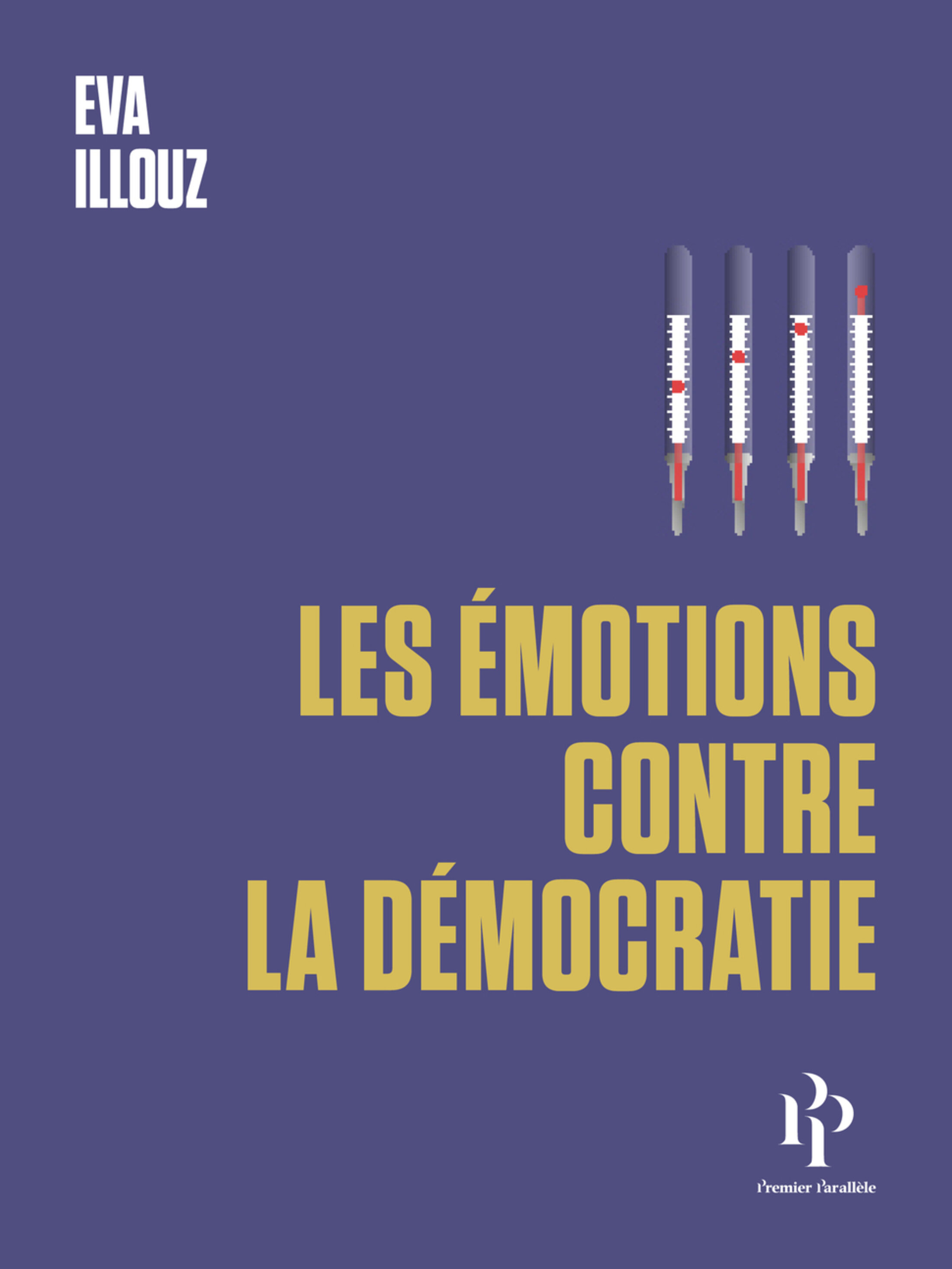
Ce recodage a mobilisé des affects négatifs, telles que la méfiance, la peur (qui est tangible et justifiée chez les Israéliens) mais aussi le sentiment d’appartenance religieuse. Eva Illouz décrit notamment la manière dont Netanyahu et ses alliés ont produit une interprétation religieuse du patriotisme, éloignée du patriotisme laïque des travaillistes qui ont fondé l’État hébreu. Les processus de paix, et la perspective d’une entente que la gauche a souhaité (et souhaite, de façon contrastée) avec les interlocuteurs régionaux sont assimilés à de la traîtrise envers l’État mais aussi envers les Juifs dans leur globalité (citoyens d’Israël ou non). Ainsi, Eva Illouz rappelle les mises en accusation d’être de « mauvais juifs » adressées aux partisans de la paix et aux tenants d’une interprétation séculaire de ce que sont Israël et ses symboles. En juillet 1995, Netanyahu était en tête de cortège d’une fausse procession funéraire de Yitzhak Rabin, premier ministre de centre-gauche de l’époque, où étaient scandés des « mort à Rabin!», alors même que les services de sécurité avaient prévenus le leader du Likoud qu’un assassinat contre le premier ministre était en préparation. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin se fait tirer dessus par Yigal Amir, un extrémiste religieux juif opposé aux processus de paix d’Oslo de 1993.
Autre exemple, celui de la dichotomie entre « élite ashkénaze » et les Mizrahi. Ce dernier groupe rassemble grossièrement, et en dépit des réalités diverses, les Juifs orientaux et du Maghreb, souvent arrivés récemment en Israël. En développant un discours et une mémoire contre une soi-disant arrière-garde ashkénaze, élitiste et tournée vers l’international, les nationalistes religieux du Shas sont parvenus à attirer des électeurs des classes populaires comme aisées, mais qui se sentaient discriminés ou avaient vécu des inégalités. Surtout, le Shas a utilisé l’auto-victimisation pour se faire apprécier, en créant un parallèle entre ses affaires judiciaires et les discriminations vécues par les Mizrahi. Arié Dér‘i, son leader, est condamné en 1999 pour corruption, et est alors engagé dans une campagne médiatique visant à dénoncer la gauche, les élites qui le persécutent. Netanyahu reprend cette stratégie et dénonce à la suite un establishment qui veut sa peau et qui le persécute (alors qu’il devient premier ministre et symbolise lui-même le « système »). Une stratégie semblable s’est retrouvée chez Trump. En mobilisant ces termes et en faisant transparaître des émotions telles que l’injustice et la colère, Netanyahu s’adressait aussi aux Mizrahi, qui avaient renforcé sa base électorale. Et il est vrai que ceux-ci sont discriminés sur les plans économiques et éducatifs ; comme le note E. Illouz :
« si les disparités salariales des deux groupes ont pu légèrement diminuer au fil du temps, des études ont montré […] que les enfants d’immigrés mizrahi ont encore […] 2,5 à 3 fois moins de chances [que les enfants immigrés ashkénazes] de faire des études universitaires. En 2012, dans les rangs de la population urbaine d’Israël, les immigrés de la deuxième génération d’origine mizrahi ne touchaient des salaires que légèrement supérieurs (9%) au salaire israélien moyen, alors que les immigrés de la deuxième génération d’origine ashkénaze touchaient des salaires supérieurs de 42 % au salaire israélien moyen » (p.72).
Mais si les Mizrahi ont en effet été marginalisés lors de la fondation et la pérennisation de l’État d’Israël, ils sont depuis plus d’une vingtaine d’années – bien – représentés (par le Shas et le Likoud) . Néanmoins, le discours politique à leur égard se cristallise sur la supposée domination politique au présent des Ashkénazes et n'engage pas de discours critique contre les inégalités économiques : ressasser l'inégalité de représentation passée est un crédo, l'aspect de classe est tu.
Toutefois, Eva Illouz note que des affects positifs sont mobilisés dans une perspective nationaliste, tant en Israël, qu’aux États-Unis d’Amérique, qu’en Pologne ou qu’en Hongrie. Elle cite particulièrement « l’amour de la patrie », qui, mêlé à une formulation religieuse et a-critique, en vient à fondre dans un ensemble contradictoire des groupes sociaux qui pourtant n’ont pas vraiment les mêmes intérêts. Elle pointe d’ailleurs la propension pour les électeurs de classe populaire d’intégrer le nationalisme et la critique de supposés « ennemis intérieurs » (ceux qui n'aiment pas leur pays), en particulier pour rehausser leur sort et créer un sentiment commun d’appartenance, national et/ou religieux. Netanyahu, en « entrepreneur du dégoût », fond même l’identité israélienne dans l’identité juive et la pratique de la religion – abandonnant ainsi la tradition laïque israélienne.
Néanmoins, Eva Illouz fait un constat grave de cette politique de l’identité, des affects et de l’accusation de traîtrise : dans un pays pourtant fondé sur la solidarité nationale (assurances sociales, redistribution, impôts progressifs), la fraternité est malmenée, et des groupes entiers opèrent une séparation entre « bons » et « mauvais » israéliens. Dans le même temps, la gauche ne reprend que des arguments moraux et ne défend ses principes qu’en réaction aux attaques, en mobilisant le lexique de la « blessure ». Dégradant le lien social et clivant le peuple dans une tension qui mêle dégoût de l’autre, ressentiment et méfiance vis-à-vis de la traîtrise, Illouz montre que la démocratie en ressort affaiblie : d’une part, une logique de contamination se met en place : les organisations et les individus se déclarant solidaires des minorités sont suspectés de traîtrise ou de ne pas aimer leur patrie ; d’autre part, l’instrumentalisation de l’identité par ces forces populistes et nationalistes fournit une légitimité et un socle permettant la révision de grands principes qui paraissaient bien installés. Les derniers événements en Israël, quasi-coup d’État institutionnel (la Knesset a voté la réforme des décisions de la Cour suprême, suspectée d’être trop politisée, elle ne pourra plus invalider la nomination "irraisonnable" d'une personne à un poste de ministre, et ses juges ne seront plus choisis par un collège d'avocats) sont à analyser en continuité de cette politique de l’identité nationaliste. Illouz pointe aussi les arrangements entre les gouvernements populistes et nationalistes, en dépit de la lutte contre l’antisémitisme : ainsi, l’extrême droite israélienne se tourne volontiers vers la Pologne et la Hongrie, pays dont les chefs de gouvernement ont tenus des propos antisémites ou ont participé à délégitimer la mémoire de l’Holocauste.
En conclusion, la chercheuse enjoint le lecteur, citoyen et attaché à l’égalité à rester vigilant face aux interprétations « paranoïdes de la société » (qui avancent qu’un « État profond » persécute les élites populistes). Eva Illouz propose que la société civile encourage un respect mutuel minimal, et que des dispositions émotionnelles allant dans le sens de la fraternité doivent être développées. En visant la « société décente », elle souhaite que la compassion et la fraternité soient des moteurs pour considérer « l’altérité radicale et la grande diversité des membres » de la société. De plus, elle souhaite prolonger la solidarité mais la sépare la fraternité : la solidarité (notamment redistributive) peut intervenir dans des sociétés individualistes (comme en France, en Israël ou en Suède), mais la fraternité, elle, n’est pas nécessairement issue de la solidarité, voire, doit en être séparée. Ainsi, la fraternité est fondée sur « une idée morale et impartiale de la justice entretenue dans la communauté politique » – c’est un devoir sacré, et sécularisé, qui amène à protéger les minorités des majorités dominantes et à accepter l’interdépendance des cultures contre l’isolationnisme. Pour Eva Illouz, « la fraternité est le sentiment qui transforme l’universalisme en affect. »
II. Néolibéralisme, populisme et grand ressentiment, avec Eric Fassin.
Les analyses d’Eva Illouz, bien que se concentrant sur le cas du populisme de droite nationaliste, peut outiller l’observateur politique pour critiquer le populisme en général, dont celui de gauche. Dans son essai paru en 2017 « Populisme : le grand ressentiment » de la collection de la Petite encyclopédie critique des éditions Textuel, Eric Fassin analyse la stratégie populiste de gauche, ses ressorts et ses difficultés à se rendre hégémonique, face à la droite populiste vorace et au potentiel dominant. Sociologue, passé par l’ENS et enseignant à l’Université Paris-8, Eric Fassin est classé dans la gauche radicale. S’il a parfois fait polémique sur les questions de la « race », son petit ouvrage sur le populisme de gauche est intéressant en ce qu’il prend le contre-pied de ceux qui voyaient dans la stratégie populiste un moyen d’unir les classes populaires – ceux qui croyaient au « moment populiste » en Europe.

Agrandissement : Illustration 2

Fassin fait d’abord le constat d’une inflation du terme « populiste » ces dernières années, qui définit des mouvements divers et parfois antagonistes, mais qui partagent des traits de familiarités absolument non-exclusifs : le Front National/Rassemblement National et la France insoumise en France, Syriza en Grèce, Alternative pour l’Allemagne (AfD), UKIP en Grande-Bretagne… « Populiste » est aussi un adjectif accolé à des dirigeants (autoritaires mais populaires) tels que Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, Donald Trump aux États-Unis ou Victor Orbán en Hongrie. Toutefois, définir le populisme reste difficile, et engage souvent une vision subjective de ce « concept » ou de cette stratégie. Pour remédier à cette incertitude, Eric Fassin s’appuie sur une décision de la Cour suprême étasunienne concernant la pornographie. En 1964, un de ses juges étant incapable de définir la pornographie de manière claire, a néanmoins consacré l’évaluation subjective de ce qu’elle est dans la phrase : « je la reconnais quand je la vois » (p.13). Fassin adopte cette ligne au long de son essai, et reste attentif aux discours d’exclusion qui suggèrent ou affirment qu’un « nous » se mobilise contre « eux ». Toutefois, il s’attache à rappeler au lecteur que « populiste » a été et est parfois encore un adjectif teinté de mépris pour disqualifier des électeurs, en particulier ceux des classes populaires. Il cite le philosophe Jacques Rancière (lui aussi de gauche radicale), qui dans une tribune de 2011 parue dans Libération1, expliquait que le terme de « populiste » adressé aux classes populaires renvoyait à une vision méprisante de ce qu’elles étaient réellement : à la manière d’un Gustave le Bon, on dépeint le peuple comme une masse brutale, hargneuse, et violente, et on psychologise ces traits pour rejeter leurs engagements politiques. Rancière ajoute que les nationalistes n’utilisent pas les passions racistes innées et les discours xénophobes inhérents des classes populaires, mais que les nationalistes eux-mêmes les diffusent du haut vers le bas de la société.
Eric Fassin fait un autre constat, celui de l’expansion de l’appropriation du label « populiste » depuis les années 2010. Cette réappropriation (cette fois positive) intervient en même temps qu’un « moment populiste » se dessine en Europe et en Amérique latine. Ce « moment populiste » est d’ailleurs espéré et appelé par des intellectuels de gauche qui entendent saisir le moment pour que la gauche infléchisse sa stratégie et remporte des suffrages. Chantal Mouffe, philosophe belge qui se qualifie de « post-marxiste » est l’une (sinon la) conceptrice d’un populisme de gauche. Proche de Jean-Luc Mélenchon, compagne d’Ernesto Laclau (décédé en 2014, philosophe argentin qui a démarré son engagement chez les péronistes), Mouffe renverse l’injure populiste et « retourne le stigmate » pour donner à la gauche une stratégie de conquête de l’électorat populaire. Contre la suspicion de racisme et de xénophobie inhérentes au populisme, elle préfère y voir un anti-élitisme et un sentiment d’injustice sociale partagé. Elle refuse ainsi d’abandonner la figure du « peuple » à l’extrême droite… au risque de brouiller le clivage binaire et traditionnel entre la gauche et la droite. Voire en ne luttant plus officiellement contre la droite mais contre « eux », les élites, figure indistinguable et cristallisée dans un objectif politique commun : nuire au « nous ».
Toutefois, Fassin fait remarquer que le populisme de gauche se pose comme objectif de « construire le peuple », contre le néolibéralisme considéré comme un « dépeupleur », marginalisant et réduisant la société à des agrégats d’individus. D’ailleurs, Mouffe aperçoit une dépolitisation du peuple dans le pseudo-consensus néolibéral, qui s’instigue au tournant des années 90 : de la droite conservatrice aux sociaux-démocrates, le néolibéralisme apparaît comme inévitable voire souhaitable pour faire dialoguer la société. Néanmoins, le néolibéralisme apparaît lui-même comme indiscutable, si bien que le sens de l’histoire va avec lui. Fassin cite la politiste de gauche et étasunienne Wendy Brown (université de Berkeley), qui après les attentats du 11 septembre 2001 s’inquiète de la menace des Républicains vis-à-vis des libertés publiques mais aussi de l’adéquation des néo-conservateurs avec l’économicisme néolibéral. Pour elle, la morale néoconservatrice ne s’aliène pas les néolibéraux sur le plan économique. Si bien que « l’économicisme » (ou la marchandisation de tous les domaines de la vie) devienne une caractéristique intime aux humains, au travers des notions de « capital humain » ou alors de reconnaissance sociale rationalisée dans des domaines divers (affection, sexualité, connaissances personnelles…). Cette rationalisation néolibérale atomise et met en concurrence les individus de la société, ce qui déstructure les potentiels politiques des mouvements et leur création même. Cette dépolitisation débouche sur ce qu’elle nomme une « dé-démocratisation » : le marché tord le cou aux volontés de participation et de reconnaissance politique des individus. Cependant, cela ne sonnerait pas le glas de la politique, puisque ce mouvement de dépolitisation instigue lui-même une binarité entre « eux » et « nous » – l’autre renvoyant à tous ceux et celles qui ne s’engagent pas dans cette atomisation où n’y sont pas encore arrivé (Fassin y voit un lien avec le retour de la thématique du conflit des civilisations après 1989). Dans ce prolongement, le néolibéralisme n’est pas toujours corollaire de « libéralisation politique ».
A cet égard, la quatrième partie de son essai est consacrée aux « coups d’État démocratiques », savoir, les dispositions autoritaires ou les renversements d’un ordre politique dans une visée de mise à l’ordre et de libéralisation économique. Il cite les dispositions de l’État d’urgence votées en 2016, concomitantes des utilisations de l’article 43.-3 de la Constitution dans le cadre des débats sur la loi Travail (El Khomri), régression sociale au vu de notre histoire du droit du Travail en France et par le pouvoir que ces réformes confèrent au Capital. Certes « cette manière de contourner le parlement est constitutionnelle », mais il n’en est pas moins que celle-ci constitue une poussée illibérale (elle se fait contre les parlementaires et les mouvements sociaux engagés contre) et antisociale. Alors une confusion s’installe quand le néolibéralisme s’immisce, ces exemples venant renettre en cause son apparat de démocratisation. La force de ce dé-peupleur provient aussi de son rapport avec le nationalisme. Certes, des libéraux rejettent ce qui se rapproche explicitement du nationalisme (les marcheurs attaquent souvent le RN pour cela). Mais dans le même temps, des tenants du néolibéralisme utilisent la xénophobie afin de renforcer des sentiments particularistes nationaux. Fassin utilise l’exemple de Nicolas Sarkozy, libéral économiquement mais pas loin d’être franchement nationaliste. L’État-nation n’est donc pas un point de résistance contre la « globalisation », mais une variété de tout un panel d’État-nation qui ont aussi une identité culturelle particulariste. Néanmoins, tous ces États se lient par des échanges économiques libéralisés2. L’État-nation qui s’universalise s’invite même chez les islamistes, qui se sont convertis à cette idée en dépit de leur idéal d’umma réunifiée, et acceptent même l’économie de marché (p.41). En somme, pour Jean-François Bayart : « le national-libéralisme, c’est le libéralisme pour les riches, et le nationalisme pour les pauvres »
L’aspect religieux du nationalisme n’est pas non plus exclu par les nationaux-libéraux, les exemples de Trump, Netanyahu (E.Illouz) et Erdoğan vont dans ce sens : ils fondent l’identité nationale dans une essence religieuse présumée. L’expression favorite du député et président des Républicains Eric Ciotti de civilisation « judéo-chrétienne » pour désigner la France est très sûrement à lire dans ce sens – les Républicains n’étant pas contre le libéralisme économique. Enfin, l’aspect de classe, l’ethnie et la religion semblent être des variables à prendre en compte dans la construction et l’analyse d’une base électorale populiste3. Eric Fassin note que les pauvres n’ont pas majoritairement voté pour Trump en 2016 bien qu’ils se distancient de Hillary Clinton (il faut de même rappeler que cette élection n’a mobilisé que 55 % de l’électorat étasunien). Surtout, la majorité d’électeurs de Trump provient des couches de revenus moyennes, moyennes-supérieures et supérieures, même si les personnes qui n’ont pas ou peu étudié sont surreprésentées lorsqu’on observe le facteur d’éducation. Les protestants et les religieux pratiquant un rite au moins une fois par semaine sont aussi bien représentés dans l’électorat de Trump. En prenant en considération l’ethnie et le sexe, on remarque néanmoins que les Blancs et les hommes votent majoritairement pour Trump et que les Latino/Hispaniques et les Asiatiques ne rejettent pas Trump comme les Noirs le font, à plus de 88 %. Ces derniers votent d’ailleurs 1,7 fois plus que les Blancs d’après Fassin. L'auteur cite un autre exemple d’instrumentalisation populiste de la classe : le vote FN aux régionales de 2015 chez les ouvriers. Nonna Mayer parle alors d’« ouvriéro-lepénisme » pour qualifier ces 52 % d’ouvriers ayant voté pour le FN contre 20 % dans les catégories supérieures – pour 50 % d’abstention en général. Néanmoins, la grande attention médiatique à propos du vote des classes populaires produit un discours qui dépeint cet électorat comme catégoriquement xénophobe et fermé sur le monde. Toutefois, et comme Fassin l’affirme, se porter sur l’abstention des classes populaires peut être une stratégie envisageable, surtout que cette abstention est plurielle et engage des variables multiples (géographiques, d’âge, d’éducation, d’origine…) et des significations politiques multiples. Eric Fassin en appelle donc à prendre en compte la « démocratie de l’abstention » et à ne pas réduire les classes populaires au vote, et surtout au vote populiste.
Le populisme détient néanmoins cette force d’unification, qui agrège dans ses mouvements (de droite et de gauche) des alliances qui peuvent sembler improductives : le salarié et le cadre qui critiquent l’État et ses mécanismes sociaux ; le petit patron et le chômeur qui rejettent quelconque politique d’accueil des exilés… Ce potentiel d’alliance découle aussi du fait de la réappropriation de symboles nationaux et populaires (Fassin souligne la parenté de cette stratégie avec Gramsci). Ainsi, il ne semble pas décalé que LFI ait adopté le drapeau national et l’ait adapté à son objectif, alors que des forces de gauche radicale décident de ne pas le brandir du fait de son instrumentalisation nationaliste. Toutefois, le symbole ne porte pas toujours qu’une seule définition, et ce que voit Jean-Luc Mélenchon dans le drapeau national, tous ses électeurs ne le voient pas à l'identique, voire le nient. De plus, cette politique des symboles est une stratégie ardue puisqu’elle est déjà monopolisée par des significations nationalistes, conservatrices ou bien éloignées de toute critique de la patrie et de son histoire (on ne retrouve pas de critique constructive de l’histoire nationale). Confinée à l’État-Nation, cette stratégie ne s’étend pas à un objectif européen ou transnational malgré des essais (DiEM25 de Yanis Varoufakis par exemple) et débouche sur un ressentiment diffus auprès de ses sympathisants contre « l’oligarchie » (souvent européenne, aussi mondiale), qui bloque la volonté d’un seul peuple particulier, ou de plusieurs peuples désarticulés dans leurs luttes. Ce grand ressentiment est le pétrole des nationalistes et des xénophobes. L’adapter à un objectif de gauche est délicat et suggère d’adapter un ressentiment motivé par le nationalisme à un ressentiment motivé par l’injustice sociale. Les « dérapages » peuvent y être nombreux, comme l’illustrent les nombreuses théories qui voudraient qu’un complot orchestré par des banquiers utilise nos institutions pour liquider la souveraineté nationale. Ces thèses et ces discours dirigés contre une « oligarchie » (ce « eux », puissances d’argent élaborant des stratégies pour défaire la société) alimentent un imaginaire antisémite, malgré la discrétion de ses références et l’affirmation de ne pas y voir de l’antisémitisme mais une critique sociale constructive et non dirigée ; voire, on se targue de ne pas haïr les Juifs activement. Cela se retrouve à l’extrême droite (les « mondialistes », « cosmopolites », cristallisés dans la figure de George Soros ou la famille de Rothschild) et à gauche (selon le précepte « à gauche, pas d’antisémitisme, que de la critique sociale », et souvent par l’assimilation de la critique de l’antisémitisme de gauche avec volonté de nuire à la gauche4).
On le voit, le populisme est une stratégie à angles morts, qu’Eric Fassin décrit dans son essai. Néanmoins, il clôt sa réflexion en appelant à construire un programme substantiel de gauche, qui au lieu de s’attacher à « construire un peuple » doit d’abord se construire elle-même, avec ses aspirations et la direction qu’elle souhaite emprunter, en emmenant avec elle les abstentionnistes.
III. Construire une gauche par la fraternité universelle.
Eva Illouz et Eric Fassin décrivent des phénomènes qui nous interrogent sur les plans stratégiques et sociaux. Il et elle proposent de reconstruire un dialogue et une éthique de gauche, mettant l’accent sur l’autre, tout en éloignant la perspective populiste. Illouz comme Fassin rendent compte de la force des affects dans la mobilisation politique. Le ressentiment est improductif même s’il peut être moteur de quelque chose, encore faut-il allier le ressentiment avec d’autres émotions afin qu'il devienne productif. Néanmoins, Illouz met l’accent sur l’universalisme et la fraternité, cependant que Fassin reste discret sur les affects et la morale concurrentes du populisme, si ce n’est qu’il souhaite que le dégoût électoral se transforme en goût pour la politique. Nos deux auteur’ices mettent toutefois en évidence la propension nationaliste à la fragmentation sociale, et l’adaptation du néolibéralisme aux nationalismes particuliers.
Pour prolonger ces réflexions sur la fraternité universelle, nous aborderons dans le second billet de la série la question de l'accueil des réfugié'es et des exilé'es, en nous appuyant sur le petit essai "On ne peut pas accueillir toute la misère du monde". En finir avec une sentence de mort (Ed.Anamosa, 2022) du philosophe Pierre Tevanian et du juriste Jean-Charles Stevens. Dans ce même épisode, nous nous arrêterons sur la laïcité, son objectif et l'esprit qu'elle renferme, au travers des travaux de Patrick Weil et de Nicolas Cadène.
1Jacques Rancière, « Non, le peuple n’est pas une masse brutale et ignorante », Libération, 3 janvier 2011.
2Jean-François Bayart, L’impasse nationale-libérale, Globalisation et repli identitaire, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2017, 229 p.
3Les statistiques de sortie d’urnes (échantillon de 24.537 votants) à l’élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis sont disponibles à cette adresse : https://archive.is/20221104114901/https://www.nytimes.com/interactive/2016/11/08/us/politics/election-exit-polls.html#selection-1459.0-1459.25
4Olia Maruani, Quelques réflexions sur l’antisémitisme et son déni à la France Insoumise, 7 février 2022, Golema. URL : http://golema.net/analyses/quelques-reflexions-sur-lantisemitisme-et-son-deni-a-la-france-insoumise/

Agrandissement : Illustration 3