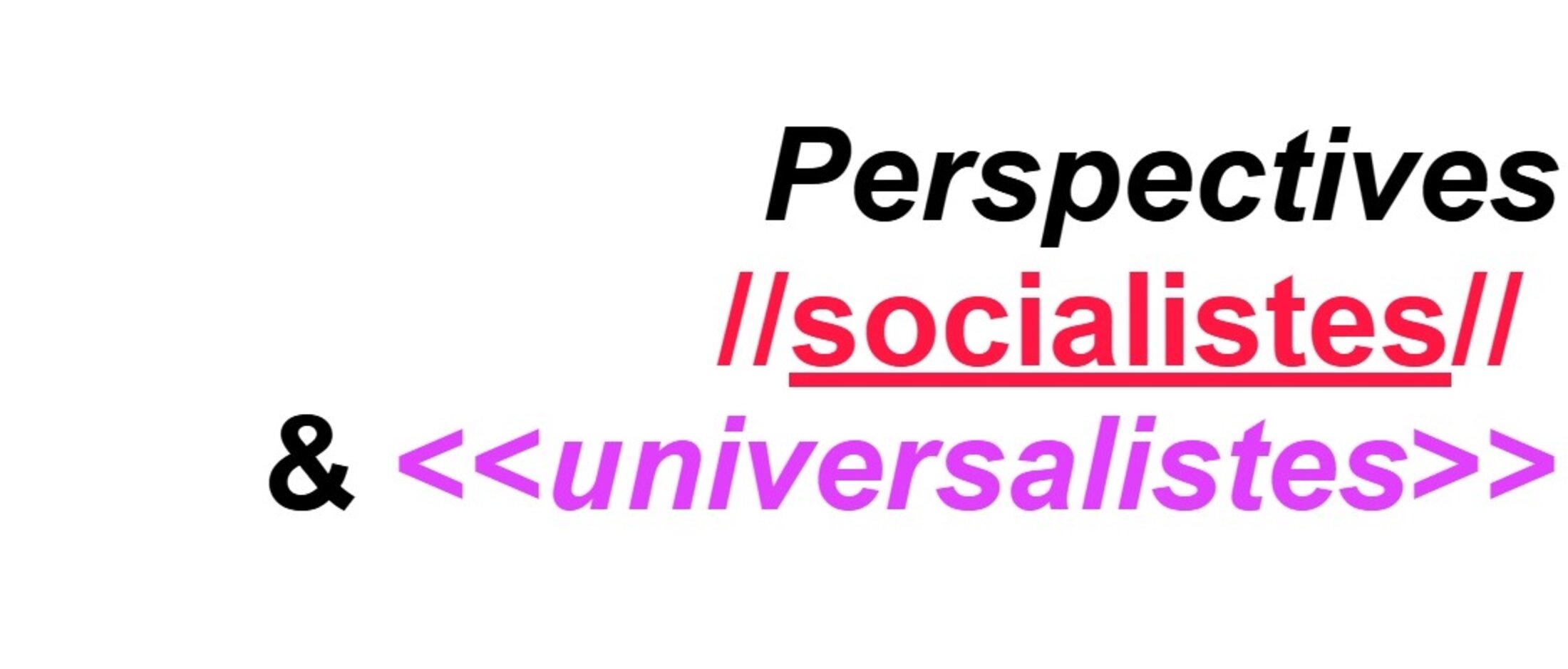Nulle causalité ne doit être vue dans le titre de ce billet, si ce n’est que la fraternité et l’universalisme peuvent être des réponses face à la décrédibilisation de la laïcité et au refus mortifère de l’accueil des exilé’es. L’accueil et la laïcité renferment toutes les deux des problématiques – et des réponses – liées à la question sociale et à la fraternité.
En finir avec une sentence de mort, avec Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens.
Pierre Tevanian est philosophe, Jean-Charles Stevens est juriste. Ces deux hommes sont engagés pour les droits des personnes exilées et pour leur accueil en Europe et en France. Dans leur court ouvrage « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». En finir avec une sentence de mort (Ed.Anamosa, 2022), nos deux auteurs souhaitent casser ce quasi-proverbe, à l’époque prononcé par le premier ministre de centre gauche Michel Rocard, dans le but de faire vivre une « certaine idée de la citoyenneté, de l’hospitalité, de la solidarité, de l’égalité et de la justice », elle-même muée par la « sympathie pour des frères et sœurs humains ».
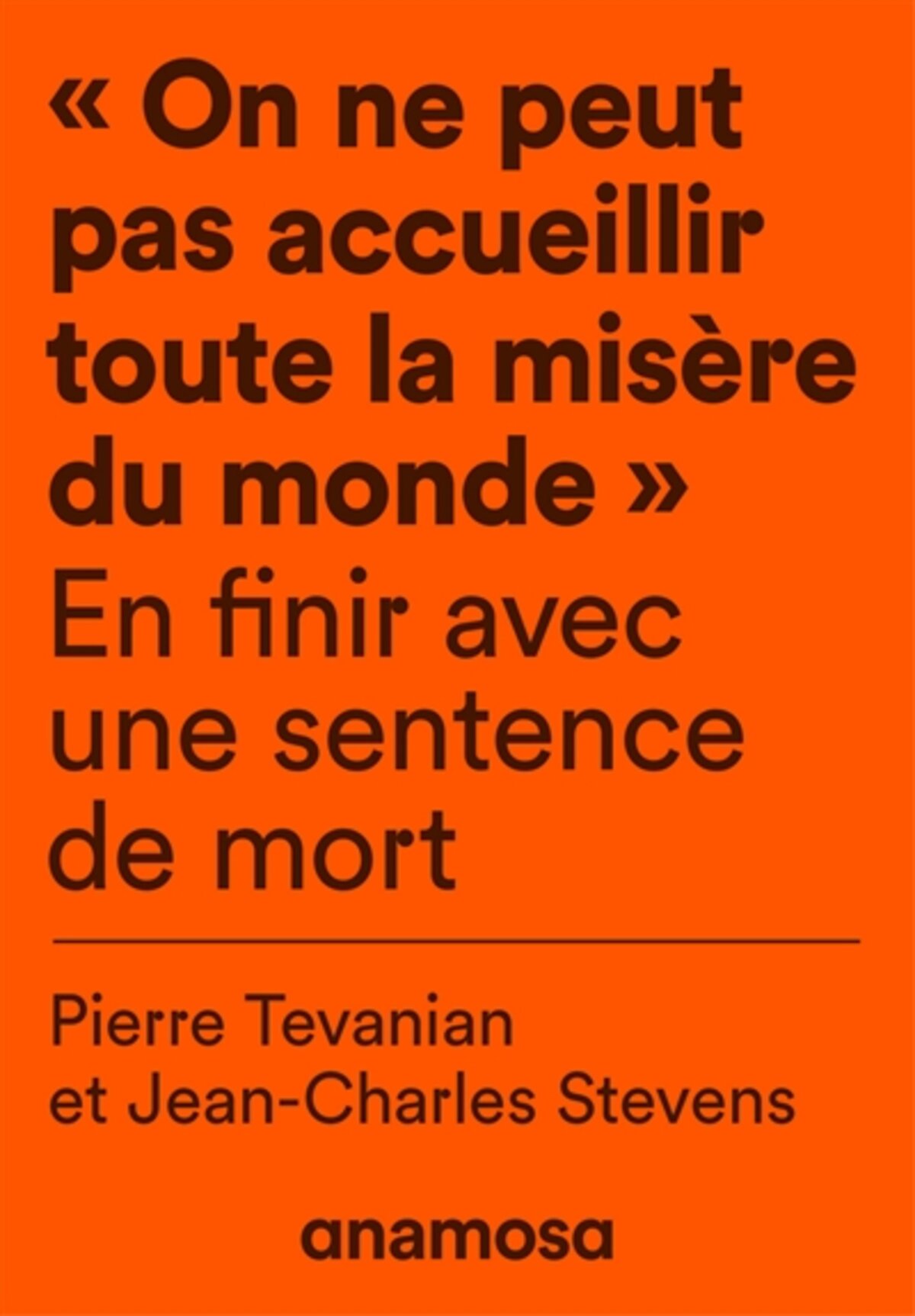
Prenant les morceaux de cette phrase-couperet, les deux auteurs analysent sa puissance, tout en montrant son caractère intolérable et contraire aux principes fondamentaux que la France et ses citoyens portent normalement. Au « On », ils opposent le « je » du locuteur ; au « ne peut pas », ils lisent l’absence de volonté et le manque de courage politique ; à « toute » ils amènent que la prise en charge et l’accueil des exilé’es est partagée au niveau mondial, mais inégalitaire, et qu’elle affecte d’abord les autres villes des pays concernés par des départs (55 % des 45,9 millions de personnes en migration en 2020 selon le haut commissariat aux réfugiés), puis les pays frontaliers (73 % des 36,5 millions des exilés à l’extérieur de leur pays), puis d’autres puissances, en particulier celles en développement ; à la « misère » ils opposent une relecture fine, et indiquent que les « couches moyennes » sont bien représentées dans les migrations, en dépit du déficit de qualification comparé à celles des « autochtones ». Ces personnes souvent qualifiées dans leur pays ne peuvent prétendre à des emplois équivalents en France, du fait de discriminations légales qui forment une barrière à l’emploi. A cet égard, l’article « Quels sont les métiers interdits aux étrangers ? » publié sur le site du Palais de la Porte dorée (musée national de l’histoire de l’immigration) mentionne que :
« au total, quelques 5 372 millions d’emplois sont fermés aux étrangers dont 4 289 millions au titre de fonctionnaires et statuts dérivés (1 335 au titre de l’administration de l'État et 1 466 pour les collectivités territoriales) et 1 083 d’emplois dans le secteur privé. »
On le comprend donc, une partie de ces nouveaux arrivants est destinée à changer de catégorie socioprofessionnelle, voire de classe sociale. Le titre de séjour pour travailler n’étant délivré que si le secteur visé manque de main d’œuvre. Sur le thème de l’emploi, Tevanian et Stevens prolongent le tableau des inégalités. Ils rappellent ainsi l’existence de cette main d’œuvre mobilisée par des patrons, sans contrat de travail et sans protections afférentes, puisque les règles interdisent aux « sans-papiers » (donc sans titre de séjour) de travailler légalement – c’est une production de la misère, en somme. Et à cette interdiction d’intégrer un emploi formel et réglementé, s’ajoute un éloignement quasi-méthodique des dispositifs d’aide sociale et monétaire (l’éligibilité au RSA est contrainte à 5 ans de séjour régulier sur le territoire et à une autorisation de travailler ; l’allocation d’Aide aux Personnes Agées n’est réservée qu’aux réfugiés et aux titulaires d’une carte de séjour courant 10 ans… mais à condition de rester 180 jours par an sur le territoire, etc.)
Contre les mythes infamants qui donnent une représentation injuste et xénophobe de l’accueil des exilé’es, Tevanian et Stevens concluent leur livre par un « Pour l’hospitalité » qui replace les préjugés contre les personnes en migration dans un mouvement plus large (les préjugés ne naissent pas et ne se perpétuent pas sans stimulation). Ils lient la peur et la haine des exilé’es avec le racisme individuel et institutionnel – dans ce dernier cas, ils désignent le dédale administratif que la reconnaissance de son statut de réfugié est en France, les inégalités en matière de santé et d’exposition aux risques sanitaires, l’enfermement administratif. Néanmoins le qualificatif de racisme ne semble pas mesuré à la question de la nationalité et de la fabrique du risque de la misère et de sa « contamination » (en ce sens le terme « apartheid » qui est utilisé est inapproprié). Toutefois, on comprend que les dispositifs destinés au contrôle et à la surveillance des personnes en migration révèlent quelque chose de plus profond qu’un besoin de traçabilité. Gérard Noiriel (historien, de gauche, engagé auprès des exilé’es) parle de « tyrannie du national » dans son ouvrage éponyme1. Selon lui, l’universalisation d’un droit commun et l’égalisation devant la loi qui a été opérée après 1848 (suffrage universel masculin) et pendant le dernier tiers du XIXe siècle a nécessité de se tourner vers un autre afin de distinguer ce qui relevait du national et de l’étranger. Cela, dans une visée universaliste mais strictement nationale (les États réorganisant la culture et les autorités des territoires qu'ils administrent afin de rendre culturellement cohérents leurs sujets). Il note qu’avec les évolutions du droit international (notamment la Convention de Genève de 1951), la focale est mise sur les « vrais réfugiés ». Leur identification se fonde alors sur des documents institutionnels justifiant leur nationalité d’origine et de leur appartenance sociale. S’y ajoutent des dispositifs d’encartement pour être reconnus institutionnellement comme de vrais réfugiés, ce qui a pu et cause toujours des difficultés afin de distinguer le faux réfugié du vrai.
Par leur appel et leur analyse fine, Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens éveillent le lecteur à une injustice de taille, qui viole toute morale universaliste et les conventions internationales (en particulier l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits Humains), et met à mal la fraternité.
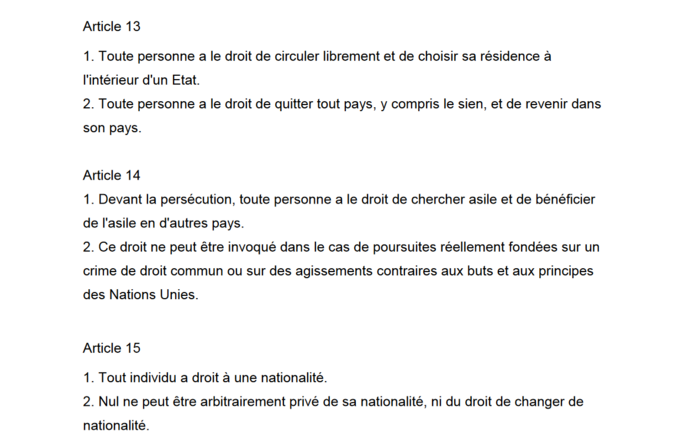
Agrandissement : Illustration 2
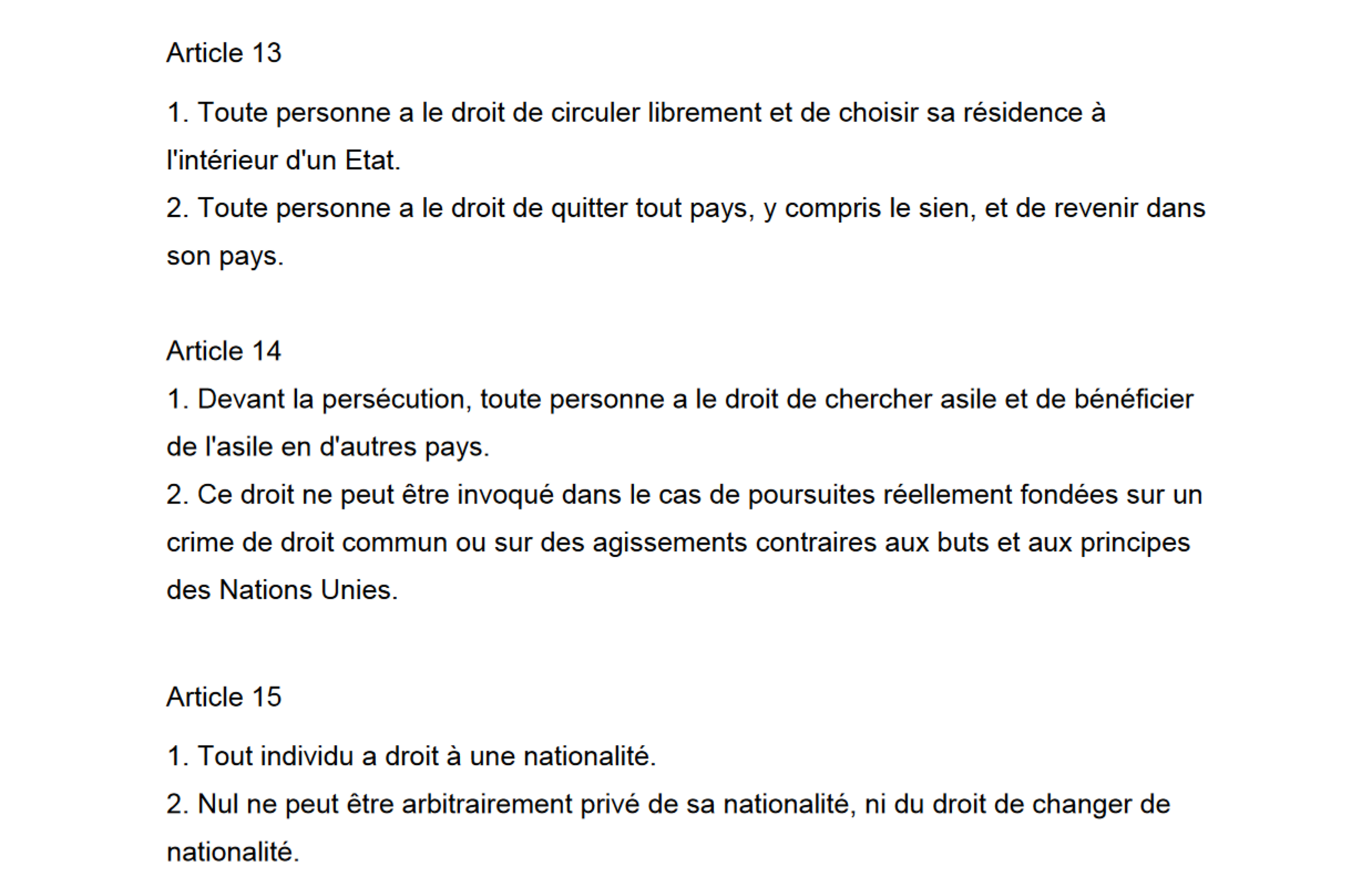
En reniant cette part d’humanité commune aux exilé’es, peut-être est-ce une détestation de cette part-là qui se manifeste. Lorsqu’il n’y a pas de négation, il y a des silences, qui rendent encore plus étanche le corps des nationaux avec celui des non-natifs. Hors des considérations morales, ils notent que la France a les moyens matériels et humains pour aider les exilé’es dans ce parcours, que la France soit le lieu d’un passage ou une terre d’installation (je souligne). Néanmoins, ils visent aussi le manque de courage politique – très probablement motivé par les discours sur l’insécurité soi-disant liée aux migrations dans notre pays. Ceux-ci sont motivés par des affects de rejet et de peur contre les personnes en migration, en dépit de violences dont des natifs français sont auteurs2. Une politique socialiste et fraternelle doit garder à l’esprit les dominations économiques et institutionnelles auxquelles sont sujettes les personnes en migrations. L’universalisme égalitaire ne peut se circonscrire à un corps détenteur d’une carte d’identité et doit considérer l’inégalité nationale comme une rupture.
Revivifier la laïcité, avec Patrick Weil et Nicolas Cadène.
S’il est une loi très égalitaire, c’est la loi du 9 décembre 1905, qui ordonne la séparation des Églises et de l’État, et qui universalise la neutralité des relations que les pouvoirs publics entretiennent avec les administrés et la société civile. Le juriste Nicolas Cadène et l’historien Patrick Weil reviennent sur la définition de cette loi et ses implications politiques et historiques dans leurs ouvrages respectifs.
Avec « En finir avec les idées fausses sur la laïcité » (Ed. De l’Atelier,2023), Nicolas Cadène entend amener le lecteur à se « réapproprier la laïcité telle que définie par le droit et notre histoire », en balayant les idées reçues et les confusions. Ce livre très pédagogique permet à tout un chacun de percevoir les mécanismes et les liens que tisse la laïcité avec l’égalité, la question sociale mais surtout avec la liberté de conscience. En 95 points, il explique clairement comment la laïcité s’applique selon les espaces, quelle est son histoire avant et après 1905, son rapport avec telle religion… Il opère aussi un retour sur les notions d’ordre public, et explore d’autres prolongements de la laïcité (son lien avec les droits des femme et la mixité…) Ne s’en tenant qu’au droit, Nicolas Cadène diffuse une interprétation classique de la laïcité – qui est en fait celle de la loi de 1905 – et prend le contre-pied d’affirmations polémiques, qui sont parfois à l’opposé de ce qu’est réellement la laïcité.
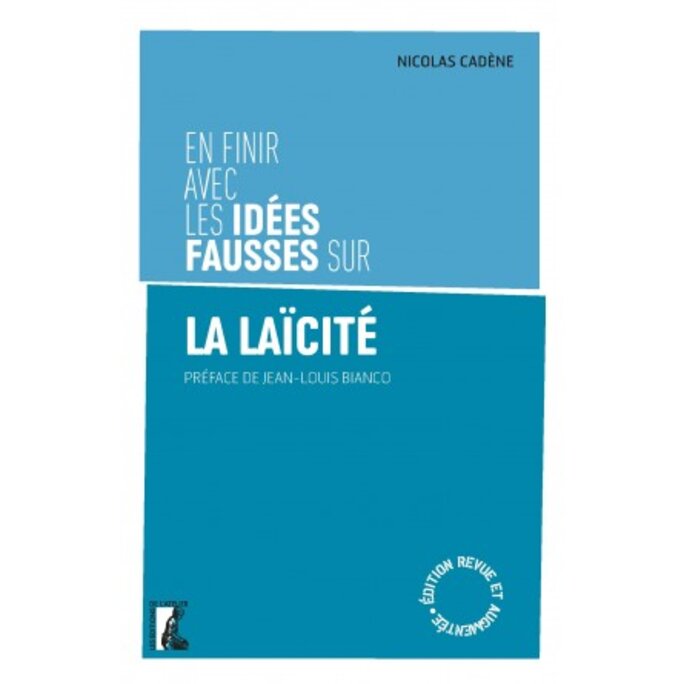
Ainsi, il répond aux affirmations suivantes : « la laïcité cantonne la religion à la sphère privée » (p.21) ; « la laïcité est d’abord une valeur » (p.37) « la laïcité est contre les religions » (p.83) ; « la laïcité est contre les musulman·e·s » (p.84) ; etc. Même si Nicolas Cadène se situe à gauche (longtemps proche du Parti Socialiste et de Ségolène Royal, candidat d’ouverture EE-LV aux législatives de 2022 pour la Nupes), son livre ne s’adresse pas qu’aux mauvais interprètes conservateurs. Il vise un public large, et son « petit manuel » mériterait d’être diffusé à gauche. Notamment pour éviter les confusions, en particulier celles qui découlent des dispositions liées aux enfants scolarisés à l’école publique. Certains avancent qu’elles relèveraient d’une politique antimusulmane – citons en particulier l’interdiction des signes ostensibles (donc à la vue de tous et toutes) dans les écoles publiques depuis la loi du 15 mars 2004 qui a fait débat. Néanmoins, reconnaître qu’à l’école les enfants apprennent à mesurer et à formuler des réflexions, et que leur discernement peut être perturbé par des pressions venant d’autres élèves, notamment via un signe, cela n’est pas diriger des dispositions contre une quelconque communauté de croyant’es (que la laïcité protège), même si cette loi intervient dans un moment critique et violent pour les musulman’es de France. Surtout, il faut y voir un moyen pour les enfants de se forger une opinion et une critique sur des idées qui les entourent, dans un cadre laïque (donc tendant vers la neutralité face aux influences religieuses et philosophiques), afin qu’ils et elles choisissent, quittent ou ne considèrent pas de religion. C’est ce que permet la laïcité. Néanmoins, Cadène s’attache à rappeler que certaines dispositions légales ne sont pas du tout liées à la laïcité et que lier celle-ci à des lois ne s’y référant pas peut être une instrumentalisation médiatique. Il cite l’exemple de la loi « anti-burqa » de du 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage dans l’espace public, pour des raisons de sécurité publique et d’interaction sociale. Même si on veut en faire une interprétation laïque (ce que je soutiens), cette loi visait au départ le port de voiles intégraux, mais elle s’est étendu aux masques, aux cagoules et aux éléments couvrant le visage, portés dans l’espace public (espace où chacun se rencontre). Mais il est vrai que cette loi a aussi vocation à ne pas laisser la burqa se diffuser en France (ce que Cadène tait, afin de rester le plus concis possible). Cette forme de voilement étant très souvent liée à une pratique religieuse ultra-orthodoxe et qui prescrit des règles d’isolement féminin et d’évitement des hommes.
Ainsi, Nicolas Cadène offre au lecteur une base pour comprendre la laïcité en effets, et l’égalité qu’elle sous-tend (l’État ne s’adresse pas aux citoyen’nes en considérant leur appartenance religieuse, la voix d’un chrétien est en principe aussi recevable que celle d’un athée ou qu’une musulmane, on ne salarie plus le clergé, corps minoritaire et privilégié, mais on permet l’accès égal à la liberté de culte par l’assistance spirituelle personnelle dans les lieux de privation de liberté, les hôpitaux, les internats et à l’armée…) Le lien entre la laïcité et l’enseignement est précieux en ce qu’il permet une ouverture et éloigne les réductionnismes religieux, en même temps qu’il approche l’élève d’une pensée critique. Néanmoins, le livre de Nicolas Cadène n’éclaire pas sur les conditions dans lesquelles la loi du 9 décembre 1905 a été votée (le format du livre n’invite pas à le faire).
C’est Patrick Weil, dans son ouvrage « De la laïcité en France » (Ed. Grasset,2021), qui fait redécouvrir au lecteur le contexte et les implications de la loi du 9 décembre 1905 dans l’ordre politique et social français de l’époque. Son retour sur l’histoire et l’encastrement de cette loi dans un contexte très particulier permet de comprendre les ressorts idéologiques, éthiques et de pouvoir qui l’entourent. Dans un premier temps, Weil rappelle les liens institutionnels que le gouvernement et l’État entretenaient avec l’Église catholique, depuis Napoléon Bonaparte et son concordat du 17 juillet 1801. Certes, l’État se liait dès 1802 aux protestants et dès 1808 aux israélites en salariant de même leurs ministères, mais la religion catholique romaine et apostolique était favorisée, reconnue alors comme « religion de la grande majorité des Français ».
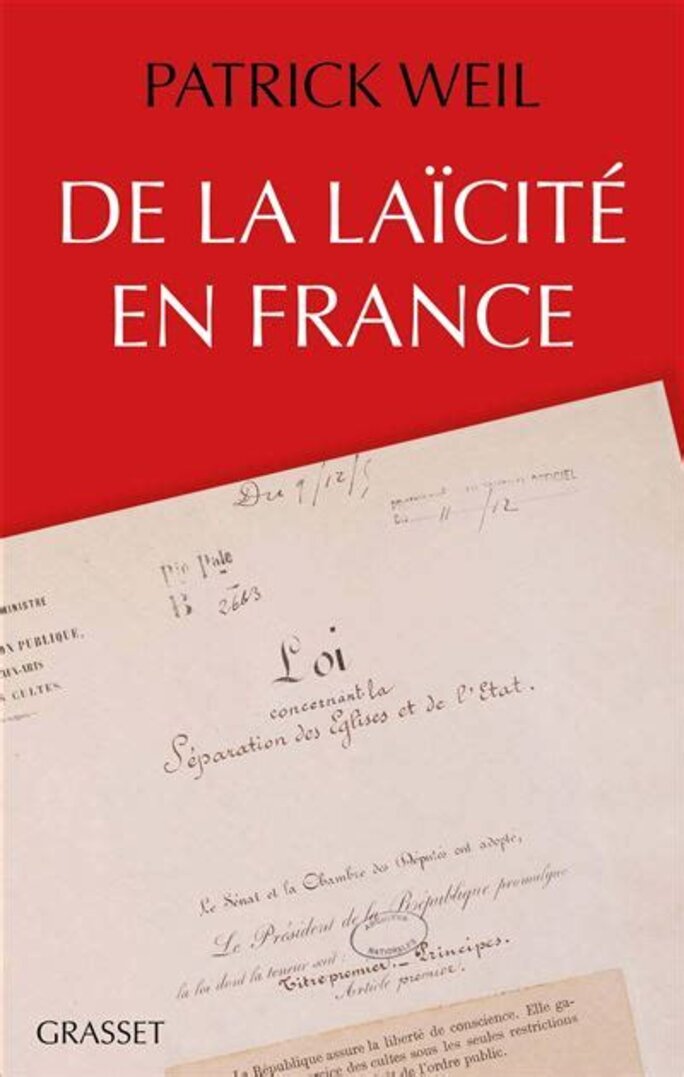
Agrandissement : Illustration 4
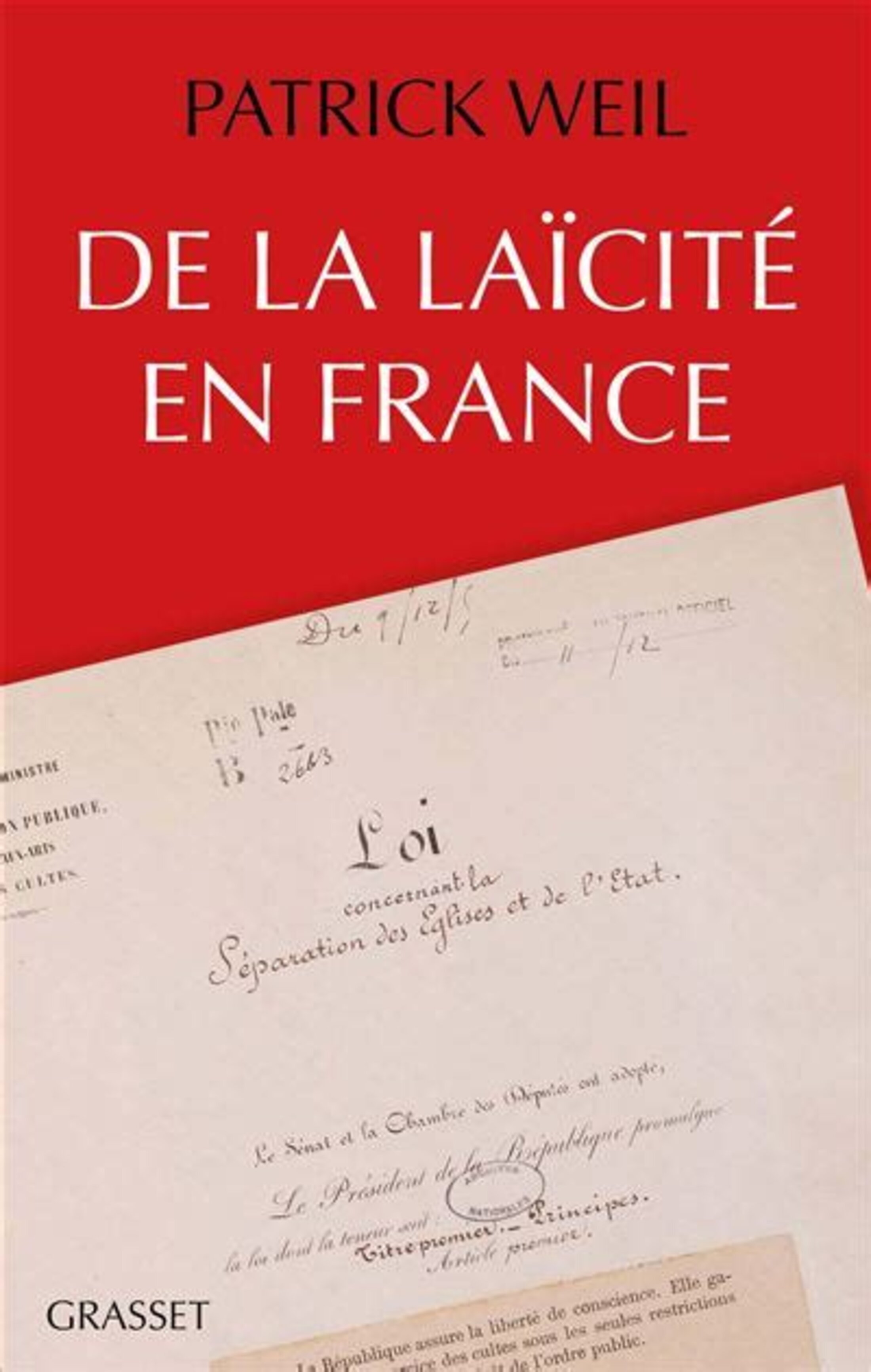
L’Église était aussi une plateforme diplomatique entre la France et le Vatican. Plus tard, sous le président Napoléon III (élu après la Révolution de 1848, et la proclamation de la IIde République), la loi Falloux de 1850 dissout les écoles normales chargées de former les instituteurs, soumet ces derniers à l’inspection du clergé, et permet la diffusion de l’enseignement par les congrégations religieuses (qui concurrencent alors les écoles publiques, puisque les collectivités doivent financer les écoles, indépendamment de leur statut). Avec la proclamation du Syllabus papal (1864), qui fait de l’administration civile des écoles une erreur, puis par la déclaration de l’infaillibilité pontificale en 1870 (Concile de Vatican I), les républicains comprennent que l’Église peut nuire à l’indépendance de la France et que la religion, alors instrumentalisée par une puissance étrangère et des personnes détenant un pouvoir spirituel et politique considérable, a un potentiel de nuisance contre leur programme de progrès sociaux et d’émancipation par l’éducation (l’éducation étant une priorité pour les républicains de l’époque). Alors, après la chute de Napoléon III et l’avènement de la République en 1875, ils s’engagent à lutter contre l’influence des religieux organisés dans les affaires de l’État. En 1879, alors que les républicains deviennent majoritaires au Sénat, les parlementaires s’attellent à légiférer afin de laïciser les institutions. Le repos dominical obligatoire est supprimé (1879), en 1881 les cimetières sont sécularisés (on leur donne une utilité civile et plus seulement religieuse), puis les hôpitaux sont laïcisés (on enlève toute référence religieuse en leur sein, ainsi que dans les tribunaux correctionnels) ; de plus, les séminaristes et religieux sont astreints au service militaire dès 1889 (cela est alors perçu comme une exercice de citoyenneté et de formation à la défense contre une possible nouvelle guerre contre l’Allemagne).
Ce mouvement qui croise sécularisation et laïcisation (la première renvoyant à un processus de marginalisation culturelle et sociale de la religion dans la société, la seconde renvoyant à la marginalisation de la religion et de son influence dans les institutions publiques) se prolonge dans les lois scolaires qui organisent l’enseignement primaire obligatoire (donc gratuit) dès 1881, et sa laïcisation dès 1882 « pour ne heurter aucune conscience » (et donc universaliser l’accès à l’enseignement quel que soit le culte de l’élève ou de sa famille).
Aristide Briand, qui siègeait auprès des socialistes, est nommé rapporteur d’une commission ayant pour objectif la rédaction d’une loi portant sur la révision du Concordat, alors que la séparation est déjà à l’ordre du jour des républicains pour les législatives de 1902. Cette année, Emile Combes est porté à la présidence du Conseil. C’est un républicain opposé à l’influence du Vatican sur le catholicisme français et partisan d’une « laïcité gallicane ». En 1903, le socialiste Francis de Pressensé dépose une proposition de loi afin d’organiser une police des cultes, « fondé sur le principe de liberté de conscience » (p.24). D’autres parlementaires lui emboîtent le pas et déposent des textes. Une commission de 33 députés est désignées pour les examiner. Weil note le coup d’avance d’une voix pour les partisans de la séparation, qui parviennent à y faire voter son principe, mais qui souhaite trouver un agencement institutionnel alternatif en place du Concordat. Ferdinand Buisson, ancien collaborateur de Ferry et architecte de la laïcisation scolaire préside la commission. Buisson et Briand tiennent la commission, et ce dernier convainc les catholiques qui y siègent de travailler la loi dans une perspective de « libération pour l’Église et pour l’État » (p.25), avec l’aide de Jean Jaurès notamment. Deux ans durant, la commission se réunie et travaille à l’élaboration de ce texte, qui malgré de longs débats, en particulier à propos de la dévolution des biens des Églises, est approuvé le 3 juillet 1905 par la Chambre, puis le 6 décembre par le Sénat – elle sera promulguée le 9 décembre et destinée à être effective dès juillet 1906. Sans aucune mention du mot laïcité, l’exposé de principes du texte de loi se pose dans la lignée de la Révolution de 1789. L’article premier de la loi confère aux Français une liberté de conscience absolue, l’exercice libre des cultes et leur manifestation extérieure « sous les seules restrictions édictées » dans les autres articles traitant de l’ordre public. Chacun peut donc épouser un culte, et celui qui par la menace ou l’insulte empêche quiconque d’exercer son culte, celui-là est puni par la loi. Dans les lieux où cela est légal, porter des signes extérieurs de son culte est même protégé. Ainsi, la laïcité institue le droit de croire ou de ne pas croire, c’est une liberté de conscience, sans pression (comme le titre du premier chapitre s’y réfère). Néanmoins cette liberté a une face pénale, en cas d’appel à la sédition ou en cas de pression sur une autre personne afin qu’elle professe ou ne professe pas un culte.
Sur le plan de la souveraineté, Weil rappelle que la loi du 9 décembre 1905 est aussi un acte diplomatique et une consécration de la souveraineté nationale et du libre-choix de l’individu. Il explique que dorénavant, le Vatican n’est plus l’intermédiaire du contrat que le gouvernement tient avec ses sujets. L’État organise ses relations avec les citoyens sans se soucier de l’avis des clercs spécifiquement, et il prend son indépendance du Saint-siège. L’individu, lui, est libre dans ses options spirituelles et il n’a de compte à rendre à personne tant que l’ordre public n’est pas menacé.
Alors, qu’est-ce que la laïcité apporte aux luttes sociales ? D’une part, elle donne une expérience de l’universelle égalité devant la loi. Elle montre aussi que se défaire d’institutions qui semblaient être indépassables est possible pour les pouvoirs publics. Avec la laïcité, la concorde et le dialogue décent peuvent émerger, indépendamment de l’appartenance religieuse – la laïcité sert de liant à la liberté, l’égalité et la fraternité. La laïcité permet de rapprocher ceux qui ne croient pas de ceux qui croient, dans toute leur diversité (on ne croit pas pour la même raison, on n’est pas athée ou agnostique pour les mêmes motivations). En considérant l’individu autrement que par son affiliation à un culte ou par sa fidélité à une divinité, on peut nouer plus aisément une relation fraternelle, fondée sur un impératif de justice pour tous’tes, et un respect minimal et mutuel, afin de s’engager dans des combats communs, au sein de coalitions. La laïcité, même si elle est invoquée par des nationalistes et des identitaires, peut être un rempart contre ceux-là, puisqu’elle implique de ne pas réduire systématiquement à sa religion l’autre, protège des assignations injurieuses, et propose de faire entrer dans un régime de liberté de conscience ceux qui viennent en France, mais aussi ceux qui vivent et évoluent en France. Même si la visibilité de signes religieux peut aujourd’hui questionner (surtout pour ceux et celles qui n’en portent pas), il faut s’en tenir à la laïcité (qui protège la manifestation de signes religieux sauf dans certains cas précis), la liberté de conscience et la liberté de culte, et dénoncer ses entorses. Cela ne signifie pas fonder son combat sur la surveillance des religieux et des religieuses afin de faire la publicité des fautes lorsqu’une entorse est constatée, mais savoir s’opposer aux religieux intégristes et leurs soutiens comme aux personnes qui font de la laïcité un instrument anti-religieux (ou un moyen de rejeter les musulman’es). Individuellement, une personne peut refuser telle ou telle religion, la critiquer et la rejeter, néanmoins, injurier, inciter à la discrimination, à la haine et diffamer en se liguant avec d’autres personnes ou non contre des individus, du fait de leurs croyances et opinions est prohibé par la loi (et on en le sait que trop bien par la médiatisation de personnages anti-laïcité).
Le combat socialiste a beaucoup été influencé par des militant’es religieux’se (pratiquant’es ou simple croyant’es), en particulier au Parti Socialiste Unifié, chez les Verts ou chez la jeune Confédération française démocratique du travail (autogestionnaire à ses débuts). Toutefois, ces mouvements ne se fondaient pas systématiquement au nom de la foi de leurs sympathisants, leurs instances étaient plutôt laïcisées, et ces organisations s’adressaient au grand public. Néanmoins, pour beaucoup leur parcours individuel était motivé par la foi, ce qui n’est pas la même chose. Pour ma part, je ne pense pas que le socialisme ait pour tâche d’annihiler le sentiment religieux des gens. En revanche, je pense que la laïcité est liée à la démocratie et au progrès social, car elle permet à celui qui veut de s’extraire d’un système de pensée, de valeurs et de normes qui ne lui plaît pas pour en épouser un autre, ou ne pas en épouser du tout. Par l’enseignement laïque les individus peuvent acquérir une rigueur rationnelle et ne plus s’attacher à des superstitions ou des idées préconçues par telle ou telle morale religieuse. Ainsi, ils peuvent s’engager en conscience dans une cause ou s'en éloigner. La capacité d’action individuelle est consacrée, en même temps que la formation intellectuelle en ressort enrichie, et dégarnie d’injonctions épousées sans réflexion.
Malgré ces valeurs qui me semblent positives, j’ai conscience qu’intégrer la laïcité dans des combats présents peut sembler être difficile, notamment pour les militant’es disqualifié’es au nom même de la laïcité, mais aussi pour les travailleurs de secteurs en tension, en manque de budget et de personnels, à l’instar de l’Éducation nationale, où les conditions actuelles d’enseignement sont particulièrement difficiles, et rendent compréhensible la faible mobilisation de la gauche institutionnelle en faveur de la laïcité à l’école (sauf chez des syndicats d’enseignant’es). Mais je pense que les demandes, en particulier celles des mouvements de gauche, de remettre notre modèle de services publics sur les rails doivent incorporer cette dimension, en particulier dans le secteur de l’enseignement, qui est une porte pour l’émancipation individuelle. De plus, le combat laïque se prolonge dans le combat pour une éducation de qualité et pour la mixité sociale : sans ces avancées sociales, la laïcité est mise à mal par la stratification de la société, et une dégradation de l’enseignement3. Enfin, au sein des mouvements de gauche, la laïcité est une valeur qui peut permettre l’intégration de plus de militant’es (tant qu’ils et elles ne rendent pas strictement confessionnel leur engagement). Cela est particulièrement important dans un contexte où les musulmans, mais surtout les musulmanes, sont visé’es par une présomption de trahison ou d’accointance avec des fondamentalistes par les droites et certains pseudo-laïques du PS et du centre (j’y inclus le Printemps « républicain »). De même pour ces Juifs et Juives soupçonné’es d’office d’être des soutiens de la colonisation en Cisjordanie ou des traîtres à la cause.
La religion prend de la place dans la vie de beaucoup de personnes, il faut l’accepter, mais aussi rendre possible la coexistence d’une multitude de motivations personnelles pour lutter en faveur d’un combat commun, circonscrit par une éthique et des règles communes, et alimenté par un dialogue pluraliste.
1 Bonnafous Simone. Gérard Noiriel, La tyrannie du National, le droit d'asile en Europe (1793-1993). In: Mots, n°29, décembre 1991. Politique et sport. Retours de Chine, sous la direction de Simone Bonnafous . pp. 122-124. www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1991_num_29_1_1664
2 Laurent Mucchielli et Barbara Joannon, Désinfox # 16 Non, l’immigration n’est pas source de délinquance. Désinfox-migrations. URL: https://www.desinfoxmigrations.fr/contenus/articles-de-d%C3%A9sinfox/d%C3%A9sinfox-16
3 Tribune « Dans les discours et dans les actes. En quoi la laïcité permet-elle de faire vivre l’égalité ? », l’Humanité, 8 janvier 2018.

Agrandissement : Illustration 5