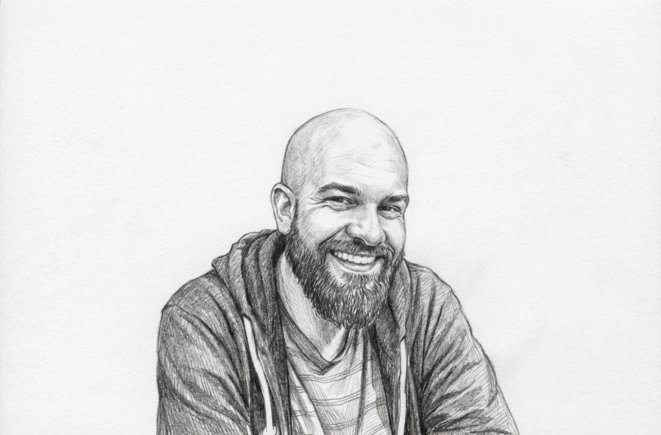En 2007, Csaba Jelinek - alors jeune étudiant quittant le domicile parental pour s'installer dans le centre de Budapest - ne se doutait pas que sa trajectoire personnelle deviendrait emblématique d'une crise nationale. « À l'époque, on ne parlait quasiment jamais du coût du logement entre amis », raconte-t-il. Il louait alors une chambre pour l'équivalent d'une centaine d'euros par mois. Quinze ans plus tard, dit-il, « une chambre similaire coûte au minimum plus du double ». Et surtout : « si vous discutez avec n'importe quel jeune de 20 ans aujourd'hui à Budapest, la crise du logement surgit immédiatement comme l'un des défis majeurs de leur vie ».
Publié dans The Guardian, ce récit d'un sociologue devenu spécialiste du logement résume le basculement qu'a connu la capitale en une quinzaine d'années. Il fait directement écho à une enquête plus approfondie, parue en 2023, menée par le Periféria Központ, un centre de recherche indépendant, dont Csaba Jelinek est co-auteur avec Márton Czirfusz. Le verdict est sans appel : le nombre de Budapestois vivant dans le parc locatif privé a triplé en dix ans, passant de 6 % en 2011 à 19 % en 2022. Quant au parc public, autrefois pilier du logement hongrois, il n'abrite désormais plus que 3 % des habitants de la capitale.
La ville, longtemps structurée par un parc social hérité de l'époque socialiste, s'est métamorphosée en un marché dominé par les investisseurs, où la location privée est devenue le seuil d'entrée - et souvent le seul horizon - de toute une génération.

Agrandissement : Illustration 1

Une génération locataire, sans héritage et sans crédit
L'étude Periféria montre qu'environ 35 % des 18-35 ans vivent désormais en location, contre seulement 4 % des plus de 60 ans. L'écart ne traduit pas un changement culturel mais une rupture économique brutale. Entre 2010 et 2024, les prix de l'immobilier ont augmenté de 234 %, la plus forte hausse de l'Union européenne, tandis que le revenu moyen ne progressait que de 86 %. L'accession à la propriété, autrefois accessible grâce à des prix modérés et à des ventes massives de logements publics dans les années 1990, devient un privilège réservé aux personnes bénéficiant d'un soutien familial ou d'un héritage.
« Sans héritage, on n'existe pas sur le marché immobilier », résume un chercheur du Periféria Központ. La Hongrie a en effet institué la propriété privée comme norme dès l'après-communisme, en facilitant massivement le rachat par les locataires de leurs logements municipaux. Deux lois clés ont rendu possible cette privatisation : le transfert des logements de l'État vers les municipalités en 1991, puis l'autorisation, en 1993, pour les locataires d'acquérir leur appartement à des prix très réduits. En quelques années, plusieurs centaines de milliers de logements publics ont été vendus à bas prix, ancrant pour longtemps l'idée d'un « pays de propriétaires ».
Tous les gouvernements, conservateurs comme sociaux-démocrates, ont entretenu ce récit. Sous Viktor Orbán, il est devenu doctrine : la propriété serait la condition naturelle de la stabilité familiale ; la location, une anomalie historique que le marché finirait par effacer. Mais cette logique se retourne désormais contre ceux qui la professent.
S'il subsiste aujourd'hui quelques logements publics - essentiellement municipaux -, il s'agit d'un parc résiduel, souvent trop dégradé pour avoir été vendu à l'époque des grandes privatisations. Héritage direct des années 1990, ce parc, concentré à Budapest et dans quelques grandes villes, ne représente plus que 2 % des logements du pays, contre 20 % en 1990. Autrement dit, la Hongrie a quasiment effacé son logement social.
Le logement social redevient désirable face à l'insécurité résidentielle
Avec l'envolée des prix et l'absence de régulation, de plus en plus de ménages se retrouvent piégés. Près d'un quart des personnes ayant demandé un crédit se l'ont vu refuser, essentiellement pour faibles revenus. Plus largement, l'enquête Periféria identifie une « cible large » de 800.000 adultes, soit 60 % de la population de la capitale, qui sont insatisfaits de leur logement, inquiets de leur avenir résidentiel ou prêts à déménager dans les trois ans.
Ce chiffre massif révèle une anxiété diffuse, mais profonde. Dans la moitié des foyers, au moins une personne prévoit de quitter son logement à court terme, un niveau inédit en Hongrie. Cette mobilité n'est pas le signe d'une ville dynamique mais signale au contraire une fuite permanente devant la hausse des loyers et l'insécurité juridique. La capitale ne connaît en effet aucune régulation des baux, aucune protection contre les expulsions abusives, aucun cadre stabilisant les conditions de location. Beaucoup de jeunes passent d'une sous-location précaire à une autre, vivant sous la menace constante d'un départ forcé.
Parmi les 800.000 personnes concernées, l'étude identifie une « cible restreinte » de 300.000 habitants prêts à s'engager dans la location de long terme si celle-ci était abordable et sécurisée, dont 100.000 pourraient intégrer immédiatement un dispositif locatif non spéculatif, sans subvention complémentaire. « Budapest ne manque pas de demande pour un secteur locatif abordable. Elle manque d'offre, de régulation et d'institutions », concluent les chercheurs.
Un marché verrouillé
Contrairement à d'autres capitales européennes, la spéculation hongroise n'est pas principalement le fait d'investisseurs étrangers. Selon The Guardian, entre 30 et 50 % des transactions immobilières récentes sont réalisées par des ménages hongrois aisés cherchant à placer leur épargne dans la pierre, ce qui alimente la polarisation sociale et l'éviction des jeunes ménages des quartiers centraux.
Le marché budapestois n'est donc pas seulement tendu : il est verrouillé, capté par des acteurs privés atomisés mais puissants dans leur somme, qui achètent pour louer cher ou conserver des logements vacants dans une logique d'investissement. Face à cela, la municipalité tente d'ouvrir des brèches. Elle a créé une Agence municipale du logement social pour mobiliser une partie des 16,7 % de logements vacants recensés en 2022, en proposant aux propriétaires une gestion professionnelle et des loyers sécurisés. Des initiatives citoyennes, comme la Maison collective de Zugló ou les projets du réseau MOBA, expérimentent des modèles coopératifs inspirés de l'Europe de l'Ouest.
Mais toutes se heurtent au gouvernement, qui entrave ou bloque les projets menés par la municipalité, dirigée par le maire écologiste Gergely Karácsony. Le cas le plus flagrant est celui de l'acquisition d'un site industriel de 85 hectares destiné à accueillir des milliers de logements abordables : une opportunité rendue possible par un vide juridique, que le gouvernement a immédiatement refermé après la signature.
Un choix de société
À mesure que Budapest devient une ville où l'on se bat pour rester plutôt que pour s'installer, une question, simple mais essentielle, ressurgit : pour qui construit-on la ville ? Pour ses habitants, ou pour ceux qui accumulent du capital en profitant de sa rareté ?
Tout ce qui précède – explosion des prix, résidualisation du parc public, refus de crédit, spéculation intérieurisée, initiatives locales bloquées, 800.000 habitants en insécurité résidentielle - décrit une ville où les trajectoires individuelles sont de plus en plus déterminées par le patrimoine familial. Une ville où l'avenir dépend moins du travail que de la transmission.
Pourtant, Budapest ne manque ni de demande pour un logement abordable, ni d'acteurs prêts à construire des alternatives. Mais tant que l'État refusera d'assumer un rôle structurant, ces expériences resteront marginales. Le résultat, aujourd'hui, est limpide : la capitale ne perd pas seulement ses logements abordables, elle perd sa capacité à accueillir celles et ceux qui la font vivre.
La crise du logement, talon d'Achille d'un régime ?
Ce décalage entre le récit officiel et la réalité vécue pourrait devenir une vulnérabilité politique. La doctrine de la propriété - présentée comme un attribut quasi naturel de l'identité hongroise - se heurte désormais à une génération pour qui l'achat d'un logement est hors de portée. Dans les années 1990, les privatisations massives avaient laissé croire que la propriété serait toujours accessible. Or ce temps est révolu et la propriété n'est aujourd'hui plus un signe d'émancipation, mais un marqueur d'origine sociale.
Le discours du « château familial » promu par Viktor Orbán vacille face à la réalité des loyers prohibitifs, des refus de crédit, des chambres exiguës converties à la hâte et des déménagements à répétition. Quand les jeunes affirment qu'ils n'ont « ni châteaux, ni clés, seulement des loyers », ils réfutent tout le mythe sur lequel la Hongrie a édifié un des piliers de son modèle social depuis plus de trente ans.
Dans un pays où le pouvoir s'est longtemps appuyé sur la passivité politique des jeunes urbains, la crise du logement pourrait devenir l'un des rares terrains capables de fissurer ce paysage. Car la question du logement touche à ce qu'il y a de plus fondamental : la possibilité d'avoir un avenir quelque part. Et si une brèche existe dans le récit de stabilité que le gouvernement s'efforce de maintenir, elle pourrait bien se trouver ici : dans la découverte, par toute une génération, que la ville qui devait être leur avenir devient chaque année un peu plus inaccessible.