Il y a dans l’enfance une sorte de silence organisé... Éducation ou soumission ? On y apprend à obéir sans explication, à sourire quand on n’en a pas envie, à se taire pour ne pas déranger ou à faire des câlins pour faire plaisir. Et on appelle cela : bien se comporter.
Mais si ce que nous croyions être une normalité était en fait une initiation ?
Une formation à ne pas dire non.
À encaisser.
À rester à sa place.
C’est dans cette trame invisible que les inégalités se tissent : entre adultes et enfants, mais aussi entre hommes et femmes, dominant·e·s et dominé·e·s.

Agrandissement : Illustration 1

Adulte : classe dominante ?
Quand on évoque les violences faites aux enfants, on pense d’abord aux formes les plus spectaculaires : l’inceste, les coups et la maltraitance, les négligences extrêmes, l’affaire Bétharram... Ces violences ne doivent jamais être minimisées — d’autant qu’elles restent encore trop souvent mal prises en charge, invisibilisées ou étouffées. Mais ce n’est pas l’objet de ce billet.

Agrandissement : Illustration 2

Ici, il s’agit de parler d’un autre niveau, plus insidieux, plus quotidien, que l’on continue à considérer collectivement comme étant normal, banal si ce n’est nécessaire. Les violences éducatives ordinaires : punitions, humiliations, chantage affectif, cris, gestes brusques, et tout simplement ce refus d’expliquer une décision parce que "je suis l’adulte, tu es l’enfant".
Comme le rappelle Yves Bonnardel, la domination adulte repose sur un consensus social profondément ancré : "L’enfant est un être à éduquer, façonner, corriger. Il ne sait pas, il ne peut pas, il ne comprend pas."
La philosophe et documentariste Charlotte Bienaimé pousse encore plus loin dans sa série Domination adulte (été 2023) : cette asymétrie est si internalisée qu’elle devient presque invisible. Elle conditionne notre rapport à l’autorité, à la parole, au corps, au consentement dès le plus jeune âge.
La place du militantisme
Depuis quelques années, cette critique de la domination adulte émerge dans les milieux militants féministes, anti-validistes et antiracistes. La dénonciation des violences éducatives, loin d’être une simple affaire privée ou parentale, est aujourd’hui perçue comme un enjeu politique à part entière.
Elle s’incarne dans des collectifs de survivant·e·s d’inceste et de violences intra-familiales qui revendiquent leur double statut de premier·e·s concerné·e·s et d’acteur/rices politiques, des groupes de recherche et d’autodéfense et des parents en rupture avec les modèles éducatifs autoritaires qui expérimentent d’autres rapports (horizontaux, dialogiques, non punitifs).

Bien loin d'un phénomène supposé de mode : c’est une ligne politique.
Remettre en cause l’idée que les enfants n’ont pas à être entendus, ou que les adultes savent « mieux ».
C’est affirmer que l’enfant n’est pas un adulte en devenir, mais un sujet présent, ici et maintenant, digne d’écoute, de respect, de droits.
Buzz, récupération et confusion
Mais à mesure que cette notion gagne en visibilité, elle est aussi détournée, instrumentalisée et/ou récupérée.
> L'instrumentalisation
Certaines figures publiques, comme Marguerite Stern ou Dora Moutot en font un outil rhétorique au service d’un discours transphobe. Dans leur essai Transmania, elles utilisent l’argument de la « protection des enfants contre l’idéologie trans » pour justifier leur hostilité à l’égard des mineur·es trans, en accusant les parents ou les associations LGBTQIA+ de « manipulation mentale ».

Agrandissement : Illustration 5

Sur Twitter ou Instagram, #adultisme est utilisé pour défendre des postures réactionnaires, comme dans cette vidéo relayée par Blast, autour de la supposée « panique trans » dans les écoles. On feint de s’émouvoir pour les enfants, alors qu’on instrumentalise leur condition pour attaquer les luttes minoritaires, queer, féministes, décoloniales.
C’est un retournement pervers pour
taire les trans
taire les queer
taire les survivant·e·s
et rien à foutre des enfants au passage.
> Le détournement de responsabilité
On aime croire que tout se joue dans le foyer où il suffit 'juste' d'être un parent parfait. La perfection est une injonction irréaliste qui nourrit la charge mentale des parents (et énormément des mères).

Agrandissement : Illustration 7

La vérité, c’est que l’adultisme est tissé dans des institutions entières et se fait l'écho de toutes les discriminations existantes : l’école qui punit plus sévèrement certain·e·s, la justice qui doute de la parole des enfants, la médecine qui prescrit sans écouter les filles, les politiques publiques qui parlent de protection mais rarement de prévention.
Voilà la recette d'un système qui prive très tôt de voix et de choix.
Luttes intersectionnelles
On ne peut pas penser l’adultisme comme une bulle isolée, suspendue dans l’air. La domination adulte n’existe jamais seule : elle s’entrelace, elle s’accroche, elle nourrit. Les filles découvre très tôt que son "non" compte moins, parce que la voix des adultes se marie au patriarcat pour lui rappeler sa place. L'enfant en situation de handicap subit une double confiscation : l’âge qui réduit au silence et le validisme qui l’efface encore davantage, comme si décider pour lui allait de soi. L'enfant racisé·e sera puni pour les autres, parce qu'il faut faire un exemple.
Alors non, on ne peut pas séparer l’adultisme du racisme, du sexisme ou de l’anti-validisme. Ce serait amputer la réalité et trahir la parole des premier·e·s concerné·e·s. L’intersectionnalité n’est pas une option militante : c’est la seule manière de voir les engrenages tels qu’ils sont, de comprendre comment les oppressions se superposent et se renforcent. Sans cela, on ne fait que poser un pansement sur une plaie qui continue de s’ouvrir ailleurs.
Refuser l’adultisme, c’est remettre en cause une structure verticale profondément ancrée qui façonne nos réflexes de pouvoir en :
- Créer des espaces de parole réellement accessibles et sûrs pour les enfants et les adolescent·e·s.
- Former les adultes (en contact direct - éducateur/rices, parents, soignant·es - mais aussi dans l'ensemble) à la non-violence éducative, à l’écoute active et au consentement.
- Soutenir les collectifs de jeunes et de premier·e·s concerné·e·s
- Exiger des moyens pour les services publics qui les accompagnent (éducation, santé, justice, prévention, protection de l’enfance...).
- Refuser que la critique de la domination adulte serve à renforcer d’autres formes de domination.

Agrandissement : Illustration 8
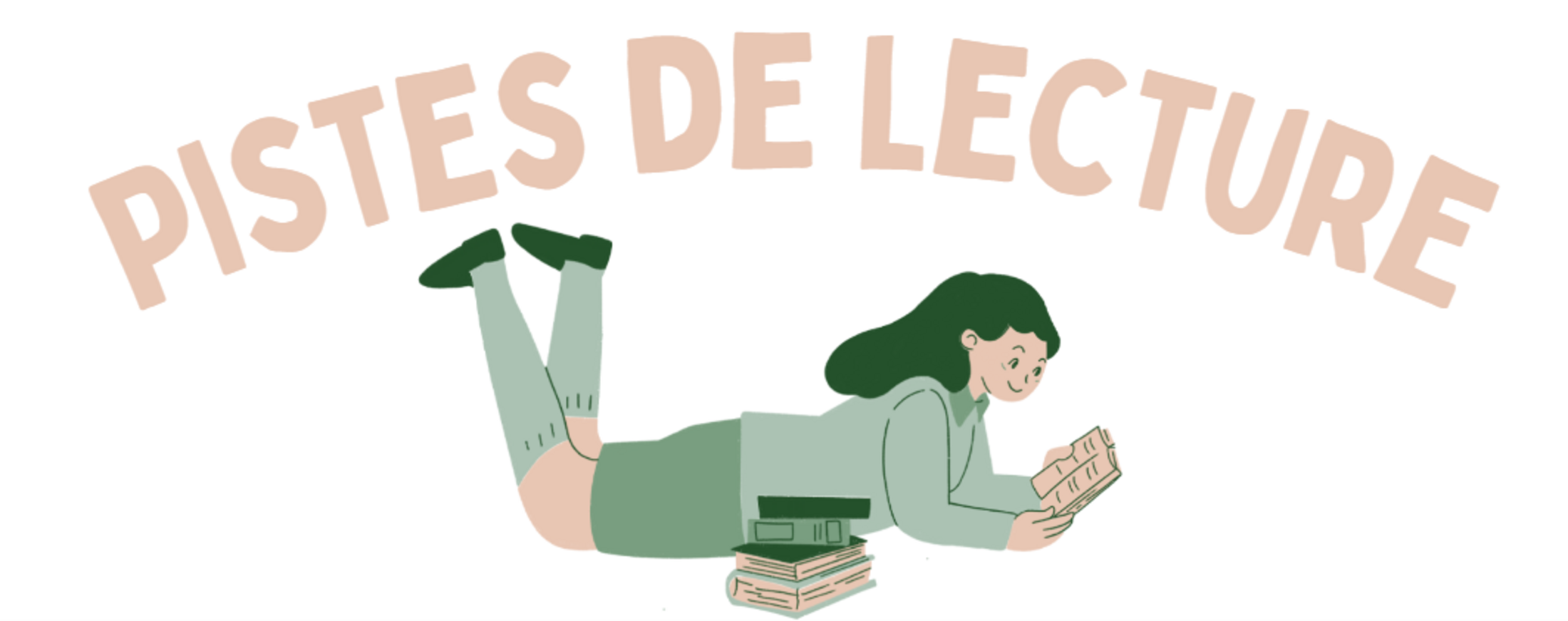
- Entretiens avec un égalitariste - Gustave Adore
- Rencontre avec Charlotte Bienaimé - ARTE Radio Podcast
- Un podcast à soi - Charlotte Bienaimé
- Les mots pour dire la domination adulte et les violences faites aux enfants - Texte collectif / L'Humanité
- Violences faites aux enfants : mettre fin à l’inacceptable - NPA L'anticapitaliste
- Collectif Infantiste
- La révolte des mères - Manifeste



