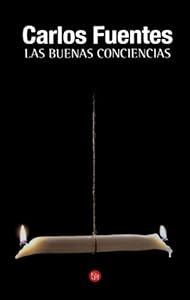
Il fallait bien parcourir près d’un siècle d’histoire politique mexicaine, du mitan du 19ème a la moitie du 20ème, pour conférer une telle ampleur sociale, sociétale et morale aux questionnements adolescents du jeune Jaime Ceballos. Une réflexion qui se révèle infine plus complexe qu’on ne pourrait le croire, l’ironie mordante émaillant sans vergogne la majorité de l’œuvre laissant place dans les derniers chapitres à une gravite inattendue ou la mélancolie le dispute au renoncement d’une jeunesse déjà révolue. Si “les bonnes consciences” était un film, il serait une comédie dramatique tant le pathétique des personnages et des situations y est omniprésent et tant leur caricature initiale contient les ferments d’une dimension quasi tragique, a savoir une capacité a balayer la poussière de leur(s) envie(s) sous un tapis de conscience constamment sali par les pieds crottés des bonnes manières.
Jaime Ceballos, une quinzaine d’années, est l’unique héritier d’une des familles les plus réputées de Guanajuato, ville coloniale, cultivée, berceau d’une élite économique et culturelle de bon aloi gardienne des bonnes valeurs et du bon goût. Autour de lui et de son éducation gravitent trois personnages essentiels : son père biologique tout d’abord, commerçant aux gouts et plaisirs simples faisant tâche dans l’univers de broderies et de manières affectées propres au rang des Ceballos ; sa tante, pur produit de sa lignée et déterminée à faire de Jaime le fils qu’elle n’a jamais eu ; son oncle, enfin, homme d’argent a la réussite indéniable, à la morale toujours inclinée du cote du parti dominant et désireux d’endosser les habits du chef de famille par ses pensums et sermons définitifs. Jaime va toutefois fomenter sa rébellion intellectuelle et morale autour d’un idéal complexe mâtiné de syndicalisme, de littérature et de catholicisme, se convainquant de la nécessité pour les hommes de transformer leurs paroles en actes et de sa responsabilité sociale et théologique envers eux. A l’origine et a la confluence d’une telle ambition trône un consortium hétéroclite de rencontres forme d’un jeune étudiant issu des classes populaires, d’un syndicaliste en fuite, d’un doute grandissant quant à l’identité de sa mère biologique et d’une statue géante du Christ sur la croix semblant s’adresser a lui. A lui seul.
La rectitude fantasmée du jeune Jaime commence par une classique reconfiguration des schémas de l’autorité : remise en cause d’une autorité institutionnelle trop pesante (celle de l’oncle) et trop hypocrite ; recherche d’une autorité de type « partenariat » et fondée sur la simplicité de la figure du père biologique, malheureusement trop faible pour s’imposer a la figure ombrageuse de l’oncle sentencieux et ne trouvant, de la sorte, grâce aux yeux de son fils exigeant. A ce schéma classique s’ajoute une forte dimension théologique volontiers rabaissée au rang « d’évangélisme » car trop attachée à la vérité des textes et non a une pratique sécularisée qui a appris a faire fi de certains principes encombrants : soit l’avènement sur Terre d’un royaume des Cieux ou les péchés seraient partages par tous de même que les richesses, donnant un coup de pied a la fourmilière trop bien organisée de cette élite artistocratico-bourgeoise rythmée par une bonne conscience qui arrange tant ceux qui veulent bien lui prêter une oreille attentive. La bonne idée de l’œuvre est d’ajouter a cette dimension théologique un discours critique plus global renvoyant dos à dos la bienveillance catholique et conservatrice bon teint des hommes de pouvoirs et d’affaires tout comme la prétention humaniste, sociale et bien-pensante très théorique venue « d’en haut », mais bien ignorante des réalités du monde. Tous deux coupables de « bonne conscience », tous deux fermant la porte au Royaume des Cieux comme a une société plus juste : recluses, égoïstes et individualistes dans leur quête de la salvation aux yeux de l’Eglise comme aux yeux des autres, elles ne constituent qu’une pathétique et éternelle quête d’accumulation de privilèges et de reconnaissances, symboliques cette fois-ci…
Pour donner un surplus d’émotions a une œuvre qui aurait très bien pu tourner au pamphlet désabusé et potentiellement simpliste, Carlos Fuentes possède de surcroit deux armes imparables. La première est son écriture, simple, précise et élégante, alternant avec bonheur toutes les postures du narrateur possibles et imaginables tout en s’attachant a une description très visuelle des lieux et des situations qui plonge immédiatement le lecteur dans le creuset des âmes symbolisé par cette ville coloniale aux ruelles étroites et aux couleurs changeantes. Successivement écrin, relique du passé, cité ennemie, labyrinthe chatoyant et protecteur, libération et emprisonnement, Guanajuato est un personnage à part entière dont l’auteur permet une immersion totale. Carlos Fuentes saisit également à merveille les postures affectées propres aux prétentieux discours d’adolescents vieillis par leur impossible ambition intellectualiste, rendant chaque tableau aussi vivant que possible, les paroles n’illustrant que des lieux, des gestes, des attitudes. Evitant ainsi le risque d’un récit poseur et alourdi par son propos vindicatif, il offre une véritable chronique qui le rapproche de la tradition du « roman d’éducation » qu’il visait en premier lieu.
La seconde est sa science des personnages, conférant a chacun d’eux une intensité inattendue, plaçant Jaime au centre d’un jeu complexe de sentiments et de pulsions adultes qu’il ne comprend que trop peu : dernier recours, dernière chance, dernière source d’apaisement pour un père prive de sa vie et de son épouse, trop prosaïque pour être digne des Ceballos ; seul objet d’affection et de désir d’une tante délaissée par son mari en tant que mère comme en tant que femme ; unique héritier de la famille et passage oblige de la transmission des affaires d’un oncle jouant au guide pragmatique et moral. Ce pathétique trio au lustre compasse et illusoire ne fait finalement que livrer un combat entre l’autorité et le sexe, une lutte entre pouvoir moral et attente charnelle dont la façade s’effrite page après page ; écrite en 1959, l’œuvre possède une liberté de ton qui préfigure la révolution sexuelle a venir. Et si l’autorité semble avoir le dernier mot, le lecteur ne saurait être dupe quant a son hypocrisie : scènes de cabaret, de masturbation, de frustration et d’abandon concourent a démontrer la vacuité de cette « bonne conscience » que l’émoi d’un adolescent n’aura suffi a ébranler, certes, mais aura mis à jour les faux-semblants. Pour ébranler ce monde, il aurait fallu prendre conscience des autres et non de sa seule prétention a racheter leurs crimes et péchés. « Je ne suis pas venu pour les appeler les Justes, mais les pécheurs », dit la Bible et c’est presque paradoxalement, dans un ultime pied de nez, que sort de la bouche d’un ecclésiastique bon teint un sermon poignant, le seul qui « aurajustifiésesétudesauséminaire » et dans lequel l’auteur place son message, l’ultime banderille dans le dos de sa plus belle et bonne conscience : celle de son jeune héros.
Thibaud MARIJN
Toutes nos chroniques sont sur www.madamedub.com
Et toujours notre maison d'édition sur www.dubeditions.com



