[Fabienne Deyris Carcedo est médecin coordinatrice dans une structure bayonnaise d’hospitalisation à domicile. Elle suit les gens qu’on sait en fin de vie, elle sait que la fin contient des multiplicités et des surprises. Elle adore le travail d’équipe et de présence. Elle fait entendre le plaisir qu’il y a à faire le métier d’aide-soignante non sans s’inquiéter de ce que les politiques leur font subir. Le texte qu’elle donne à lire ici décrit comment par le travail d’équipe et par la parole organisée dans le cadre de ce travail, éthique et pratique médicales se nourrissent l’une l’autre, et nourrissent aussi bien les relations entre personnes soignantes et personnes soignées qu’entre les personnes soignantes elles-mêmes, double condition pour un juste soin.]

Agrandissement : Illustration 1
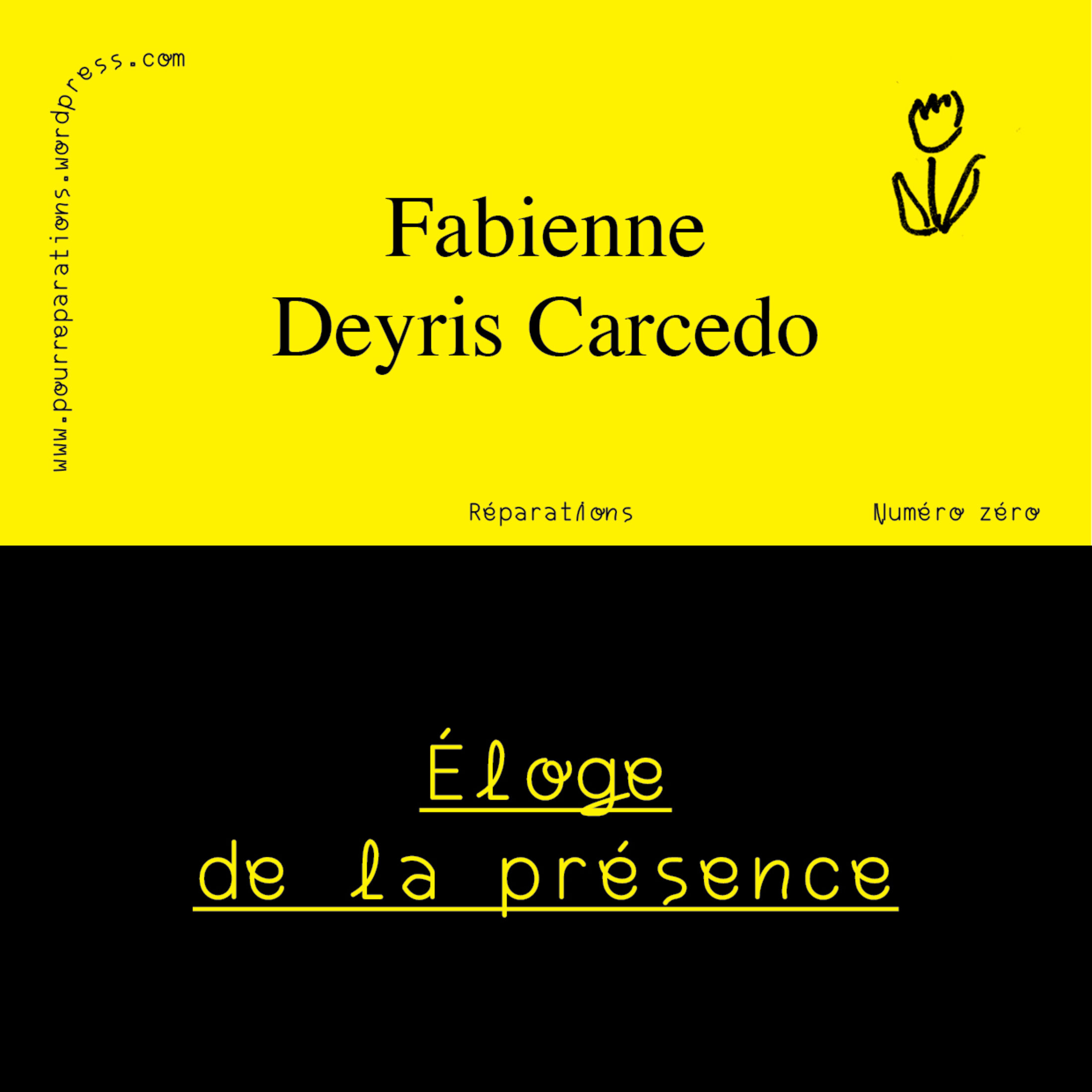
« Agir en homme de pensée et penser en homme d’action » [1]
« La meilleure façon de défendre son métier, c’est encore de s’y attaquer en cultivant les affects, les techniques et les émotions qui le gardent vivant » [2]. Cette formule d’Yves Clot constituera le fil d’Ariane du propos qui sera le mien, vous parler de la réunion d’équipe dans les soins palliatifs.
Je suis médecin coordonnateur dans un établissement à but non lucratif d’hospitalisation à domicile. Pour ma part j’accompagne essentiellement des patients en fin de vie atteints de maladies graves, incurables. J’accompagne aussi leur médecin traitant dans les prises de décision et le maniement des traitements contre la douleur et autres symptômes parfois complexes à soulager en fin de vie. Mon rôle est de faire le lien entre le patient, son entourage et leur(s) projet(s), ainsi que l’équipe soignante. Au domicile les soignants se déplacent à tour de rôle, ils ne s’y croisent que rarement. Même si les nouvelles technologies (tablettes, e-dossier médical et de soin, smartphone, réunions en audio, skype …) facilitent la transmission entre nous, la crise sanitaire qui nous a privés de nos réunions hebdomadaires d’équipe « au bureau » pendant un an, a montré combien se retrouver, échanger, partager et réfléchir ne pouvait se passer de la présence, pour les uns comme pour les autres.
Plusieurs choses me passionnent dans mon métier, en premier lieu, l’accompagnement palliatif des plus vulnérables et de leur entourage dans leur lieu de vie, qui est le lieu choisi de leur fin de vie. Le territoire dont j’ai la charge est mixte : urbain, semi-rural et très rural. Mon métier me permet de rencontrer des gens très divers, de tous les âges dans des univers exceptionnellement variés. L’hospitalisation à domicile permet la fin de vie de personnes chez elles dans des situations complexes (médicalement, psychologiquement, et/ou sociologiquement…). C’est une sorte de défi de répondre en équipe à ces projets. Je dis bien en équipe car c’est un métier qui ne peut pas s’exercer seul, on a besoin de nombreuses compétences. Voici la deuxième chose qui m’anime, et qui sera au cœur de ce texte : rendre vivante l’équipe qui s’articule autour du patient pour que notre accompagnement soit au service de la fin de vie, donc de la vie du patient. Ayant travaillé pendant quinze ans en service de cancérologie à l’hôpital, j’ai trop souvent vu la vie des patients hospitalisés rythmée par les perfusions, les visites des médecins, les bruits du couloir, le ménage dans la chambre.
Au domicile, même si nous avons des contraintes organisationnelles, nous réfléchissons différemment y compris quand la prise en charge nécessite une importante médicalisation. Nous sommes nombreux à intervenir, à commencer par le médecin traitant avec qui les médecins coordonnateurs collaborent. « Nombreux », je pourrais dire « nombreuses », des femmes surtout, des aides-soignantes, des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales, une diététicienne, une ergothérapeute… Les métiers du care et particulièrement au domicile sont des métiers au féminin. Il faut rajouter les auxiliaires de vie, souvent tellement peu formées et pourtant de longues heures, seules, auprès des patients.
La réunion d’équipe est le lieu de rencontre des professionnels, le lieu de construction du projet de soin, le lieu d’échange sur les savoirs, les techniques, les difficultés, un peu les émotions. Nous prenons le temps (20 à 30 à minutes par patient) de décortiquer la situation souvent complexe et de donner du sens et de la cohérence à nos soins. Toutes les prises en charge que nous assurons n’auront pas la chance de bénéficier de ce temps de réunion spécifique ; il nous faut faire des choix en sachant que cette manière d’aborder un projet sert finalement à tous les patients. D’autres réunions seront ailleurs proposées pour dire un petit mot sur chaque patient.
Je n’ai jamais appris au cours de mes études à animer une réunion. Pourtant depuis bientôt douze ans que je fais ce métier singulier de médecin coordonnateur, je n’ai de cesse de les construire, de me nourrir des sciences humaines (non enseignées en médecine à l’époque), d’écouter, de réfléchir — jamais seule heureusement —, sur cette question de l’animation de réunion, de partager mes préoccupations et mes recherches sur le sujet avec d’autres. Même si en tant que médecin, nous apprenons à écouter, observer, il ne s’agit pas tout à fait de la même chose que dans la relation soignant-soigné.
En Ehpad, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, où j’ai travaillé pendant quatre années, j’ai eu la chance de construire avec une équipe pluri-professionnelle un modèle de réunion, au sens expérimental du terme. Aujourd’hui, plus d’un an après le début de la pandémie, j’ai quitté l’Ehpad et travaille à temps plein à l’hospitalisation à domicile où nous recommençons à peine les réunions d’équipe en « semi-présentiel » pour des raisons de jauge et de distanciation. Depuis plus d’un an, ces réunions s’étaient transformées en rendez-vous collectif audio, en transmissions d’informations, en expression individuelle de colère, de fatigue dont on ne savait trop quoi faire (nous, cadres, médecins, psychologues regroupés autour d’un téléphone en haut-parleur connecté avec une vingtaine de soignants chacun depuis son domicile). Aujourd’hui il faut repartir à zéro, avec des soignants épuisés, des nouveaux qui ne nous ont que rarement croisés, et apprendre à se connaître, à se faire confiance, à faire le pari de réfléchir ensemble même dans des conditions difficiles.
Réparations est le titre de ce numéro de la revue. Réparations est le chantier qui m’attend ces prochaines semaines dans les réunions d’équipe pour retrouver collectivement le sens de notre travail et le plaisir du travail bien fait en équipe, le plaisir de faire groupe ; transmettre aux plus jeunes, apprendre des regards neufs, décortiquer, réfléchir, construire. Je suis convaincue que la réparation passe par la présence. Un jour j’ai eu lors d’un colloque une révélation, un médecin parlait de juste présence alors qu’on nous avait tant appris la juste distance avec laquelle j’étais si mal à l’aise. Ce qui est bon pour la relation soigné-soignants est bon je crois pour la relation soignants-soignants au sein d’une équipe.
Je pense à Levinas qui décrit l’éthique comme un bouleversement ; comment faire avec l’autre ? Il s’agit du cœur de l’expérience la plus radicale. Avec un patient, sa famille, j’ai appris, je n’ai jamais cessé de le faire. C’est le cœur de mon métier.
Avec l’équipe, recommencer, retrouver ce qui s’est cassé, ça m’impressionne un peu mais je pense qu’il en va de ma responsabilité de médecin coordonnateur. J’en fais l’expérience et même l’épreuve : perdre la maîtrise en réunion, c’est-à-dire laisser s’exprimer tout le monde, puis proposer un consensus, ou pas, rarement, c’était un jeu avant la pandémie. Un jeu parce que j’avais la confiance de l’équipe ; voilà ce qui est à retrouver lorsque l’équipe comme c’est aujourd’hui le cas est renouvelée sans cesse, redistribuée.
Je vais partir de l’expérience suivante : en 2019, je quitte un poste de médecin coordonnateur en Ehpad pour me rapprocher de chez moi. J’y exerçais depuis deux ans, deux demi-journées par semaine. À l’occasion de mon départ et pour nourrir une conférence [3] sur le plaisir au travail, j’ai interviewé des aides-soignantes. L’entretien des aides-soignantes a été pour moi un moment magique et l’occasion de mieux comprendre ce qui se jouait en réunion de leur point de vue. Ces échanges vont me servir, me donner de l’énergie, je le sais, tant l’expérience a été riche.
Quand j’ai interviewé les aides-soignantes sur le plaisir, les questions de la pénibilité et de la reconnaissance revenaient sans cesse. Il y avait presque de la honte ou plutôt le sentiment que rire, prendre du plaisir n’était parfois pas bien perçu par les familles, l’institution, la société. Pour ce qui touche aux familles, elles n’étaient d’ailleurs pas toutes d’accord entre elles.
« On a le sentiment de ne pas être considérées, que notre travail n’est pas considéré. Ça c’est dur à vivre. Parce qu’on fait un métier envers l’humain. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas lui mentir et même si tu lui mens, la personne le ressent les résidents ils absorbent tout. Je parle de mon travail mais c’est dans tous les travails, mais on a besoin de reconnaissance, pas qu’on nous dise que c’est bien tous les jours. »
« Oh ça pas de risques… »
« Ce qui est paradoxal, c’est qu’on s’occupe d’êtres humains et avec nous, on n’est pas très humain. C’est paradoxal. »
« On parle de reconnaissance mais ça commence par l’écoute. »
« Pour bien soigner, il faut être bien soi-même. »
« On a besoin d’être guidé, on voit ça mais… »
« La réunion, entretient un dynamisme, quand on cherche ce qu’on peut faire de mieux, de différent, ça donne un dynamisme à tous les soignants, on ne baisse pas les bras quoi. C’est important tant pour le résident que pour le soignant. »
« En fait on râle mais ce n’est pas vraiment râler et surtout pas râler pour râler, c’est dans le bon sens du terme… »
« Je crois que la capacité d’émerveillement est aussi en rapport avec la capacité à s’indigner. Quand on est capable de l’un, on est capable de l’autre. »
La question de la reconnaissance passe par l’écoute, elles le disaient. À la fois l’ambiance de cet entretien et l’ambiance des réunions du mercredi étaient le reflet du plaisir partagé. Il fallait voir l’intérêt porté, il fallait les entendre, les observer s’écouter, réfléchir en même temps, s’emballer, ne pas être d’accord et le dire, être d’accord et le dire, se moquer avec respect, rire. Je crois que ce qui m’animait le plus, pour ma part, c’était ce dynamisme, ces yeux autour de la table, ces yeux si vifs alors que nous parlions de situations difficiles. Cette réunion hebdomadaire de l’ensemble des intervenants de l’Ehpad, durait une heure montre en main, je m’engageais à tenir le temps car cela constitue une marque de respect essentielle pour chacun dans son emploi du temps, pour le collectif dans la capacité à élaborer des solutions et le deal avec la direction (du temps de travail c’est du personnel et de l’argent). Dans ces réunions, c’est le collectif qui partageait des façons de faire, des analyses différentes, avec respect des unes et des autres. Il n’y a pas de bons soignants ou de mauvais soignants. Parfois, tout avait été essayé et nous étions bien obligées de nous rendre compte que nos techniques, notre bonne volonté avaient des limites. L’assumer en groupe et ne pas en faire une fatalité est aussi le rôle de l’encadrement (médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice et psychologue). Un projet de soin, une nouvelle façon de s’y prendre était formulée en fin de réunion, un compte rendu était rédigé pour les collègues en repos et tout le monde s’engageait. Quelques semaines plus tard il fallait ré-évaluer et s’adapter. Au fur et à mesure que les aides-soignantes et infirmières ont participé aux réunions elles ont appris également à faire confiance aux décisions prises par le collectif y compris lorsqu’elles n’avaient pas participé à la discussion ou qu’elles n’étaient pas tout à fait d’accord.
Chacune était là à double titre, son expertise professionnelle au sens de son métier et sa légitimité individuelle, au sens de sa personne avec son expérience, son caractère et ses affects. J’ai toujours visé une animation complice avec la psychologue et l’ensemble de l’équipe. Chaque réunion était différente, même si parfois on pouvait pressentir l’issue, la décision, le chemin pour y arriver était toujours surprenant, inattendu, inouï. La richesse tenait à ça : le chemin pour y arriver avec des échanges plus ou moins poussés, drôles, dynamiques.
On parlait de qui elles voulaient, jamais plus de deux situations dites complexes, deux situations qui n’allaient pas, toujours problématiques comme elles disaient. D’ailleurs c’étaient les aides-soignantes qui décidaient de qui on allait parler. Elles apportaient toujours des situations où elles se retrouvaient confrontées à ce que Jacques Derrida a formulé : « C’est au moment où « je ne sais pas quelle est la bonne règle » que la question éthique se pose. C’est ce moment où je ne sais pas quoi faire, où je n’ai pas les normes disponibles, mais où il me faut agir, assumer mes responsabilités, prendre parti. » [4] Les aides-soignantes se saisissaient de ce temps de réunion comme d’un temps pour un questionnement qui succède à une action plutôt insatisfaisante et précède une action plus réfléchie, partagée, plus élaborée. Une action qui engageait tout le monde, une question de responsabilité dans le souci de l’autre. L’une d’entre elles se faisait la porte-parole du groupe pour exposer le problème et souvent cela se terminait par « comment on fait, nous ? » D’un air de dire, « vous aussi le médecin va falloir vous y coller ! » Et la conversation commençait, mon rôle était de permettre une présentation à plusieurs voix de la situation. J’ai toujours détesté les présentations de malades du type cas clinique, se voulant purement objective et factuelle. Je crois au contraire que lorsqu’on commence à échanger sur une situation difficile, il faut laisser les soignants raconter, s’exprimer et repérer où sont les difficultés, les ressources, les points d’intérêt et de désaccord au sein de l’équipe. C’est ensuite qu’on fait le tri, qu’on recentre sur le propos, qu’on caricature pour mieux appréhender la complexité. Ce jeu se fait ensemble, j’en suis l’animateur, le garant.
La difficulté est de guider sans enfermer, sans manipuler ni dicter. À un moment donné, la discussion m’échappe et c’est tant mieux, on ne doit d’ailleurs pas craindre le résultat et l’absence de maîtrise de celui-ci. J’ai toujours fait confiance au groupe. Cette confiance paraissait réciproque et je n’ai jamais vu de dérives ou d’irrespect envers un patient, une famille ou des collègues. Les règles du jeu étaient énoncées régulièrement en début de réunion quand un nouveau soignant intégrait l’établissement. La recherche du plaisir intellectuel, le plaisir à partager a toujours été un objectif pour le groupe. La démarche éthique, non au sens de protocole mais comme mise en jeu du questionnement, de l’humour, de la provocation, de la comparaison à d’autres situations, propose des outils qui éveillent la curiosité, permettent de déplacer son angle de vue, enrichissent nos expériences et permettent à l’imagination de se mettre à l’œuvre. Il en faut, de l’imagination, dans ces situations toujours singulières et si complexes. Ce dont j’ai été le témoin c’est d’une qualité d’observation, d’adaptation et de l’immense exigence intellectuelle dont les aides-soignantes ont toujours fait preuve ; et la place du plaisir comme véritable outil d’animation. J’ai été impressionnée par le plaisir qu’elles éprouvaient à réfléchir, à partager entre elles, à rigoler même en parlant de choses graves. Il me semble qu’on a toujours plus ou moins plaisanté dans le cadre de ces réunions. C’était le lieu autorisé.
Quand je suis partie le plus grand cadeau que les aides-soignantes m’ont fait est de me remercier de leur avoir permis de penser ensemble, d’écouter ce qu’elles avaient à dire, de leur avoir appris qu’on pouvait faire équipe en ayant des points de vue très divers, qu’il s’agissait d’une richesse plutôt que de désaccords. Ce qu’elles appelaient point de vue rejoignait les principes éthiques, l’autonomie de la personne vulnérable au sens de sa liberté toujours conservée en partie même en cas de troubles cognitifs, la bientraitance, la non-malfaisance, la dignité. Sans prononcer ces mots, nous avons décortiqué des situations banales, car quotidiennes mais complexes en partant de l’expérience concrète pour trouver des solutions à nos difficultés. Il s’agissait par exemple de maintenir un minimum d’hygiène pour un résident refusant de se laver ou d’être aidé, d’accompagner un proche dans l’acceptation des troubles de son parent.
En parallèle à ces réunions, nous avons mis en place un cycle de formation destiné à l’ensemble du personnel de la maison de retraite, sur l’éthique et l’accompagnement en fin de vie. Les deux sont à mon avis indissociables, la formation et la formation continue associées à la réflexion hebdomadaire sur son travail.
En début d’entretien avec les aides-soignantes, je leur avais demandé de définir en quelques mots spontanément leur métier d’aides-soignantes. Les mots sont venus, à l’infinitif :
« Accompagner — Écouter — Permettre de garder la dignité — Maintenir l’autonomie et la communication »
Je trouve magnifique cette définition à quatre voix du métier d’aide-soignante. Actrices de leur réflexion, elles ne parlent pas des actes qu’elles engagent, au sens de la toilette, de donner à manger mais évoquent la façon dont elles les font et la visée qu’elles espèrent. Le savoir, le geste, la technique, la relation, le savoir-être, le positionnement sont consciemment au service de l’autre. L’autre respecté dans sa dignité et son autonomie. J’ai été très émue d’entendre ces mots. Ils m’ont marquée et me rassurent encore sur le chemin à prendre pour donner du sens à notre travail commun.
Nous étions à un tournant inquiétant pour notre société, les écoles d’aides-soignantes ne remplissaient plus leurs promotions, les auxiliaires de vie manquaient cruellement. De nombreux aides-soignantes, infirmières, épuisées, pensaient à se reconvertir professionnellement. Faut-il oser poser la question de l’attractivité de ces métiers, de la pénibilité, de la valorisation, de l’épanouissement après un an de pandémie ? J’avais croisé à l’époque une directrice d’un service d’aide à la personne à la campagne, je lui demandai timidement si elle avait du personnel, si elle arrivait à recruter. Elle revenait d’une réunion départementale avec ses collègues, on leur proposait un audit, un audit coûteux pour savoir de quoi manquait la profession. Elle me disait, fatiguée mais aussi en colère : « pas besoin d’audit, nous manquons de personnes, de gens bien payés, formés, soutenus tout le long de leur carrière car beaucoup de gens ont envie de s’occuper des autres mais qu’est-ce qu’on a à leur offrir, un métier usant physiquement et psychiquement avec la difficulté d’assurer les fins de mois ».
L’heure est encore plus grave que je ne le pensais à l’époque. Comment ne pas se décourager, comment y remédier chacun à son échelle.
Ce que montrent ces entretiens c’est l’importance du plaisir dans la relation à l’autre, le soigné, mais aussi l’importance de ces temps d’échange, de ces réflexions collectives où se travaillent les projets de soin, les difficultés, le savoir-faire, où s’interroge la juste présence, la notion d’équipe ; des temps de travail où on prend une heure hebdomadaire pour prendre du recul, s’écouter, échanger, trouver des solutions, élaborer des stratégies, penser nos métiers du care. Ce que j’essaie, avec d’autres, les psychologues notamment et l’infirmière en soins palliatifs avec qui je me déplace au domicile, c’est de permettre au cours de ces réunions l’expression des émotions, des affects.
Le soignant est pudique, on nous a appris à laisser nos sentiments au vestiaire, un soignant qui craque ou s’exprime avec émotion est un soignant en difficulté. Combien de fois j’ai entendu cela. Or, je pense le contraire, pour faire preuve d’empathie, trouver son lieu en tant que professionnel, il faut pouvoir partager ses sentiments avec les collègues au sens large (avec tous les acteurs de tous les métiers). Se rendre compte qu’on est touché, comprendre pourquoi, permet de se repositionner rapidement à sa juste place de professionnel, mais de professionnel humain. Nous ne sommes pas tous touchés par les mêmes situations et cela fait la force du groupe mais également celle de chacun au sein du collectif. C’est une façon pour l’équipe de prendre soin de chacun et donc du collectif et de dédramatiser tout ce que nous vivons ou tout ce qui nous est donné à voir.
Aujourd’hui, je suis intimidée par cette tâche immense dont je me sens responsable. Levinas me rappelle que c’est bien parce que cette épreuve est inassumable vis-à-vis de l’autre, vouée à l’échec, que je suis mise en question. Comment m’y prendre aujourd’hui ? Les gens changent, la société change si vite. Les soignants sont pris dans ce tourbillon. Nous sommes fatigués, en colère, les moyens s’effilochent. La formation, les réunions c’est du temps. Tous les établissements manquent de soignants. Comment vais-je m’y prendre quand je sais que la confiance, la complicité dans le travail est quelque chose qui se gagne avec du temps alors que je suis soumise à l’urgence ? En commençant à préparer cet article et en partageant avec des amis obligés d’enseigner en « distanciel » j’ai lu Barbara Stiegler [5]. « Le rêve ultime des néo-libéraux : chacun, confiné seul chez soi devant son écran, participant à la numérisation intégrale de la santé et de l’éducation, tandis que toute forme de vie sociale et d’agora démocratique était décrétée vecteur de contamination. […] Mais l’effet d’aubaine fut de courte durée. […] L’éducation comme la santé impliquaient non seulement un tissu de relations réelles et en présence, faites d’affectivités et d’interactions, mais […] elles étaient aussi et surtout, chacune à leur manière, un ensemble d’actions sociales, qui ne pouvaient se soutenir que collectivement. »
Aujourd’hui, je suis heureuse de retrouver les collègues, leurs visages, certes masqués mais leurs yeux, leurs regards, leurs postures, leurs tons de voix, de partager à nouveau dans les réunions, fatiguée du téléphone, mais j’ai un peu le trac, peur de ne pas être à la hauteur car je sens tellement la colère et la fatigue des soignants et le fossé s’est à nouveau creusé entre les soignants « du terrain » comme ils disent et nous les gens du bureau même si nous sommes, nous aussi médecins, tous les jours auprès des malades, chez eux.
Dans ces réunions, j’observe, j’écoute et je discute pour mieux appréhender à quel endroit je peux servir l’équipe. J’ai repris la lecture de l’excellent ouvrage de Jérôme Ravat, Éthique et polémiques — Les désaccords moraux dans la sphère publique, pour trouver d’autres outils, d’autres leviers pour nos réunions d’équipe, car j’ai peur que le contexte rende les discussions peut-être plus difficiles, les opinions plus tranchées. Animer, faire circuler la parole, trouver absolument des solutions, des conduites à tenir dans un temps court est difficile. C’est un jeu que j’ai envie de partager en même temps que je ressens l’urgence de donner des espaces de respiration aux soignants en formation. J’ai également envie de lire John Dewey, je vais continuer de me nourrir, de questionner, de m’émerveiller et de m’indigner pour que nos métiers vivent. Quelle chance de profiter des idées et des réflexions de philosophes quand on exerce un métier si riche en expériences humaines et dont le quotidien est une expérience de pensée, à condition de se prêter également aux jeux.
Nos métiers exigent ces temps de recul collectif. C’est la condition sine qua non pour agir en hommes et femmes de pensée et penser en hommes et femmes d’action.
Fabienne Deyris Carcedo — Réparations, numéro zéro — Juillet 2022.
—
[1] BERGSON (H), « Message au Congrès Descartes », juillet 1937, Mélanges, édition d’André Robinet, PUF, 1972, p.1579.
[2] CLOT (Y), Le travail à cœur , Éditions de la Découverte, Paris, 2010, p.61.
[3] GEFERS [Groupe d’étude et de formation en éthique de la relation de soin] : Vieillissement, éthique et société. Novembre 2019. « Du plaisir dans les oppositions au soin de nursing » Dr Pierre Azanza et Dr Fabienne Deyris.
[4] « Entretien avec Jacques Derrida — penseur de l’événement », de Jérôme-Alexandre Nielsberg.
[5] STIEGLER (B), De la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation, Paris, Tracts Gallimard, 2021, p.35.



