[Odile Etcheto est aujourd’hui infirmière dans un centre médico-psychologique à Avignon. Plus que de constater, jour après jour, la destruction programmée de l’hôpital public et notamment psychiatrique par les pouvoirs économico-politiques, elle trouve avec ses collègues et depuis ses ressources propres, intellectuelles, psychiques, physiques et émotionnelles, des solutions pour maintenir l’existence de ce bien public, pour les personnes qui ont besoin d’être quotidiennement soignées. Cette générosité et cette éthique est présente à un même degré d’intensité dans sa vie personnelle, traversée par des géographies et des histoires éparses. Depuis cette connaissance, par l’expérience de la multiplicité résidant en soi, et par son intelligence des manières d’être, Odile Etcheto, dans son travail comme dans ses relations amicales et familiales, considère chaque individu dans sa complexité, sociale et personnelle. Elle y parle de son métier. Le texte publié ci-dessous est la retranscription partielle d’un entretien réalisé avec elle les 7 et 8 juillet 2021 au Banchet.]
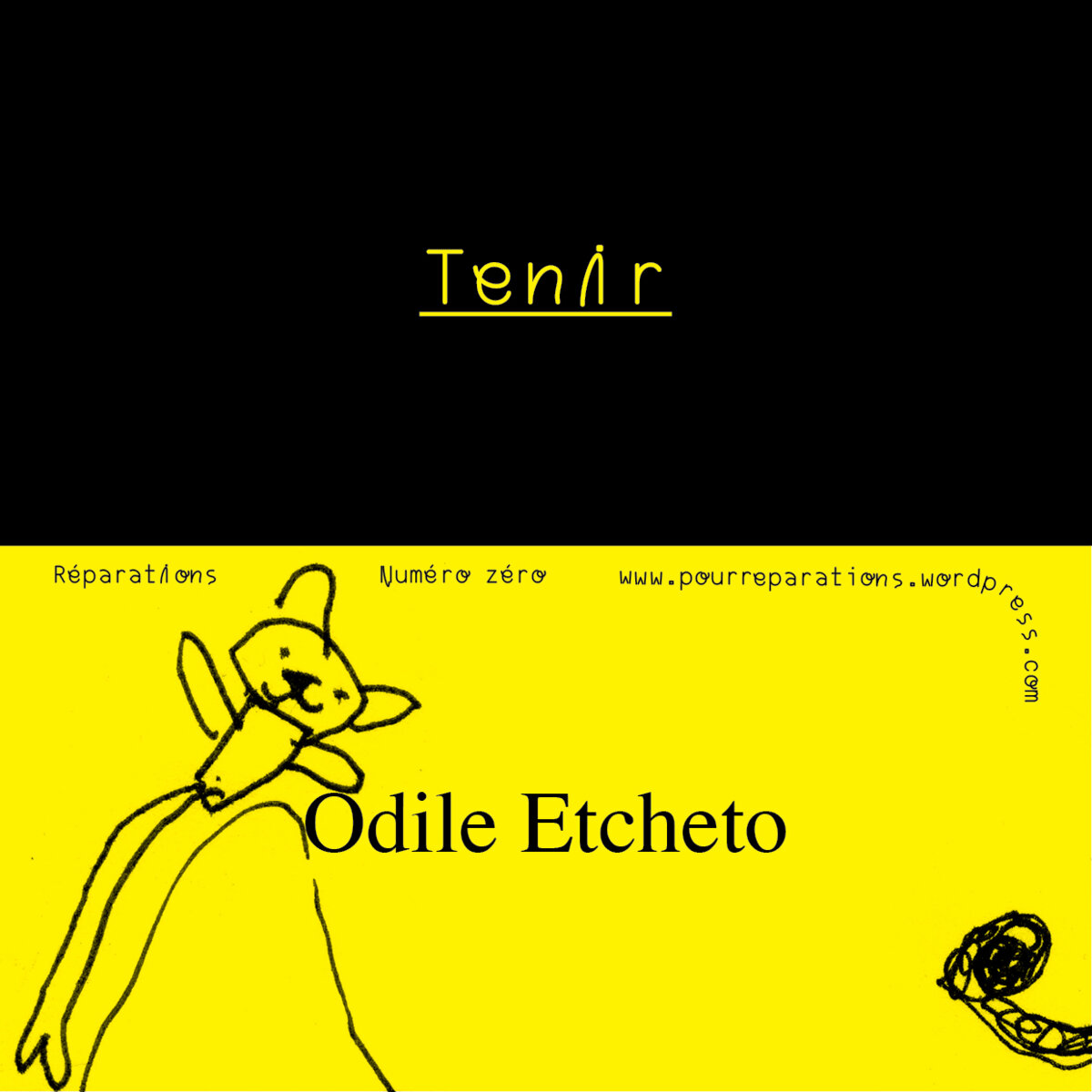
Agrandissement : Illustration 1

Je suis infirmière dans le secteur de la psychiatrie. J’en suis arrivée à travailler comme infirmière dans une deuxième partie de ma vie.
Auparavant, j’ai travaillé dans le secteur culturel et social, et après avoir pris un temps d’arrêt pour m’occuper de mes enfants, j’ai décidé de repartir dans le milieu professionnel dans un secteur qui m’intéressait déjà auparavant, c’est-à-dire le soin. Donc j’ai repris des études sur le tard, alors que j’avais déjà une famille, deux enfants. J’ai repris des études à l’école d’infirmières d’Avignon, qui est une école que je ne regrette pas d’avoir choisie. Notre diplôme est un diplôme double, qui nous permet de travailler et en soins généraux, et en psychiatrie, selon les choix que l’on fait une fois diplômé. L’enseignement était censé nous apporter tout ce qu’il fallait pour pouvoir choisir un de ces deux secteurs. Et à ce moment-là, c’était une formation conséquente.
Il faut savoir qu’avant ce diplôme-là, il y avait deux diplômes différents : le diplôme d’infirmiers en soins généraux, qui avait une formation basée uniquement sur les soins somatiques, et un autre diplôme qui était le diplôme d’ISP — le diplôme d’infirmier de spécialisation en psychiatrie. Ces soignants avaient un enseignement conséquent basé sur la psychiatrie avec des stages uniquement en psychiatrie, ils étaient spécialisés. Quand j’ai fait mes études, l’ISP était une espèce en voie de disparition, l’objectif était qu’on devienne tous des IDE — infirmiers diplômés d’État. Et moi j’ai eu la chance d’être à l’école d’infirmiers d’Avignon — la chance, parce que chaque école a ses tendances, en fonction d’où elle est implantée, de qui la dirige, quels sont les intervenants, et là c’était une école qui était installée dans un hôpital psychiatrique, donc fortement marquée par ça, et aussi avec une directrice qui venait du secteur de la psychiatrie et qui nous a formés dans ce domaine avec une grande rigueur professionnelle. Dans l’enseignement que j’ai suivi il y avait des sciences humaines, de la philo, de la sociologie, des choses comme ça, ça poussait un peu loin la réflexion. Mais quand cette directrice est partie, ça a été repris par d’autres personnes qui n’avaient pas du tout le même parcours. Et avec la transformation du diplôme infirmier, les études d’infirmiers se sont calées sur le parcours de la faculté, de l’université — quelque chose de beaucoup moins spécifique sur la question du « prendre soin ».
Aujourd’hui, il n’y a plus d’école d’infirmières. Il y a eu une coupe drastique sur les heures d’apprentissage en psychiatrie qui font énormément défaut aux étudiants actuels. Quand ils arrivent sur le terrain, il faut leur apprendre et la théorie et la pratique. Moi j’ai eu la chance de passer juste à temps, juste avant cette transformation, et j’ai choisi d’être infirmière en psychiatrie parce que ça m’a tout de suite intéressée. Le milieu de la psychiatrie est complètement différent de celui des soins généraux : il me semblait qu’il y avait une réflexion, une place différente de l’infirmière dans l’équipe. Le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire, d’avoir des temps de réunion et beaucoup de place pour la réflexion.
—
Quand j’ai commencé ma carrière on avait beaucoup plus de moyens humains. J’ai assisté à la diminution des ces moyens au fur et à mesure des années de travail. Peut-être que c’était déjà à l’œuvre quand j’ai commencé à travailler, mais c’est devenu criant quand sont apparues des politiques de santé où il fallait diminuer les coûts, et aussi avec la mise en place du contrôle de la Haute Autorité de Santé qui nous demande de justifier les « actes » faits. Parce qu’on est payé à l’acte.
L’hôpital est payé aux actes qu’il fait, au remplissage, au turnover des lits. Ça veut dire qu’en fonction du nombre d’actes faits, l’hôpital a des budgets qui peuvent varier. Le but des directeurs d’hôpitaux aujourd’hui est d’équilibrer le budget en fonction de l’argent qu’ils reçoivent et de ce que ça coûte. La notion de rentabilité est apparue.
On a un logiciel avec dedans les dossier des patients. C’est un logiciel interne à l’hôpital, il est protégé, et sur ce logiciel à chaque fois qu’on fait un entretien infirmier, une visite à domicile, un entretien psycho, un entretien assistante sociale, une réunion, on doit coter nos actes, nos actions quoi. On doit y entrer qui a fait quoi, quand, combien de temps ça a duré, et en fonction de tout ça, on peut quantifier notre activité. Même si cette quantification ne représente pas notre activité parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas coter.
Comment coter un silence, assise près d’une personne qui a juste besoin d’une présence, par exemple ? Il y a aussi des choses qu’on oublie de coter parce que ça prend un temps fou à faire, et qu’il y a peut-être plus urgent à gérer à ce moment-là.
Le temps passé sur l’administratif dans la journée de travail d’un infirmier est phénoménal, et on ne le passe pas avec les patients. Ça submerge les infirmiers en général.
Avant, on n’actait pas, il y avait un dossier papier, et pour chaque patient, on y notait nos observations, l’état du patient, tous les jours.
Mais en dehors de ça, on actait juste les entrées et les sorties de l’hôpital du patient. L’institution nous faisait confiance, semble-t-il. La cotation c’est aussi le début de la suspicion. En actant, n’importe qui de l’administration ou de nos chefs peut avoir un contrôle sur ce qu’on fait. Et par ailleurs ça conditionne les budgets de l’hôpital à l’activité.
Du coup, nous, on a conscience de ça, et on se contraint à cet exercice pour ne pas perdre de moyens, même si ça nous fait chier. Cela peut avoir des conséquences sur le nombre de postes, sur le nombre de lits...
—
La psychiatrie de secteur, c’est l’organisation de la psychiatrie en France. Il y a un hôpital par département, et le département est découpé en secteurs géographiques, et dans chacun de ces secteurs il va y avoir des CMP — Centres Médico-Psychologiques —, des hôpitaux de jours ainsi que des unités d’hospitalisation. Tout cela, pour être au plus proche de la population.
L’hôpital psychiatrique est utile pour les personnes qui sont à un stade aigu de leur pathologie et qui ont besoin d’être hospitalisées.
L’hospitalisation des patients peut être nécessaire soit pour les contenir, pour mettre en place un traitement, pour les rassurer, pour les observer, soit pour les aider par exemple à mettre en place leur logement, à sortir d’une situation d’insalubrité, ou à trouver des solutions d’orientation.
Notre spécificité, en psychiatrie, c’est qu’on ne peut pas séparer les conditions de vie des gens de la maladie, on est toujours à cheval sur du médical et du social, on ne peut pas faire autrement en psychiatrie du fait de leur fragilité à être dans le monde, dans la réalité parfois. Sinon le reste du temps, la politique de la psychiatrie de secteur met en place une aide pour que les sujets puissent vivre dans la cité. L’idée est de sortir les gens des hôpitaux, de ne pas les chroniciser dans un espace en dehors du monde.
Pendant la seconde guerre mondiale il y a des tas de gens qui sont morts dans des hôpitaux psychiatriques, ils y sont morts de faim parce qu’il n’y avait plus personne pour s’occuper d’eux. Suite au traumatisme que ça a entraîné, mais aussi avec des idées qui émergeaient depuis les années 30, il y a eu un mouvement en faveur d’un virage ambulatoire. C’est-à-dire un mouvement pour en finir avec l’enfermement des fous, et supprimer les asiles, en soignant en dehors des hôpitaux. C’est dans ce contexte qu’a été mise en place la psychiatrie de secteur, dans les années 60.
Et puis il y a eu aussi la naissance des neuroleptiques, qui permettaient de soigner les gens à l’extérieur de l’hôpital. Avant les neuroleptiques, c’était les murs qui contenaient.
L’hôpital s’est donc organisé comme ça : un hôpital pour la crise, et la mise en place des CMP à l’extérieur des hôpitaux pour le suivi des patients psychiatriques, les aider à s’insérer dans la société tels qu’ils sont, et les remettre à une place de citoyens.
Les CMP sont rattachés à l’hôpital psychiatrique. Ce sont des unités de l’hôpital en dehors de l’hôpital. Ils ont été créés dans les anciens dispensaires de santé. Ils sont aujourd’hui un pivot du secteur. Avant, les gens pouvaient passer 50 ans dans un hôpital psychiatrique et y mourir, comme Camille Claudel. Désormais ils vont y passer quelques mois, mais après ils rentrent chez eux. Les CMP ne proposent pas d’hébergement. Ce sont des endroits qui sont ouverts la journée, et qui permettent aux gens d’avoir des consultations médicales, des suivis infirmiers, de rencontrer des assistantes sociales, et aussi de faire des psychothérapies.
Les CMP sont disséminés un peu partout sur le territoire du département. L’idée c’est d’être au plus proche de la population.
Tout ça, c’est une philosophie qui a été pensée dans le cadre de la psychiatrie de secteur. Et ça a bien marché pendant très longtemps. Avec de belles idées, l’utilisation de différentes théories, avec beaucoup de sciences humaines incluses dans la réflexion. Et puis il y a eu les changements politiques et de politiques de santé, avec leurs aspects financiers prioritaires et structurants. Et là on a perdu beaucoup. Tant en moyens qu’en philosophie du soin.
À partir du moment où on a fait du soin quelque chose de mercantile, c’est devenu difficile. C’est encore pire avec la particularité de la psychiatrie qui est un soin avant tout relationnel.
On assiste à l’appauvrissement de l’hôpital. Et bien sûr ça a des conséquences directement sur les patients. On peut dire qu’on a de moins en mois d’outils à utiliser pour aider les patients qui sont en difficulté.
La diminution du nombre de lits s’est faite partout en France, dans tous les hôpitaux, que ce soit des lits de réa, des lits dans les hôpitaux somatiques, en hôpital psychiatrique, partout, partout on a fermé des lits, parce que ça coûte trop cher.
Et la crise du Covid a mis en évidence les dysfonctionnements de la politique de santé qui a été menée depuis 20 ans. C’est une politique qui est dénoncée par tous les acteurs du soin. Les urgentistes sont à bout. Dans les hôpitaux généraux, les infirmières souffrent du travail qu’elles sont obligées de faire, elles doivent courir, courir, courir, parce qu’elles ne sont pas assez nombreuses. Et la qualité du soin est en train de se perdre. Avec ça, l’hôpital n’est plus attractif, ni pour les médecins, ni pour les infirmiers, et ceux qui y sont finissent par s’en aller. La durée de vie d’une carrière d’infirmière est de 8 ans à peu près. Après, elles finissent par aller bosser ailleurs. Il y a énormément de burn out. C’est un secteur en souffrance totale. Parce que c’est un secteur qui travaille avec l’humain, et les infirmiers et les médecins sont en première ligne. Ils affrontent la souffrance humaine, la douleur, la mort, et par manque de moyens ils ont l’impression de ne pas pouvoir faire le maximum, voire d’être maltraitants. Les instances dirigeantes, depuis leurs bureaux, ne sont pas confrontées à cette réalité.
Être maltraitant, je pense qu’on s’en approche. Mais je ne me sens pas responsable en fait. Je ne me sens pas maltraitante en tant que personne, mais par contre le système dans lequel je travaille peut l’être, il peut commencer à l’être. Par exemple on a des files d’attente pour les gens qui ont besoin de rentrer à l’hôpital — on nous demande même de prioriser les niveaux d’urgence, comme en médecine de guerre. Ceux-là, on peut penser qu’ils sont maltraités. Certains sont en grande souffrance et peuvent même en mourir, c’est fou !
Et dans les soins somatiques, ce n’est pas mieux. Il y a des gens qui meurent aux urgences parce qu’ils n’ont pas pu être pris en charge. Donc oui le système est maltraitant. Moi je ne me sens pas maltraitante. Par contre parfois je ne sais plus quoi dire aux patients tant l’institution que je représente n’est plus à la bonne place, celle de la bienveillance et de l’égalité d’accès au soin. On a aussi beaucoup souffert dans notre CMP du manque de médecins. Ça a fini par nous atteindre. C’était déjà le cas dans d’autres services. Par exemple en pédopsychiatrie, c’est la catastrophe la plus totale. Les délais d’attente pour voir un médecin en pédopsychiatrie sont d’un an. Chez nous, pour avoir un rendez-vous avec une psycho- logue, il y a un délai d’un an, un délai d’un an pour avoir accès à une psychothérapie alors que ça peut aussi sauver des vies, des familles.
Les psychologues, elles sont trois, elles ne sont pas assez nombreuses.
Il y a un déficit de psychiatres qui sortent des facs de médecine. Ça ne tente plus les jeunes médecins. Ils ont envie de faire autre chose, plutôt de travailler dans les neurosciences. À l’hôpital public, il faut savoir que les salaires ne sont pas compétitifs par rapport au privé, ils ont été gelés pendant des années et des années, pour faire des économies, donc ce n’est pas du tout attractif pour des jeunes médecins qui sortent de la fac. Et puis on est dans une société où le service public n’a plus du tout la même place dans la tête des gens.
On est quand même dans un système libéral qui exerce son pouvoir partout, même dans l’enseignement, même dans la façon dont on formate les étudiants. Ils ont tendance à aller vers des activités lucratives plutôt que de s’occuper de la communauté, et de s’y investir, comme dans le service public.
Les psychologues demandent à être plus nombreux à l’hôpital public, bien sûr. Mais la réponse de la politique de santé se fait dans le cadre d’une conception neurobiologique de la santé en général, et de la santé mentale en particulier. Il y a une remise en question de tout ce qui a été fondateur de la psychiatrie de secteur, avec par exemple la pratique de la psychanalyse, de la psychothérapie institutionnelle. Tout ça est remis en question comme étant des méthodes non rentables, dans le sens où c’est trop long, ça prend trop de temps, et ça mobilise trop de gens pour pas assez de résultats mesurables.
Mais comment peut-on mesurer le résultat sur de la psychologie, sur de la psychiatrie ? La maladie mentale, par exemple, elle va elle vient, il y a des périodes de stabilité et puis à un moment donné ça craque et nous, on essaye d’être imaginatifs, d’être créatifs pour trouver des projets, des façons de faire pour que chacun avec sa particularité arrive à vivre du mieux possible sa vie dans la cité.
Mais ce n’est pas quelque chose de linéaire. Et donc, la psychanalyse et toutes les pratiques qui prennent du temps et qui s’intéressent à la personne dans sa singularité sont remises en cause. Maintenant on est dans la rentabilité, avec l’émergence — et ça depuis pas mal d’années maintenant — de toutes les thérapies brèves, qui auraient l’avantage d’amener des résultats concrets plus rapidement. On ne sait pas quand ça va émerger chez un être humain, combien de temps ça va prendre pour qu’il y ait des choses qui se passent en lui, ça on ne sait pas, on n’est pas des machines. Chacun son propre temps.
Aujourd’hui on favorise de plus en plus les thérapies comportementales, dites brèves.
Tout ça fleurit avec les recherches génétiques sur le gène responsable des maladies mentales. Tout doit désormais s’expliquer par des causes neurobiologiques, et plus par un ensemble d’événements qu’a pu traverser le sujet. Et le tout orienté vers le recours à la chimie, au grand bénéfice des laboratoires.
On est dans une libéralisation de la politique de la santé, et une déconstruction du service public pour aller vers sa privatisation.
Le manque d’organisation, le manque de lits, le manque de moyens, tout ça a été mis en évidence par la pandémie du Covid. Et on aurait pu espérer que ça fasse réagir les pouvoirs publics, tout de suite, et qu’ils mettent en place de nouvelles priorités. C’était super intéressant cette crise sanitaire parce que ça mettait en lumière tout ce que les gens dénonçaient depuis des années. Eh bien ça n’a pas suffi.
On a continué à fermer des lits pendant la pandémie, ça ressemblait à une sorte de rouleau compresseur que personne ne peut arrêter.
C’est une aberration.
Avec la crise des masques, au début de la pandémie, on s’est retrouvés, nous, les soignants, dans une espèce d’état de sidération, parce qu’on ignorait ce que c’était que ce Covid. On l’a tellement annoncé comme la peste du xxi e siècle qu’on s’est sentis fragiles, menacés par ce virus, et nos patients aussi on les a sentis fragiles et menacés. Nous n’avons pas du tout été épaulés par nos institutions. On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de masque en France, qu’il n’y avait pas de gel hydroalcoolique, qu’il n’y avait pas d’oxygène en France pour les gens qui étaient sur les lits de réa. On s’est sentis quasiment abandonnés.
En début de pandémie, on nous a livré 5 masques pour 15 jours, pour 13 personnes. Alors nous on en a ri mais ça donne une idée de l’état désastreux de l’organisation de la politique de la santé en France.
On a eu très peur au début de la pandémie parce qu’on se demandait ce qu’allaient devenir nos patients, avec leurs fragilités. Notre CMP n’a pas fermé contrairement à d’autres. Nous avons choisi de rester ouverts, et on appelait tous nos patients, tous les jours, au téléphone. Pour savoir où ils étaient, comment ils allaient. Parce qu’on avait juste peur d’en retrouver un mort chez lui. Mais aussi pour mesurer à quel point tout ça les atteignait. On a eu peur pour eux. On a eu très peur pour eux. Donc on recevait encore les patients, on allait vers eux. Les psychologues ont fait du télétravail. C’était mieux que rien, c’était synonyme de ne pas disparaître dans un monde devenu étrange et sans repères connus par eux. Deux assistantes sociales qui étaient fragiles de santé ont télétravaillé aussi.
Un des médecins a complètement disparu pendant le premier confinement, il s’est mis au vert. Nous n’avions déjà pas beaucoup de médecins, alors le boulot a été assuré par le seul qui restait. Et nous, les infirmiers, on n’a pas bougé. Nous étions tous là. Voilà. Ce n’est pas qu’on soit meilleurs que les autres, mais si nous on disparaît eh bien il n’y a plus personne dans l’horizon des patients.
—
Cette crise sanitaire a bousculé plein de trucs, elle a mis en évidence plein de choses. Mais on a tenu. On s’est serré les coudes.
On a tenu parce qu’on s’est engagés dans un service public, on s’est engagés auprès des patients. On est là pour eux.
On a tenu parce qu’on travaille en équipe. On a tenu parce qu’on a l’habitude de se parler et de réfléchir ensemble. Ce travail de réflexion on s’y est accrochés plus que jamais, la situation était inédite donc il ne fallait pas s’éclater, mais se poser. Nous avons continué à nous réunir malgré les consignes de la direction, qui nous limitait dans cette partie de notre activité sous prétexte de nous protéger. Pas plus de 4 dans la même pièce disaient-ils, et nous étions 13. Nous on s’est dit que ça n’était pas possible. Chacun de nous est important, et ignorant. On a tous besoin de se parler, alors on va parler des patients, mais on va parler aussi de ce qui se passe, on va parler de comment il est possible de rebondir, on va parler de nos possibilités de faire mieux ou de comment juste bien faire.
On a tenu. On a résisté quelque part. La colère nous a envahis aussi et on l’a transformée en force de travail.
Mais comment on tient ? On tient parce qu’on espère. On est peut-être des idéalistes mais on espère qu’un jour tout ça va s’arrêter, on se dit que ce n’est pas possible que ça aille encore plus loin. Même si régulièrement on a la mâchoire qui tombe un peu plus, à chaque fois qu’on découvre une nouvelle orientation politique, d’autres restrictions, d’autres protocoles qui n’ont pas forcément de sens. À chaque fois on est dégoûtés, dépités. On est affaiblis. On ne peut pas dire le contraire, on est affaiblis. On est affaiblis, quand même. On le sent. Parfois on est obligés de se donner des coups de pied au cul.
Parce que parfois on fait le minimum pour le patient, alors qu’on pourrait faire mieux. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire sur « comment on tient ». Je ne sais pas. À part que tant qu’il est possible de donner un sens à ce que l’on fait tous les jours, tant que cela a un sens, on tient. Il y a eu tellement d’épreuves dans l’histoire de ce pays pendant lesquelles les gens ont tenu.
Nous savons qu’on ne reviendra pas complètement en arrière.
Mais on se dit qu’à un moment donné, de toute façon, ces politiques, ces théories libérales, cette comptabilité de l’humain, c’est ça qui ne va pas tenir. Déjà on le voit, on arrive au bout de ce système-là, il s’épuise. Bon. Tu vas me dire que la folie humaine peut aller loin.
Mais je n’arrive pas à croire que ça va aller jusqu’à l’implosion.
En tout cas, ce système, s’il s’écroule complètement, ce n’est pas le privé qui va réussir à compenser. Ce n’est pas possible. Donc il va y avoir des conséquences sur la santé des gens, que ce soit dans les soins généraux ou dans la psychiatrie, ça va causer beaucoup de malheur, beaucoup, beaucoup de malheur. Je pense qu’on va vers quelque chose de grave, de très grave. La pauvreté matérielle s’est accrue terriblement. La pauvreté de la santé va suivre le même chemin. Donc soit ça va jusqu’à l’implosion totale, soit les gens réagiront, exigeront de leurs politiques autre chose. Ou alors oui ça va péter. Et il faudra rebâtir autre chose sur les ruines. Mais de toute façon ça ne pourra pas continuer comme ça, ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible parce que ça montre déjà ses limites. Comment vont faire ceux qui suivent ?
Ce qui est important aussi c’est la question de la transmission.
Parce que nous, on va partir à la retraite. La nouvelle génération d’infirmiers qui arrivent reçoit un enseignement très pauvre en psychiatrie. Nous, on est importants dans cette chaîne-là, du côté de la transmission de notre philosophie. C’est un fonctionnement de la pensée qu’on essaye de transmettre avant de partir. C’est ce qu’ont fait les ISP, en leur temps, eux qui ont vu s’écrouler leur monde professionnel. Quand les infirmiers spécialisés en psychiatrie ont été confrontés au fait que leur spécialité disparaissait, qu’elle n’allait plus exister, qu’elle n’était plus enseignée, ils ont été catastrophés.
Il a fallu qu’ils tiennent dans le nouveau système. Et malgré tout, ce qui a perduré c’est la transmission de leur savoir.
Bon, il y a de la perte. On ne peut pas tout transmettre. Ce n’est pas possible. Mais en tout cas c’est quelque chose que nous, à notre niveau, on essaie de maintenir. On a des étudiants en stage, régulièrement. Nous sommes un maillon de l’enseignement des étudiants infirmiers. Mais on constate qu’il y a de moins en moins de stages inclus dans leur formation, ainsi que de moins en moins d’enseignement théorique sur la psychiatrie. Cette responsabilité nous incombe aussi sans que ce soit dit. On a conscience de ça. Il faut qu’on leur insuffle la théorie et la pratique. De toute façon on peut jamais faire l’un sans l’autre, en psychiatrie ce n’est pas possible.
Alors oui on s’y attache beaucoup à cette question de la transmission.
Il y a parfois des chocs de cultures théoriques, d’école de pensées, parce qu’ils arrivent avec les nouvelles théories enseignées dans les écoles, sur les neurosciences, les thérapies courtes...
—
Devant cette situation inédite où les dangers viennent d’une part de l’extérieur par une pandémie qui entraîne des morts, et d’autre part par des dangers intérieurs, du fait de la fragilisation de l’institution qui nous enlève les moyens et les outils nécessaires pour prendre soin, et qui continue son œuvre de destruction, implacablement, et de manière morbide, même pendant la crise sanitaire, il a fallu tenir, oui. Tenir la barre, tenir ensemble, tenir les patients. Et le pire des dangers ou des risques dans ce genre de situation aurait été d’être envahis par un sentiment d’impuissance. Ça nous aurait mis à terre.
L’impuissance comme perte du désir. Du désir d’agir. De continuer à agir. Comme dirait Spinoza : « la puissance d’exister et d’agir. »
Nous avons tenu parce que nous avons continué à avoir une action dans ce monde. Nos responsabilités par rapport aux patients nous ont maintenus dans cette puissance et ce désir. Ça nous a permis par exemple de décider que l’unité resterait ouverte, accueillante pour les patients alors que soudainement tout était éteint, fermé. La vie était arrêtée. Malgré les risques, le manque de masques, le choc d’une situation inédite, nous ne nous sommes pas laissé envahir par l’impuissance. Nous avons continué à agir d’un commun accord, en collectif. Alors que d’autres CMP ont décidé de fermer leurs portes tout en maintenant une présence téléphonique, nous, nous avons pu rester ouverts et continuer à recevoir les patients en présentiel. Pour nous c’était évident que nous n’allions pas installer une méfiance par rapport au risque de contamination dans nos rapports avec les patients, fragilisés par le contexte. Ça aurait été la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase. Pour nous, ce n’était pas possible. Nous avons continué à rencontrer les gens en chair et en os. On sait trop l’importance de la présence physique, de l’implication du corps dans nos relations, les uns avec les autres. Le langage non-verbal. Les regards. Les sourires, même masqués, même derrière des masques. Les mouvements des bras. Les accompagnements vers la porte. Le fait de les recevoir, de les faire entrer dans un bureau. Tous ces mouvements sont importants. Et tout ça, ça nous a fait tenir, parce qu’on ne s’est pas laissé être les objets des événements en cours. Ce qu’on faisait avait un sens. Nous avons maintenu notre désir d’agir et d’être cohérents. Nous, nous avons eu cette chance. D’autres ne l’ont pas eue, parce qu’ils ont été soumis à un cadre beaucoup plus serré, à une charge professionnelle inhumaine dans des conditions de travail indignes. Je pense à mes collègues des urgences où des services de réa par exemple. Je me demande, eux, comment ils ont tenu, et quels ravages ça a occasionné chez eux.
Comment on tient dans l’équipe ? Quand je pose la question à mes collègues — comment on tient ? —, Rosy dit qu’en CMP on peut encore prendre le temps pour les patients. On échange entre nous et on arrive à offrir une continuité de soin et de présence aux patients. Moi c’est ce qui me fait tenir dit Rosy. Le docteur Bourgeois, lui, il dit ici on soigne les patients à 95 % par une aide humaine. Mais ça, ce n’est pas ce qui se profile à l’avenir, avec la cérébrologie, c’est-à-dire avec le fait que tout devient neurologique et biologique. Miloudia, elle, elle dit : moi ce qui me fait tenir c’est rencontrer des gens, croiser des histoires, c’est ça qui fait tenir. Je crois que je suis encore utile. Je sais que je suis encore à ma place, pour l’instant. Mais je ne sais pas si je supporterai la charge de travail d’ici à la retraite. Si je ne supporte pas je partirai, parce que moi, dit Miloudia, je n’arrive pas à accepter les dérives actuelles. Et ce qui se prépare comme projets pour la santé mentale, ce n’est pas ça qui m’a fait venir en psychiatrie. Je ne pourrai pas, je préférerai faire autre chose. Rosy dit : moi je dis que quel que soit l’endroit où on bosse en psychiatrie il y aura toujours des personnes qui réfléchissent, qui cherchent à donner du sens, ce n’est pas possible que tout s’arrête, la transmission c’est important.
Comment on tient ? On tient ensemble, en groupe, en équipe, grâce au collectif. Et pour le sujet, dans toute sa singularité. On tient parce qu’on est sûr d’être à sa place, une place choisie, travaillée, élaborée, précisée auprès de l’autre. L’autre, c’est le patient, sujet malade, auprès duquel on a choisi d’être, c’est ça notre place, elle est là, près de l’autre, prêt à relever, prêt à soutenir, prêt à entendre.
Grâce aux liens qui nous unissent, aux liens qui se tissent. Être là, à une place presque immuable, comme une garantie que l’homme est là pour l’homme, toujours, et quoi qu’il arrive. Une solidarité dans laquelle nous nous sommes engagés, quoi qu’il arrive. Un engagement d’humains pour l’humain, contre vents et marées. Que les vents soient des pandémies, que les marées soient des aberrations institutionnelles. Nous sommes la grève entre ça et vous. Comment résister aux événements tout en étant toujours les mêmes. Nous avons tenu ensemble. L’équipe s’est soudée. Le collectif a réfléchi. Comment faire avec les protocoles pour rester ce que nous sommes, pour vous.
Nous avons contrevenu aux diktats d’une institution désorganisée, incapable de nous protéger. Nous avons décidé par nous-mêmes de ne pas nous laisser tomber, d’être là. Nous avons opposé au protocole notre créativité. Nous avons inventé des méthodes de travail, osé dire nos peurs, nos limites, et les risques que nous étions prêts à prendre.
Parler, échanger, face à la catastrophe annoncée. Nous avons tenu ensemble et sur la durée. Qu’est-ce qui nous a fait tenir ? La solidarité du collectif. Quand je flanche, quand je doute, un autre prend la barre. Le collectif qui admet la sensibilité de l’autre, qui l’entend.
Ce qui nous fait tenir, c’est l’engagement dans le service public, le bien commun pour le bien de l’individu. Ce qui nous fait tenir c’est d’être des êtres humains en connexion avec d’autres êtres humains.
Nous continuerons. Nous nous battrons contre l’adversité qui tente de nous faire disparaître. Parce que nous serons toujours libres de faire des relations humaines le cœur de notre travail. C’est notre unique but, notre unique valeur. Il y a des subtilités humaines qui sont inaliénables, et qui n’entreront jamais dans une logique comptable.
Odile Etcheto — Revue Réparations, numéro zéro — Juillet 2022



