[La mise à l’écriture chez Isabelle Querlé peut ressembler à une lutte sociale, une résistance transclasse. Ses premiers dispositifs, objectivistes, sériels et mécaniques comme un travail à la chaîne, sont autant de travail en perruque, temps d’écriture volé sur le travail salarié, ce temps de travail, ce temps de travail comme matériau – par exemple dans un aéroport, à partir d’un stand de boulangerie, pour la série Vues d’aéroport. La force reproductive du corps de la femme est observée de la même manière dans les Lettres au Capitaine, écrites tandis que l’enfant se fabrique/est fabriqué. Depuis ces lettres, et dans le texte ici publié, se pose la question philosophique du sujet, jamais perçue dans notre société comme possiblement pluriel, notre tradition philosophique occidentale n’ayant été formulée que par des hommes dont l’expérience ontologique reste immuablement unitaire. Interroger l’implicite, pour en révéler les idéologies sous-jacentes passe aussi dans le travail d’Isabelle Querlé par la coordination du groupe Hymen Redéfinitions, qui travaille à rendre au mot hymen la matérialité qu’il recouvre, et à défaire le lien véhiculé entre cette matérialité et la notion de virginité.]
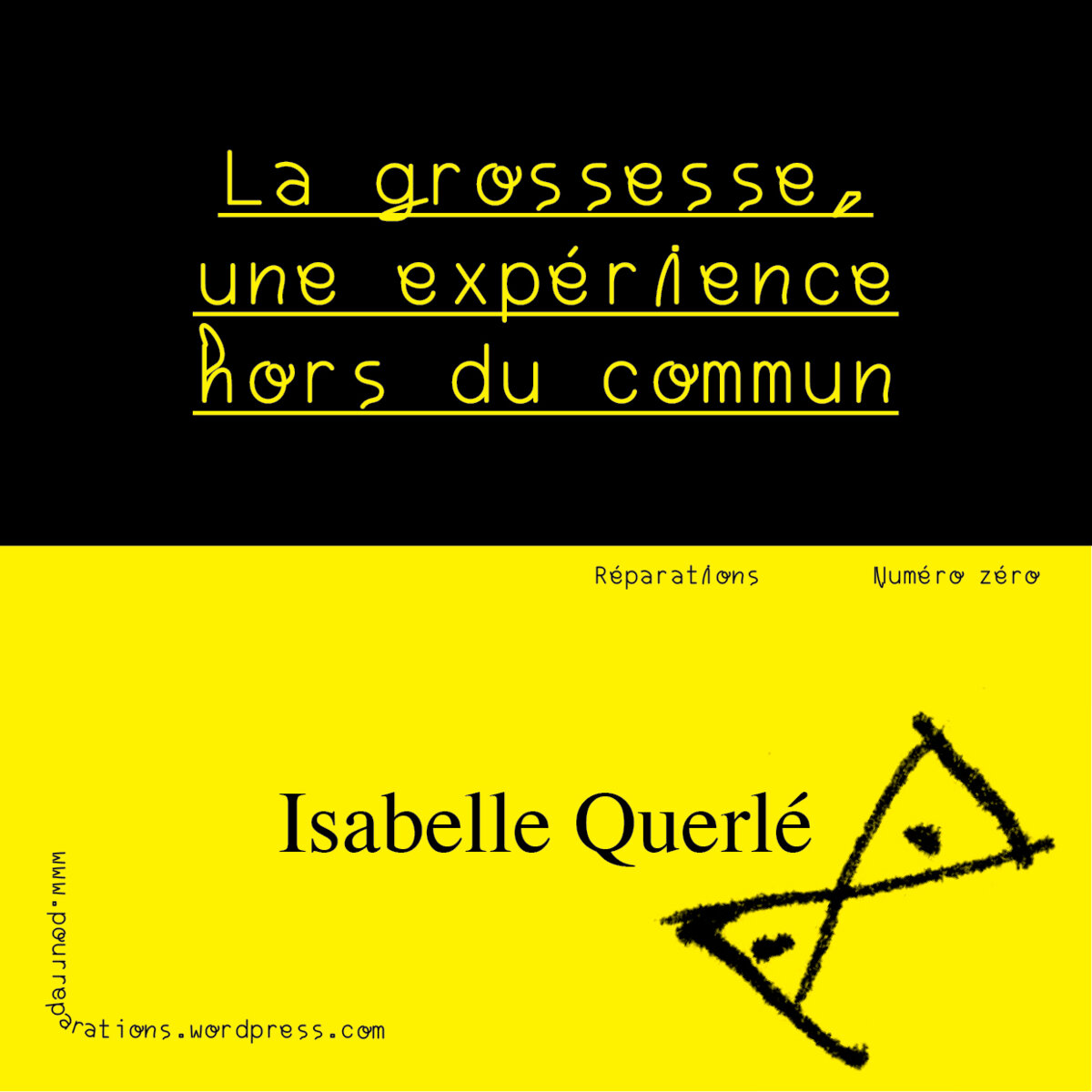
Agrandissement : Illustration 1
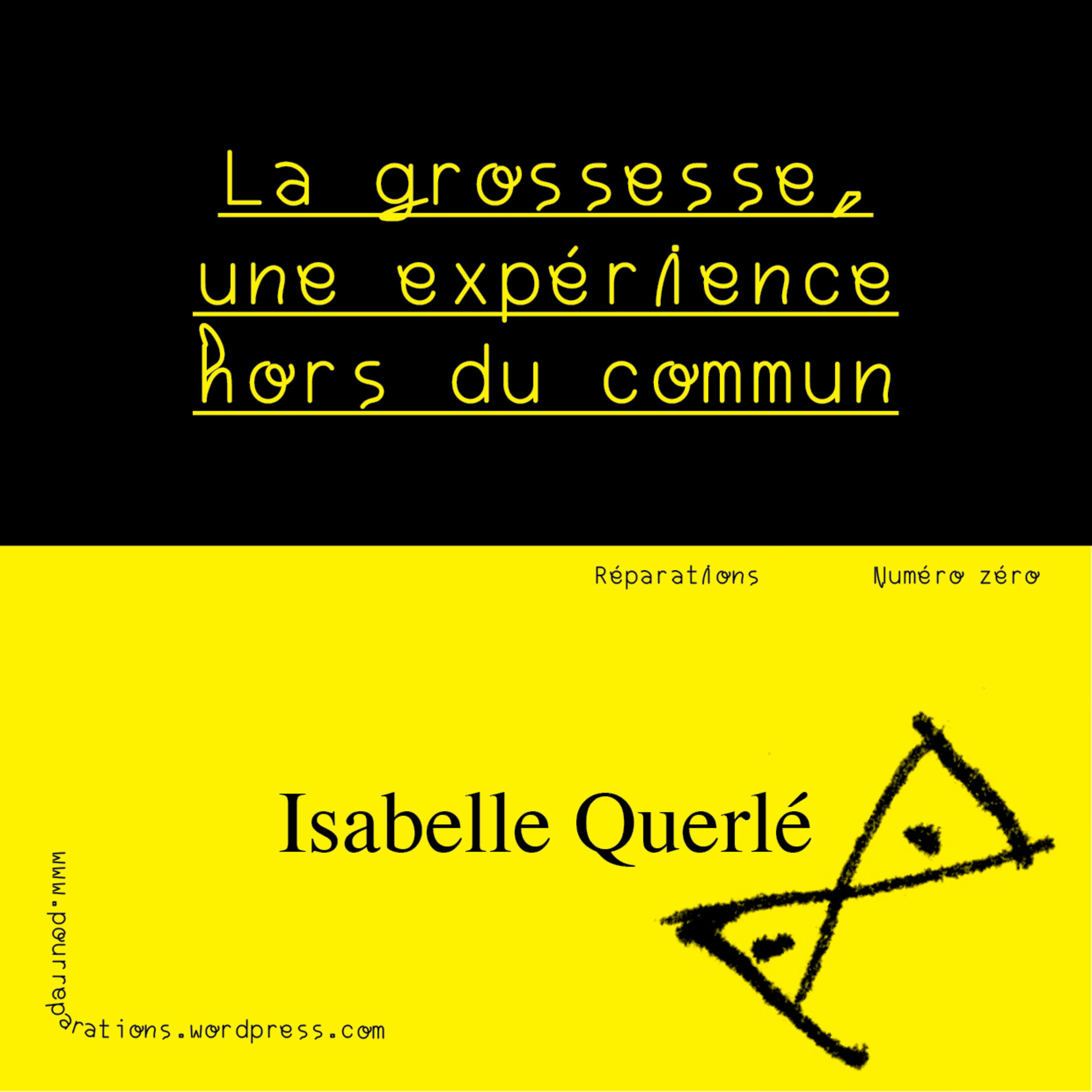
I. L’expérience
Il y avait le monde, il y avait la peau. Il y avait toi, ta peau.
Les autres, leur peau.
Chacun son corps, chacun sa peau.
Simple. [1]
_
[1] Tous les textes en italiques (sauf mention contraire) sont extraits de mon travail poétique disponible sur le site http://www.isabellequerle.wordpress.com.
J’ai 42 ans, je suis une femme individualiste dans une société indivi- dualiste qui valorise les parcours de vie individuels. Jusqu’à mes 36 ans, je savais ce que voulait dire réussir sa vie, je savais que je ne la réussissais pas mais, bon, passons. J’avais une vision claire, simple de ce qu’est une vie, de ce qu’est un corps.
Et puis un jour ton corps explose.
Une grossesse, deux grossesses, un bouleversement. La grossesse est un état extra-ordinaire où l’on voit son corps se modifier sous nos yeux comme un retour à la transformation adolescente, où l’on voit son corps devenir un monde en soi, un cosmos, un environnement pourvoyant gîte et couverts à ce qui deviendra peut-être un autre être humain. C’est un moment où l’on peut incarner un nous ambulant, soi et l’hôte, relié·e·s 24h/24. Et, la grossesse est une expérience qui modifie profondément notre rapport au moi, à l’identité.
C’est quoi une frontière intérieure ? C’est quoi un ailleurs au centre ? Je peut-il être plusieurs ? Si Je est plusieurs, est-ce qu’avant, Je n’était pas vraiment Un ? Si Je est Un alors où commence l’hôte ? Où finit Je ? Est-ce qu’on est moins entier quand on est deux ? Un être humain dans un être humain, ça fait combien d’êtres humains ?
Le moi, selon le Robert, c’est « ce qui constitue l’individualité, la personnalité d’un être humain ». L’individu, étymologiquement c’est le « corps indivisible » (Le Robert), c’est l’unité de base de l’humanité. Alors, que devient-on quand, dans le cadre d’une grossesse, on partage son corps avec un autre être humain ? Divisée, je deviens quoi ?
Et ce corps minuscule, enfermé entre les murs de ses cellules, n’est plus le tien. Tu es devenue un monde en soi, un biotope, un cosmos. Au cœur de tes entrailles, un territoire indécidable, à la fois totalement tien et totalement autre se développe, repousse estomac, foie, poumons, pour se faire sa place. Pendant 9 mois, tu es tous les sexes à la fois, clitoris & pénis et tu vois une partie de ton corps sortir de toi et s’animer et grandir et devenir soi et toujours un peu toi. Ton corps déborde ton corps, déborde le monde. Tu ne comprends plus rien.
Le premier constat, c’est l’absence de références communes sur ce sujet. Quand je me suis demandé « Qui, que suis-je pendant cette expérience ? », aucun texte, aucune pensée, rien n’est remonté de mes souvenirs concernant ce que j’appelle le moi enceint. Seules quelques références approchantes me sont venues à l’esprit :
Sigourney Weaver qui murmure d’une voix grave, toute de shantung orange « There is no Dana, there’s only Zuul » dans Ghostbusters ; un livre de Jean-Luc Nancy, Êtres singuliers pluriels […], « Je est un autre » de Rimbaud bien sûr, Norman Bates, assis sur sa chaise, dans Psychose, recouvert d’une couverture râpeuse ne laissant dépasser que sa main droite, ne disant rien, nous fixant de son regard, tête de mort subreptice, laissant toute la place à la mère, « je n’écraserais même pas cette mouche ». La boucle est bouclée : l’enfant, autrefois hébergé dans le corps de la mère, héberge à son tour l’esprit maternel.
Les histoires de corps ou d’esprits partagés existent mais très peu concernent directement la grossesse à part peut-être Rosemary’s Baby de Polanski qui montre une possession du corps de la femme par l’autre. Mais je ne me sentais pas uniquement « prise par l’autre », c’était plus compliqué que ça. Devant cette difficulté à trouver des réponses à la question du moi enceint, je me suis dit, là, il y a quelque chose à chercher. Si tu l’as senti, d’autres l’ont senti. Si tu commences à le penser, d’autres l’ont pensé. Allez, vas-y, creuse.
II. Les recherches
Je suis une chercheuse amatrice, je n’ai pas accès au réseau des bibliothèques universitaires, des revues, Google est ma bibliothèque. Sans viser à l’exhaustivité, ce que je veux montrer ici, c’est une série de rencontres et l’impact de celles-ci sur mes questionnements sur le moi enceint.
J’ai rencontré le travail des philosophes féministes différentialistes françaises : Antoinette Fouque, Julia Kristeva et Luce Irigaray. Elles se sont penchées philosophiquement sur les spécificités du corps « féminin ». C’est un travail difficile d’accès pour moi, la langue est abstraite, influencée par la psychanalyse. J’ai, dans ma bibliothèque, le livre Speculum (publié en 1974) de Irigaray mais je ne parviens pas à y entrer, c’est un mur, alors qu’on y trouve cette expression « ni une ni deux » qui décrit tellement bien l’état de grossesse.
J’ai entendu Kristeva dire dans une conférence intitulée Le corps maternel [2] que le corps de la femme enceinte est « plein » et je me suis dit « et les femmes qui n’ont pas d’enfant, elles sont vides ? » Je ne pense pas que la maternité soit LA réalisation pour une femme, elle peut être « pleine » de bien d’autres choses qu’un enfant.
_
[2] Le corps maternel, conférence aux rencontres philosophiques de Monaco, 27 avril 2017. Disponible sur YouTube.
Les travaux de Fouque, eux, me posent question parce qu’ils accordent une valeur morale à l’expérience de la grossesse et de la maternité. Par exemple, dans un discours pour le droit à l’hospitalité, elle dit ceci : Nous, femmes, avons reçu pour l’espèce humaine le don d’héberger, dans notre corps, le corps différent, nous qui, à chaque naissance, témoignons que l’hospitalité charnelle est une chance de vie nouvelle, nous qui, par notre expérience intime, bénéficions d’une personnalité xénophile démocratique [3]. Déjà, induire que femme = mère = grossesse, c’est douteux (toutes les femmes ne sont pas mères, toutes les mères ne sont pas enceintes, toutes les personnes enceintes ne sont pas des femmes). De plus, moraliser et valoriser ainsi l’expérience de la grossesse me semble problématique parce que grossesse et accueil ne sont pas synonymes : la mère peut refuser d’accueillir l’enfant et refuser le nous par le déni de grossesse, l’avortement ou le rejet de l’enfant à venir. Problématique aussi parce que ce type de propos laisse de côté l’ambiguïté profonde de la maternité. La procréation est un don et une malédiction, le travail du care est bienveillance et soumission, la maternité est aliénation de son corps et annexion d’un autre corps. Oui, il y a Marie, Gaïa, Bonne Maman, mais n’oublions pas Médée, Agrippine, Marine Le Pen, Monique Olivier, les électrices de Trump… Bref, pas une grande rencontre avec les féministes différentialistes (Fouque a une vision assez rétrograde sur la question du genre par exemple) mais une ren- contre fertile tout de même parce que j’ai pu me situer par rapport à ce discours féministe historique sur la question de la grossesse.
_
[3] « Pour une hospitalité citoyenne », 1997, dans le recueil de textes Gravidanza, 2007, Éditions des femmes.
J’ai rencontré le travail de la philosophe Elselijn Kingma sur la métaphysique de la grossesse dont la thèse est que le fœtus est un organe temporaire de la mère (Kingma utilise un terme plus général dans son travail, « part », partie, mais je trouve le terme d’organe plus parlant) qui prend son autonomie au moment de la naissance. Ses arguments sont d’ordre biologiques. Cette philosophe est à la tête du seul programme de recherche philosophique en Europe autour de la grossesse : le B.U.M.P [4] , à l’université de Southampton en Angleterre. Son travail est descriptif et laisse de côté les conséquences morales.
_
[4] Site internet du programme de recherche. Il y a des articles en anglais disponibles. http://www.bump.group. J’ai découvert son travail par cette conférence sur YouTube, The Metaphysics of Pregnancy : http://www.youtube.com/watch?v=COZEansw_Ts.
Pour montrer la difficulté à penser de façon simple le passage d’un corps (celui de la femme avant la grossesse) à deux corps (celui de la mère et de l’enfant après la grossesse), je souhaite faire dialoguer la théorie d’Elselijn Kingma avec celle des chrétiens (entre autres) qui tient que le fœtus est un être humain dès le premier amas de cellules. Théorie qui tient davantage, elle, sur des bases morales.
Reprenons :
1. Théorie d’Elselijn Kingma : fœtus = organe temporaire → la femme reste Une pendant toute la grossesse. La théorie est biologiquement plausible mais un fœtus, ce n’est pas seulement un bout de chair qui se développe. En cas de grossesse voulue, on projette, on lui donne un nom, on communique avec le bébé à venir. De plus, un fœtus est viable aujourd’hui à partir de 22 semaines de grossesse. L’humanité précède donc la naissance. Si l’on considère que le fœtus appartient au corps de la mère jusqu’à la naissance, une des conséquences théoriques serait la possibilité de l’avortement jusqu’aux derniers mois de grossesse puisque « mon corps m’appartient », pour reprendre le slogan féministe. Ce qui m’intéresse dans le travail de Kingma, c’est qu’elle vient apporter de la complexité à un modèle qui arrangeait tout le monde : la mère d’un côté, le fœtus de l’autre (elle parle du modèle du gâteau dans le four, le gâteau ne faisant pas partie du four). Que se passe-t-il justement pour l’ego de la mère face à ce mélange manifeste des corps ?
2. Théorie chrétienne (entre autres) : fœtus = être humain à protéger dès le début de la grossesse → Deux personnes sont en présence pendant toute la grossesse. Là, le problème c’est que la personne enceinte devient un simple réceptacle (le four du gâteau) n’ayant aucun contrôle sur ce que fabrique son propre corps. De plus, les impacts physiologiques et socio-économiques parfois dramatiques qu’impliquent une grossesse sont secondaires face à l’importance de conserver « la vie » (pour reprendre les mots des anti-avortement).
La première théorie est avant tout philosophique. La deuxième est morale et elle est mise en place dans de nombreux pays par le biais d’une interdiction de l’avortement. La législation sur l’avortement de chaque pays vient en effet répondre à la question : à quelle date le fœtus rentre-il dans l’humanité pendant la grossesse ? Ce sera à 12 semaines de grossesse en France, 24 semaines en Angleterre, 18 semaines en Suède… Au-delà de cette durée (sauf exception médicale), le fœtus devient une personne protégée par la société.
Après ces recherches, je vois à quel point il est impossible de trouver LE moment où d’une personne, tu deviens deux. Il n’y a pas d’octroi, pas de checkpoint. « Ni une, ni deux » pour reprendre les mots d’Irigaray ou tout aussi bien « et une et deux ».
J’ai rencontré l’article Pregnant Embodiment de Iris Marion Young en lisant Women Monstrosity and Horror Film / Gynaehorror de Erin Harrington sur la figure féminine dans les films d’horreur (la vierge, la femme enceinte, la vieille sorcière… chouette livre que je conseille aux anglophones).
Le sujet enceint, selon moi, est décentré, divisé ou doublé de plusieurs manières. La femme vit son corps comme sien et non sien. Ses mouvements intérieurs appartiennent à un autre être, mais ils ne sont pourtant pas autres, parce que les limites de son corps changent et parce que la localisation corporelle de son moi est située dans son torse en plus de sa tête. (traduction personnelle)
Pregnant Embodiment [5] (la traduction est complexe : Le corps enceint, pas ça, La grossesse incorporée, bizarre, L’incarnation enceinte, Faire corps enceinte…) vient poser le problème du moi enceint (qu’elle nomme plutôt « sujet enceint ») et fait dialoguer sa théorie avec celles des philosophes phénoménologues français comme Merleau-Ponty. Celui-ci remet en effet en question « les catégories sujet et objet, intérieur et extérieur, moi et monde » mais « n’abandonne pas toutefois l’idée d’un moi unifié comme une condition de l’expérience ». Ce texte pose clairement une particularité du moi enceint par rapport aux théories traditionnelles du moi. Il s’agit, à mon avis, du texte de référence sur la question.
_
[5] « The pregnant embodiment », article écrit en 1984, disponible dans Throwing Like a Girl, And Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory, Indiana University Press, 1990.
J’ai rencontré le travail des biologistes Diana Blanchi et J.Lee Nelson sur le micro-chimérisme [6] en faisant des recherches sur la notion de « soi » en biologie, qui désigne ce qui appartient ou pas à un organisme. Le micro-chimérisme décrit le fait que nous avons toustes dans le corps des cellules vivantes de nos mères (voire de nos grand-mères) et que les personnes qui ont connu des grossesses conservent dans leur corps à la fois les cellules de leurs mères et celles de toutes les hôtes de leurs grossesses, terminées ou non. On conserve donc la trace de l’autre en soi toute notre vie. Ce qui expliquerait pourquoi les femmes sont davantage victimes de maladies auto-immunes (maladies qui ne sont plus alors si « auto » que cela).
_
[6] Pour plus de renseignements, voici le lien vers une présentation du microchimérisme postgestationnel réalisée par Laetitia Albano pour un cours de l’université de médecine de Nice, http://www.soc-nephrologie.org/PDF/epart/industries/gambro/2011/13-albano.pdf.
J’ai failli rencontrer le travail de Adrienne Rich dans Of Woman Born mais j’ai oublié le livre sur un banc à Brest (partie remise…)
III. Et Alors ?
Il existe donc des travaux qui, depuis les années 70, testent les théories du moi comme principe unifié à partir d’une expérience vécue par une grande partie de la population. Quelle est l’influence de ce travail sur la considération de la question du moi de façon générale (c’est-à-dire non féministe ) ?
J’ai lu l’article « Je » du Dictionnaire du vocabulaire philosophique européen, l’article « Moi » de Wikipédia, l’article « Moi » de l’Encyclopédie Universalis, rien sur l’expérience de la grossesse. J’ai lu le Dictionnaire encyclopédique des identités, ouvrage généraliste paru en 2020 qui comporte bien des entrées sur la greffe (à laquelle on compare souvent la grossesse) et sur le fœtus (l’autre partenaire) mais rien sur le moi enceint ou sur le corps maternel. Pas de trace non plus de l’expérience de la grossesse dans les quatre épisodes « Le moi dans tous ses états » de l’émission Les chemins de la philosophie sur France Culture.
Rien.
Tout le monde s’en fout.
Alors qu’il y a des femmes philosophes qui travaillent sur le sujet depuis les années 70.
Pourquoi ?
1) La société patriarcale, bien sûr, pour qui la question féminine n’est pas la question humaine. Que ce qui concerne l’homme comme catégorie de genre concerne tout le monde et que ce qui concerne la femme concerne… la femme et reste donc cantonné au rayon féministe de la bibliothèque.
« C’est pénible les classements de la Bibliothèque Nationale de France : je découvre que mon livre et mon recueil de philosophie féministe sont classés en féminisme et non en philosophie. Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir est en littérature et en féminisme, pas en philo. La philosophie féministe n’est pas de la philosophie ? » (Manon Garcia, entretien à Libération, le 6 mai 2021)
2) L’agenda féministe dans une société individualiste : la priorité du féminisme occidental a longtemps été de se libérer de l’esclavage de la reproduction non choisie (et c’est tout à fait logique). Il s’est agi de faire de la femme une individue comme les autres, la grossesse et la maternité étant appréhendées uniquement sous l’aspect de l’aliénation. Il y a donc peu de travaux féministes sur le sujet de la grossesse par des personnes concernées. Mais en 2021 il faut se rendre à l’évidence : en France, la majorité des personnes pouvant porter des enfants le font (idéalement comme elles le veulent, et quand elles le veulent). Il est donc temps de réfléchir la grossesse d’une façon plus complexe et de l’intégrer à la réflexion féministe.
Un jour un ami m’a dit : « Mais, ça ne te suffit pas que cette réalité du moi soit présente dans des livres féministes ? » Non, ça ne me suffit pas. Parce que créer des théories sur le moi humain et l’identité en excluant l’expérience d’une grande partie de l’humanité, c’est malhonnête. Et puis, me rendre compte que cinquante ans de pensée féministe n’ont pas changé d’un iota les imaginaires communs, ça me fait mal. Je n’ai jamais aimé les sous-catégories (en littérature : science-fiction, polar, érotisme contre la grande littérature blanche ). « Femme » n’est pas une sous-catégorie. Je veux ouvrir n’importe quelle encyclopédie et trouver des réponses à mes questions, surtout quand elles concernent une expérience aussi fréquente que la grossesse.
—
Pour finir, je pense que ce qui m’a touchée dans l’expérience de la grossesse, c’est que j’ai vécu deux mouvements contradictoires :
D’un côté, être enceinte a été pour moi une expérience relevant du commun : faire corps avec un autre être humain, partager une expérience avec des générations de femmes avant et après moi. En tant que personne très individualiste, la grossesse a été aussi un révélateur de l’importance du « nous », de l’inanité de mythes comme celui du self-made-man, comme si on pouvait se faire tout seul… Un révélateur aussi de la manipulation présente derrière la valorisation à outrance de l’individu de notre temps qui nous isole, nous culpabilise et vise à empêcher toute lutte collective.
Mais,
Dans le même temps, ma grossesse a aussi été une expulsion du commun parce l’impact de cette expérience sur mon individualité m’a laissée seule, sans connaissance partagée. Avec ce corps multiple aux frontières intérieures floues, avec ce moi en expansion, j’ai compris que je n’étais plus une individue, puisque je me divisais, mais je n’avais pas de mots pour savoir ce que j’étais en train de devenir. J’ai dû chercher longtemps, lire des textes en langue étrangère, rebondir d’un texte à l’autre pour retrouver des mots qui disaient ce que je vivais. J’aurais préféré taper « moi enceint » ou « moi grossesse » sur ma barre de recherche et voir s’afficher une longue liste de références.
Aucun aphorisme, aucun slogan ne parvient à exprimer ce que tu es aujourd’hui dans ce bain-ci. Force vibratoire, chat de Schrödinger aquatique : à la fois un et deux, l’un et l’autre, je et nous. Tu es la porteuse de tout un cosmos à l’intérieur d’un ballon musculeux. Rimbaud a écrit « Je est un autre » pour toi, tu le sais.
Tu es un monstre.
Et on retrouve cette antienne d’un commun réducteur qui fait tant de mal : le commun c’est UNE expérience de vie, celle du corps dominant du moment, pour notre part, l’homme blanc bourgeois valide (etc.). C’est son expérience du monde qui prévaut. Et comme son corps est UN, le corps est UN, comme son esprit est UN, l’esprit est UN. Et tout ce qui sort de ce schéma sort du commun et des représentations.
À tout cela, je préfère cette phrase lue, minuscule, côté pile d’une pièce nord-américaine : E pluribus, unum. De la multitude vient l’unité.
Isabelle Querlé — Réparations, numéro zéro — Juillet 2022.



