[Depuis sa propre expérience et le chemin de recherche qu’elle se fraie elle-même, avec opiniâtreté, dans les milieux militants joyeux et ailleurs, Alix analyse les impasses relationnelles que notre société orchestre — qu’il s’agisse des scolarités institutionnelles, du modèle du couple hétéronormé, des oppressions de genre — et questionne notamment nos intelligences émotionnelles. Ici, le texte proposé aborde la notion du care, mettant en perspective sa non-reconnaissance comme pratique féminine profitant aux relations, et son appropriation par le développement personnel au profit du modèle capitaliste et de l’autonomie individuelle. Au-delà de penser ces rapports, Alix les met en œuvre au quotidien avec ses proches, les apprenants et apprenantes pianistes qu’elle accompagne, et les collectifs dans lesquels elle s’inscrit, cherchant à traverser les situations de tensions et de conflits par la création de dispositifs expérimentaux. Par le désir de défaire les situations d’oppressions.]
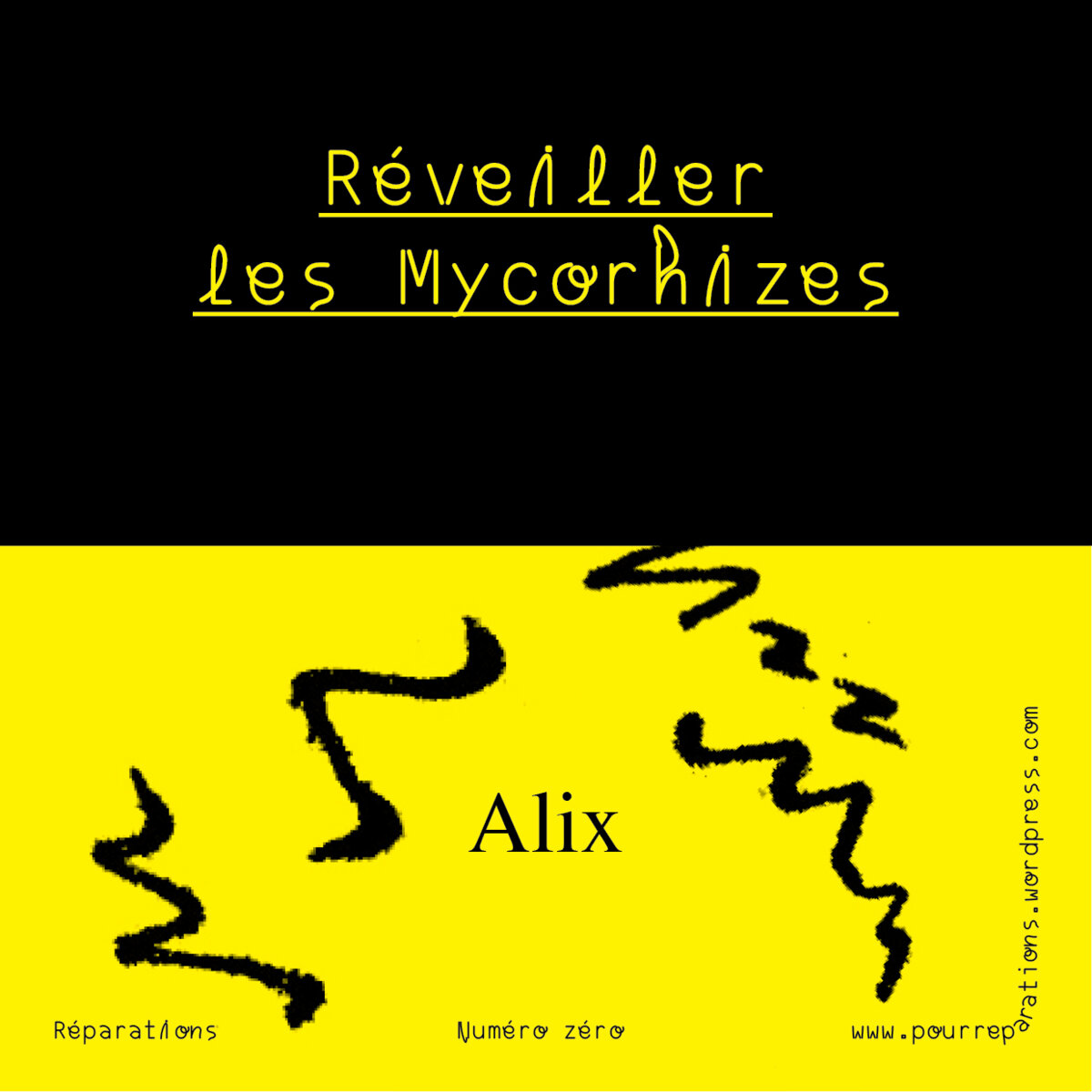
Agrandissement : Illustration 1
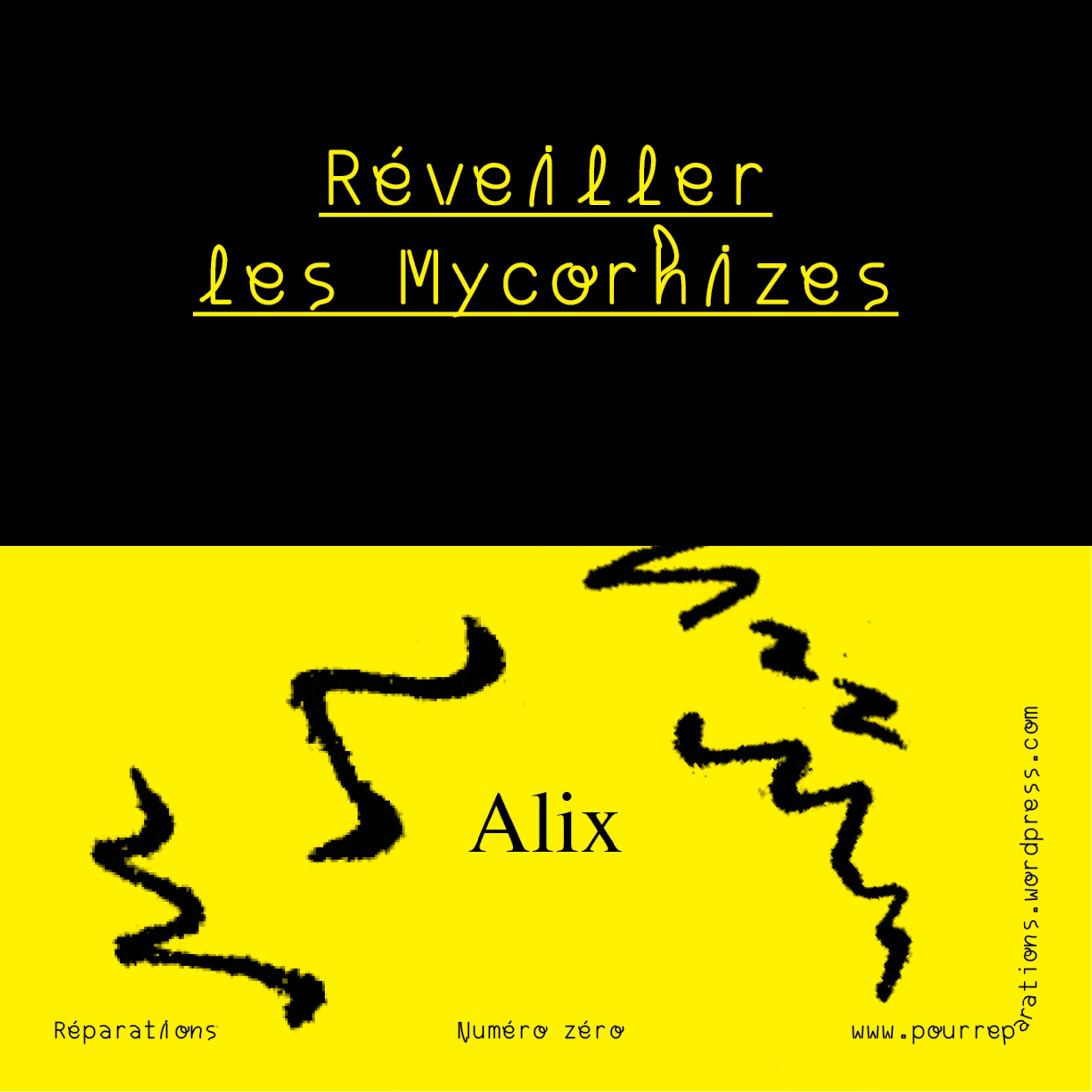
Appel
« Moi ma conviction, c’est qu’il faut ré-affectiver le monde du travail. Reconnaître les émotions qui nous traversent dans leur diversité, dans leur ambivalence. Leur faire une place, ni trop, ni trop peu. En apprécier la valeur. Et à mon avis, c’est une manière de résister aux logiques gestionnaires et managériales, de recréer du collectif, et de lutter chacun à sa manière contre les effets délétères des organisations du travail contemporaines. »
Aurélie Jeantet, sociologue, Conférence TedX, Les émotions, source d’inégalités et de domination.
—
En 2018, dans sa BD Le pouvoir de l’amour, Emma, ingénieure informaticienne et dessinatrice, invente une nouvelle notion qui se propage comme une traînée de poudre : la charge émotionnelle. La charge émotionnelle « désigne la propension à se soucier d’autrui et à offrir des signes d’affection ou d’attention », et elle est « particulièrement développée par les femmes, dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée » °. La création de cette expression permet de mettre au jour un travail invisible assigné aux femmes. Le tour de force de son approche consiste à dénoncer non pas la charge émotionnelle en cherchant à la dégrader pour que les femmes s’en retirent, mais à la revaloriser en interpellant les hommes sur leur responsabilité à « faire l’effort d’investir cette sphère émotionnelle. En étant plus à l’écoute, plus empathiques. En tentant de comprendre et de satisfaire, eux aussi, les besoins de leur entourage. »°° . La charge émotionnelle ne doit pas être lâchée par les femmes, mais prise par les hommes.
Si l’angle d’approche est intéressant, la notion, elle, ne rencontre pas beaucoup de fondements scientifiques. Emma étaye son concept sur une interprétation erronée de l’emotional labour°°° d’Arlie Hochschild, sociologue américaine ayant « ouvert la voie à la sociologie des émotions », comme le dit la quatrième de couverture de son livre Le prix des sentiments — Au cœur du travail émotionnel. Cet « emotional labour », traduit en français par « travail émotionnel », désigne les tâches qu’un·e travailleu·r·se effectue au sein d’un travail rémunéré, tâches ayant pour objectif de maintenir le comportement social jugé culturellement adéquat dans le métier donné. Il crée chez la personne une aliénation à ses propres sentiments et sensations. Arlie Hochschild refuse explicitement l’interprétation de ce concept telle que la fait Emma°°°° . Cependant, cette dernière n’est pas la seule à faire cette erreur, et l’on peut interpréter cette méprise récurrente comme une preuve de la nécessité à nommer un impensé.
C’est plutôt chez Carol Gilligan que l’on peut trouver un concept permettant de nommer le travail invisible qui consiste à prendre soin de l’autre et des relations. Dans son livre Une voix différente — Pour une éthique du care, elle explore la relation entre genre et morale et répond aux conclusions des travaux de Lawrence Kohlberg, qui avec son « échelle du développement moral » en était arrivé, entre autres observations, à la conclusion que les femmes sont moralement moins évoluées que les hommes. C’est en s’entretenant avec des femmes que Carol Gilligan parvient à faire apparaître un biais dans le travail de Kohlberg : la définition de la morale telle qu’utilisée dans ses travaux serait adaptée au genre masculin mais pas au genre féminin, ce qui expliquerait la différence observée. Elle propose une nouvelle forme de morale, pratiquée par les personnes de genre féminin : l’éthique du care. Son livre Une voix différente sort en 1983 aux États-Unis, et en 2008 en France. La notion de care débarque en France plus de vingt années après sa conceptualisation en Amérique, pour mettre au jour la partie immergée de l’iceberg... Dans l’ombre de la vie politique, marchande, et institutionnelle, quelque chose d’important se trame ; un travail muet, qui est pourtant la base de toute société : maintenir le lien humain.
Dans la lignée du travail d’Emma, visant à encourager la pratique d’un féminisme mixte et local (voire domestique), et dans la lignée du travail de Carol Gilligan, visant à explorer le nouveau paradigme de care, je propose d’étirer le concept de care au-delà de l’éthique, pour en explorer les moindres recoins. L’éthique du care est un nouveau territoire sur lequel nous venons tout juste d’accoster, et nous nous trouvons dans une posture sensiblement semblable à celle que la science éprouve depuis la naissance de la physique quantique : nouveau paradigme, tout est à repenser.
La différenciation femme/homme que fait Carol Gilligan est évidemment à prendre avec des pincettes. Lorsque nous parlons d’« homme » ou de « femme », de « masculin » et de « féminin », nous parlons ici d’un genre social °°°°° , et non d’une sexuation ou d’un genre identitaire°°°°°° . La binarité est inévitable dans cette étude, non pas parce qu’elle est fondée psychologiquement ou scientifiquement, mais parce qu’elle est un fait social.
Nous utiliserons les termes de carer°°°°°°° (les personnes qui sont dans les pratiques, l’éthique, les attitudes, du care, et qui sont majoritairement issues du genre social féminin) et de cared-for (les personnes qui sont prises en soin par les premières). Le choix de mots anglais n’est pas définitif et toute traduction pertinente de ces termes serait bien-venue. Jusqu’ici, le terme care ne trouve que des traductions controversées n’exprimant pas l’étendue de l’acception anglophone. Par conséquent, j’ai décidé de privilégier le « goût » de ce mot sur le regret de perpétuer l’hégémonie de la langue et de la culture nord-américaine.
L’éthique « de la raison » (si l’on cherche à nommer le pendant « masculin » de l’éthique du care), organise en despote l’intégralité de la société. Cour de Justice, Éducation Nationale, économie marchande, élections présidentielles, capitalisme, sont autant de concrétisations de cette morale, qui ne prennent que très partiellement en compte l’éthique du care. Lorsqu’elles la prennent en compte, c’est parce que la logique, reine au royaume de l’éthique de la raison, en arrive à un excès trop ouvertement délictueux : l’inhumanité. Alors, l’attitude du care sera adoptée par défaut, et les gestes qualifiés d’« humains » seront acceptés, mais avec dénigrement et méfiance, de manière à conserver le caractère despotique de l’éthique de la raison. Le résultat de la tyrannie de l’éthique de la raison est ce que Marcel Bolle De Bal, dans son article Reliance, déliance, liance : émergence de trois notions sociologiques, nomme « société raisonnante » : une « société de raison » prise de la « folie raisonnante », consistant à tout compartimenter systématiquement et ayant pour résultat une « déliance » généralisée.
Les personnes de genre social féminin sont imprégnées par défaut d’une éthique du care via une éducation genrée (à laquelle elles sont néanmoins plus ou moins attachées). Leur insertion dans la société ne devrait pas se faire via leur conversion à l’éthique de la raison, qui laisse de côté un savoir-faire précieux et leur demande une adaptation coûteuse et éventuellement contrainte. Au contraire, elle devrait se faire via un déploiement de leurs pratiques du care de la sphère privée aux sphères politique, économique et sociale, ceci transformant, réorganisant, voire réinventant radicalement les dispositifs qui caractérisent notre société. Nous ne serions plus alors dans un rapport de domination de l’éthique de la raison sur l’éthique du care, perpétuant la paupérisation des métiers et des praticien·ne·s du care, mais dans une complémentarité salutaire et indispensable, dans laquelle gagner ou prendre soin ne sont pas respectivement une force et une faiblesse.
Explorer le care passera par le fait de donner des noms à ce qui existe déjà. L’économie du care, la pédagogie du care, les pratiques du care, les compétences du care, sont à nommer si l’on veut qu’une société saturée de l’éthique de la raison les reconnaisse comme légitimes. Tout est là, il n’y a plus qu’à dire.
—
Faut-il visibiliser ce qui est invisible ?
Le monde des affects est-il montrable ?
Faut-il disséquer le care pour convaincre de son bon fonctionnement et de sa légitimité ?
Ou devons-nous revendiquer le respect de ce qui ne se montre pas ?
Demander une confiance là où l’on nous demande une transparence ?
—
° Article Wikipédia « charge émotionnelle ».
°° Le pouvoir de l’amour, Emma.
°°° Littéralement « travail émotionnel ».
°°°° The Concept Creep of « Emotional Labor », Julie Beck dans The Atlantic.
°°°°° Genre social = c’est la classe de genre à laquelle vous appartenez, indépendamment de votre volonté. En fonction de votre sexuation à la naissance, un genre vous est attribué, celui-ci vous conditionnant dans certains comportements. L’éthique que vous adopterez dépend de cette assignation.
°°°°°° Genre identitaire : « gender identity » en anglais, est le genre que vous vous sentez être.
°°°°°°° Littéralement : « aidant·e ».
°°°°°°°° Littéralement : « entretenu·e, pris·e en soin ».
—
Care et fatalité
« Le véritable amour, c’est faire passer les besoins des autres avant les siens. »
[V.O. : « True love is putting someone else before yourself. »]
Olaf dans La Reine des Neiges.
Voici les paroles d’Olaf expliquant à Anna (sœur de la Reine Elsa) ce qu’est l’amour. Traumatisée dans son enfance par l’arrêt brutal et inexpliqué de sa relation sororale et par la séquestration dont elle est victime jusqu’à un âge avancé, la pauvre jeune femme, une fois libre, est aussitôt victime d’un manipulateur (eh oui, pas d’bol). Au sortir de cette relation, elle est également mourante car son cœur a été accidentellement glacé par sa propre sœur (décidément...). Elle recherche désespérément à recevoir un geste d’amour véritable et doit par conséquent distinguer un véritable amour d’une relation toxique. Olaf, petit bonhomme de neige drôle et tendre, lui explique donc en ces mots ce qu’est l’amour.
Comme j’étais en attente de la vérité sur cette affaire (c’est quoi l’amour ? est-ce qu’un dieu existe ? pourquoi vit-on ? et cœtera), mon intérêt éveillé a été choqué par cette leçon : c’est donc cela qu’on apprend aux petites filles. En quelques mots : aimer, c’est se sacrifier.
—
En entrant dans une relation de care, les carer entrent dans une logique d’interdépendance, où le travail effectué maintient une personne en vie, ou la maintient en-dehors de la souffrance ou de la douleur. Les carer ne peuvent arrêter leur travail qu’en étant relayé·e·s, ou en acceptant de nuire à la vie ou au bien-être d’une personne.
—
« Moi j’ai fait l’expérience de mon gamin malade que je ne voulais pas amener chez le pédiatre parce que c’était tout le temps à moi de l’amener chez le pédiatre. J’ai dit à son père : « Tu t’en charges ! » Il ne l’a pas fait à temps, le gamin a fini avec un tympan percé. […] Ce que j’ai fait c’est horrible, mais en même temps, ce n’était pas mon tour. »
En voyant des chaussettes sales par terre, j’ai pété les plombs.°°°°°°°°°°
Titou Lecoq.
Sur Twitter, diverses réactions d’internautes aux paroles de Titiou Lecoq :
« Quand on emmène pas son gosse chez le médecin parce que c’est pas notre tour c’est le ministère de la connerie qu’il faut appeler. Mais ça n’existe pas encore, trop de boulot. »
« C’est pas hallucinant, c’est normal ! C’est toi qui est hallucinante. T’es folle. C’est toi qui aurais dû aller à l’hôpital. Pas pédiatrique, psychiatrique. »
« C’est précisément ce que tu as fait connasse. Je suis père de famille, fier de l’être et mon fils passe avant tout. Savoir que des déchets comme toi ont des enfants à charge me répugne. En fait, tu gardes juste ton enfant pour les allocs. »
—
« On reconnaît principalement un fait social à ce signe que [la résistance au changement d’une chose] ne peut pas être modifiée par un simple décret de la volonté. »
Les Règles de la méthode sociologique, Émile Durkheim.
—
°°°°°°°°°° www.youtube.com/watch?v=40dEig6KldI
—
DP et privilège
Le DP (développement personnel) et le care manipulent tous les deux le système Moi-L’autre-Les autres. Le bien-être d’un·e individu·e dépend de son contexte, ou encore : le fonctionnement d’un groupe est soumis aux agissement des individu·e·s.
Mais si ces deux pratiques travaillent le même système, elles ne cherchent cependant pas à agir avec la même intention. Le care est pratiqué par une personne dans l’intention d’agir positivement sur les individu·e·s qui composent son environnement : prendre soin de l’autre, des autres, des relations. Le carer est un instrument : son bien-être n’est pas une finalité mais un moyen pour le bien-être de l’autre. Le sacrifice de son propre bien-être peut faire partie, pour le carer, des options envisageables pour arriver à sa finalité. On est centré·e sur les relations et les autres. Dans le cas du DP, au contraire, c’est l’épanouissement de la personne qui est visé. C’est l’inverse du care : l’environnement doit être bon parce que la personne doit s’épanouir. On est centré sur soi.
Donc si le care a une intention purement altruiste avec un égoïsme collatéral, le DP a une intention purement égoïste avec un altruisme collatéral, même si, comme les frontières sont poreuses du fait que le « Soi » est pris dans un système relationnel qui dépend de fait des autres, ni l’un ni l’autre ne peuvent être, en pratique, strictement altruiste ou égoïste. Le DP demande donc des compétences qui sont les mêmes que celles du care, mais ces compétences sont pratiquées dans une autre intention.
—
Le DP rapporte beaucoup d’argent.
—
Je suis assez tôt tombée dans la potion magique : un milieu grouillant de pratiques destinées à un mieux-être. Adolescente, j’ai été touchée par Émile ou De l’Éducation et Les Confessions (Jean-Jacques Rousseau). Je me suis formée en Communication Non Violente (Marshall Rosenberg), j’ai pratiqué la Sophrologie (Alfonso Caycedo), la Somato-Psycho-Pédagogie (basée sur les recherches d’Eve Berger), l’Analyse Transactionnelle (Eric Berne) et l’Approche Centrée sur la Personne (Carl Rogers). J’ai rencontré la Maïeusthésie (Thierry Tournebise), la Biodanza (Rolando Toro Araneda), la Psychosynthèse (Roberto Assagioli). J’ai assisté à des Constellations Familiales (Bert Hellinger). J’ai fermement étudié la Sociocratie (Gerard Endenburg) et les Cercles Restauratifs (Dominic Barter). J’ai fait différents tests de personnalité tels que l’Ennéagramme (Georges Gurdjieff), et à cet effet, j’ai lu Les cinq blessures qui empêchent d’être soi (Lise Bourbeau). Je m’adonne régulièrement à des lectures d’horoscope. J’évolue dans le monde de la « parentalité bienveillante » parce que mes enfants ne vont pas à l’école (les grands noms de la parentalité bienveillante : Isabelle Filliozat, Thomas Gordon, Aletha Solter). Je côtoie de très près des unschoolers (André Stern, John Caldwelt Holt, et la très marginale et fabuleuse Mélissa Plavis) et les théories des pédagogies « nouvelles »(Maria Montessori, Rudolf Steiner, Ovide Decroly, Célestin et Elise Freinet, etc.). Discuter avec des platistes est une seconde nature pour moi et je croise de temps en temps des personnes qui me disent se nourrir de lumière (en tout cas, ils ont entendu parler de quelqu’un·e qui le fait). Les concepts interprétés et parfois issus d’appropriation culturelle telles que « Univers », « bienveillance » ou « Karma » sont pour moi monnaie courante. Depuis quelques temps, des collapso un peu perdus grossissent nos rangs... Lorsque je travaille, j’utilise des Mindmaps (Tony Buzan) et des tableaux kanban (du japonais : « étiquette ») et il m’est même arrivé de lire Tim Ferriss pour repenser mon économie...
—
Soit une grande majorité d’hommes blancs occidentaux cis-genres et hétérosexuels.
Soit, dans un monde patriarcal, capitaliste et occidentalo-centré, les personnes les plus privilégiées.
—
Le DP rapporte beaucoup d’argent.
—
Dans un geste ultime de haine, je m’élève, moi, dégoulinante et dégoûtante, de ma vase m’arrachant, de mon marécage puant, moi, grande prêtresse à la traîne lourde de la boue qui m’enfante, grouillante et foisonnante de vipères et de rats, et de moustiques et de tiques et de sang et de bacilles du choléra, grande symphonie de l’emmerdement féministe ! Pour être une infection, une Peste, la onzième plaie d’Égypte ! Je débarque, moi, à l’happiness-party du vingt-et-unième siècle, toute de rose vêtue, du rose bien rosé (je me suis changée) qui met en valeur la pointe bien pointue de mon couteau super-flippant, et sur le grand autel de la sociologie, moi, je vais le dépecer, je vais me le faire moi, ce bâtard, cette pseudo-magie, fausse discipline, rognure des sciences humaines, ce suppôt du néo-libéralisme, je vais te me le faire frire ce triste individu, de ses yeux implorant une pitié illusoire, et qui ne servirait à rien, non, qui ne servirait à rien, tant il est déjà presque mort, ce supplicié, presque déjà tout mort et qu’on se demande s’il n’est pas déjà en enfer, le suppliant — le supplicié je veux dire — et que je vais, HAHA, me le faire en papillotes ! me le dévorer en bouchée à la Reine ! que de Reine, il n’y a PAS ! Si ce n’est MOI ! HAHAHAHA !
Achever
le
développement personnel
—
Care, résilience et marchandise
« La dette, c’est ce qui se passe dans l’entre-deux : quand les deux parties ne peuvent pas encore se séparer, parce qu’elles ne sont pas encore égales. Mais elle opère dans l’ombre de l’égalité finale. Cependant, puisque atteindre cette égalité détruit la raison même d’avoir une relation, tout ce qui est intéressant se passe dans l’entre-deux. Tout ce qui est humain, en fait, se passe dans l’entre-deux — même si cela signifie que tous les rapports humains de ce genre comportent, fût-ce à dose infime, une élément de criminalité, de culpabilité, ou de honte. Pour les femmes Tiv que j’ai évoquées en début de chapitre, ce n’était pas vraiment un problème. En faisant en sorte que chacune ait toujours une toute petite dette envers les autres, elles créaient de fait une société humaine, même si elle était très fragile — une délicate toile d’araignée faite d’obligations de rendre trois œufs ou un sac de gombos, de liens renouvelés et recréés, puisque chacun d’entre eux pouvait être supprimé à tout moment. »
Dette, 5000 ans d’histoire, David Graeber.
—
Les personnes dominées sont des personnes soumises à un « pouvoir sur » (« pouvoir » étant compris comme « pouvoir d’agir »). Elles subissent le pouvoir d’agir des personnes dominantes, qui « peuvent agir sur »°°°°°°°°°°° elles. Lorsqu’on subit du pouvoir-sur, on est poussé·e à mobiliser (si l’on a déjà intégré cette compétence) ou à développer certaines attitudes du care comme l’empathie, permettant de « manipuler » la personne dominante pour éviter qu’elle use de son pouvoir sur soi. Une forme de soin (dont la finalité n’est pas de prendre soin mais de survivre) est ainsi donnée par la personne dominée à la personne dominante. Cette utilisation particulière du care est nommée par Elsa Dorlin, dans son livre Se défendre : une philosophie de la violence : le care négatif ou dirty care (c’est carrément plus badass).
Le care négatif est utilisé dans une situation d’interdépendance subie, contrairement au care tout court, dans lequel on s’implique initialement par choix (mais dans lequel on peut également se retrouver piégé·e du fait que l’économie du care répond à d’autres lois que l’économie marchande). L’interdépendance dans ce cas-là n’est pas désirée mais impossible à défaire. Le care négatif est alors une forme de résilience de la personne dominée, piégée dans une relation toxique, et dans laquelle son unique pouvoir d’agir sera cette hypervigilance lui permettant de survivre.
—
Le DP n’a jamais été considéré comme une continuation du care.
Il naît de la transformation des compétences pratiquées du care — c’est-à-dire un savoir-faire — en discours et méthodes — c’est-à-dire un savoir. Le care préexiste au DP, il a existé de tout temps. Les compétences, les attitudes et la pratique qui leur sont communes préexistent au DP et sont pratiquées de manière invisible et non rémunérée (jusqu’à une insertion économique des femmes, et dans ce cas, la rémunération est associée aux gestes du prendre soin et non au care en lui-même). Les personnes ayant développé les théories du DP s’inspirent de toute cette tradition hors-circuit et l’intègrent d’une part à un domaine intellectuel et d’autre part à une économie marchande, pour leur bénéfice financier et intellectuel personnel, et ce, sans citer de sources.
Si l’on considère les deux genres sociaux – féminin et masculin – comme deux mondes différents avec chacun leur propre culture, le DP est une forme d’appropriation culturelle de l’éthique du care. Ce geste d’appropriation d’une classe dominante sur une classe opprimée est d’autant plus désobligeant lorsque l’on se rend compte que son outil, le care, est le fruit et l’outil de la résilience des personnes dominées.
—
— C’est un mec. Il fait exactement ce que je fais depuis longtemps avec ma mère, ma sœur, ma grand-mère, ce que fait mon arrière-grand-mère, ma cousine, mes tantes. Le mec fait pareil. Sauf qu’il écrit un bouquin dessus. C’est un bouquin révolutionnaire. Il le vend. Après, il forme des gens. Les formé·e·s deviennent des formateurs. Les formateurs forment ma mère, moi, ma sœur, ma grand-mère [ad libitum] pour faire ce qu’on fait déjà depuis super longtemps mais maintenant on a un certificat et on peut revendiquer qu’on sait faire, le truc qu’on faisait déjà. On est très contentes parce que c’est la première fois qu’on se sent reconnues pour ce qu’on sait faire.
— Tu veux dire que tu paies pour apprendre un truc que tu sais déjà faire mais qu’il faut qu’on dise que c’est un mec qui te l’a appris pour que tu puisses vraiment dire que tu sais le faire ?
— Exactement.
—
°°°°°°°°°°° Je reprends cette notion de l’article Le pouvoir d’agir — Pouvoir sur, pouvoir de, pouvoir avec du site gentilvirus.org.
—
Ô mes amies
« Nous crachons sur Hegel. La dialectique maître-esclave est un règlement de compte parmi les collectivités masculines. Elle ne prend pas en considération la libération de la femme, la grande opprimée de la civilisation patriarcale. La lutte de classe comme théorie révolutionnaire développée à partir de la dialectique maître-esclave exclut également la femme. »
Carla Lonzi, Crachons sur Hegel.
—
Si je suis un arbre et si tu manges mes fruits. Si mes fruits te plaisent mais que tu ne peux pas les vendre. Si ton objectif, c’est d’être riche.
Alors mes fruits te plaisent mais ne satisfont pas ton plan. Tu pourras pester. Moi, mes fleurs vont continuer de fleurir, et mes fruits continuer de mûrir. Presque malgré moi.
Si tu décides d’abattre cet arbre pour y faire pousser des fruits, aussi bons mais vendables. Je pourrai jouer ton jeu. Je pourrai me greffer, me tuteurer, m’arracher, ou même replanter une autre image de moi. Parce que, coupable de ne pas être parfaitement à ton goût, je voudrai te plaire, et vous plaire, et pour vous plaire, faire que mes fruits soient vendables.
Mais je ne le ferai plus. Scie-moi, tu verras.
J’ai même envie d’être une forêt tu vois. Une arbre, deux arbres, une immense forêt d’arbres, qui fructifient sans produire et mycorhizent bras-dessus bras-dessous entre elles. J’ai déjà commencé, d’ailleurs. On mycorhize tout le temps. On retourne la terre, on compte de l’argent qui s’échange comme du papier, en riant parce qu’il va s’envoler. On regarde nos fruits en secouant nos branchages.
On rit, toutes dents dehors.
Scie-moi, tu verras. On est éternelles.
—
Alix — Revue Réparations, numéro zéro — Juillet 2022



