Les roses cultivées à l’Haÿ en 1902 : essai de classement/ par Jules Gravereaux
Avant-Propos d'André Theuriet
Cette roseraie, dont le propriétaire et le créateur, M. Gravereaux, raconte
ici l'histoire illustrée, cette roseraie est une des merveilles de la banlieue pari-
sienne. Enfouie dans les antiques frondaisons d'un grand parc dont les murs
bordent la route de l'Hay, elle ressemble à l'admirable princesse du conte de la
Belle au bois dormant. Il faut franchir une épaisse ceinture de verdoyantes
futaies pour pénétrer jusqu'au domaine où elle repose dans sa prestigieuse
beauté. Mais aussi, lorsqu'on a percé les fourrés pleins d'ombre, traversé les
pelouses encloses dans les taillis, et qu'on arrive au seuil du plateau ensoleillé,
quel enchantement!
La généreuse floraison des roses étale ses chatoyantes couleurs au ras du sol ;
elle s'élance en guirlandes, en arcades et en portiques le long des armatures de
fer ; elle décore à perte de vue la voûte des spacieuses et profondes tonnelles.
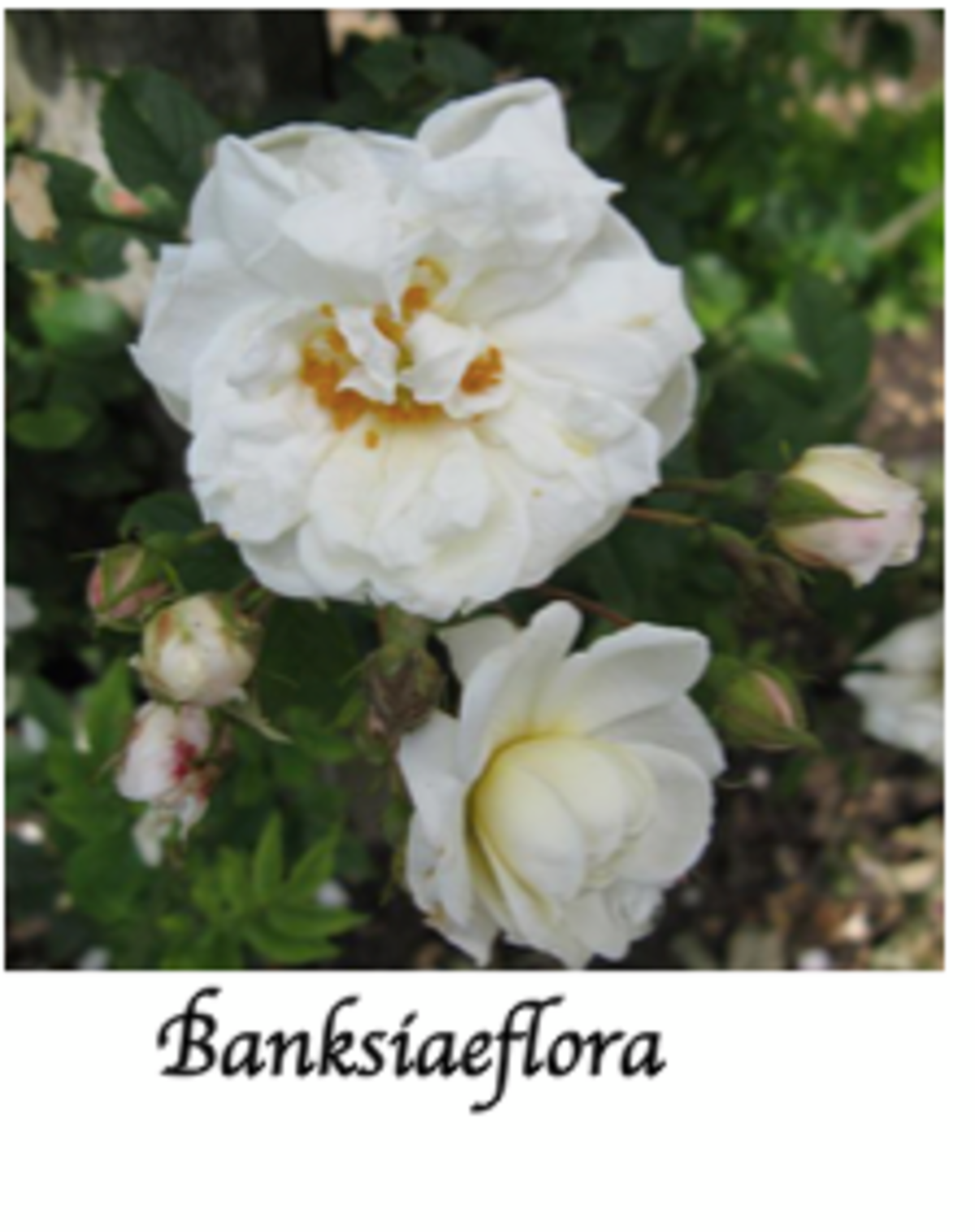
Toutes les blancheurs s'y épanouissent depuis la molle neige des Banks jusqu'à
la pâleur carnée des Souvenirs de la Malmaison ; tous les jaunes aussi : les
nuances saumonées des Gloires de Dijon,
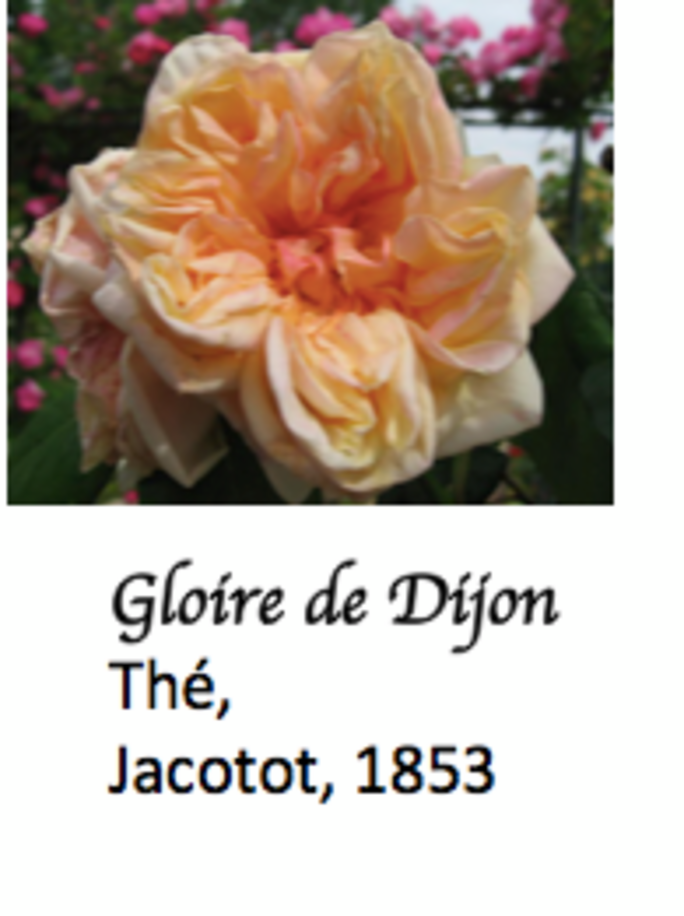
les pétales soufrés du Maréchal Niel,

le safran foncé des Rêves d'or,
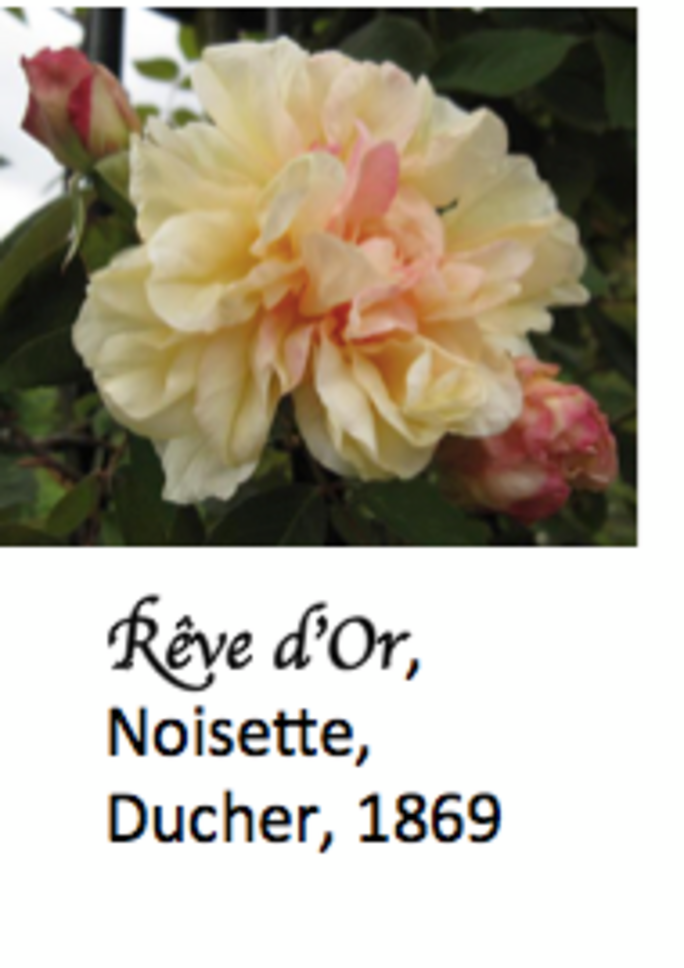
l'or mat des Chromatelles
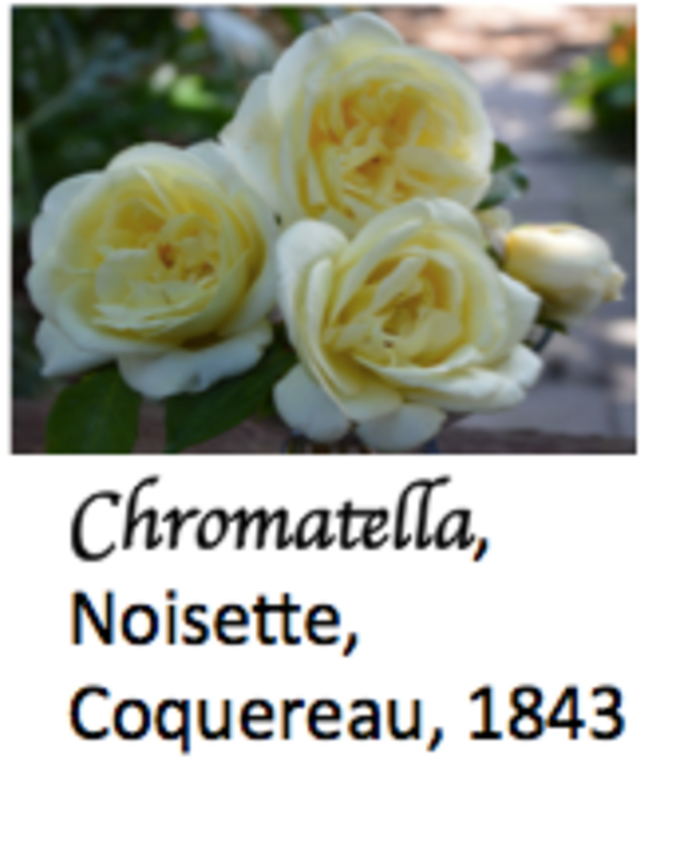
. Le rose tendre et chif-
fonné de la France
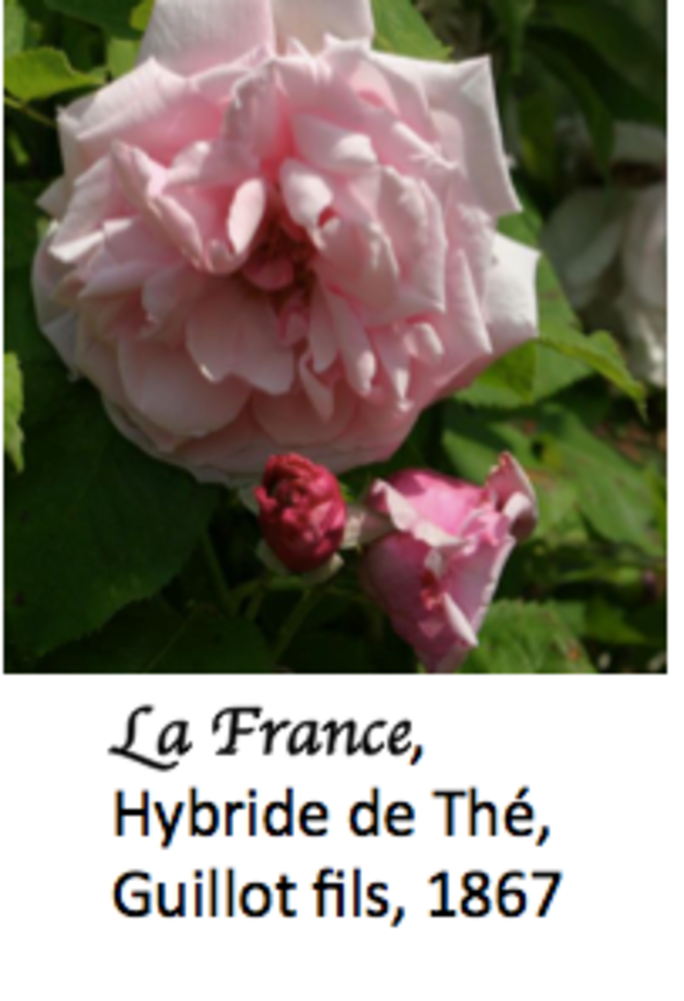
y voisine avec le rouge cramoisi de la Gloire de Bourg-la-
Reine, le rouge cerise des Marie-Henriette, le rose vif de la Coupe d'Hébé

, la
pourpre foncée du Lion des Batailles et de l'Empereur du Maroc

. De toutes ces
corolles à demi ouvertes ou pleinement écloses s'exhalent des parfums aussi
variés que les formes et les tonalités de chaque espèce : odeurs musquées qui
rappellent l'Orient, odeurs mourantes et alanguies, haleines suaves comme celle de la vigne en fleurs, voluptueuses comme des baisers, légères comme le pre-
mier souffle du printemps. L'œil et l'odorat sont grisés ; et dans la vibrante
clarté estivale, un confus murmure d'abeilles, de bourdons et de cétoines dorées
fait un harmonieux accompagnement à la musique chantante des aromes et des
couleurs.
En ce vaste terrain admirablement approprié à la culture des roses, chaque
série est artistement groupée. D'abord, à fleur du sol, les espèces rampantes,
puis les buissons, les rosiers à hautes tiges et enfin sur les arceaux prolongés
des tonnelles toute la tribu des roses grimpantes. Il y a le coin des roses-thé,
celui des roses remontantes, celui des rosiers de l'Inde, du Japon ou de la
Chine, et aussi la plate-bande réservée pieusement aux rosiers aimés de nos
pères et maintenant presque démodés : — roses à cent feuilles, roses moussues,
roses de Damas ou de Provins. Enfin tout un espace est consacré aux églantiers
destinés aux greffes et dont les espèces indigènes ou exotiques offrent une infinie
variété de formes, de feuillages et de fleurs. A côté de la collection horticole, il
y a la collection botanique, infiniment curieuse et riche, aménagée en vue des
études de croisements et d'hybridations.
Le propriétaire de ce paradis des roses, M. Gravereaux, est un sage. Après
s'être retiré des affaires, il a voulu utiliser royalement ses loisirs et s'est voué
au culte de la reine des fleurs. Sur le tard, il s'est mis à piocher sérieusement la
botanique et à grands frais il a créé cette roseraie, maintenant en pleine prospé-
rité, où il a rassemblé plus de 6000 espèces provenant de toutes les parties du
globe.
Chargé en 1901 par le ministre de l'Agriculture d'une mission ayant pour objet
l'étude des roses des Balkans, M. Gravereaux a parcouru la Serbie, la Bulgarie,
les environs de Constantinople et une partie de l'Asie Mineure. Dans ces régions
où depuis un temps immémorial on s'est livré à la culture des rosiers à parfum
et à la production de l'essence de roses, il a recueilli une importante collection
des plantes sauvages du genre Rosa et il a rapporté de précieux documents sur
les procédés employés dans les Balkans pour la distillation de l'essence...
Après tant de généreux efforts, suivis de si féconds résultats, M. Gravereaux
a voulu aujourd'hui mettre sous les yeux des collectionneurs et des horticulteurs
les résultats de ses études et de ses recherches ainsi qu'un catalogue détaillé de
ses magnifiques collections. L'ouvrage, enrichi de fraîches aquarelles, de lavis,
et de dessins à la plume, se divise en trois parties. La première comprend
la description et la nomenclature des rosiers sauvages; — la seconde contient le
catalogue raisonné de la collection horticole des roses de jardin; — la troisième
enfin a trait aux rosiers sarmenteux (sauvages et horticoles). L'auteur a bien
voulu me charger de présenter au public ce précieux et intéressant florilège de
roses. Cette mission m'est d'autant plus douce qu'elle me donne l'occasion d'ac-
quitter un devoir de gratitude. Si, comme on l'a dit, celui qui plante un arbre est
un bienfaiteur de l'humanité, il nous faut placer au même rang celui qui crée une
rose, car il nous donne la sensation rare de la Beauté. M. Gravereaux est un de
ces créateurs et de ces initiateurs, et à ce titre je suis heureux de lui témoigner
ici la reconnaissance des poètes et des artistes.
15 octobre 1901.
ANDRÉ THEURIET
de l'Académie Française.



