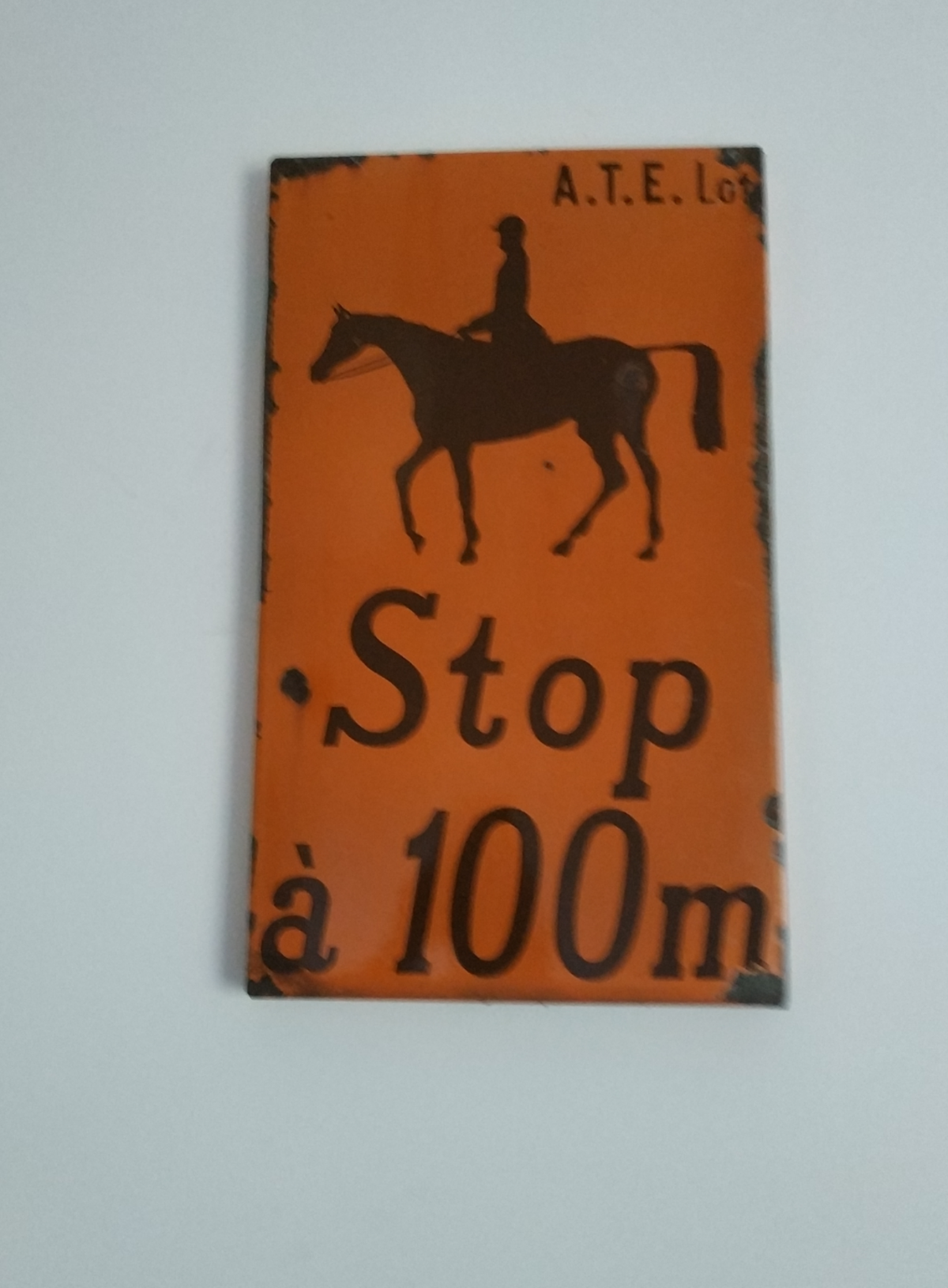
Agrandissement : Illustration 1
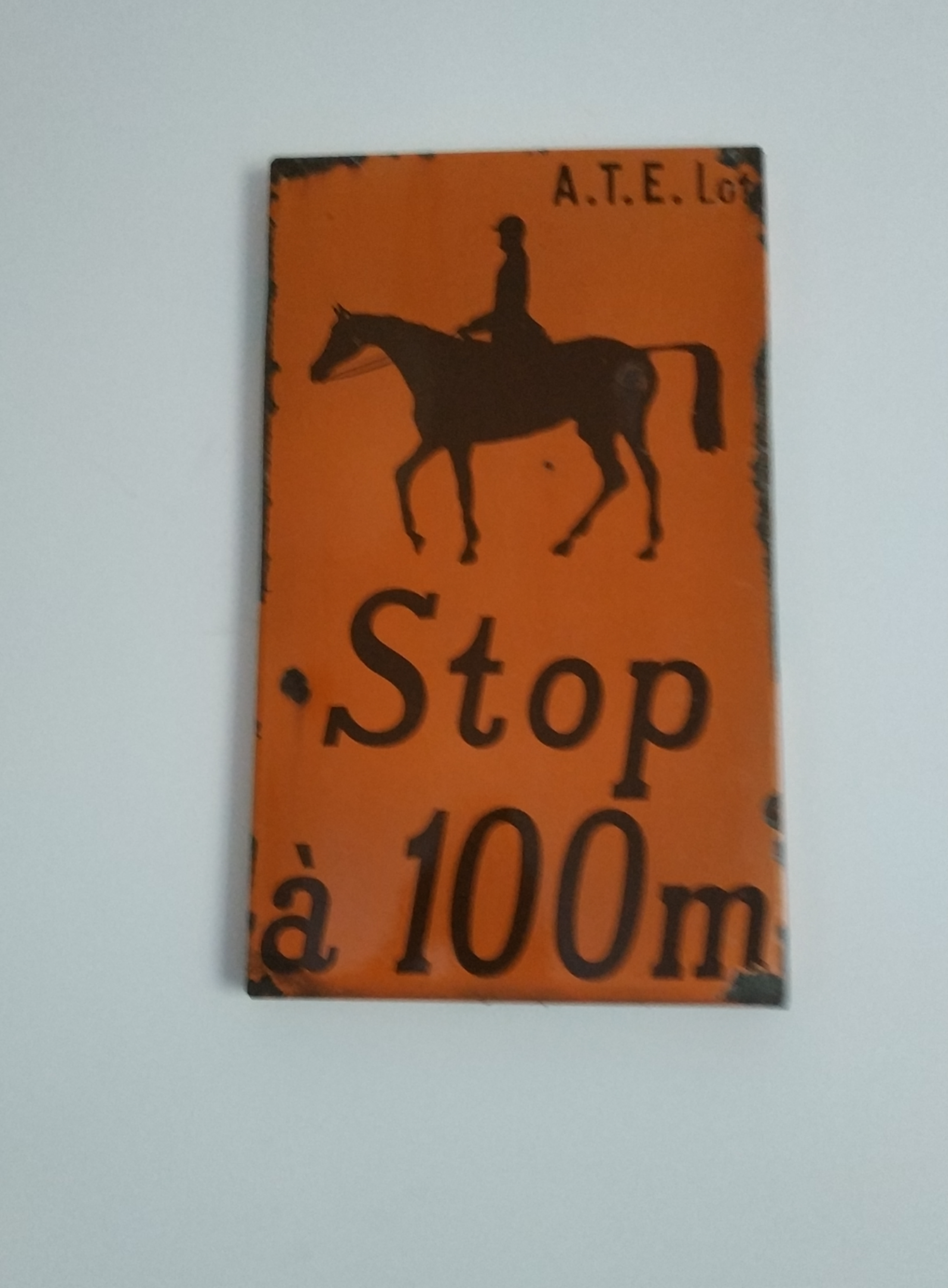
Lacan, L’Ethique de la psychanalyse - Le Séminaire, livre VII Lecture des leçons XIX, XX et XXI VIII des 25 mai 1960, 1er et 8 juin 1960.
Les numéros de page renvoient à l'édition du Seuil. Pour le texte de l'Antigone Sophocle, la traduction utilisée est celle de la collection de poche GF Flammarion, trad. Robert Pignarre, les numéros de page y renvoient.
Jacques Lacan a consacré trois séances du séminaire L'éthique de la psychanalyse à la figure d'Antigone, ces séances sont regroupées sous le titre "L'essence de la tragédie - Un commentaire de l'Antigone de Sophocle" : leçons des 25 mai 1960, 1er et 8 juin 1960, pp. 285-333.
Lacan s'attache à faire bouger les hypothèses souvent émises- la catharsis, l'exigence de moralité dans le conflit des lois écrites et celles non-écrites, l'héroïsme même- pour tenter d'expliquer le scandale Antigone, et peut-être de le minimiser : "Essayons de nous laver un peu la cervelle de tout ce bruit fait autour d'Antigone", (p. 292). Le livre d’André Bonnard, D’Antigone à Socrate, par exemple, pour citer un contemporain, faisait de Créon une sorte de fasciste et d’Antigone une résistante, selon l'helléniste Florence Dupont. Lacan nous amène sur des rives bien contraires : Antigone n'est en rien une figure créée à des fins d'édification morale.
UNE IMAGE
Lacan nous rappelle tout d'abord que la tragédie a pour but la catharsis, c'est-à-dire la purgation, la purification de la crainte et de la pitié, émotions indésirables, par le moyen même de la crainte et de la pitié. S'il renvoie aux débuts collaboratifs de Freud et de Breuer et à la méthode dite cathartique, sorte de préhistoire de la psychanalyse, Lacan fait part de sa réserve, "le terme de catharsis rest[ant] singulièrement isolé dans la Poétique.", (p. 287). L'allusion aux travaux de Jacob Bernays, selon qui, Aristote, fils de médecin, aurait été guidé dans l’emploi du mot « catharsis » par une préoccupation thérapeutique et non morale, confirme un usage quasi médical du spectacle de la tragédie. L'apaisement est obtenu par le plaisir, selon Aristote, Lacan s'interroge sur la nature de "ce plaisir auquel on fait retour après une crise" et situe le plaisir "en deçà" du désir", (p. 288).
Dès lors, sa lecture d'Antigone est orientée et conduite par la perspective de "la place propre du désir dans l'économie de la Chose", dans la mesure où "Antigone nous fait voir le point de visée qui définit le désir.", (p. 289-90). Lacan annonce, au début de la deuxième leçon, le projet final de "saisir le sens véritable"de la "fameuse catharsis", (p. 300).
Antigone est avant tout une image qui "fait ciller les yeux" quand on la regarde, qui "fascine dans son éclat insupportable ... qui nous retient et nous interdit". Lacan introduit l'objet regard, l'objet pulsionnel par excellence, dans ce qu'il nomme "l'éclat d'Antigone". C'est "du côté de cet attrait" qu'il faut chercher. Cette image est l'instrument de la purgation et assure la catharsis: "nous sommes purgés par l'intermédiaire d'une image", (p. 290). Il ne s'agit donc pas tant d'émotions que de "fascination", le spectateur "est fasciné par l'image d'Antigone.", les émotions, "le Chœur s'en charge", (p. 295).
Le propos de Lacan se resserre sur " l'éclat d'Antigone" par lequel, "s'établit pour nous un certain rapport à l'au-delà, mais aussi ce qui nous interdit d'en voir la véritable nature, ce qui nous éblouit et nous sépare de sa véritable fonction. Le côté touchant de la beauté fait vaciller tout jugement critique, arrête l'analyse ... L'effet de beauté est un effet d'aveuglement.", (p. 327).
L'éclat, la beauté constituent un danger pour la raison et pour la spéculation. C'est ce qui aveugle. Kant y fait allusion, quand, par exemple, il lit Rousseau : "Le goût gêne l'intelligence. Il me faut lire et relire Rousseau jusqu'à ce que la beauté de l'expression ne me trouble plus, alors seulement je puis le saisir avec raison.", (Remarques touchant les Observations sur le sentiment du Beau et du Sublime.) De même, Lacan met en évidence l'"effet du beau sur le désir", le beau comme visée du désir (et comme effet de la tragédie). L'éclat est un "leurre" qui piège le désir, c'est-à-dire que l'"émoi" est "réel", mais sans objet, il n'y a pas d'objet, pas de sens, (p. 291).
Cependant, même si Lacan rappelle que le théâtre est un art du langage, où le spectacle n'y est qu'accessoire, d'après Aristote, (p. 295), cette première leçon se conclut sur une image, l’œil inerte du monstre marin de la scène finale de la Dolce Vita, dans lequel le public a cru voir et "retrouver [l]a fameuse Chose" lacanienne, quelque chose de dégueulasse "qu'on extrait de la mer avec un filet", (p. 296). Ce dégueulasse-là, c'est l'envers de l’éclat.
Lacan rappelle ce qu'on oublie parfois, à savoir qu'Antigone encourt le châtiment d'être enfermée vivante au tombeau et il parle du "sort d'une vie qui va se confondre avec la mort", (p. 291), qu'il va appeler "seconde mort". La pièce met en scène le fantasme sadique. Lacan marque là une nouvelle étape : "Nous voici maintenant en devoir d'entrer dans ce texte d'Antigone en y cherchant autre chose qu'une leçon de morale.", (p. 292). De même, il s'oppose à Hegel et à son idéalisme qui interprète la tragédie Antigone comme "un conflit de discours", opposant Créon à Antigone, tels deux principes de la loi et du discours, deux discours, donc, qui s'en "vont toujours vers la conciliation.", Lacan, lui, doute de la conciliation dans Antigone. (p. 292). La deuxième leçon, celle du 1er juin 1960, marque l'entrée dans le texte de Sophocle, dont les "articulations" sont imagées par le "tassement" d'un "château de cartes" prêt à s'effondrer, (p. 308). Lacan nous figure la tragédie telle une poussée devant soi (ἄγειν, ágein, "conduire, mener, pousser devant soi"), bien plus que comme un aboutissement (πράττειν, práttein), (p. 308). L'image de la structure d'une tragédie est ensuite raffinée avec les "courbes [qui] n'ont plus qu'à s'écraser les unes sur les autres", (p. 316), et ainsi produite, elle se complète avec le motif de l'anamorphose, image déformée que donne un miroir courbe. L’anamorphose à laquelle se réfère Lacan, à la troisième leçon, est celle du cylindre qui fait se réfléchir les lignes d'un tableau de la crucifixion, imité de Rubens. Quand il dit qu'"une très belle image de la passion apparaît ... tandis que quelque chose d'assez dissous et dégueulasse s'étale autour.", (p. 318), on retrouve là le dégueulasse, l'envers de l'"éclat", l'éclat d'Antigone, qui se redresse. Le procédé de l’anamorphose consiste à déformer une image jusqu’à anéantir son pouvoir de représentation, mais de sorte qu’elle se redresse lorsqu’on la regarde d’un autre point de vue, c'est un jeu de perspective, et la tragédie, "c'est ce qui se répand en avant pour produire cette image. ... image d'une passion", (p. 318), celle d'Antigone qui se redresse.
LOIS ECRITES ET LOIS NON ECRITES Dans la première leçon, le détour par la référence aux Conversations de Goethe d'Eckermann, (1822-1832),- où "l'Antigone de Sophocle" est prise comme modèle de la "beauté de la moralité" -, permet de poser deux points : - - la pièce ne se résout pas en un antagonisme entre deux droits, deux discours, celui de Créon et celui d'Antigone, contrairement à ce qu'en a commenté Hegel. Il n'y a pas d'effet de symétrie ente les deux protagonistes.
À côté des lois des hommes, écrites, spécifiques à chaque cité, il existe en Grèce des lois sacrées, non écrites, et communes à tous les Grecs, comme le devoir impératif pour les enfants de leur rendre les honneurs funèbres. La pièce met en évidence un conflit entre des lois qui touchent au rites funéraires et des lois humaines, celles de Créon. Dans le passage célèbre où, pour justifier la transgression qu’elle a commise au regard de la loi de Créon en ensevelissant son frère, Antigone invoque les lois divines : "Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer (ὑπερδραμεῖν) les lois divines θεῶν/νόμιμα.", dit-elle à Créon après la mort de son frère Polynice et interdiction faite de l’enterrer sous peine de mort, (Antigone, p. 61). Le grec dispose de plusieurs mots pour parler des lois, et Antigone emploie le terme νόμιμα (νόµιµον) et parle de άγραπτα νόµιµα, lois non écrites. Ce sont des lois des dieux, donc sacrées, et beaucoup plus graves à transgresser car rendant l’auteur de la transgression sacrilège. Ainsi, pendant que Créon s'arrange avec "ce qui est formulé, dit, dans la loi par les dieux", la Δίϰη, Díϰē, le jugement des dieux. (p. 322), Antigone se révolterait contre les règles imposées par le législateur, Créon, et aspirerait à un idéal supérieur de justice. C'est l'interprétation qui est très souvent donnée, et qui sert d'explication à ses actes tout en assurant la promotion de l'héroïne. Lacan s'y oppose et nuance : Antigone ne représente pas "simplement la défense des droits sacrés du mort et de la famille", (p. 297). La Δίϰη des dieux, elle en fait ce qu'elle veut, sa position est des plus ambiguës.
Quand, au deuxième épisode, Créon lui repoche d'avoir désobéi, "pass[é] outre (ύπερδραμεῖν, úperdrameĩn) à [s]on ordonnance", elle répond : "Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'a promulguée, et la Justice qui siège auprès des dieux de sous la terre n'en a point tracé de telles parmi les hommes.", (p. 61), on a cru voir là la clé du drame, mais Lacan propose la lecture suivante : "Elle répudie que ce soit Zeus qui lui ait ordonné de faire cela. Ni non plus la Dikê ... Précisément, elle se désolidarise de la Dikê. ... [Elle] ne [s']en mêle pas, de tous ces dieux d'en bas, qui ont fixé les lois parmi les hommes.", (p. 324). Antigone ne meurt pas pour des idées. Antigone ne défend pas plus que cela les lois non écrites de la Diké, alors qu'"on croit avoir dit assez en disant qu'Antigone la défend".
Lacan déplace l'opposition entre νόμοϛ, nomos, les lois écrites, et ἄγραπια, agrapia, les lois non écrites : les lois, νόμοϛ, expriment "une certaine légalité", elles sont une conséquence des lois non écrites, et non plus une opposition aux dieux. Les lois écrites relèvent relèvent maintenant "de l'ordre de la loi, mais qui n'est développé dans aucune chaîne signifiante, dans rien.", (p. 324). Et l'on va voir combien ce rien va se révéler primordial.
- Lacan rapporte également l'étonnement de Goethe devant un passage énigmatique du texte de Sophocle, quand Antigone se justifie sur ses actes, au quatrième épisode, alors que tout est joué : elle n'aurait jamais défié l'interdiction pour un mari ou un enfant, mais pour un frère, oui : " Je me suis dit que, veuve, je me remarierais et que, si je perdais mon fils, mon second époux me rendrait mère à nouveau, mais un frère, maintenant que mes parents ne sont plus sur la terre, je n'ai plus d'espoir qu'il en naisse un autre.", (Antigone, p. 81). La perte d'un frère ne se répare pas. Ces vers sont un bruit qui dérange, qu'il faut écouter, au sens du mot bien connu de John Cage : Si un bruit te dérange, écoute-le !. Lacan les "serr[e] de près", (p. 294) et il va fait de ce passage, l'essentiel de "la visée d'Antigone."
Dans la même perspective, Lacan pointe deux phénomènes sonores, deux signaux dans le texte grec qui peuvent interpeller et qui sont venus à ses oreilles : - ce sont premièrement les lamentations aiguës d'Antigone, tels "les gémissements de l'oiseau à qui ses petits ont été ravis.", (p. 307).
- le deuxième signal est le mot invariable grec μετά, lequel recouvre des sens divers- "au milieu de, parmi", "par derrière, à la suite", "en opposition avec, contre", "avec", "entre", "par le moyen de", "après, à la suite de", "pour"... -qui presque tous marquent une scansion temporelle ou spatiale : "Mετά, c'est à proprement parler ce qui vise la coupure", (p. 308). Plusieurs occurrences de μετά sont citées par Lacan, qui viennent frapper à la fin du vers dans les répliques d'Antigone : au vers 48 : ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα, "Créon n'a pas le droit de me séparer des miens", (Antigone, p. 43) ; au vers 70 : πράσσειν, ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα, "d'ailleurs, même si tu te ravisais, tu ne me seconderais pas de bon coeur." et au vers 73 : φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα, "je reposerai au près de mon frère chéri", (Antigone, p. 44) et toutes impriment le caractère inflexible de l'héroïne.
Mετά et les cris d'oiseau sont le "mode de présence tranchant de notre Antigone", (p.308).
L'ATE, LA LIMITE
Le deuxième temps de la leçon du 1er juin 1960 introduit à l'Até, "terme répété vingt fois". Les vers du Choeur, au deuxième stasimon, par exemple, mettent en évidence l'Até : "Quand un esprit égaré prend le mal pour le bien, c'est qu'un Dieu pousse son âme à l'égarement (πρὸς ἄταν, pros atan, "vers l'Até"). Un moment suffit alors pour le perdre.", (Antigone, p. 69). Le Choeur met en garde celle qui "par son désir, viole les limites de l'Atè.", (p. 322), avec les occurrences de ἐκτὸς ἄτας qui "a dans le texte le sens du franchissement d'une limite", (p. 315). Avec l'Até, ἄτη, en grec ancien, Lacan désigne et nomme la limite. La "limite que la vie humaine ne saurait trop longtemps franchir.", et "au-delà, c'est là que veut aller Antigone.", (p. 305).
Le Chœur éclate, explose, après sa condamnation : "Comme on retrouve dans la fille le caractère intraitable du père ! Elle ne sait pas fléchir devant l'adversité.", (Antigone, p. 61). Le Choeur témoigne ainsi de ce qu'Antigone "a été chercher son Atè.", (p. 322). Pour le Chœur, Antigone a dépassé les bornes, elle est allée chercher sa limite, l'au-delà.
Dans la mythologie grecque, Até, Ἄτη, est la déesse incarnant la Faute et l'Égarement, c'est la déesse de l'égarement funeste et des actes irréfléchis. Ce peut être une folie passagère causée par l’action d’un dieu ou d’un démon. Le chant du Chœur fait une référence énigmatique à trois épisodes mythologiques, au cours desquels la "folie de Dionysos" opère, tel un avatar de l'Atè. Les dictionnaires anglo-saxons traduisent le terme par "perplexité" ou "engouement", causés par l'aveuglement ou l'illusion envoyée par les dieux, principalement en punition d'une imprudence ou d'une témérité coupable. Lacan précise que l'Até, "ce n'est pas l'άμαρτία" (amartia), la faute ou l'erreur, ce n'est pas faire une bêtise.", ce qui est du registre de Créon, - "héros secondaire" et non pas "héros tragique". "L'Até, qui relève de l'Autre, du champ de l'Autre, n'appartient pas à Créon, c'est par contre le lieu où se situe Antigone.", (p. 323). Pour preuve, les paroles du Coryphée, lorsqu'il voit revenir Créon tenant dans ses bras son fils mort :"Voici le Roi qui s'avance, portant dans ses bras le témoignage trop clair d'un malheur qu'il ne doit qu'à lui-même.", (p. 96), αὐτὸς ἁμαρτών., au vers 1259-1260, "de sa propre erreur". "Il ne s'agit pas de l'ἀλλοτρίαν (allotria) ἄτη", l'Até d'autrui. Cependant, Créon veut le bien de tous, c'est tout naturel en tant que chef de la cité, mais c'est aussi sa "faute", son "erreur de jugement", (p. 300), car il le fait dans l'excès, Créon exagère, tout autant qu'Antigone. Dans son éloge de l'homme, aux vers 360-375, "Entre tant de merveilles du monde, la grande merveille, c'est l'homme.", (Antigone, p. 56), le Chœur, de fait, condamne l'obstination de Créon. Tirésias l'avertit, lui dit qu'il "frôle, cette fois encore, le tranchant de la fortune.", (Antigone, p. 85). Le Coryphée, à son tour, invite Créon à la "prudence", (Antigone, p. 90). Créon prend peur et veut réparer le manquement fait à Polynice, mais tardivement. Lacan commente ainsi : "l'Até vient encore là", (p. 309). Avec Créon est la démonstration que "le bien ne saurait régner sur tout, sans qu'apparaisse un excès dont la tragédie nous avertit des conséquences fatales." Créon est dans l'excès, en même temps, "c'est sur un autre champ que Créon comme un innocent, déborde.", (p. 301).
L'important à retenir, c'est que là où l'opposition entre deux systèmes de lois, deux discours, deux idéologies ne tient pas, Lacan introduit la notion de limite ; en place du jugement des dieux, que "nous chrétiens avons balayé(s)". La question de la limite, qui est "là sans doute depuis toujours", est définie par Lacan "comme la limite de la seconde mort.", (p. 302).
La "seconde mort" est un concept forgé à partir de la pensée de Sade, à partir de l'idée que le vrai crime est la transgression à l'égard de la nature, à savoir l'interruption des processus de génération et de destruction de la nature. La "visée de ce crime" est de freiner la "reproduction des formes" afin de "forcer" la nature "à recommencer à partir de rien.", à partir du ex nihilo. C'est la raison pour laquelle "le crime est pour nous un horizon de notre exploration du désir".
Nous voulons être à l'origine.
La destruction crée les conditions de possibilité pour l’événement du nouveau. La création en tant que telle est toujours création de quelque chose qu’il n’y avait pas auparavant. C’est ce désir qui provoque l’effet du beau.
Lacan rappelle aussi que c'est "à partir d'un crime originel que Freud a reconstruit la généalogie de la loi.", (p. 303).
Lacan met en évidence le "fantasme fondamental dans Sade, celui d'une souffrance éternelle.", qui conjugue douleur et beauté. L'"exposition émouvante de la victime" est une image qui "laisse ... interdit", d'autant plus que la menace n'est pas "l'anéantissement."
Par analogie avec Kant- pour qui, les formes sont à distinguer dans le phénomène du beau, "mais sans que l'objet soit concerné."- dans le fantasme sadique, l'objet s'absente, "l'objet n'est là que comme pouvoir d'une souffrance, qui n'est elle-même que le signifiant d'une limite." Lacan illustre ce point par l'"image exemplaire" de la crucifixion, "apothéose du sadisme", "cette limite où l'être subsiste dans la souffrance". Cette image universelle "tire à elle tous les fils de notre désir", [qui] absorbe toutes les autres images du désir chez l'homme ", (pp. 304-5).
LES ECLATS ET L'EXCITATION TRANCHANTE DE LA PIECE Au cours des trois leçons, en même temps qu'il pose ces éléments qui lui permettent de penser le scandale Antigone : image, fantasme sadien, limite, limite de l'Atè, limite de la seconde mort, Lacan déroule les étapes de la pièce.
La première scène, le dialogue avec Ismène, sous le signe de l'inimitié. Le sadisme est à l’œuvre quand Antigone repousse sa sœur, de même qu'elle refuse sa solidarité à l'autre bout du parcours. Tout cela est cruel, "atroce", (p. 306), autrement dit, cru. La scène du garde est, elle aussi un "sommet de la cruauté, mais on s'amuse.", (p. 310). Face à Hémon, son fils et le fiancé d'Antigone, Créon s'entête "et [le] laisse partir sur les pires menaces.", (p. 311).
Alors le Chœur "éclate" (troisième stasimon), il "devient fou", saisi de l'himéros, ιμερος, le "désir incontrôlable", c'est "au moment où Créon décrète le supplice auquel Antigone sera vouée - elle va entrer toute vivante au tombeau", (p. 311), "je la murerai vivante dans un caveau", (Antigone, p. 76).
Himéros provient du verbe grec himeirein, "désirer". Himéros est le dieu du désir passionné, ardent, physique et sexuel dans la mythologie grecque. Son nom contient le nom du dieu Éros et avec son frère Eros, ils forment les Érotes ou Amours. Alors qu’Éros est l’amour comme sentiment, Himéros est le désir sexuel proprement dit. A la fin du second discours de Socrate, dans le Phèdre de Platon, l'"âme cède à " l'himeros", désir amoureux ou amour-passion et les sentiments de Zeus pour Ganymède sont décrits comme du "désir" : Lacan y fait référence pour montrer la force et le caractère sexuel du désir d’Antigone. "Himéros, ... le reflet du désir en tant qu’il enchaîne même les dieux. C’est le terme utilisé par Jupiter pour désigner ses rapports avec Ganymède. Himéros enargés, c’est littéralement le désir rendu visible. Tel est ce qui apparaît au moment où va se dérouler la longue scène de la montée au supplice.", (p. 311).
La beauté d'Antigone est évoquée par le Chœur (troisième stasimon) : "... l'attrait qui rayonne / des yeux de la femme promise.", (Antigone, p. 77). Le thème du désir né du regard apparaît à cet endroit de la pièce. C'est un désir qui se voit, qui a été vu par le Chœur, ébloui.
Himéros est parmi les termes de la démesure, le terme privilégié, préféré à celui d'hybris ; mais quand le Coryphée voit Antigone, telle une demi-déesse, pour elle, c'est un outrage, au sens de "passer outre", de "franchissement" et elle accuse le Choeur d'un autre terme de la démesure, l'ὑβρίζεις, l'hybris, la démesure, l'excès, au vers 840, οὐκ οἰχομέναν ὑβρίζεις, ἀλλ᾽ ἐπίφαντον, "As-tu le coeur de m'outrager en face ? Attends du moins que je sois morte.", (Antigone, p. 79). En fait, Antigone ne se tient pas face à Créon, il n'est pas pour elle un adversaire véritable, ni un détracteur valable ; c'est au Choeur qu'Antigone fait face. Le moment de l'éloge de l'homme chanté par le Choeur, au deuxième stasimon, ne fait que porter sur les rapports de l'homme avec l'Até. Lacan s'oppose au prétendu humanisme de Sophocle et procède à une lecture de ce fameux morceau qui en révèle toute la portée ironique. Le "bon à tout", παντοπόρος, pantopóros, quelquefois traduit par "ingénieux en tout", "génie universel", (Antigone, p. 57), s'inverse en "Il n'en rate pas une.", (p. 321), le contresens est débusqué. L'homme n'est pas venu à bout de la mort, il remédie à des maladies, mais il en crée d'autres. Lacan oriente sa traduction de ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ἔχων "qui va au-delà de tout espoir", dans les vers 365 et 366 : σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων / τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει, dans le sens plutôt d'une errance, l'homme, "se dirige tantôt vers le mal tantôt vers le bien", (p. 321), à partir du terme grec ἕρπει d'une racine grecque ἕρπω (« ramper »), que l'on retrouve avec une altération du h initial dans le mot "serpent"., et qui donnnera le latin herpes. Cette merveille, l'homme, est ensuite réduite au παρέστιος, paréstios, compagnon ou voisin de foyer, celui qui garde le coin du feu et n'en bouge pas, le domestique- au vers 373 : ξύνεστι τόλμας χάριν. μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος. C'est celui dont il vaut mieux se séparer, celui avec lequel il vaut mieux ne partager ni proximité, ni désir, comme il est dit au vers 375 : γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει., où ἴσον φρονῶν, ison phronôn, signifie avoir le même désir. "C'est de ce désir de l'autre qu'il sépare son désir.", (p. 222). C'est ni plus ni moins un désir solitaire, celui d'Antigone, autonome, qui ne veut rien partager de son acte avec Ismène. Lacan a beau lui agrèger la figure socratique et la formule du Connais-toi toi-même, il souligne surtout la solitude du héros de tragédie, "le héros de tragédie participe toujours de l'isolement", l'homme également.
MON FRERE
Antigone, le Chœur l'appelle "autonome", le Chœur voit en Antigone une sorte d'électron libre, le mot, en grec, a le sens de qui se gouverne par soi-même. Le Chœur reproche à Antigone son autonomie, c’est-à-dire de vouloir fonder sa propre loi. Elle ne se justifie que d'elle-même. Dans son obstination devant Créon, elle montre qu'elle ne reconnaît pas d'autre loi que son désir. Son côté "à-bout-de-course", son "côté implacable, sans crainte et sans pitié, qui se manifeste à tout instant chez [elle].", (p. 318), son "esprit d'indépendance qui [la] perd.", (Antigone, p. 80), c'est ce que traduit αὐτόγνωτος, autognôtos, au vers 875.
Le raisonnement est le suivant : de toute manière, si elle avait obéi à Créon, ce sont les dieux qui l'auraient punie : "Je savais bien que je mourrais ; c'était inévitable.", (p. 61). Pour Lacan, il n'y a pas d'explication à donner : "Quand Antigone s'explique devant Créon sur ce qu'elle a fait, Antigone s'affirme d'un c'est comme ça parce que c'est comme ça, comme la présentification de l'individualité absolue.", (p. 323). Comme Electre - celle qui veut venger le père- elle peut affirmer : "Je suis bien d'accord, mais je ne peux pas faire autrement.", (p. 322) Lacan fait un sort particulier au mot ὥρισεν (ὣρισαν όρίζω ὅροϛ, hṑrisan órízō hóros),
"l'image de l'horizon, de la limite ... sur laquelle elle se campe, ... inttaquable", (p. 324), dans les vers de la confrontation à Créon,et nul ne peut passer outre. Le désir est affaire d’horizon, de visée.
C'est un "horizon déterminé ... [qui) n'existe qu'à partir d'un langage de mots [et qui] en montre la conséquence infranchissable." Car Antigone entre dans le langage, "quelque chose peut être dit", prononcé, énoncé et ce "quelque chose", c'est "mon frère est mon frère", sans doute criminel, mais aussi ᾄθαπτος, áͅthaptos (sans sépulture) et surtout ἀδελφός, adelphos (né du même utérus, de la même matrice). Avec le mot χθονὸς, chthonos, la terre, Lacan montre qu' Antigone, dans son attachement à son frère, "passé dans le monde souterrain", ne se tient pas dans les sphères célestes, pas plus que Créon qui mêle les lois du pays avec les décrets des dieux. Elle se tient au plus près "des attaches les plus radicalement chthoniennes des liens du sang", (p. 322), c'est en ce sens seulement qu'elle s'oppose au commandement (kérygme), de Créon." Le seul horizon, la seule visée, finalement, dont elle se réclame est le frère. Elle "[s']avance vers cette limite fatale", car, au contraire d'un mari ou d'un enfant qui sont "remplaçables", "ce frère est ce quelque chose d'unique, et c'est cela seul qui motive qu'[elle s']oppose à [ses] édits. Antigone n'évoque aucun droit que ceci", (p. 324). Elle ne reconnaît pas d'autre loi que ces mots, équivalents à un "droit qui surgit dans le langage du caractère ineffaçable de ce qui est - ineffaçable à partir du moment où le signifiant qui surgit l'arrête comme une chose fixe à travers tout flux de transformations possibles. ... Tout le reste, elle le repousse. ... et tout ce que l'on met autour n'est qu'une façon d'éluder le caractère absolument radical", (p. 325). Lacan souligne qu'on ne peut se passer de sépulture. Sinon, impossible "d'en finir avec ses restes", les restes de "celui qui a pu être situé par un nom", (p. 325). Plus bas, Lacan ajoute qu' en dehors du langage, "la valeur unique de [l'] être ne saurait être conçue." Lacan aboutit ici à une éthique qui dégage "la valeur unique de [l'] être" comme "valeur de langage", (p. 325), par delà le bien et le mal. Le "langage scande tout ce qui se passe dans le mouvement de la vie.", (p. 325), ainsi les mots mon frère qui font coupure, ils se découpent et ils se séparent des lignes biographiques de ce Polynice, "du drame historique qu'il a traversé", de Thèbes ; "c'est là justement la limite, l'ex nihilo autour de quoi se tient Antigone. Ce n'est rien d'autre que la coupure qu'instaure dans la vie de l'homme la présence même du langage.", (p. 325). La parole et la prise de parole sont toujours un franchissement. Les paroles, les assertions d'Antigone sont à évaluer au même titre que ce qui est formulé, énoncé, dit, dans la loi ou prononcé par les dieux (θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν, theō̃n t᾽ énorkon díkan). Les paroles d'Antigone valent autant que la Dikê des dieux, dans leur "dimension proprement énonciatrice", (p. 322).
LA LOI D'EX NIHILO Antigone ne meurt pas pour ses idées, mais pour son désir. Antigone est l'incarnation du désir pur, c'est-à-dire sans objet. "Antigone mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce que l'on peut appeler le désir pur, le pur et simple désir de mort comme tel. Ce désir, elle l'incarne.", (p. 329) et la mort signe le désir.
A la troisième leçon, "L'entre-deux-morts", le développement se poursuit sur l'Atè, comme la limite entre la vie et la mort, la limite absolue, la "position à bout de course de tous les héros ... [qui] sont des personnages situés d'emblée dans une zone limite, entre la vie et la mort.", (p. 316).
Les vers 559-560 : "Ne te décourage pas : ta vie est devant toi ; la mienne est finie ; il y a longtemps que je l'ai consacrée à mes morts.", (Antigone, p. 66), nous donnent la position d'Antigone à l'égard de la vie - elle dit que son âme est morte depuis longtemps", (p. 315), telle Electre, "véritable doublet d'Antigone - morte dans la vie ... déjà morte à tout.", (p. 317). Le Chœur évoque "trois épisodes", (p. 327), "trois destinées ... orchestrées à cette limite de la vie et de la mort, du cadavre encore animé ... l'image autour de laquelle tourne l'axe de la pièce.", (p. 311). Dans l'exodos, pour le Chœur, Créon, "naguère digne d'envie ... est un mort qui respire.", (Antigone, p. 93).
LE DESTIN TRAGIQUE D'ANTIGONE
Lacan produit un effet de coup de théâtre en évoquant l'apparente volte-face du kommos, la plainte d'Antigone. Antigone chante avec le chœur au moment où condamnée par Créon elle traverse l’orchestra pour partir et aller mourir dans une grotte souterraine. Ce passage est reçu comme le moment le plus intense de la douleur de deuil. Juste avant de rentrer vivante dans son tombeau, Antigone fait entendre une longue plainte, devant le destin cruel qui est le sien. Antigone, l'héroïne implacable qui n'éprouve ni crainte ni pitié, s'apitoie sur son sort devant la décision de Créon qui la "prive de [s]on fiancé, de [s]es noces, de |s]a part d'épouse et de mère", qui la prive des joies de l’amour, du plaisir et de la maternité. Antigone n'est donc pas sans désir et elle le proclame au moment de mourir. Juste, avant de mourir, Antigone est vivante et désirante. Mais il s'agit d’un désir né sur le rien, créé à partir du rien, de cette zone impossible, zone entre deux morts, dans laquelle Antigone évolue : "Je ne serai plus ni chez les humains ni chez les défunts séparée à la fois des vivants et des morts", (Antigone, p. 82). Elle se plaint de tout ce qu'elle va manquer : un mari, des enfants... Cela n'a plus rien à voir avec l'intraitable Antigone et on peut déplorer le manque d'unité dans son caractère et dans le texte. Lacan, au contraire, y voit une cohérence, "car pour Antigone, la vie .... ne peut être vécue et réfléchie, que de cette limite où déjà elle a perdu la vie, où déjà elle est au-delà - mais de là, elle peut la voir, la vivre sous la forme de ce qui est perdu.", (p. 326). Eh bien, cela, c'est un peu l'affaire de tous, d'avoir perdu ce que l'on convoque, de devoir perdre les choses pour pouvoir les convoquer par le langage. Elle devient ainsi l’emblème de cette position désirante, "à l’opposé du court-circuit qu’implique la morale des biens, du corps offert comme bien que l’on s’échange et partage. À aucun moment, elle n’accepte l’échange", comme le commente Patrick Guyomard, lors de sa conférence "L'éthique de la psychanalyse selon Freud et après Lacan : Quelle est la loi d'Antigone ?", E.P.H.E.P., le 15 juin 2018.
Antigone est dite "autonome", or il n'y a pas plus enchaînée à son hérédité, à son destin qu'Antigone. Dans la tragédie grecque, la fatalité porte le même nom que l’erreur, "l'atè". Lacan précise que "quand on s'approche d'Até, c'est en raison de quelque chose qui est lié ... à une chaîne, celle du malheur des Labdacides.", (p. 306), et il reprend le thème de la "descendance de l'union incestueuse, dédoublée en deux frères", à l'un, la "puissance", à l'autre, le "crime" : Antigone occupe la place libre laissée pour le crime. On reconnaît là le thème du fatum, du destin qui écrase le héros tragique : "Antigone doit faire le sacrifice de son être au maintien de cet être essentiel qu'est l'Até familiale", (p. 329). La lamentation d'Antigone évoque la malédiction, l'accumulation de malheurs qui remonte à Laïos, le père d' Œdipe et fils de Labdacos : "Ah ! tu as touché là ma plaie à vif, / mon triple sujet de plaintes, / le malheur de mon père et de notre famille, / le malheur qui n'épargne aucun des Labdacides ! Sur le lit maternel, ô malédiction / jetée, ô couple impur du fils et de sa mère, / las ! de mon père et de ma mère infortunée... / De quels êtres je suis donc née, misérable ! ce sont eux qu'aujourd'hui, maudite et non mariée / je m'en vais rejoindre... ", (Antigone, p. 80).
La fatalité peut s'interpréter comme la pulsion de mort qui oeuvre : Antigone répète le destin de son père. Antigone s'identifie à Niobé se pétrifiant, "cet inanimé" est mis en relation avec "l'instinct de mort", (p. 327). Lacan pousse à l'extrême la visée qui définit le désir d’Antigone en le qualifiant de "désir pur ... Antigone mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce que l'on peut appeler le désir pur, le pur et simple désir de mort comme tel. Ce désir, elle l'incarne.", (p. 329). Cela veut dire qu'il faut qu'Antigone aille jusqu'au bout, dans le sens où son acte signe son désir, son acte se porte garant de son désir. Il s'agit d'agir conformément à son désir, non pas pour se mettre en conformité, mettre en conformité un désir et son objet- d'objet, il n'y en a pas, en réalité-, mais de faire exister ce désir, d'en assurer l'assomption. La dimension ultime du désir, le désir pur, est la confrontation à la mort. C'est radical. "Aucune médiation n'est ici possible, si ce n'est ce désir, son caractère radicalement destructif.", (p. 329). C’est son désir d’aller au bout, et aller au bout c'est mourir, il n'y a pas de meilleure forme, de meilleure preuve d'engagement.
Mais en aucun cas, Antigone ne meurt pour ses idées ; elle ne va pas vers la mort pour des raisons idéologiques, mais pour son désir peur de tout objet. C’est un désir qui ne cédera devant rien, pas même devant la mort. Lacan infléchit la question de la fatalité. Antigone n'est pas assujettie au "jeu cruel des dieux". Si Antigone se présente comme αὐτόνομος, autónomos, c'est qu'elle est image, "rapport ... de l'être humain avec ce dont il se trouve miraculeusement porteur à savoir la coupure signifiante, qui lui confère le pouvoir infranchissable d'être, envers et contre tout, ce qu'il est.", (p. 328).
Lacan conclut sur Sophocle : "On le trouve humain", (p. 319), entre Eschyle et Euripide, mais, "Sophocle nous présente l'homme et l'interroge dans les voies de la solitude, et nous situe le héros dans une zone d'empiétement de la mort sur la vie, ... son rapport à ce que j'ai appelé ici la seconde mort. Ce rapport à l'être suspend tout ... la transformation, ... [le] cycle des générations et des corruptions, ... l'histoire même, et nous porte à un niveau plus radical que tout". Antigone "en face de Créon, se situe comme la synchronie", stoppée, "suspendue" à un moment donné du temps, opposée à Créon, celui qui évolue dans l'histoire, dans le temps et qui représenterait la "diachronie", (p. 330). Car surtout, ce "rapport à l'être", "il est suspendu au langage.", telles les "jeunes filles suspendues à des arbres." L'homme en est plutôt au stade de la "décompos[ition]", dans son "rapport au signifiant", le splitting, (p. 319), qui génère la séparation, la division, la scission.
Lacan achève sa lecture critique de la figure d'Antigone sur l'"effet du beau" et sur la tragédie qui ne peut être cantonnée à l'effet d'une catharsis "morale.", (p. 332).
Marie-Pierre CHARITAT
Lacan, L’Ethique de la psychanalyse - Le Séminaire, livre VII Lecture des leçons XIX, XX et XXI VIII des 25 mai 1960, 1er et 8 juin 1960.
Les numéros de page renvoient à l'édition du Seuil. Pour le texte de l'Antigone Sophocle, la traduction utilisée est celle de la collection de poche GF Flammarion, trad. Robert Pignarre, les numéros de page y renvoient.
Jacques Lacan a consacré trois séances du séminaire L'éthique de la psychanalyse à la figure d'Antigone, ces séances sont regroupées sous le titre "L'essence de la tragédie - Un commentaire de l'Antigone de Sophocle" : leçons des 25 mai 1960, 1er et 8 juin 1960, pp. 285-333.
Lacan s'attache à faire bouger les hypothèses souvent émises- la catharsis, l'exigence de moralité dans le conflit des lois écrites et celles non-écrites, l'héroïsme même- pour tenter d'expliquer le scandale Antigone, et peut-être de le minimiser : "Essayons de nous laver un peu la cervelle de tout ce bruit fait autour d'Antigone", (p. 292). Le livre d’André Bonnard, D’Antigone à Socrate, par exemple, pour citer un contemporain, faisait de Créon une sorte de fasciste et d’Antigone une résistante, selon l'helléniste Florence Dupont. Lacan nous amène sur des rives bien contraires : Antigone n'est en rien une figure créée à des fins d'édification morale.
UNE IMAGE
Lacan nous rappelle tout d'abord que la tragédie a pour but la catharsis, c'est-à-dire la purgation, la purification de la crainte et de la pitié, émotions indésirables, par le moyen même de la crainte et de la pitié. S'il renvoie aux débuts collaboratifs de Freud et de Breuer et à la méthode dite cathartique, sorte de préhistoire de la psychanalyse, Lacan fait part de sa réserve, "le terme de catharsis rest[ant] singulièrement isolé dans la Poétique.", (p. 287). L'allusion aux travaux de Jacob Bernays, selon qui, Aristote, fils de médecin, aurait été guidé dans l’emploi du mot « catharsis » par une préoccupation thérapeutique et non morale, confirme un usage quasi médical du spectacle de la tragédie. L'apaisement est obtenu par le plaisir, selon Aristote, Lacan s'interroge sur la nature de "ce plaisir auquel on fait retour après une crise" et situe le plaisir "en deçà" du désir", (p. 288).
Dès lors, sa lecture d'Antigone est orientée et conduite par la perspective de "la place propre du désir dans l'économie de la Chose", dans la mesure où "Antigone nous fait voir le point de visée qui définit le désir.", (p. 289-90). Lacan annonce, au début de la deuxième leçon, le projet final de "saisir le sens véritable"de la "fameuse catharsis", (p. 300).
Antigone est avant tout une image qui "fait ciller les yeux" quand on la regarde, qui "fascine dans son éclat insupportable ... qui nous retient et nous interdit". Lacan introduit l'objet regard, l'objet pulsionnel par excellence, dans ce qu'il nomme "l'éclat d'Antigone". C'est "du côté de cet attrait" qu'il faut chercher. Cette image est l'instrument de la purgation et assure la catharsis: "nous sommes purgés par l'intermédiaire d'une image", (p. 290). Il ne s'agit donc pas tant d'émotions que de "fascination", le spectateur "est fasciné par l'image d'Antigone.", les émotions, "le Chœur s'en charge", (p. 295).
Le propos de Lacan se resserre sur " l'éclat d'Antigone" par lequel, "s'établit pour nous un certain rapport à l'au-delà, mais aussi ce qui nous interdit d'en voir la véritable nature, ce qui nous éblouit et nous sépare de sa véritable fonction. Le côté touchant de la beauté fait vaciller tout jugement critique, arrête l'analyse ... L'effet de beauté est un effet d'aveuglement.", (p. 327).
L'éclat, la beauté constituent un danger pour la raison et pour la spéculation. C'est ce qui aveugle. Kant y fait allusion, quand, par exemple, il lit Rousseau : "Le goût gêne l'intelligence. Il me faut lire et relire Rousseau jusqu'à ce que la beauté de l'expression ne me trouble plus, alors seulement je puis le saisir avec raison.", (Remarques touchant les Observations sur le sentiment du Beau et du Sublime.) De même, Lacan met en évidence l'"effet du beau sur le désir", le beau comme visée du désir (et comme effet de la tragédie). L'éclat est un "leurre" qui piège le désir, c'est-à-dire que l'"émoi" est "réel", mais sans objet, il n'y a pas d'objet, pas de sens, (p. 291).
Cependant, même si Lacan rappelle que le théâtre est un art du langage, où le spectacle n'y est qu'accessoire, d'après Aristote, (p. 295), cette première leçon se conclut sur une image, l’œil inerte du monstre marin de la scène finale de la Dolce Vita, dans lequel le public a cru voir et "retrouver [l]a fameuse Chose" lacanienne, quelque chose de dégueulasse "qu'on extrait de la mer avec un filet", (p. 296). Ce dégueulasse-là, c'est l'envers de l’éclat.
Lacan rappelle ce qu'on oublie parfois, à savoir qu'Antigone encourt le châtiment d'être enfermée vivante au tombeau et il parle du "sort d'une vie qui va se confondre avec la mort", (p. 291), qu'il va appeler "seconde mort". La pièce met en scène le fantasme sadique. Lacan marque là une nouvelle étape : "Nous voici maintenant en devoir d'entrer dans ce texte d'Antigone en y cherchant autre chose qu'une leçon de morale.", (p. 292). De même, il s'oppose à Hegel et à son idéalisme qui interprète la tragédie Antigone comme "un conflit de discours", opposant Créon à Antigone, tels deux principes de la loi et du discours, deux discours, donc, qui s'en "vont toujours vers la conciliation.", Lacan, lui, doute de la conciliation dans Antigone. (p. 292). La deuxième leçon, celle du 1er juin 1960, marque l'entrée dans le texte de Sophocle, dont les "articulations" sont imagées par le "tassement" d'un "château de cartes" prêt à s'effondrer, (p. 308). Lacan nous figure la tragédie telle une poussée devant soi (ἄγειν, ágein, "conduire, mener, pousser devant soi"), bien plus que comme un aboutissement (πράττειν, práttein), (p. 308). L'image de la structure d'une tragédie est ensuite raffinée avec les "courbes [qui] n'ont plus qu'à s'écraser les unes sur les autres", (p. 316), et ainsi produite, elle se complète avec le motif de l'anamorphose, image déformée que donne un miroir courbe. L’anamorphose à laquelle se réfère Lacan, à la troisième leçon, est celle du cylindre qui fait se réfléchir les lignes d'un tableau de la crucifixion, imité de Rubens. Quand il dit qu'"une très belle image de la passion apparaît ... tandis que quelque chose d'assez dissous et dégueulasse s'étale autour.", (p. 318), on retrouve là le dégueulasse, l'envers de l'"éclat", l'éclat d'Antigone, qui se redresse. Le procédé de l’anamorphose consiste à déformer une image jusqu’à anéantir son pouvoir de représentation, mais de sorte qu’elle se redresse lorsqu’on la regarde d’un autre point de vue, c'est un jeu de perspective, et la tragédie, "c'est ce qui se répand en avant pour produire cette image. ... image d'une passion", (p. 318), celle d'Antigone qui se redresse.
LOIS ECRITES ET LOIS NON ECRITES Dans la première leçon, le détour par la référence aux Conversations de Goethe d'Eckermann, (1822-1832),- où "l'Antigone de Sophocle" est prise comme modèle de la "beauté de la moralité" -, permet de poser deux points : - - la pièce ne se résout pas en un antagonisme entre deux droits, deux discours, celui de Créon et celui d'Antigone, contrairement à ce qu'en a commenté Hegel. Il n'y a pas d'effet de symétrie ente les deux protagonistes.
À côté des lois des hommes, écrites, spécifiques à chaque cité, il existe en Grèce des lois sacrées, non écrites, et communes à tous les Grecs, comme le devoir impératif pour les enfants de leur rendre les honneurs funèbres. La pièce met en évidence un conflit entre des lois qui touchent au rites funéraires et des lois humaines, celles de Créon. Dans le passage célèbre où, pour justifier la transgression qu’elle a commise au regard de la loi de Créon en ensevelissant son frère, Antigone invoque les lois divines : "Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer (ὑπερδραμεῖν) les lois divines θεῶν/νόμιμα.", dit-elle à Créon après la mort de son frère Polynice et interdiction faite de l’enterrer sous peine de mort, (Antigone, p. 61). Le grec dispose de plusieurs mots pour parler des lois, et Antigone emploie le terme νόμιμα (νόµιµον) et parle de άγραπτα νόµιµα, lois non écrites. Ce sont des lois des dieux, donc sacrées, et beaucoup plus graves à transgresser car rendant l’auteur de la transgression sacrilège. Ainsi, pendant que Créon s'arrange avec "ce qui est formulé, dit, dans la loi par les dieux", la Δίϰη, Díϰē, le jugement des dieux. (p. 322), Antigone se révolterait contre les règles imposées par le législateur, Créon, et aspirerait à un idéal supérieur de justice. C'est l'interprétation qui est très souvent donnée, et qui sert d'explication à ses actes tout en assurant la promotion de l'héroïne. Lacan s'y oppose et nuance : Antigone ne représente pas "simplement la défense des droits sacrés du mort et de la famille", (p. 297). La Δίϰη des dieux, elle en fait ce qu'elle veut, sa position est des plus ambiguës.
Quand, au deuxième épisode, Créon lui repoche d'avoir désobéi, "pass[é] outre (ύπερδραμεῖν, úperdrameĩn) à [s]on ordonnance", elle répond : "Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'a promulguée, et la Justice qui siège auprès des dieux de sous la terre n'en a point tracé de telles parmi les hommes.", (p. 61), on a cru voir là la clé du drame, mais Lacan propose la lecture suivante : "Elle répudie que ce soit Zeus qui lui ait ordonné de faire cela. Ni non plus la Dikê ... Précisément, elle se désolidarise de la Dikê. ... [Elle] ne [s']en mêle pas, de tous ces dieux d'en bas, qui ont fixé les lois parmi les hommes.", (p. 324). Antigone ne meurt pas pour des idées. Antigone ne défend pas plus que cela les lois non écrites de la Diké, alors qu'"on croit avoir dit assez en disant qu'Antigone la défend".
Lacan déplace l'opposition entre νόμοϛ, nomos, les lois écrites, et ἄγραπια, agrapia, les lois non écrites : les lois, νόμοϛ, expriment "une certaine légalité", elles sont une conséquence des lois non écrites, et non plus une opposition aux dieux. Les lois écrites relèvent relèvent maintenant "de l'ordre de la loi, mais qui n'est développé dans aucune chaîne signifiante, dans rien.", (p. 324). Et l'on va voir combien ce rien va se révéler primordial.
- Lacan rapporte également l'étonnement de Goethe devant un passage énigmatique du texte de Sophocle, quand Antigone se justifie sur ses actes, au quatrième épisode, alors que tout est joué : elle n'aurait jamais défié l'interdiction pour un mari ou un enfant, mais pour un frère, oui : " Je me suis dit que, veuve, je me remarierais et que, si je perdais mon fils, mon second époux me rendrait mère à nouveau, mais un frère, maintenant que mes parents ne sont plus sur la terre, je n'ai plus d'espoir qu'il en naisse un autre.", (Antigone, p. 81). La perte d'un frère ne se répare pas. Ces vers sont un bruit qui dérange, qu'il faut écouter, au sens du mot bien connu de John Cage : Si un bruit te dérange, écoute-le !. Lacan les "serr[e] de près", (p. 294) et il va fait de ce passage, l'essentiel de "la visée d'Antigone."
Dans la même perspective, Lacan pointe deux phénomènes sonores, deux signaux dans le texte grec qui peuvent interpeller et qui sont venus à ses oreilles : - ce sont premièrement les lamentations aiguës d'Antigone, tels "les gémissements de l'oiseau à qui ses petits ont été ravis.", (p. 307).
- le deuxième signal est le mot invariable grec μετά, lequel recouvre des sens divers- "au milieu de, parmi", "par derrière, à la suite", "en opposition avec, contre", "avec", "entre", "par le moyen de", "après, à la suite de", "pour"... -qui presque tous marquent une scansion temporelle ou spatiale : "Mετά, c'est à proprement parler ce qui vise la coupure", (p. 308). Plusieurs occurrences de μετά sont citées par Lacan, qui viennent frapper à la fin du vers dans les répliques d'Antigone : au vers 48 : ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα, "Créon n'a pas le droit de me séparer des miens", (Antigone, p. 43) ; au vers 70 : πράσσειν, ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα, "d'ailleurs, même si tu te ravisais, tu ne me seconderais pas de bon coeur." et au vers 73 : φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα, "je reposerai au près de mon frère chéri", (Antigone, p. 44) et toutes impriment le caractère inflexible de l'héroïne.
Mετά et les cris d'oiseau sont le "mode de présence tranchant de notre Antigone", (p.308).
L'ATE, LA LIMITE
Le deuxième temps de la leçon du 1er juin 1960 introduit à l'Até, "terme répété vingt fois". Les vers du Choeur, au deuxième stasimon, par exemple, mettent en évidence l'Até : "Quand un esprit égaré prend le mal pour le bien, c'est qu'un Dieu pousse son âme à l'égarement (πρὸς ἄταν, pros atan, "vers l'Até"). Un moment suffit alors pour le perdre.", (Antigone, p. 69). Le Choeur met en garde celle qui "par son désir, viole les limites de l'Atè.", (p. 322), avec les occurrences de ἐκτὸς ἄτας qui "a dans le texte le sens du franchissement d'une limite", (p. 315). Avec l'Até, ἄτη, en grec ancien, Lacan désigne et nomme la limite. La "limite que la vie humaine ne saurait trop longtemps franchir.", et "au-delà, c'est là que veut aller Antigone.", (p. 305).
Le Chœur éclate, explose, après sa condamnation : "Comme on retrouve dans la fille le caractère intraitable du père ! Elle ne sait pas fléchir devant l'adversité.", (Antigone, p. 61). Le Choeur témoigne ainsi de ce qu'Antigone "a été chercher son Atè.", (p. 322). Pour le Chœur, Antigone a dépassé les bornes, elle est allée chercher sa limite, l'au-delà.
Dans la mythologie grecque, Até, Ἄτη, est la déesse incarnant la Faute et l'Égarement, c'est la déesse de l'égarement funeste et des actes irréfléchis. Ce peut être une folie passagère causée par l’action d’un dieu ou d’un démon. Le chant du Chœur fait une référence énigmatique à trois épisodes mythologiques, au cours desquels la "folie de Dionysos" opère, tel un avatar de l'Atè. Les dictionnaires anglo-saxons traduisent le terme par "perplexité" ou "engouement", causés par l'aveuglement ou l'illusion envoyée par les dieux, principalement en punition d'une imprudence ou d'une témérité coupable. Lacan précise que l'Até, "ce n'est pas l'άμαρτία" (amartia), la faute ou l'erreur, ce n'est pas faire une bêtise.", ce qui est du registre de Créon, - "héros secondaire" et non pas "héros tragique". "L'Até, qui relève de l'Autre, du champ de l'Autre, n'appartient pas à Créon, c'est par contre le lieu où se situe Antigone.", (p. 323). Pour preuve, les paroles du Coryphée, lorsqu'il voit revenir Créon tenant dans ses bras son fils mort :"Voici le Roi qui s'avance, portant dans ses bras le témoignage trop clair d'un malheur qu'il ne doit qu'à lui-même.", (p. 96), αὐτὸς ἁμαρτών., au vers 1259-1260, "de sa propre erreur". "Il ne s'agit pas de l'ἀλλοτρίαν (allotria) ἄτη", l'Até d'autrui. Cependant, Créon veut le bien de tous, c'est tout naturel en tant que chef de la cité, mais c'est aussi sa "faute", son "erreur de jugement", (p. 300), car il le fait dans l'excès, Créon exagère, tout autant qu'Antigone. Dans son éloge de l'homme, aux vers 360-375, "Entre tant de merveilles du monde, la grande merveille, c'est l'homme.", (Antigone, p. 56), le Chœur, de fait, condamne l'obstination de Créon. Tirésias l'avertit, lui dit qu'il "frôle, cette fois encore, le tranchant de la fortune.", (Antigone, p. 85). Le Coryphée, à son tour, invite Créon à la "prudence", (Antigone, p. 90). Créon prend peur et veut réparer le manquement fait à Polynice, mais tardivement. Lacan commente ainsi : "l'Até vient encore là", (p. 309). Avec Créon est la démonstration que "le bien ne saurait régner sur tout, sans qu'apparaisse un excès dont la tragédie nous avertit des conséquences fatales." Créon est dans l'excès, en même temps, "c'est sur un autre champ que Créon comme un innocent, déborde.", (p. 301).
L'important à retenir, c'est que là où l'opposition entre deux systèmes de lois, deux discours, deux idéologies ne tient pas, Lacan introduit la notion de limite ; en place du jugement des dieux, que "nous chrétiens avons balayé(s)". La question de la limite, qui est "là sans doute depuis toujours", est définie par Lacan "comme la limite de la seconde mort.", (p. 302).
La "seconde mort" est un concept forgé à partir de la pensée de Sade, à partir de l'idée que le vrai crime est la transgression à l'égard de la nature, à savoir l'interruption des processus de génération et de destruction de la nature. La "visée de ce crime" est de freiner la "reproduction des formes" afin de "forcer" la nature "à recommencer à partir de rien.", à partir du ex nihilo. C'est la raison pour laquelle "le crime est pour nous un horizon de notre exploration du désir".
Nous voulons être à l'origine.
La destruction crée les conditions de possibilité pour l’événement du nouveau. La création en tant que telle est toujours création de quelque chose qu’il n’y avait pas auparavant. C’est ce désir qui provoque l’effet du beau.
Lacan rappelle aussi que c'est "à partir d'un crime originel que Freud a reconstruit la généalogie de la loi.", (p. 303).
Lacan met en évidence le "fantasme fondamental dans Sade, celui d'une souffrance éternelle.", qui conjugue douleur et beauté. L'"exposition émouvante de la victime" est une image qui "laisse ... interdit", d'autant plus que la menace n'est pas "l'anéantissement."
Par analogie avec Kant- pour qui, les formes sont à distinguer dans le phénomène du beau, "mais sans que l'objet soit concerné."- dans le fantasme sadique, l'objet s'absente, "l'objet n'est là que comme pouvoir d'une souffrance, qui n'est elle-même que le signifiant d'une limite." Lacan illustre ce point par l'"image exemplaire" de la crucifixion, "apothéose du sadisme", "cette limite où l'être subsiste dans la souffrance". Cette image universelle "tire à elle tous les fils de notre désir", [qui] absorbe toutes les autres images du désir chez l'homme ", (pp. 304-5).
LES ECLATS ET L'EXCITATION TRANCHANTE DE LA PIECE Au cours des trois leçons, en même temps qu'il pose ces éléments qui lui permettent de penser le scandale Antigone : image, fantasme sadien, limite, limite de l'Atè, limite de la seconde mort, Lacan déroule les étapes de la pièce.
La première scène, le dialogue avec Ismène, sous le signe de l'inimitié. Le sadisme est à l’œuvre quand Antigone repousse sa sœur, de même qu'elle refuse sa solidarité à l'autre bout du parcours. Tout cela est cruel, "atroce", (p. 306), autrement dit, cru. La scène du garde est, elle aussi un "sommet de la cruauté, mais on s'amuse.", (p. 310). Face à Hémon, son fils et le fiancé d'Antigone, Créon s'entête "et [le] laisse partir sur les pires menaces.", (p. 311).
Alors le Chœur "éclate" (troisième stasimon), il "devient fou", saisi de l'himéros, ιμερος, le "désir incontrôlable", c'est "au moment où Créon décrète le supplice auquel Antigone sera vouée - elle va entrer toute vivante au tombeau", (p. 311), "je la murerai vivante dans un caveau", (Antigone, p. 76).
Himéros provient du verbe grec himeirein, "désirer". Himéros est le dieu du désir passionné, ardent, physique et sexuel dans la mythologie grecque. Son nom contient le nom du dieu Éros et avec son frère Eros, ils forment les Érotes ou Amours. Alors qu’Éros est l’amour comme sentiment, Himéros est le désir sexuel proprement dit. A la fin du second discours de Socrate, dans le Phèdre de Platon, l'"âme cède à " l'himeros", désir amoureux ou amour-passion et les sentiments de Zeus pour Ganymède sont décrits comme du "désir" : Lacan y fait référence pour montrer la force et le caractère sexuel du désir d’Antigone. "Himéros, ... le reflet du désir en tant qu’il enchaîne même les dieux. C’est le terme utilisé par Jupiter pour désigner ses rapports avec Ganymède. Himéros enargés, c’est littéralement le désir rendu visible. Tel est ce qui apparaît au moment où va se dérouler la longue scène de la montée au supplice.", (p. 311).
La beauté d'Antigone est évoquée par le Chœur (troisième stasimon) : "... l'attrait qui rayonne / des yeux de la femme promise.", (Antigone, p. 77). Le thème du désir né du regard apparaît à cet endroit de la pièce. C'est un désir qui se voit, qui a été vu par le Chœur, ébloui.
Himéros est parmi les termes de la démesure, le terme privilégié, préféré à celui d'hybris ; mais quand le Coryphée voit Antigone, telle une demi-déesse, pour elle, c'est un outrage, au sens de "passer outre", de "franchissement" et elle accuse le Choeur d'un autre terme de la démesure, l'ὑβρίζεις, l'hybris, la démesure, l'excès, au vers 840, οὐκ οἰχομέναν ὑβρίζεις, ἀλλ᾽ ἐπίφαντον, "As-tu le coeur de m'outrager en face ? Attends du moins que je sois morte.", (Antigone, p. 79). En fait, Antigone ne se tient pas face à Créon, il n'est pas pour elle un adversaire véritable, ni un détracteur valable ; c'est au Choeur qu'Antigone fait face. Le moment de l'éloge de l'homme chanté par le Choeur, au deuxième stasimon, ne fait que porter sur les rapports de l'homme avec l'Até. Lacan s'oppose au prétendu humanisme de Sophocle et procède à une lecture de ce fameux morceau qui en révèle toute la portée ironique. Le "bon à tout", παντοπόρος, pantopóros, quelquefois traduit par "ingénieux en tout", "génie universel", (Antigone, p. 57), s'inverse en "Il n'en rate pas une.", (p. 321), le contresens est débusqué. L'homme n'est pas venu à bout de la mort, il remédie à des maladies, mais il en crée d'autres. Lacan oriente sa traduction de ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ἔχων "qui va au-delà de tout espoir", dans les vers 365 et 366 : σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων / τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει, dans le sens plutôt d'une errance, l'homme, "se dirige tantôt vers le mal tantôt vers le bien", (p. 321), à partir du terme grec ἕρπει d'une racine grecque ἕρπω (« ramper »), que l'on retrouve avec une altération du h initial dans le mot "serpent"., et qui donnnera le latin herpes. Cette merveille, l'homme, est ensuite réduite au παρέστιος, paréstios, compagnon ou voisin de foyer, celui qui garde le coin du feu et n'en bouge pas, le domestique- au vers 373 : ξύνεστι τόλμας χάριν. μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος. C'est celui dont il vaut mieux se séparer, celui avec lequel il vaut mieux ne partager ni proximité, ni désir, comme il est dit au vers 375 : γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει., où ἴσον φρονῶν, ison phronôn, signifie avoir le même désir. "C'est de ce désir de l'autre qu'il sépare son désir.", (p. 222). C'est ni plus ni moins un désir solitaire, celui d'Antigone, autonome, qui ne veut rien partager de son acte avec Ismène. Lacan a beau lui agrèger la figure socratique et la formule du Connais-toi toi-même, il souligne surtout la solitude du héros de tragédie, "le héros de tragédie participe toujours de l'isolement", l'homme également.
MON FRERE
Antigone, le Chœur l'appelle "autonome", le Chœur voit en Antigone une sorte d'électron libre, le mot, en grec, a le sens de qui se gouverne par soi-même. Le Chœur reproche à Antigone son autonomie, c’est-à-dire de vouloir fonder sa propre loi. Elle ne se justifie que d'elle-même. Dans son obstination devant Créon, elle montre qu'elle ne reconnaît pas d'autre loi que son désir. Son côté "à-bout-de-course", son "côté implacable, sans crainte et sans pitié, qui se manifeste à tout instant chez [elle].", (p. 318), son "esprit d'indépendance qui [la] perd.", (Antigone, p. 80), c'est ce que traduit αὐτόγνωτος, autognôtos, au vers 875.
Le raisonnement est le suivant : de toute manière, si elle avait obéi à Créon, ce sont les dieux qui l'auraient punie : "Je savais bien que je mourrais ; c'était inévitable.", (p. 61). Pour Lacan, il n'y a pas d'explication à donner : "Quand Antigone s'explique devant Créon sur ce qu'elle a fait, Antigone s'affirme d'un c'est comme ça parce que c'est comme ça, comme la présentification de l'individualité absolue.", (p. 323). Comme Electre - celle qui veut venger le père- elle peut affirmer : "Je suis bien d'accord, mais je ne peux pas faire autrement.", (p. 322) Lacan fait un sort particulier au mot ὥρισεν (ὣρισαν όρίζω ὅροϛ, hṑrisan órízō hóros),
"l'image de l'horizon, de la limite ... sur laquelle elle se campe, ... inttaquable", (p. 324), dans les vers de la confrontation à Créon,et nul ne peut passer outre. Le désir est affaire d’horizon, de visée.
C'est un "horizon déterminé ... [qui) n'existe qu'à partir d'un langage de mots [et qui] en montre la conséquence infranchissable." Car Antigone entre dans le langage, "quelque chose peut être dit", prononcé, énoncé et ce "quelque chose", c'est "mon frère est mon frère", sans doute criminel, mais aussi ᾄθαπτος, áͅthaptos (sans sépulture) et surtout ἀδελφός, adelphos (né du même utérus, de la même matrice). Avec le mot χθονὸς, chthonos, la terre, Lacan montre qu' Antigone, dans son attachement à son frère, "passé dans le monde souterrain", ne se tient pas dans les sphères célestes, pas plus que Créon qui mêle les lois du pays avec les décrets des dieux. Elle se tient au plus près "des attaches les plus radicalement chthoniennes des liens du sang", (p. 322), c'est en ce sens seulement qu'elle s'oppose au commandement (kérygme), de Créon." Le seul horizon, la seule visée, finalement, dont elle se réclame est le frère. Elle "[s']avance vers cette limite fatale", car, au contraire d'un mari ou d'un enfant qui sont "remplaçables", "ce frère est ce quelque chose d'unique, et c'est cela seul qui motive qu'[elle s']oppose à [ses] édits. Antigone n'évoque aucun droit que ceci", (p. 324). Elle ne reconnaît pas d'autre loi que ces mots, équivalents à un "droit qui surgit dans le langage du caractère ineffaçable de ce qui est - ineffaçable à partir du moment où le signifiant qui surgit l'arrête comme une chose fixe à travers tout flux de transformations possibles. ... Tout le reste, elle le repousse. ... et tout ce que l'on met autour n'est qu'une façon d'éluder le caractère absolument radical", (p. 325). Lacan souligne qu'on ne peut se passer de sépulture. Sinon, impossible "d'en finir avec ses restes", les restes de "celui qui a pu être situé par un nom", (p. 325). Plus bas, Lacan ajoute qu' en dehors du langage, "la valeur unique de [l'] être ne saurait être conçue." Lacan aboutit ici à une éthique qui dégage "la valeur unique de [l'] être" comme "valeur de langage", (p. 325), par delà le bien et le mal. Le "langage scande tout ce qui se passe dans le mouvement de la vie.", (p. 325), ainsi les mots mon frère qui font coupure, ils se découpent et ils se séparent des lignes biographiques de ce Polynice, "du drame historique qu'il a traversé", de Thèbes ; "c'est là justement la limite, l'ex nihilo autour de quoi se tient Antigone. Ce n'est rien d'autre que la coupure qu'instaure dans la vie de l'homme la présence même du langage.", (p. 325). La parole et la prise de parole sont toujours un franchissement. Les paroles, les assertions d'Antigone sont à évaluer au même titre que ce qui est formulé, énoncé, dit, dans la loi ou prononcé par les dieux (θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν, theō̃n t᾽ énorkon díkan). Les paroles d'Antigone valent autant que la Dikê des dieux, dans leur "dimension proprement énonciatrice", (p. 322).
LA LOI D'EX NIHILO Antigone ne meurt pas pour ses idées, mais pour son désir. Antigone est l'incarnation du désir pur, c'est-à-dire sans objet. "Antigone mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce que l'on peut appeler le désir pur, le pur et simple désir de mort comme tel. Ce désir, elle l'incarne.", (p. 329) et la mort signe le désir.
A la troisième leçon, "L'entre-deux-morts", le développement se poursuit sur l'Atè, comme la limite entre la vie et la mort, la limite absolue, la "position à bout de course de tous les héros ... [qui] sont des personnages situés d'emblée dans une zone limite, entre la vie et la mort.", (p. 316).
Les vers 559-560 : "Ne te décourage pas : ta vie est devant toi ; la mienne est finie ; il y a longtemps que je l'ai consacrée à mes morts.", (Antigone, p. 66), nous donnent la position d'Antigone à l'égard de la vie - elle dit que son âme est morte depuis longtemps", (p. 315), telle Electre, "véritable doublet d'Antigone - morte dans la vie ... déjà morte à tout.", (p. 317). Le Chœur évoque "trois épisodes", (p. 327), "trois destinées ... orchestrées à cette limite de la vie et de la mort, du cadavre encore animé ... l'image autour de laquelle tourne l'axe de la pièce.", (p. 311). Dans l'exodos, pour le Chœur, Créon, "naguère digne d'envie ... est un mort qui respire.", (Antigone, p. 93).
LE DESTIN TRAGIQUE D'ANTIGONE
Lacan produit un effet de coup de théâtre en évoquant l'apparente volte-face du kommos, la plainte d'Antigone. Antigone chante avec le chœur au moment où condamnée par Créon elle traverse l’orchestra pour partir et aller mourir dans une grotte souterraine. Ce passage est reçu comme le moment le plus intense de la douleur de deuil. Juste avant de rentrer vivante dans son tombeau, Antigone fait entendre une longue plainte, devant le destin cruel qui est le sien. Antigone, l'héroïne implacable qui n'éprouve ni crainte ni pitié, s'apitoie sur son sort devant la décision de Créon qui la "prive de [s]on fiancé, de [s]es noces, de |s]a part d'épouse et de mère", qui la prive des joies de l’amour, du plaisir et de la maternité. Antigone n'est donc pas sans désir et elle le proclame au moment de mourir. Juste, avant de mourir, Antigone est vivante et désirante. Mais il s'agit d’un désir né sur le rien, créé à partir du rien, de cette zone impossible, zone entre deux morts, dans laquelle Antigone évolue : "Je ne serai plus ni chez les humains ni chez les défunts séparée à la fois des vivants et des morts", (Antigone, p. 82). Elle se plaint de tout ce qu'elle va manquer : un mari, des enfants... Cela n'a plus rien à voir avec l'intraitable Antigone et on peut déplorer le manque d'unité dans son caractère et dans le texte. Lacan, au contraire, y voit une cohérence, "car pour Antigone, la vie .... ne peut être vécue et réfléchie, que de cette limite où déjà elle a perdu la vie, où déjà elle est au-delà - mais de là, elle peut la voir, la vivre sous la forme de ce qui est perdu.", (p. 326). Eh bien, cela, c'est un peu l'affaire de tous, d'avoir perdu ce que l'on convoque, de devoir perdre les choses pour pouvoir les convoquer par le langage. Elle devient ainsi l’emblème de cette position désirante, "à l’opposé du court-circuit qu’implique la morale des biens, du corps offert comme bien que l’on s’échange et partage. À aucun moment, elle n’accepte l’échange", comme le commente Patrick Guyomard, lors de sa conférence "L'éthique de la psychanalyse selon Freud et après Lacan : Quelle est la loi d'Antigone ?", E.P.H.E.P., le 15 juin 2018.
Antigone est dite "autonome", or il n'y a pas plus enchaînée à son hérédité, à son destin qu'Antigone. Dans la tragédie grecque, la fatalité porte le même nom que l’erreur, "l'atè". Lacan précise que "quand on s'approche d'Até, c'est en raison de quelque chose qui est lié ... à une chaîne, celle du malheur des Labdacides.", (p. 306), et il reprend le thème de la "descendance de l'union incestueuse, dédoublée en deux frères", à l'un, la "puissance", à l'autre, le "crime" : Antigone occupe la place libre laissée pour le crime. On reconnaît là le thème du fatum, du destin qui écrase le héros tragique : "Antigone doit faire le sacrifice de son être au maintien de cet être essentiel qu'est l'Até familiale", (p. 329). La lamentation d'Antigone évoque la malédiction, l'accumulation de malheurs qui remonte à Laïos, le père d' Œdipe et fils de Labdacos : "Ah ! tu as touché là ma plaie à vif, / mon triple sujet de plaintes, / le malheur de mon père et de notre famille, / le malheur qui n'épargne aucun des Labdacides ! Sur le lit maternel, ô malédiction / jetée, ô couple impur du fils et de sa mère, / las ! de mon père et de ma mère infortunée... / De quels êtres je suis donc née, misérable ! ce sont eux qu'aujourd'hui, maudite et non mariée / je m'en vais rejoindre... ", (Antigone, p. 80).
La fatalité peut s'interpréter comme la pulsion de mort qui oeuvre : Antigone répète le destin de son père. Antigone s'identifie à Niobé se pétrifiant, "cet inanimé" est mis en relation avec "l'instinct de mort", (p. 327). Lacan pousse à l'extrême la visée qui définit le désir d’Antigone en le qualifiant de "désir pur ... Antigone mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce que l'on peut appeler le désir pur, le pur et simple désir de mort comme tel. Ce désir, elle l'incarne.", (p. 329). Cela veut dire qu'il faut qu'Antigone aille jusqu'au bout, dans le sens où son acte signe son désir, son acte se porte garant de son désir. Il s'agit d'agir conformément à son désir, non pas pour se mettre en conformité, mettre en conformité un désir et son objet- d'objet, il n'y en a pas, en réalité-, mais de faire exister ce désir, d'en assurer l'assomption. La dimension ultime du désir, le désir pur, est la confrontation à la mort. C'est radical. "Aucune médiation n'est ici possible, si ce n'est ce désir, son caractère radicalement destructif.", (p. 329). C’est son désir d’aller au bout, et aller au bout c'est mourir, il n'y a pas de meilleure forme, de meilleure preuve d'engagement.
Mais en aucun cas, Antigone ne meurt pour ses idées ; elle ne va pas vers la mort pour des raisons idéologiques, mais pour son désir peur de tout objet. C’est un désir qui ne cédera devant rien, pas même devant la mort. Lacan infléchit la question de la fatalité. Antigone n'est pas assujettie au "jeu cruel des dieux". Si Antigone se présente comme αὐτόνομος, autónomos, c'est qu'elle est image, "rapport ... de l'être humain avec ce dont il se trouve miraculeusement porteur à savoir la coupure signifiante, qui lui confère le pouvoir infranchissable d'être, envers et contre tout, ce qu'il est.", (p. 328).
Lacan conclut sur Sophocle : "On le trouve humain", (p. 319), entre Eschyle et Euripide, mais, "Sophocle nous présente l'homme et l'interroge dans les voies de la solitude, et nous situe le héros dans une zone d'empiétement de la mort sur la vie, ... son rapport à ce que j'ai appelé ici la seconde mort. Ce rapport à l'être suspend tout ... la transformation, ... [le] cycle des générations et des corruptions, ... l'histoire même, et nous porte à un niveau plus radical que tout". Antigone "en face de Créon, se situe comme la synchronie", stoppée, "suspendue" à un moment donné du temps, opposée à Créon, celui qui évolue dans l'histoire, dans le temps et qui représenterait la "diachronie", (p. 330). Car surtout, ce "rapport à l'être", "il est suspendu au langage.", telles les "jeunes filles suspendues à des arbres." L'homme en est plutôt au stade de la "décompos[ition]", dans son "rapport au signifiant", le splitting, (p. 319), qui génère la séparation, la division, la scission.
Lacan achève sa lecture critique de la figure d'Antigone sur l'"effet du beau" et sur la tragédie qui ne peut être cantonnée à l'effet d'une catharsis "morale.", (p. 332).
Marie-Pierre CHARITAT



