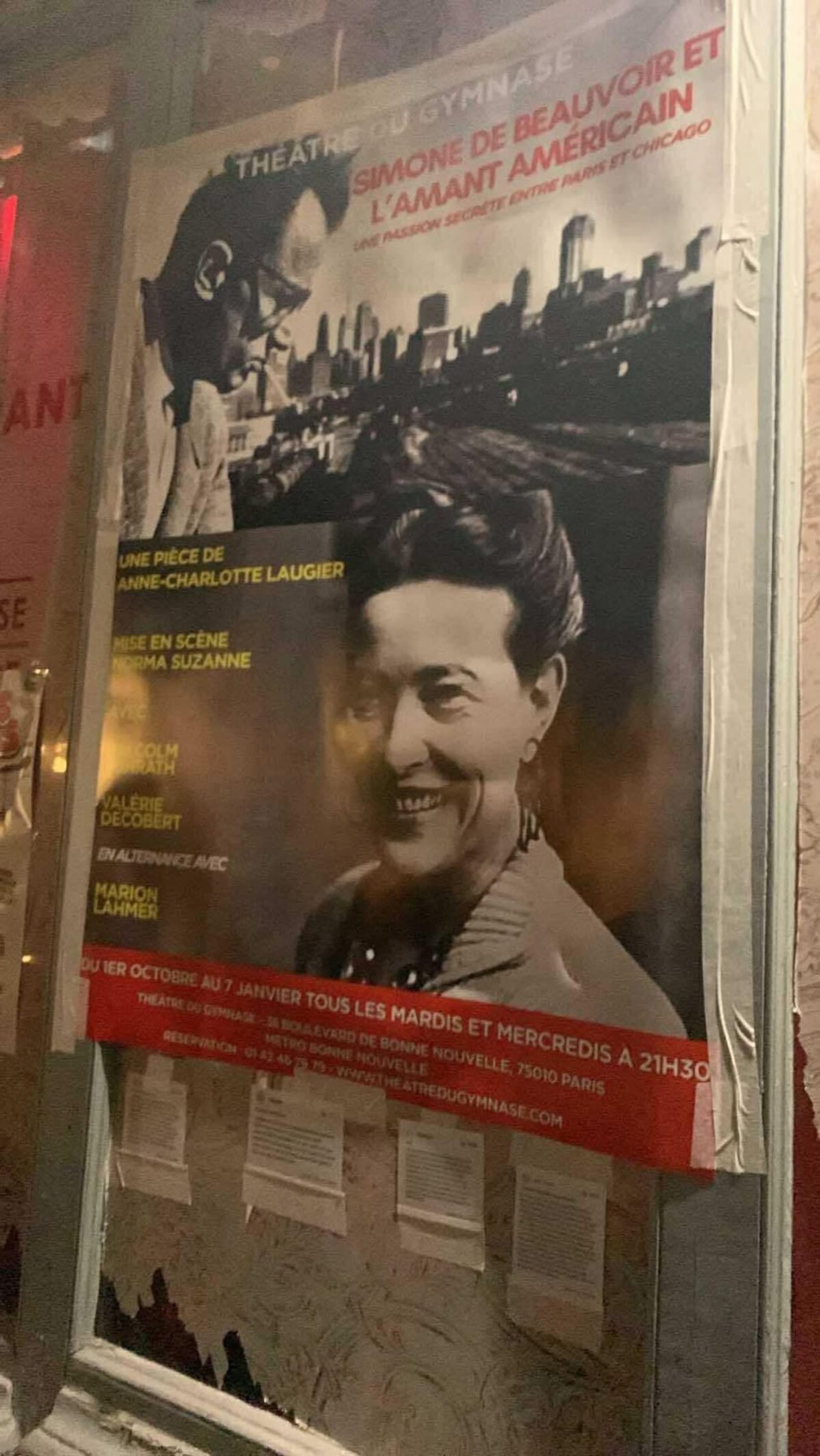
Agrandissement : Illustration 1
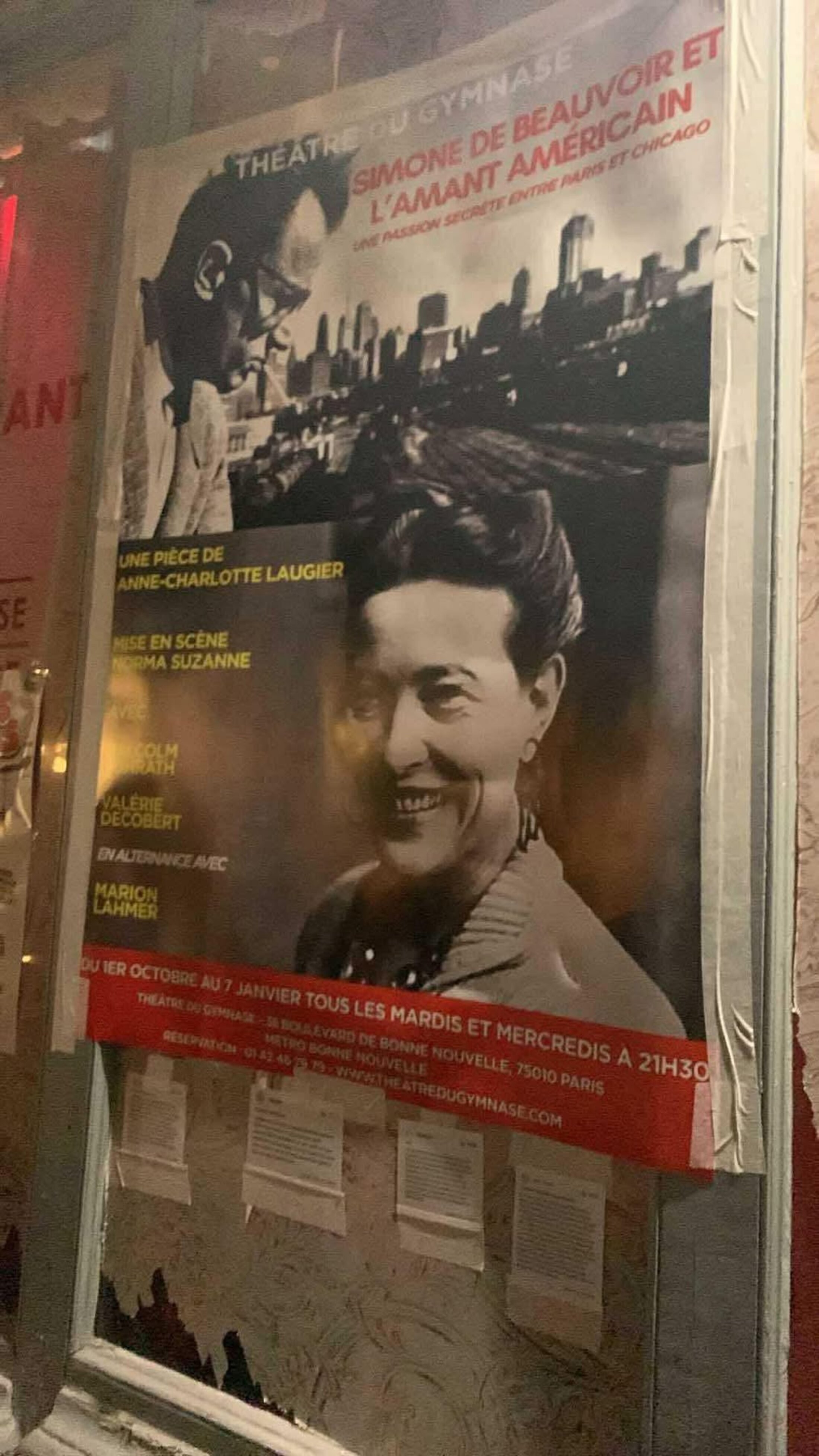
Le hasard d’une rencontre comme celle de Beauvoir et d’Algren obéit à une logique qui semble échapper aux lois, mais que l’on pourrait presque modéliser, l’instant d’une première impression agit comme une équation intuitive, une fonction de variables invisibles où se mêlent le calcul inconscient, la contingence et la norme. À la manière d’une Grundnorm kelsenienne (la norme hypothétique et suprême qui fonde la validité de tout l’ordre juridique sans être elle-même fondée sur une norme supérieure. ), cette première impression institue la règle fondatrice d’une relation, tout ce qui suivra passion, distance, hiérarchie ou rupture découle de ce point d’origine non démontrable mais structurant, à la fois axiome affectif et loi interne. Entre hasard mathématique, nécessité symbolique et construction juridique de la norme, l’amour révèle la tension entre liberté individuelle et ordre latent, entre le sentiment comme expérience du chaos et la relation comme architecture.
Dès lors comment le hasard amoureux, apparemment contingent, engendre-t-il un ordre intérieur comparable à une norme fondamentale une Grundnorm affective qui structure toute relation humaine ?
Pour y répondre, nous verrons d’abord comment les amours de Simone de Beauvoir illustrent cette tension entre liberté et hiérarchie affective, avant d’en analyser les ressorts philosophiques à travers Schopenhauer, Weininger, Camus, Baudrillard et Baricco, pour enfin dévoiler, à travers la critique du polyamour et de la modernité sentimentale, la crise du lien et la recherche d’une rareté authentique dans l’amour.
Les amours de Simone de Beauvoir : entre liberté et hiérarchie affective
Dans la correspondance qu’elle entretient avec Nelson Algren entre 1947 et 1964, Simone de Beauvoir dévoile une part intime de sa pensée, bien plus vibrante que celle, austère, des traités philosophiques. « Je pense à toi avec une douceur qui n’a pas de nom », écrit-elle depuis Paris en 1948, alors que l’océan sépare déjà leurs corps. Ce lien transatlantique, fondé sur la distance, fait de l’absence un moteur de désir et de langage. Beauvoir écrit pour combler le vide, Algren lit pour s’y accrocher. À chaque lettre, les kilomètres deviennent une métaphore de la tension entre liberté et attachement, elle ne veut pas rompre le pacte existentiel conclu avec Sartre, il voudrait qu’elle s’enracine à Chicago. Dans cette asymétrie naît une hiérarchie affective implicite, Beauvoir vit plusieurs amours, mais un seul amour “nécessaire”, celui de Sartre, demeure l’axe autour duquel les autres gravitent.
Sartre et Beauvoir, par leur pacte, instaurent une forme d’ordre sentimental inédit. Dans une lettre de 1947, elle confie à Algren, « Je t’aime à ma manière, librement, mais sans légèreté. » Cette phrase condense la tension de tout leur lien, une passion authentique, mais soumise à une éthique de la liberté. Elle aime sans promettre, elle désire sans appartenir. L’amour devient un exercice moral, presque stoïcien, où la sincérité compte davantage que la fidélité. Ce qu’elle appelle « l’amour nécessaire » n’est pas celui de la fusion, mais celui de la constance de regard, Sartre demeure le témoin fondateur de son existence, le “socle ontologique” à partir duquel les autres émotions prennent sens. Dans une lettre à Sartre, elle lui dit, « Tu es mon présent et mon avenir, même quand je suis ailleurs. » Tout est là, la liberté proclamée suppose un centre stable, une forme d’orthodoxie affective qui légitime ses “hérésies” sentimentales.
Le prix de cette construction est lourd. Algren souffre d’un amour où la liberté de l’une se traduit en incertitude pour l’autre. Il lui écrit :« Je n’ai jamais su si j’étais un homme dans ta vie ou un voyage. » La douleur du déséquilibre traverse toute la correspondance : Beauvoir se montre tendre, mais rationnelle ; Algren, charnel et ancré. L’un rêve de maison, l’autre d’œuvre. Entre eux, la géographie devient un langage moral, l’Amérique du réalisme, la France de la lucidité. Leurs lettres, souvent datées du matin, après une nuit d’insomnie ou de travail, témoignent d’une oscillation constante entre l’élan et la maîtrise. L’amour, chez Beauvoir, est un champ d’expérimentation pour la liberté ; chez Algren, un appel à l’enracinement.
Cette expérience amoureuse prend valeur d’épreuve philosophique, comment aimer sans posséder ? Peut-on séparer l’intensité du lien et la souveraineté de soi ? Beauvoir se veut pionnière d’une éthique de l’amour non exclusif, mais sa correspondance révèle moins une sérénité qu’un travail de justification permanente. Le refus du mariage, du foyer et de la dépendance n’abolit pas le besoin d’un centre, d’une “norme fondamentale” affective une Grundnorm de l’amour qui structure son univers moral. Algren ne comprend pas cette logique : pour lui, aimer suppose d’élire. Pour elle, aimer, c’est reconnaître sans absorber. D’où une fracture silencieuse, l’égalité proclamée masque une dissymétrie émotionnelle profonde.
L’écriture devient alors le lieu où Beauvoir transforme la souffrance en sens. Les Mandarins (1954) rejoue sa liaison avec Algren, Lewis Brogan y incarne cet Américain passionné, Anna (double de Beauvoir) tente de concilier liberté et fidélité. L’œuvre opère une catharsis, ce qu’elle ne peut résoudre dans la vie, elle l’ordonne dans la fiction. Écrire, pour Beauvoir, c’est sauver la vérité d’une expérience sans trahir la logique existentielle ; c’est faire de l’échec affectif une victoire symbolique. Le roman se clôt sur un constat lucide, “On ne peut pas être deux à la fois libres et heureux.” La phrase résume tout l’horizon moral de son parcours, la liberté n’est pas la plénitude, mais le prix à payer pour rester sujet.
Ainsi, les amours de Beauvoir, loin d’être de simples aventures, révèlent une architecture invisible, chaque lien est une tentative de concilier le hasard de la rencontre et la rigueur d’une norme intérieure, une tension entre contingence et nécessité. C’est là que se noue le paradoxe fondamental, vouloir vivre l’amour comme espace de liberté absolue, tout en y cherchant une loi, un ordre, une Grundnorm affective.
Cette dialectique entre désir et loi, entre hasard et ordre intérieur, trouve un écho chez les philosophes qui ont interrogé la nature du vouloir et de la souffrance, de Schopenhauer à Weininger, de Camus à Baudrillard, tous cherchent à comprendre comment la passion, qu’elle soit sentimentale ou intellectuelle, naît d’un manque et se transforme en structure.
Interprétations philosophiques : Schopenhauer, Weininger, Camus, Baudrillard, Baricco
Schopenhauer fut l’un des premiers à pressentir que l’amour, sous ses apparences romantiques, obéit à une logique plus sombre et plus métaphysique, celle de la Volonté de vivre. Dans Le Monde comme volonté et comme représentation(1819), il écrit que « l’amour n’est qu’un piège tendu à la conscience pour servir la vie ». Cette phrase, souvent citée et mal comprise, signifie que le sentiment amoureux n’est pas un choix libre mais l’expression d’une force vitale aveugle, cherchant à se perpétuer. Ainsi, quand Beauvoir écrit à Algren, « Je t’aime d’une façon que je ne comprends pas », elle semble rejoindre cette intuition schopenhauerienne, aimer, c’est être pris dans une dynamique qui nous dépasse. L’amour, chez Schopenhauer, n’est pas une éthique mais un mécanisme, une ruse de la nature; la souffrance qui en découle n’est pas accidentelle, mais nécessaire. Il n’y a pas d’équilibre possible entre la possession et la liberté, entre le désir et la paix. C’est pourquoi il propose l’ascèse, l’art ou la lucidité comme seules échappatoires au cycle infini du manque. On retrouve cette idée dans la posture de Beauvoir, écrire pour elle, est une manière d’élever la passion au-dessus de la douleur, de convertir le désir en œuvre exactement ce que Schopenhauer appelait la “contemplation désintéressée”.
Otto Weininger, lui, pousse cette logique jusqu’à la destruction. Dans Sexe et Caractère (1903), il élabore une typologie quasi métaphysique du masculin et du féminin, l’H pur (principe spirituel, rationnel) et la F pure (principe vital, érotique). “L’homme ne sait pas aimer”, écrit-il en substance, parce qu’il ne cherche pas l’autre comme sujet mais comme miroir de son propre salut. Pour Weininger, l’homme “pur” ne peut aimer qu’une femme “pure”, c’est-à-dire la plus éloignée du monde des affects sinon, il s’autodétruit. “L’homme s’élève vers la femme qu’il imagine, mais il la hait dès qu’il la trouve réelle”, dit-il encore. Dans ce paradoxe se dessine le tragique de l’amour intellectuel, l’homme projette sur la femme la grâce qu’il espère pour lui-même, puis la condamne pour n’en être que le reflet imparfait. Weininger lui-même finira par se suicider à 23 ans, scellant dans sa vie cette tension insoutenable entre idéal et incarnation. Si l’on transpose ce schéma à Beauvoir et Algren, on voit combien l’“homme pur” l’écrivain américain sincère, enraciné ne peut supporter l’abstraction affective de la philosophe, tandis que Beauvoir, refusant de se fondre, échappe à la logique sacrificielle du féminin selon Weininger. Elle inverse ainsi le mythe, c’est l’homme qui se consume dans la passion, et la femme qui en fait œuvre.
Albert Camus, que l’on a souvent rattaché à Sartre et à Beauvoir, s’en démarque radicalement. Il n’est pas existentialiste, il le dit explicitement dans L’Homme révolté (1951) “Je ne suis pas un philosophe de l’absurde, mais un homme de la mesure.” Chez Camus, le drame n’est pas celui du sens perdu, mais celui de la tension entre le désir de sens et le silence du monde. L’amour, pour lui, n’est pas une délivrance métaphysique, mais une expérience de lucidité. Dans Noces (1938), il écrit, « Aimer, ce n’est pas se soumettre, c’est consentir à la joie du monde. » Cette phrase éclaire toute sa pensée, aimer, c’est reconnaître la beauté du réel sans la vouloir éternelle, c’est résister à la tentation du système, du “tout expliquer”. Là où Sartre conçoit la liberté comme fondement de l’engagement, Camus y voit une limite, l’homme doit rester fidèle à la vie, non à l’idée. Beauvoir, souvent écartelée entre sentiment et concept, retrouve chez Camus ce refus de l’absolu, aimer sans enfermer, être libre sans fuir. L’absurde, en amour comme dans l’existence, n’est pas une impasse mais une exigence de clarté.
Baudrillard, lui, observe que la société postmoderne transforme le sentiment en signe. Dans De la séduction (1979) et La société de consommation (1970), il montre que le désir ne se vit plus comme un élan vital, mais comme une mise en scène codée. “Nous ne faisons plus l’amour, nous l’échangeons”, écrit-il. Le polyamour, la transparence sentimentale, les contrats affectifs que revendiquent certains milieux intellectuels ne sont, pour lui, que des simulacres de liberté, on remplace la passion par la gestion, l’imprévisible par le protocole. La multiplicité des partenaires devient une illusion d’autonomie la version libidinale du marché. Beauvoir et Sartre avaient voulu échapper à la possession bourgeoise du couple; leurs héritiers ont souvent basculé dans la marchandisation des affects. Ce que Baudrillard appelle “l’illusion libidinale” décrit bien ce paradoxe, plus on croit s’affranchir des cadres, plus on reproduit les codes du système. L’amour n’est plus vécu, il est performé.
Enfin, Alessandro Baricco, dans Les Barbares (2006), propose une lecture culturelle de cette mutation, la modernité ne détruit pas la profondeur, elle la horizontalise. Ce que les élites vivaient autrefois comme raffinement ou liberté, le libertinage, la pluralité amoureuse, la conversation intellectuelle se démocratise et devient un style de vie mainstream. “Les barbares”, dit-il, “ne sont pas venus de l’extérieur, ce sont nos enfants.” Autrement dit, la transgression est devenue la norme. Ce qui était subversion chez Beauvoir ou chez les surréalistes devient aujourd’hui un simple marqueur social, une posture de distinction. Baricco parle de “barbarisation” non pas comme d’une décadence morale, mais comme d’une mutation du regard, la profondeur devient surface, la fidélité devient option, et la liberté se confond avec le zapping affectif.
De Schopenhauer à Baricco, un même fil se tisse, l’amour comme lieu de tension entre le désir d’absolu et la contingence du monde, entre la singularité et la série, entre la vérité et le simulacre. Là où Beauvoir cherchait une éthique de la liberté amoureuse, la philosophie et la culture contemporaines révèlent la persistance d’un déséquilibre, vouloir aimer sans loi, mais toujours selon un code.
Cette tension éclate aujourd’hui dans la mise en scène contemporaine du “polyamour”, qui prétend abolir la hiérarchie des désirs tout en la reproduisant. Ce sera l’enjeu de la dernière partie, comprendre comment, derrière l’idéologie de la pluralité et de la transparence, se rejouent les mêmes illusions, les mêmes violences psychiques et les mêmes contradictions que celles qu’avaient déjà pressenties Beauvoir, Baudrillard et leurs prédécesseurs.
La fraude du polyamour et la crise du lien moderne
Le besoin contemporain de relations “ouvertes” ou de formes dites “polyamoureuses” trouve son origine dans une longue réaction historique. Dans la bourgeoisie française du XIXᵉ siècle, le mariage n’était pas un choix sentimental, mais une institution contractuelle, une alliance économique et sociale décidée par les familles. Les unions se concluaient jeunes, souvent entre dix-huit et vingt ans, dans un cadre où le devoir primait sur le désir. Le mariage d’amour apparaissait comme une exception, presque une imprudence. Cette contrainte institutionnelle produisit mécaniquement une contre-culture, celle des liaisons libres, d’abord clandestines, puis assumées. Les salons libertins, les correspondances adultères et plus tard les relations triangulaires de la bohème parisienne prolongent ce besoin de soustraire l’amour à la loi. Ce que la bourgeoisie avait imposé comme norme le mariage arrangé engendra, par réaction, une revendication de liberté intime, d’abord aristocratique, puis intellectuelle. La relation libre n’est donc pas née d’une modernité libérale, mais du refus d’un ordre matrimonial hiérarchisé où le sentiment devait se taire.
Ce désir d’émancipation affective se perpétua jusque dans les années 1920-1930, les avant-gardes littéraires et philosophiques s’en emparèrent comme d’une revendication existentielle. Les couples à trois, comme Gide, Colette ou Beauvoir et Sartre plus tard, se voulaient à la fois expérimentation morale et critique sociale. Dans une société encore corsetée par la morale catholique, ils cherchaient à démontrer que l’amour pouvait exister hors de la propriété, que la fidélité pouvait être spirituelle et non sexuelle. Beauvoir dira à ce sujet, « Ce n’est pas le corps qu’on trahit, c’est la parole donnée. » Pourtant, cette tentative d’émancipation se heurta à une contradiction, si l’amour se veut égalitaire, pourquoi le couple central persiste-t-il toujours ? Dans la pratique, même les relations dites “ouvertes” reproduisent une hiérarchie cachée, il y a toujours un cœur de gravité affectif, une Grundnorm sentimentale autour de laquelle s’ordonnent les autres relations. Le polyamour, en prétendant abolir la différence des intensités, nie ce que Schopenhauer appelait “l’inégalité essentielle des désirs”. On peut multiplier les corps, jamais les âmes, chaque lien reste unique et incommensurable.
Ce que l’on appelle aujourd’hui “trouple” ou “polyamour éthique” réinvente, sous un vocabulaire nouveau, les pratiques des élites d’hier les aristocrates du XVIIIᵉ siècle partageaient déjà leurs amants dans une logique codifiée, les salons du XIXᵉ cultivaient le double jeu des apparences. En un sens, la “révolte amoureuse” de Beauvoir et Sartre, contre l’ancien modèle conjugal, réactive paradoxalement la tradition qu’elle croyait subvertir. Le couple libre n’est pas une invention moderne, c’est le retour, sous d’autres mots, de l’ancienne diplomatie sentimentale des milieux privilégiés. Là où les aristocrates vivaient leurs amours multiples sous le signe du raffinement et du secret, les intellectuels du XXᵉ siècle en ont fait un manifeste politique et moral. Baudrillard aurait dit que la modernité en fait un simulacre d’égalité, un dispositif de mise en scène où chacun joue le rôle du sujet libre tout en restant soumis à la logique du code. Le discours sur la transparence, la communication permanente, la négociation des désirs, n’abolit pas la structure du couple, il la rend simplement contractuelle. La liberté devient une clause, non un sentiment. Ce que la modernité affective présente comme rupture n’est qu’un recyclage des codes aristocratiques, vulgarisé et psychologisé. Baricco appellerait cela une “barbarisation de la nuance”, la profondeur des sentiments anciens, transgressive car cachée, s’aplatit en un modèle comportemental de surface, consumériste et normé.
Mais derrière cette illusion d’équilibre demeure une violence psychique. Philippe de Vulpillières, dans L’homme tue et la femme rend fou, décrit la dissymétrie fondamentale entre la violence masculine, visible et physique, et la violence féminine, psychique et symbolique. Dans les relations ouvertes, cette dissymétrie s’amplifie, celui qui aime le plus devient celui qui souffre le plus, car l’absence d’exclusivité fragilise le repère affectif qui le structure. L’ouverture peut alors servir de masque à un transfert de souffrance, on célèbre la liberté de chacun tout en laissant le plus sensible porter le coût émotionnel collectif car il y a toujours un couple dans un trouple ou une relation libre,
C’est ce que l’on observe dans les journaux intimes ou les correspondances modernes, sous le langage de l’autonomie, s’exprime souvent un sentiment d’épuisement affectif. L’amour libre exige une force intérieure que peu possèdent.
Camus l’avait pressenti dans son Discours de Suède (1957), « L’obsession amoureuse n’est qu’une forme de l’absurde, l’exigence d’un absolu dans un monde qui ne le donne pas. » Pour lui, l’amour absolu, comme le besoin de sens, relève du même vertige, on cherche une unité que la vie refuse. C’est pourquoi il prône la mesure, non le renoncement, aimer avec lucidité, sans mensonge, mais sans idolâtrie. Cette “fidélité sans illusion” est ce qui manque souvent aux idéologies du polyamour. En voulant neutraliser la jalousie, elles suppriment aussi la profondeur du lien, cette part de risque et d’abandon sans laquelle il n’y a pas de rencontre réelle. L’obsession amoureuse, chez Camus, n’est pas une pathologie, mais la trace de notre condition tragique, nous voulons l’infini dans le fini.
La passion moderne se présente donc comme une utopie égalitaire, mais elle rejoue en réalité des structures anciennes sous le signe de la transparence. La liberté sexuelle est devenue la nouvelle norme de conformité, non plus un scandale, mais un devoir culturel. Derrière cette apparente ouverture se dissimule une injonction paradoxale, être libre, c’est désormais ne pas choisir, ne pas s’attacher. Dans ce contexte, aimer vraiment c’est-à-dire reconnaître l’autre comme irremplaçable devient un acte de résistance. L’enjeu n’est plus de multiplier les liens, mais de retrouver la rareté du lien, de rendre à l’amour sa densité symbolique, sa singularité non reproductible. Comme l’écrivait Beauvoir à Algren : « J’ai besoin de toi comme d’un hasard nécessaire. » C’est peut-être là le dernier mot de la fidélité, aimer non pas beaucoup, mais juste.
Aimer juste, ce n’est pas seulement refuser la logique consumériste du sentiment, c’est aussi respecter la structure biologique et symbolique de l’attachement humain. Les études en neurobiologie de l’amour (Helen Fisher, Lucy Brown) montrent que le lien romantique active le système de récompense dopaminergique et la libération d’ocytocine et de vasopressine, hormones qui favorisent la fidélité, la reconnaissance du partenaire et la formation de liens exclusifs. Même chez les mammifères monogames comme le campagnol des prairies, la manipulation de ces récepteurs suffit à créer ou détruire l’attachement, signe que notre besoin de lien stable n’est pas pure invention culturelle.
Sur le plan évolutif, les recherches en anthropologie montrent que la monogamie sociale s’est imposée dans la majorité des sociétés modernes parce qu’elle réduit la compétition masculine et favorise l’investissement parental, autrement dit, elle protège le groupe en stabilisant les dyades. Schopenhauer l’avait deviné avant la science, l’amour n’est pas un caprice individuel, mais la ruse de la nature pour préserver l’espèce. C’est pourquoi l’humain, même moderne, tend à préférer la qualité d’un lien exclusif à la quantité des expériences interchangeables.
Les plateformes de rencontre et la société algorithmique essaient d’effacer cette vérité en transformant l’amour en suite de choix équivalents. Mais, comme le rappellerait Baudrillard, le signe ne remplace jamais le réel, on ne “scroll” pas un être humain. Et Baricco dirait que cette horizontalité de la séduction détruit la profondeur du lien. Aimer juste, c’est donc un acte de résistance, refuser la logique du marché, mais aussi honorer notre nature biologique et notre humanité singulière, celle qui fait que chaque être est, par essence, irremplaçable.
Pour conclure, de la première impression, cet instant d’intuition où se fonde, comme par accident, la loi intérieure d’un lien jusqu’aux architectures sentimentales les plus modernes, tout confirme la même tension, le hasard engendre de l’ordre, et la liberté appelle une structure. Ce que Hans Kelsen nommait Grundnorm, la norme fondamentale qui fonde tout l’ordre juridique sans être elle-même fondée, trouve ici son équivalent symbolique, une loi affective première, non écrite mais structurante, à partir de laquelle tout amour s’organise.Chez Beauvoir, cette Grundnorm est le couple-pivot avec Sartre ; chez Schopenhauer, c’est la volonté de l’espèce ; chez Camus, la mesure lucide qui empêche la démesure ; chez Baudrillard, c’est la résistance du réel au simulacre. Aimer “juste” revient alors à reconnaître cette norme cachée, ce principe de cohérence du sentiment, contre la dispersion quantitative du marché des désirs. C’est une fidélité non à la possession, mais à la structure intérieure du lien une fidélité à la singularité, à ce qui échappe à la série et à l’échange. La Grundnorm affective, c’est la loi silencieuse qui nous lie sans contrat, la règle invisible du choix vrai.
Penser une Grundnorm du lien, c’est reconnaître que, même dans la modernité la plus fluide, nos relations ne naissent pas du néant, elles s’enracinent dans une norme première, biologique, symbolique et morale, aussi nécessaire que la Grundnorm de Kelsen l’est au droit. Là où la société algorithmique prétend tout égaliser, cette loi de l’irremplaçable réintroduit une hiérarchie du sens, tout ne se vaut pas, et tout ne peut pas être remplacé.L’enjeu devient dès lors politique et anthropologique, comment fonder un nouvel humanisme relationnel, qui reconnaisse la Grundnorm comme principe d’équilibre entre liberté et attachement ? Peut-être faut-il imaginer un monde où la technologie ne simule plus la rencontre, mais renforce la densité du lien, où la loi du cœur redevient, comme chez Kelsen, la condition de validité de tout ce que nous construisons ensemble.
Sources :
Neurobiologie du lien amoureux (IRM & circuits de récompense):
- Revue open-access (synthèse Fisher/Aron/Brown) : Helen Fisher et al., “The brain’s reward system in early-stage intense romantic love” , (accès libre via PubMed royal society publishing
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2011.0290?utm_
- Acevedo, Aron, Fisher, Brown (SCAN, 2011) : “Neural correlates of long-term intense romantic love” , page éditeur Oxford Academic (SCAN).
https://www.researchgate.net/publication/221772273_The_Puzzle_of_Mmonogamous_Marriage
- Xu et al. (Neuroscience Letters, 2011/2012) : étude IRM sur l’amour romantique précoce (entrée PubMed de la série d’études d’Xu/Aron/Brown/Weng).
https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/sex-in-long-term-relationship-acevedo-et-allong-term.6toy70wsmpbc..pdf?utm_
Ocytocine/vasopressine & attachement (campagnol des prairies):
- Lim et al. (Nature, 2004) : manipulation du récepteur, V1a et préférence de partenaire chez le campagnol, entrée PubMed (domaine prairie vole/vasopressine par la même équipe ; utile pour remonter au papier Nature 2004).
https://psy.fsu.edu/~wanglab/PDF-papers/2004/04.Nature.pdf?utm_
- Young & Wang (Nature Neuroscience, 2004) : grande revue “The neurobiology of pair bonding”, entrée PubMed / notice (le papier est souvent accessible via votre bibliothèque).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23898180/
Évolution/anthropologie de la monogamie:
- Opie et al. (PNAS, 2013) : “Male infanticide leads to social monogamy in primates”, réponse PNAS (avec liens vers l’article principal).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23898180/
- Henrich, Boyd, Richerson (Phil. Trans. B, 2012) : “The puzzle of monogamous marriage” , page université (avec renvoi DOI) + rappel biblio (vous pourrez accéder au PDF via le DOI/Royal Society).
https://coevolution.fas.harvard.edu/publications/puzzle-monogamous-marriage?utm_



