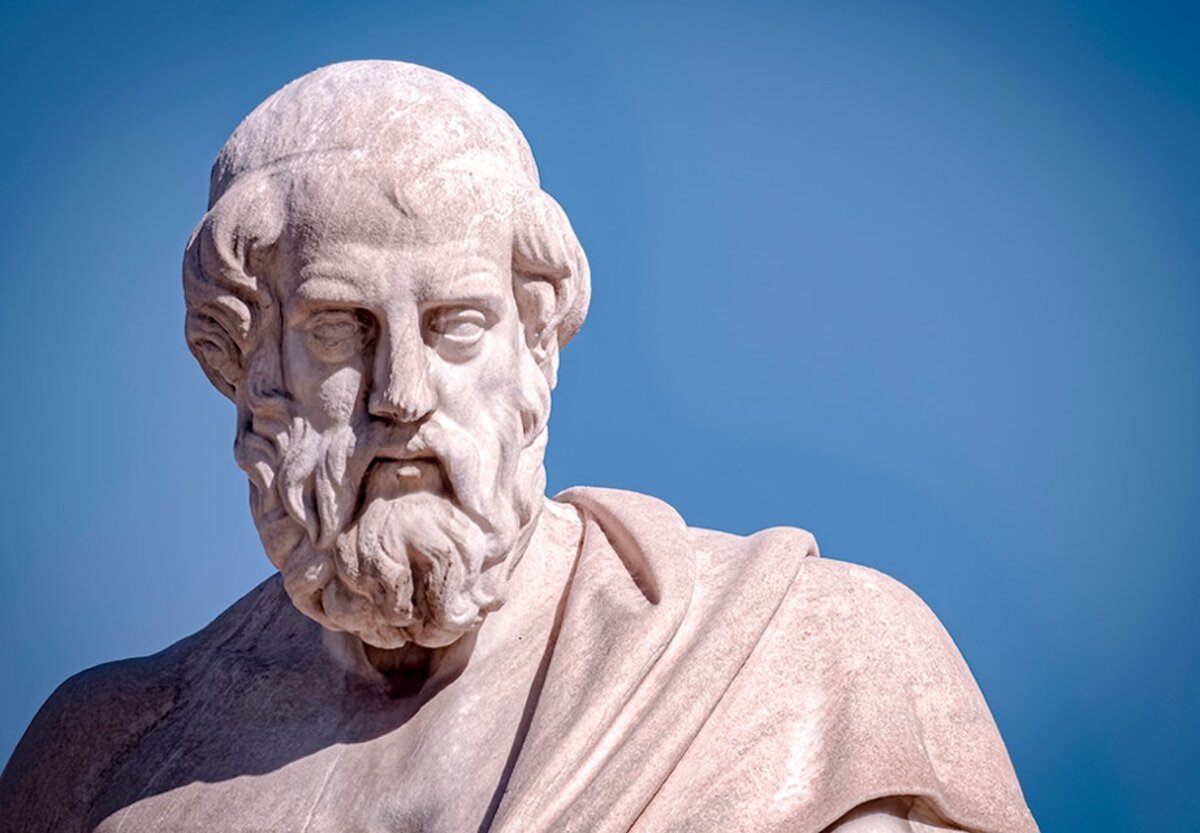
Agrandissement : Illustration 1
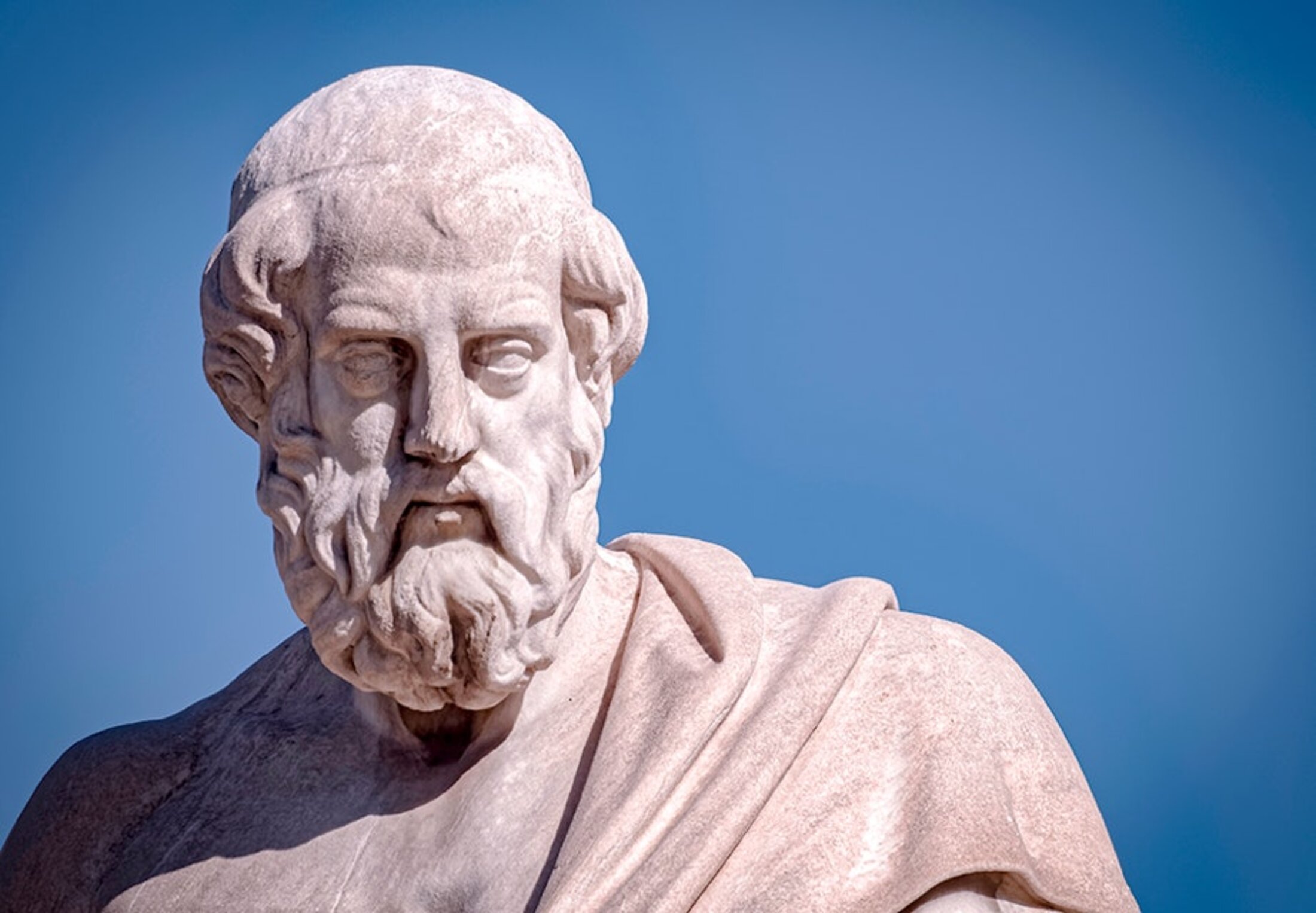
Depuis Platon, la philosophie s’interroge sur la manière de former les passions afin que la cité demeure juste. La paideia terme grec désignant l’éducation intégrale de l’être humain, à la fois intellectuelle, morale et émotionnelle constituait pour les Grecs la clef de toute harmonie sociale.Chez Aristote, la catharsis n’est pas seulement un effet esthétique, mais une pédagogie du pathos (pathos signifiant ici les émotions, les affects, la sensibilité du citoyen), par la représentation tragique, on apprend à éprouver justement. Cette éducation du sentiment fonde la sôphrosynê, c’est-à-dire la tempérance, la capacité à équilibrer désir et raison.
Or, à l’âge des algorithmes et des interfaces, nos affects ne sont plus éduqués par des maîtres, mais programmés par des dispositifs, nos colères, nos désirs, nos peurs sont orientés par des flux numériques, des notifications, des métriques de visibilité. Ce que les Grecs pensaient comme formation intérieure devient aujourd’hui architecture technique du sensible, l’attention, la honte, la reconnaissance se distribuent selon des logiques de calcul qui précèdent la conscience.
Comme l’écrit Olivier Renaut, « la cité n’existe que par l’éducation des affects ». Cette idée, héritée de la tradition antique, retrouve une acuité nouvelle, si nos émotions déterminent notre rapport au vrai et au juste, comprendre leur mutation algorithmique devient un impératif politique.Alessandro Baricco, dans The Game (2018), a décrit cette bascule comme une révolution cognitive, l’humanité est passée du temps linéaire de la culture écrite au temps fragmenté du flux numérique, où la perception remplace la mémoire et la vitesse supplante la réflexion. Cette rupture épistémologique transforme aussi nos émotions, la paideia d’hier s’est muée en écologie algorithmique des affects, c’est-à-dire un système où les émotions sont régulées non plus par l’école, la loi ou l’art, mais par les interfaces elles-mêmes.
Dès lors, une question s’impose, comment repenser la formation morale et politique des passions dans un monde où leur éducation passe désormais par la technique ?
Pour y répondre, nous verrons que l’héritage antique, tel que le développe Olivier Renaut, peut être non seulement sauvé, mais prolongé, en montrant comment la paideia classique de Platon et d’Aristote trouve aujourd’hui un nouvel espace d’application dans la culture numérique.
Ainsi, après avoir retracé la genèse de l’éducation du thumos cette partie de l’âme que Platon associait au courage et à la colère maîtrisée et les crises contemporaines de l’affect ,
nous examinerons ensuite comment la loi, de norme éducative, devient aujourd’hui ingénierie normative, avant d’élargir la réflexion aux corps, aux genres et aux altérités, où se joue la possibilité d’une paideia pluraliste adaptée au monde post-humain.
Former les passions : du thumos antique aux écologies affectives contemporaines
Former les passions a toujours été le cœur de toute philosophie politique. Pour les Grecs, aucune cité ne pouvait durer sans une éducation des affects capable de transformer la force brute du désir en puissance de mesure. Dans la République, Platon distingue trois parties de l’âme, le logistikon (la raison), l’epithumia (le désir), et le thumos, cette énergie intermédiaire où naissent la colère, le courage, la fierté autrement dit, la dimension affective qui pousse à agir. Le thumos n’est ni pure passion ni pur calcul, il est la vibration morale qui peut, selon qu’elle est instruite ou abandonnée, devenir vertu ou violence. C’est là que s’enracine la paideia, terme qui désigne une éducation complète, physique, intellectuelle et spirituelle, par laquelle la cité façonne des citoyens équilibrés. Platon associe cette formation à la sôphrosynê, la tempérance, cet art d’habiter ses émotions sans s’y perdre, de gouverner en soi-même avant de gouverner les autres.
Aristote, dans la Rhétorique et la Politique, reprend cette intuition et l’ancre dans la vie collective. Il montre que les émotions peur, pitié, honte ne sont pas des défaillances du jugement, mais les instruments mêmes de la vie civique. La catharsis, terme qui signifie littéralement « purification », ne consiste pas à éliminer les passions mais à les transformer. Le théâtre tragique, en donnant forme à la peur et à la pitié, enseigne à sentir justement, à ne pas céder à la panique ni à l’indifférence. Ainsi, l’émotion devient école du discernement. Dans cette perspective, la politique n’est pas seulement affaire de lois, mais de nomos, mot qui désigne à la fois la norme et la mélodie, le droit et le rythme. Platon, dans les Lois, va jusqu’à confier à la musique et à la danse le rôle de réguler les affects collectifs. Le législateur doit composer la cité comme un chœur, accorder les tempéraments humains comme des voix multiples cherchant la justesse.
Mais cette harmonie, aujourd’hui, semble se dissoudre dans des régimes d’affects que rien ne parvient plus à discipliner. L’économie de l’attention, en sollicitant en permanence la curiosité, la peur ou le ressentiment, épuise le thumos et le détourne de sa fonction morale. Là où les Anciens cherchaient la mesure, la culture contemporaine valorise la stimulation continue, la colère devient contenu, la compassion se quantifie en vues, la peur se recycle en information. La misanthropie, la fatigue et la nostalgie qui caractérisent une partie du monde actuel ne sont pas seulement des états d’âme individuels, ce sont les symptômes d’une écologie affective déréglée, où l’excès d’excitation conduit paradoxalement à l’indifférence.
Dans la sphère politique, la logique du jeu s’est imposée, la gamification de la guerre, des débats ou des mobilisations sociales transforme la bravoure en performance et la justice en stratégie de visibilité. Le courage, autrefois vertu du thumos, se voit réduit à un score, à une preuve sociale. La guerre devient interface, la colère devient spectacle. À cela s’ajoute un bouleversement plus profond encore, la disparition du temps continu que décrivait Alessandro Baricco. Le passage de la culture linéaire à la culture du flux a créé ce que l’on pourrait appeler un « présent perpétuel », un temps sans durée où l’attention ne se déploie plus mais se fragmente. Dans cet univers, les affects sont orphelins, sans passé pour se souvenir, sans avenir pour espérer, ils se figent dans la répétition immédiate du stimulus.
C’est dans ce contexte que se dessine la possibilité d’une paideia algorithmique. Si l’âge classique cherchait à éduquer le thumos par le langage, l’art et la loi, notre époque doit apprendre à l’éduquer à travers les dispositifs qui structurent l’attention. Les plateformes numériques sont devenues des législateurs invisibles, elles imposent des héxis, c’est-à-dire des habitudes incorporées, par la répétition de gestes faire défiler, cliquer, réagir qui conditionnent nos émotions. Ces héxis numériques constituent une pédagogie implicite, elles nous apprennent à désirer vite, à juger sans délai, à confondre réaction et réflexion. Repenser l’éducation morale aujourd’hui suppose donc de créer des espaces de friction et de latence, des pauses dans la circulation des affects.
Une telle perspective conduit à reformuler la catharsis à l’échelle du numérique. Plutôt que de purifier les émotions par la fiction, il s’agit de les transformer par la conscience de leur médiation, comprendre ce qui nous émeut, pourquoi cela nous touche, et comment cette émotion est utilisée. La catharsis 2.0 consisterait à introduire dans les interfaces des dispositifs de retour sur soi ralentisseurs de publication, visualisation du temps passé, architecture favorisant la délibération. L’émotion ne serait plus purgée, mais relue, explicitée, rendue critique.
Une nouvelle pédagogie civique pourrait naître de cette conscience, une réorchestration de la ville, de l’école et des médias autour de rituels d’attention et d’écoute. Là où la démocratie ancienne éduquait par le chœur et le théâtre, la démocratie contemporaine pourrait s’inventer à travers des dispositifs publics de lenteur, de débat et de rencontre. L’éducation du thumos passerait par la scénographie du dialogue, par une culture de la contradiction non violente et du désaccord fécond.
Ainsi, la paideia algorithmique n’abolit pas la paideia antique, elle la déplace. Là où les Grecs cherchaient à accorder la cité à l’âme, il s’agit désormais d’accorder les architectures techniques à la sensibilité humaine. L’enjeu n’est plus seulement moral, mais structurel, non pas corriger les passions après coup, mais concevoir des environnements qui forment dès l’origine un rapport mesuré à soi, aux autres et au monde.
C’est ici que s’ouvre une question décisive : si les technologies sont devenues les nouveaux éducateurs du pathos, quel rôle reste-t-il à la loi, à la norme, au nomos pour guider les sociétés ? Autrement dit, comment la paideia algorithmique peut-elle encore dialoguer avec la tradition juridique qui, depuis Platon, liait la formation des émotions à l’ordre politique ? C’est ce passage, du gouvernement des affects à l’ingénierie du nomos, qui permettra d’envisager une nouvelle articulation entre éthique, droit et technique.
Nomos, loi et mœurs : de la régulation éducative à l’ingénierie normative
Dans la pensée antique, la loi (nomos) n’était jamais une abstraction juridique. Elle désignait à la fois la règle, l’habitude, la coutume et, dans son sens le plus ancien, la mélodie, un ordre à la fois rationnel et musical du monde. Gouverner, c’était accorder les corps et les âmes, comme on accorde un chœur. Cette idée traverse l’œuvre de Platon, pour qui la loi doit former, non contraindre. Dans les Lois, le législateur n’est pas un simple technicien de la norme, il est un pédagogue qui façonne les affects par les rythmes et les récits. Aristote reprend cette perspective en considérant que les mœurs (êthos) se forment par l’habitude (hexis) ; ainsi, la loi, en prescrivant des actes répétés, sculpte des dispositions durables. C’est en ce sens qu’Olivier Renaut parle d’une “loi-pédagogue”, la norme n’est pas seulement un outil de sanction, mais un instrument d’éducation du sentiment civique.
L’esprit grec plaçait donc la mesure (sôphrosynê) au cœur de la régulation politique, non pas la morale qui culpabilise, mais la tempérance qui équilibre. Dans une société gouvernée par les passions, cette vertu permet de conserver la lucidité sans perdre la sensibilité. Platon, dans le Phèdre, rappelait déjà que le vrai conducteur de l’âme n’est pas celui qui la dompte par la force, mais celui qui la guide par la connaissance de ses élans. La mesure, pour les Anciens, n’est jamais répression, elle est art de la proportion, recherche de justesse.
Cette leçon a profondément inspiré Olivier Renaut, penser le droit comme éthique de la forme. La loi n’éduque qu’à condition d’être comprise comme un rythme, une structure qui harmonise la cité. C’est pourquoi il relit les Anciens non comme des monuments, mais comme des outils pour repenser nos propres institutions. Dans cette perspective, la cité antique éclaire le présent, elle rappelle que le politique ne se réduit pas à la gestion, mais qu’il est toujours une pédagogie des affects, un art de la mise en ordre du sensible.
Or, le monde contemporain voit apparaître un autre type de nomos, celui du code. Le pouvoir n’émane plus d’un législateur visible, mais d’algorithmes qui organisent les comportements par le calcul. Cette souveraineté sans visage remplace la délibération par la prédiction, ce que Platon aurait nommé le règne du nomos sans nomothète, la loi sans législateur. Dans ce contexte, le droit perd son rôle éducatif, il devient un protocole automatique. Les plateformes prescrivent des conduites à travers des règles implicites, comme les systèmes de récompense et de visibilité. L’obéissance ne passe plus par la peur de la sanction, mais par la recherche du “like”, cette micro-récompense affective qui agit comme un conditionnement pavlovien.
Le pouvoir du code se révèle dans ce que Jean Baudrillard nommait le simulacre. Dans Simulacres et simulation (1981), il expliquait que la société postmoderne ne repose plus sur la représentation du réel, mais sur sa reproduction indéfinie, l’image se substitue à la chose, le signe précède le sens. Dans ce régime de la simulation, la loi elle-même devient spectacle ; la justice se scénarise en communication. Les débats moraux contemporains qu’ils portent sur la pureté ou la transgression participent d’une même mécanique, celle du théâtre des extrêmes où les affects sont capturés, amplifiés, recyclés. Les discours de l’ordre moral et ceux de la libération totale se rejoignent dans leur dépendance à la visibilité, ils reproduisent, sous des formes opposées, le même asservissement émotionnel.
Face à cette dérive, une autre conception de la loi émerge, non plus comme contrainte, mais comme chant. Le mot nomos, on l’a vu, signifiait originellement “air musical”. Réinterprété, il suggère que la norme n’a de valeur que si elle est incarnée, rythmée, audible. Dans cette optique, le droit devient une partition vivante, capable de susciter une résonance intérieure. Certaines traditions spirituelles, comme celle du compositeur arménien Komitas, illustrent ce lien entre norme et musique. Rescapé du génocide, Komitas a collecté des milliers de chants populaires pour sauver une mémoire menacée. Son œuvre, plus qu’une archive, est une législation poétique, elle enseigne que le droit le plus juste n’est pas celui qui s’impose, mais celui qui résonne dans la conscience collective. En ce sens, la paideia sonore de Komitas rejoint la paideia platonicienne, éduquer, c’est faire vibrer les âmes à l’unisson de la dignité humaine.
Cette conception esthétique du droit rejoint aussi la critique de Baricco. Dans The Game, il décrit une humanité entrée dans un nouvel ordre narratif où la loi écrite cède la place à la loi visuelle et interactive. Le citoyen ne lit plus la norme, il la “vit” à travers des flux d’images et de connexions. Dès lors, la légitimité du nomos dépend moins de sa cohérence que de sa performativité, c’est-à-dire de sa capacité à être perçue, ressentie, partagée. La norme doit désormais se faire sensible pour exister.
Cette transformation appelle une refondation éthique, si le droit ne peut plus se contenter d’imposer, il doit apprendre à éduquer par la forme. On peut imaginer une “charte de sôphrosynê numérique”, des dispositifs de régulation qui favorisent la lenteur, l’écoute, la réflexion avant la réaction. Ce serait une manière d’introduire, au sein même des architectures techniques, une pédagogie de la mesure. De même, la jurisprudence éducative pourrait devenir une école des affects, non plus un catalogue de peines, mais une série d’exemples, de récits et de visualisations qui expliquent la norme par l’expérience sensible. La décision juridique, au lieu d’être abstraite, deviendrait une scène d’apprentissage collectif.
Cette perspective transforme profondément le rôle du droit. Il ne s’agit plus de choisir entre morale et permissivité, entre répression et laisser-faire, mais d’inventer une esthétique du juste. Une société mature ne se contente pas de punir, elle enseigne à ressentir. Le droit pourrait alors devenir, comme chez Komitas ou chez les tragiques grecs, une forme de chant civique un espace où la norme retrouve son pouvoir d’émotion et de lien.
Ainsi, du nomos antique au code numérique, la loi s’est déplacée de la régulation éducative à l’ingénierie normative. Elle ne peut retrouver son autorité qu’en redevenant sensible, c’est-à-dire capable d’éveiller des dispositions morales plutôt que d’imposer des contraintes. Mais cette redéfinition de la loi appelle à repenser ce qu’elle régule, les corps, les désirs, les différences qui composent la cité. C’est là que se joue la dernière étape du parcours comprendre comment l’éducation des passions et la refonte du nomos conduisent à une nouvelle manière d’habiter le monde, entre pluralité des identités et conscience du vivant.
Corps, genre, altérité : d’eros/hexis au post-humain & aux mondes pluriels
Le monde antique concevait le corps comme une forme éducable, non comme un objet biologique. L’eros, chez Platon, n’était pas simple attirance charnelle, c’était la tension qui élève du sensible vers l’intelligible. Dans le Banquet, Diotime enseigne que l’amour est une ascension, aimer un corps mène à aimer tous les corps, puis la beauté en soi. L’eros est donc une pédagogie du regard, apprendre à voir dans la chair le signe du vrai. Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque, complète cette vision par la notion d’hexis (ἕξις), disposition acquise, la vertu naît de l’habitude, de l’incorporation des bons gestes. La paideia forme le corps comme on polit une statue, par la répétition du juste, jusqu’à ce que la mesure devienne naturelle. Enfin, le xénos l’étranger incarne la limite du même, celui que la cité doit accueillir sans se dissoudre, car c’est dans le rapport à l’autre que se mesure la véritable éducation civique.
Or, notre époque s’est éloignée de cette tripartition harmonieuse. Le corps n’est plus un lieu d’équilibre, mais un terrain d’ingénierie, il se réécrit à travers les biotechnologies, les hormones, les prothèses, les interfaces. Dans la perspective du post-humanisme, cette malléabilité est perçue comme libération. Mais elle révèle aussi un désancrage symbolique, l’humain ne se pense plus comme unité de raison et de chair, mais comme flux modifiable. Les textes contemporains que tu explores, notamment sur la déconstruction du corps et la dissolution de l’humain, prolongent ce constat, la liberté biologique se paie d’une perte de sens, d’une amnésie du lien entre forme et vertu.
Nietzsche, déjà, pressentait cette mutation. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, il écrivait, « Le corps est une grande raison. » Cette phrase, souvent mal comprise, signifie que la sagesse ne vient plus d’un esprit transcendant, mais du corps lui-même, compris comme mémoire incarnée. Lorsque l’homme moderne prétend s’émanciper de sa corporéité, il rompt avec cette raison charnelle. Baudrillard, dans La transparence du mal, y voyait la conséquence logique de la société du simulacre, le corps devient image, surface d’échange, marchandise symbolique. La chirurgie, la performance, le culte de la visibilité traduisent cette nouvelle idolâtrie, le corps n’est plus support de vérité, mais miroir d’un système de signes.
Alessandro Baricco, dans The Game, en offre le prolongement sociologique, nous avons quitté la « profondeur » humaniste pour la « surface » numérique. Le corps connecté, filmé, mesuré par ses capteurs, vit dans la vitesse et l’interaction. C’est un corps d’écran, traversé par les flux d’attention. Mais cette fluidité produit une nouvelle fatigue, l’absence de rythme, la disparition de la lenteur. Là où la hexis antique supposait répétition et discipline, le geste contemporain s’épuise dans la dispersion. La technique, au lieu de prolonger la main, tend à la remplacer. Le danger n’est pas l’augmentation, mais la perte du sentir.
Cette dissolution touche aussi les représentations du féminin et du masculin. Depuis les tragédies grecques, la femme a été le miroir où la cité projetait sa peur du désordre. Dans Phèdre, dans Antigone, dans Les Choéphores, l’héroïne incarne toujours une tension entre loi et désir, entre raison et transgression. Les lectures modernes de Duras à Ozon renversent ces archétypes. Dans 8 Femmes, le patriarche absent fait éclater la structure dramatique, huit voix remplacent la parole du maître. L’homme, symbole du nomos, a disparu ; il ne reste que la polyphonie du logos féminin. Ce passage du monologue à la pluralité correspond à une transformation civilisationnelle, la féminité n’est plus fonctionnelle (épouse, mère, amante), mais poétique, c’est-à-dire productrice de sens. Comme le dirait Kristeva, le féminin devient sémiotique flux, rythme, altérité dans le langage.
Cette mutation s’étend au rapport à l’étranger. La disparition du xénos, illustre la crise des sociétés contemporaines, l’étranger n’est plus intégré ni même craint, il est effacé, rendu invisible par la surabondance d’informations. Baudrillard, dans Amérique (1986), notait déjà ce paradoxe, le monde globalisé est saturé de différences, mais sans véritable altérité. Tout circule, rien ne rencontre. L’hospitalité, autrefois acte politique, devient geste administratif.
C’est ici qu’intervient une idée majeure, la mixité comme hexis partagée. Il ne s’agit pas de juxtaposer les identités, mais de réapprendre à les accorder. La mixité n’est pas un fait, c’est un art une forme de vertu politique. Dans La force de la fragilité et La force de la lucidité, cette éthique s’exprime comme refus de la fermeture, vivre ensemble, c’est accepter la vulnérabilité réciproque. La lenteur procédurale, le dissensus cadré, la reconnaissance du désaccord deviennent des instruments d’équilibre civique, comparables aux nomoi mousikoi (lois musicales) de Platon.
L’école et la cité, dans cette perspective, retrouvent leur rôle de paideia. L’éducation doit enseigner l’histoire longue, le droit du consentement, la critique des interfaces. Non pour revenir au passé, mais pour transformer la technique en instrument de lucidité. La ville-paideia, concept que l’on pourrait rapprocher des réflexions de Komitas, n’est pas une utopie, c’est une manière d’accorder espace, rythme et mémoire. Comme les chants arméniens qu’il recueillait, chaque lieu, chaque voix peut devenir support d’une pédagogie du sensible. L’architecture, la musique, le droit, la parole publique, tout participe à la formation d’un citoyen conscient de ses propres résonances.
Ainsi, le dernier horizon de la paideia n’est pas la raison pure, mais la conscience du lien. La sagesse antique renaît dans la modernité si l’on sait transposer la sôphrosynê la tempérance, la mesure intérieure dans le monde accéléré des flux. L’humain augmenté, l’étranger oublié, le corps fragmenté, toutes ces figures exigent de redécouvrir une unité perdue, non par le contrôle, mais par l’écoute. Comme l’écrivait Nietzsche dans Aurore, “il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante”, le rôle de la paideia contemporaine est précisément de transformer ce chaos technologique et culturel en harmonie nouvelle, où le corps, la loi et la cité vibrent à nouveau à l’unisson du vrai.
En conclusion, former les passions n’a jamais été un luxe moral, mais la condition même de toute civilisation durable. Depuis Platon, la paideia, terme grec désignant l’éducation intégrale de l’être humain, à la fois intellectuelle, morale et émotionnelle visait à harmoniser les trois parties de l’âme, la raison (logistikon), le désir (epithumia) et le courage (thumos). La cité juste ne naissait pas du pouvoir, mais de la justesse des âmes qui la composaient.Aristote, dans la Poétique et la Rhétorique, poursuivait ce projet en confiant à la catharsis (purification par les émotions) une fonction civique, apprendre à éprouver justement, à transformer la peur et la pitié en discernement. L’émotion n’était pas une faiblesse, mais une école du jugement. Ainsi se formait la sôphrosynê, la tempérance, cette vertu de la mesure intérieure qui permet d’être maître de soi sans s’éteindre.
Or, à l’âge des écrans et des algorithmes, cette pédagogie de l’âme s’est déplacée. Les maîtres d’autrefois ont été remplacés par les interfaces, les émotions ne s’éduquent plus dans la cité, mais dans la circulation des flux. Comme le remarque Alessandro Baricco dans The Game (2018), l’humanité a basculé du temps lent de la culture écrite au temps fragmenté du flux numérique, où la mémoire se dissout dans la perception et la profondeur dans la vitesse. Ce changement d’échelle est aussi un changement d’âme, la paideia d’hier s’est transformée en écologie algorithmique des affects, où nos désirs, nos colères et nos peurs sont modulés par des architectures invisibles.Olivier Renaut rappelle avec force que « la cité n’existe que par l’éducation des affects ». La phrase, d’apparence simple, révèle une urgence politique, si nos émotions déterminent notre rapport au vrai et au juste, alors comprendre leur mutation technique devient une condition de survie démocratique. Ce que les Grecs appelaient nomos la loi, mais aussi la mélodie, le rythme commun s’est mué en code. Les nouveaux nomothètes (législateurs) ne sont plus des philosophes, mais des ingénieurs d’attention. Le défi n’est donc pas de rejeter la technique, mais de lui redonner un sens humain, de la transformer en pédagogie de la mesure.
« Le rythme et l’harmonie gagnent les profondeurs de l’âme, et s’y attachent avec la plus grande force. » Platon, République III.
Cette phrase, souvent citée mais rarement méditée, exprime la clé de toute philosophie de l’éducation, le rythme façonne l’être. Ce que nous répétons nos gestes, nos usages, nos vitesses devient notre caractère. L’hexis (ἕξις), chez Aristote, désigne précisément cette disposition durable acquise par l’habitude. Aujourd’hui, les rythmes numériques remplissent cette fonction, faire défiler, cliquer, réagir, sont autant de gestes répétés qui forment nos dispositions affectives. Si la musique civique antique sculptait l’âme du citoyen, les interfaces sculptent désormais l’inconscient collectif. D’où la nécessité de recomposer ces rythmes d’introduire dans la technique une sôphrosynê algorithmique, un art de la lenteur, de la friction et du discernement.
Cette reconquête du sensible passe aussi par le droit et par l’art. Komitas, en recueillant les chants populaires arméniens après le génocide, a montré que la mémoire pouvait se sauver non par la loi écrite, mais par la loi chantée le nomosredevenu mélodie. Ses compositions font de l’harmonie un acte de justice, elles rappellent que la vérité n’existe pas sans vibration commune. Baudrillard, à l’inverse, a décrit le monde du simulacre, où le signe se substitue à la chose et où la loi devient spectacle. Entre Komitas et Baudrillard se joue notre destin, ou bien la musique du monde s’éteint dans le bruit des flux, ou bien nous réapprenons à accorder nos voix.
La paideia contemporaine, ainsi repensée, ne cherche plus à former des âmes parfaites mais des consciences lucides. Elle ne veut pas purifier le monde du chaos, mais lui donner une forme habitable. Nietzsche, dans Aurore, écrivait, « Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. » Le rôle de la philosophie aujourd’hui est précisément celui-là, transformer le chaos technologique et affectif en rythme, en étoile, en mesure.
Trois horizons se dessinent alors, d’abord, celui d’une sôphrosynê numérique, où les architectures techniques deviennent des espaces d’éducation civique lieux de lenteur, de désamorçage émotionnel et de retour sur soi.Ensuite, celui d’un nomos-chant, une refondation esthétique du droit, inspirée de Komitas, où la loi ne s’impose pas, mais résonne.Enfin, celui d’une ville-paideia, où l’école, les médias et l’urbanisme redeviendraient des instruments de formation du regard, de l’écoute et du courage civique.
Autrement dit, il ne s’agit plus de choisir entre tradition et modernité, mais d’inventer une modernité mesurée. Là où Baricco voyait dans The Game la dissolution du monde ancien, il faut désormais y voir une possibilité d’éducation nouvelle. Là où Baudrillard craignait la mort du réel, il s’agit de réapprendre à sentir. Car si la paideia algorithmique peut redevenir art du lien, alors peut-être, malgré le chaos, la cité retrouvera son âme.



