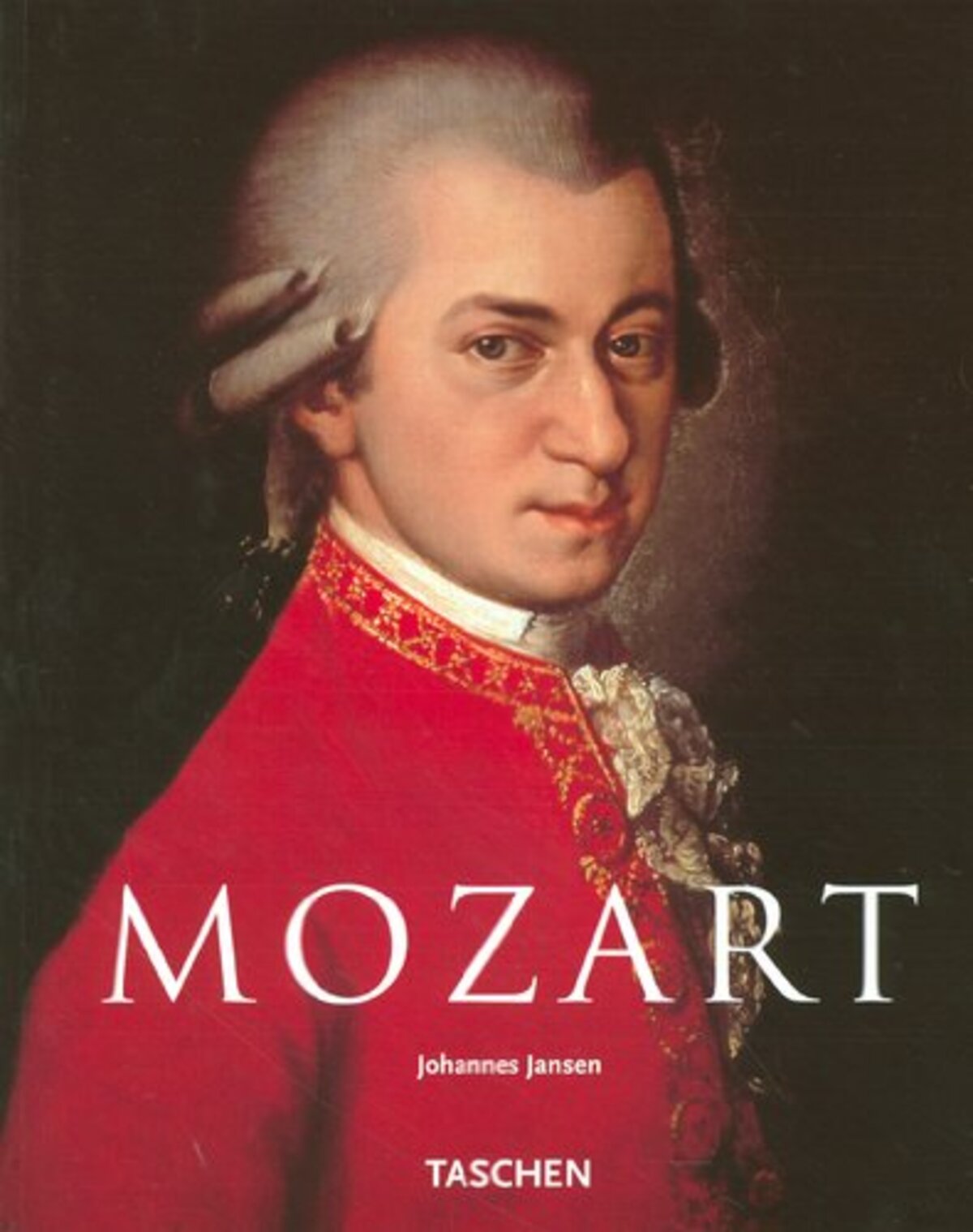
Les lois sont faites pour être interprétées, comme la musique pour être jouée », écrivait Montesquieu, rappelant que l’écriture normative n’a pas de sens sans l’acte qui la fait vivre. L’analogie est féconde , une partition, si parfaite soit-elle, demeure muette tant qu’un musicien ne lui prête pas sa sensibilité ; de même, un code reste inerte tant qu’un juge ne l’applique pas à une situation singulière. Dans les deux cas, l’universalité de la règle rencontre la singularité de l’exécution. Beethoven, lu par Glenn Gould ou par Martha Argerich, n’est pas le même, pas plus qu’un article du Code civil ne prend la même forme sous la plume de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel.
Le droit et la musique partagent ainsi une structure commune , une écriture codifiée, hiérarchisée, qui organise un ordre abstrait. Mais cet ordre, pour exister, suppose une interprétation vivante, marquée par la sensibilité de l’interprète. Dès lors, se pose une question : comment comprendre le droit à la lumière de la musique, et en quoi l’analogie avec l’interprétation musicale éclaire-t-elle la tension entre la norme et la liberté, entre l’ordre et la créativité ?
Ce texte se déploiera en trois temps pour y répondre, d’abord, montrer que droit et musique reposent sur une structure commune, celle d’un langage écrit et universel ; ensuite, souligner que leur vérité réside dans l’interprétation du juge et du musicien, toujours singulière et située ; enfin, réfléchir à la tension entre cadre et invention, et voir comment droit et musique, loin d’être de simples contraintes, deviennent de véritables arts sociaux, créateurs de résonance collective.
Le droit et la musique : deux langages structurés
À première vue, le droit et la musique appartiennent à deux univers étrangers ,l’un serait celui de la contrainte normative, l’autre celui de l’émotion esthétique. Pourtant, tous deux partagent une même structure , une écriture codifiée, un langage formalisé, qui ne prend sens que parce qu’il est reconnu collectivement et rendu effectif par l’usage. Comme une partition fixe les notes, les rythmes et les silences, le Code civil fixe des articles qui, une fois promulgués ainsi que le rappelle l’article 1er , entrent en vigueur et structurent les comportements sociaux. La loi, comme la partition, est une écriture normative : elle ne dit pas seulement ce qui existe, elle prescrit ce qui doit être. Kelsen, dans sa Théorie pure du droit, définissait déjà la norme comme une structure abstraite, indépendante de la morale ou des faits. La partition en musique joue un rôle semblable : elle détache la structure du son de son interprétation immédiate, en l’inscrivant dans un langage universel de signes. On pourrait dire que, comme les mathématiques, notation juridique et notation musicale forment deux systèmes formalisés, destinés à produire des réalités différentes mais fondés sur la même exigence de précision.
Ce formalisme, loin de brider, a pour fonction de créer une universalité. La musique occidentale classique, par ses gammes majeures et mineures, par ses accords et son solfège, institue un langage partagé qui permet à un orchestre de jouer ensemble au-delà des différences individuelles. De même, le droit, par les principes constitutionnels, par la Convention européenne des droits de l’homme et par la reconnaissance des droits fondamentaux, prétend à une validité universelle qui dépasse les contextes particuliers. Rousseau, dans son Essai sur l’origine des langues, suggérait déjà que la musique était un langage universel, antérieur aux divisions arbitraires des langues parlées. La psychanalyse freudienne rejoint cette intuition , Freud voyait dans les structures de l’inconscient des harmonies cachées, des répétitions et des rythmes qui, comme la musique, ordonnent l’expérience humaine. Droit et musique apparaissent donc comme deux formes d’écriture universelle , l’une règle les comportements sociaux, l’autre les vibrations sensibles.
Enfin, l’un et l’autre sont hiérarchisés. Le droit se déploie selon la pyramide de Kelsen : au sommet, la Constitution, puis les lois, puis les règlements, chaque norme tirant sa validité d’une norme supérieure. La musique classique repose sur une logique similaire ,la tonalité organise les rapports entre la tonique, la dominante et la sous-dominante, hiérarchie subtile mais décisive, qui donne au morceau sa cohérence. Hegel voyait déjà dans la dialectique une logique de composition , thèse, antithèse et synthèse, comme trois voix qui se confrontent et se résolvent dans une harmonie supérieure. Et Bourdieu, en sociologue, a montré que le droit comme la musique fonctionnent aussi comme des « capitaux culturels distinctifs » , ils exigent un apprentissage, une maîtrise technique, et ils confèrent à ceux qui les détiennent un pouvoir symbolique. Lire une partition ou lire un code, ce n’est pas seulement comprendre un texte, c’est affirmer une appartenance à une communauté cultivée qui reconnaît la valeur de ce langage.
Ainsi, le droit et la musique classique se rejoignent dans leur structure , une écriture formalisée, une universalité qui dépasse l’individu, une hiérarchie qui garantit la cohérence. Mais cette structure, si parfaite soit-elle, ne vit pas par elle-même. Elle appelle toujours un interprète , un juge qui applique la loi, un musicien qui joue la partition. Et c’est cette incarnation vivante, subjective et créatrice, qu’il faut maintenant interroger.
L’interprétation : juge et musicien comme herméneutes
La loi, comme la musique, n’existe qu’à travers son interprétation. Le texte normatif, fût-il clair, ne dit jamais tout ,il ouvre un champ d’applications, de nuances et d’écarts. C’est pourquoi la jurisprudence, depuis toujours, apparaît comme une seconde écriture du droit , les juges interprètent, adaptent, réinventent le même article selon les circonstances. Cette pluralité n’est pas un défaut, mais une condition de vie du système juridique. Gadamer, dans Vérité et méthode (1960), insistait sur cette vérité fondamentale : comprendre, c’est interpréter. Il n’y a pas d’accès neutre au texte, qu’il soit normatif ou artistique.
La musique illustre ce phénomène avec une évidence éclatante. Prenons Bach , interprété par Glenn Gould dans les années 1950-60, il devient une architecture analytique, dépouillée, presque mathématique ; sous les doigts de Martha Argerich, à partir des années 1980, il se transforme en jaillissement passionné, lumineux, imprévisible. La partition est la même, mais l’expérience n’a plus rien de commun. De même, un même article du Code civil peut recevoir une lecture stricte ou extensive selon la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel. Les divergences d’interprétation ne sont pas des trahisons, elles sont l’incarnation vivante d’un texte abstrait.
Chaque interprète apporte sa sensibilité. Herbert von Karajan, chef autrichien (1908-1989), imposait des Beethoven solennels, massifs, presque sculptés dans le marbre, tandis que Sergiu Celibidache (1912-1996) privilégiait des tempi lents, méditatifs, où l’œuvre se déployait comme une expérience spirituelle. Herbert von Karajan (1908-1989) imposait des Beethoven solennels, massifs, tandis que Sergiu Celibidache (1912-1996) privilégiait des tempi méditatifs, presque suspendus. Giya Kancheli (1935-2019), compositeur géorgien, poussa encore plus loin cette esthétique du silence et de la lenteur, ses œuvres, souvent marquées par de longs passages presque immobiles, rappellent que l’interprétation n’est pas seulement affaire de virtuosité mais aussi de retenue. Comme un juge qui choisit une motivation concise et mesurée plutôt qu’un développement emphatique, Kancheli montre que l’économie de moyens peut être l’expression la plus profonde. Proust, dans À la recherche du temps perdu(1913-1927), avait déjà saisi ce mystère avec la « petite phrase » de Vinteuil , une même suite de notes pouvait bouleverser différemment selon le moment, l’auditeur, la mémoire qu’elle réveillait. Lacan, dans son enseignement des années 1950, aurait dit que toute interprétation trahit un désir , qu’il soit celui d’un juge ou d’un musicien, il colore l’acte, il révèle une subjectivité qui ne peut être effacée.
La temporalité ajoute une autre dimension. Les jurisprudences évoluent , l’exemple du mariage pour tous en 2013, validé par le Conseil constitutionnel au nom du principe d’égalité, montre comment un texte ancien peut recevoir un sens nouveau en fonction du contexte social. La musique connaît le même destin , Mozart, joué au XIXᵉ siècle par un orchestre romantique, n’a rien à voir avec les interprétations « historiquement informées » qui dominent depuis les années 1980. Chaque époque relit ses partitions comme ses lois, et Michelet voyait déjà la loi comme une mémoire vivante, toujours rejouée par les générations.
C’est là qu’intervient la figure singulière de Komitas (1869-1935), compositeur et prêtre arménien, qui collecta et réinterpréta des milliers de chants populaires. Ses transcriptions ne furent jamais de simples copies , elles transformaient une mélodie orale en œuvre savante, mais sans effacer son âme. Il incarne cette vérité , l’interprétation n’est pas une trahison, mais un passage, une transfiguration. Dans le droit comme dans la musique, l’interprète est celui qui relie un texte écrit à une communauté vivante, et qui inscrit l’abstraction dans le temps social. Hartmut Rosa, dans Résonance(2016), dirait que c’est cette capacité de résonner avec les institutions, les corps et les époques, qui donne au droit comme à la musique leur force.
Ainsi, ni le juge ni le musicien ne sont de simples exécutants. Ils sont des herméneutes , ils donnent au texte une vie toujours située, toujours singulière. La norme et la partition deviennent alors des œuvres ouvertes, qui attendent qu’on les fasse vibrer.
Mais cette liberté d’interprétation ne se déploie pas dans le vide , elle suppose un cadre, un ordre, qui, loin d’étouffer, rend possible la créativité. C’est cette tension entre règle et invention, entre contrainte et liberté, qu’il faut maintenant explorer.
Entre ordre et créativité : le droit comme art social
Si le droit et la musique exigent une interprétation, cette liberté n’est jamais absolue. Elle s’exerce à l’intérieur d’un cadre, qui n’est pas une prison mais une condition de possibilité. L’article 4 du Code civil en est une illustration exemplaire , le juge a l’obligation de statuer, même en cas de silence ou d’obscurité de la loi. Autrement dit, il ne peut pas se dérober , il doit inventer dans la contrainte, donner une solution là où le texte ne suffit pas. La musique fonctionne de la même manière : les cadences de Bach ou de Mozart, tout comme les improvisations de jazz issues du répertoire classique, montrent que la créativité se déploie à partir d’un canevas fixe. Kant avait déjà vu dans cette dialectique l’essence de la liberté , être libre, ce n’est pas faire n’importe quoi, mais se donner une loi à soi-même, obéir à une contrainte qui devient condition d’émancipation.
Cette dialectique a une fonction sociale. La jurisprudence stabilise les rapports collectifs en donnant aux normes une interprétation durable, tout comme les concerts incarnent une mémoire commune où la musique, interprétée mille fois, devient un lien entre les générations. Victor Hugo, dans Les Misérables (1862), voyait dans la loi une arme de répression mais aussi un instrument d’élévation, capable de transformer la société quand elle est comprise dans son esprit et non dans sa lettre. La musique, de la même façon, n’est pas seulement un art intime , elle fonde des communautés d’écoute, de mémoire et d’appartenance. L’économie elle-même révèle ce parallèle , l’industrie musicale et le droit d’auteur obéissent aux mêmes logiques juridiques que toute autre institution, en organisant la circulation des œuvres et leur reconnaissance sociale. La fonction sociale de l’interprétation, qu’elle soit juridique ou musicale, consiste toujours à donner une forme stable à des flux mouvants.
Mais réduire le droit à un pur formalisme ou la musique à une technique, c’est les condamner à se vider de sens. Nietzsche rappelait que la vie devait être vécue comme une œuvre d’art : le droit aussi est une harmonie fragile, qu’il faut composer sans cesse entre l’ordre et la justice. Baudrillard prévenait du danger inverse , si la norme cesse d’être interprétée, elle devient un simulacre, un texte mort sans résonance ; de même, une partition réduite à un enchaînement mécanique de notes se transforme en bruit dépourvu de vie. Alessandro Baricco, dans Les Barbares (2006), soulignait que notre modernité tend à sacrifier la profondeur au profit de la surface : un droit réduit au pur formalisme procédural et une musique consommée comme un flux anonyme sur des plateformes numériques courent le même risque de perdre leur âme. Freud, enfin, rappelait que la loi comme la musique peuvent sublimer l’instinct , elles canalisent la violence brute, l’énergie du désir, pour les transformer en culture et en ordre symbolique.
Ainsi, le droit et la musique se révèlent comme deux formes jumelles de l’art social , des structures normées qui exigent d’être interprétées, des contraintes qui ouvrent sur la créativité, des écritures abstraites qui deviennent, par l’incarnation humaine, des expériences de sens et de résonance. Leur finalité n’est pas seulement d’imposer ou d’émouvoir, mais de transformer la vie collective en œuvre vivante.
En conclusion, le parallèle entre droit et musique révèle une vérité profonde , ni la loi ni la partition ne suffisent à elles seules. Leur force ne réside pas seulement dans l’abstraction d’une écriture normative ou harmonique, mais dans l’acte d’interprétation qui leur donne vie. Comme le juge, le musicien doit conjuguer fidélité et audace, rigueur et liberté. Tous deux inscrivent leur geste dans un cadre contraignant qui devient condition de créativité. C’est ainsi que le droit, loin d’être une mécanique, apparaît comme une forme d’art social, une esthétique de la société où l’ordre et la justice doivent être composés comme une harmonie fragile.
Nietzsche écrivait , « Sans musique, la vie serait une erreur » (Le Crépuscule des idoles, 1889). On pourrait ajouter , sans interprétation, le droit serait un silence. L’un comme l’autre témoignent de cette vérité , nous n’habitons pas seulement des règles, mais des résonances.
Dans un monde où l’intelligence artificielle est déjà capable d’interpréter une sonate ou de trancher des litiges simples, il faudra se demander si nous voulons confier l’acte d’interprétation à des machines, ou si nous continuerons à défendre ce qui fait la singularité humaine , la capacité d’incarner une règle comme une œuvre, en y mettant une sensibilité, une histoire, une mémoire.



