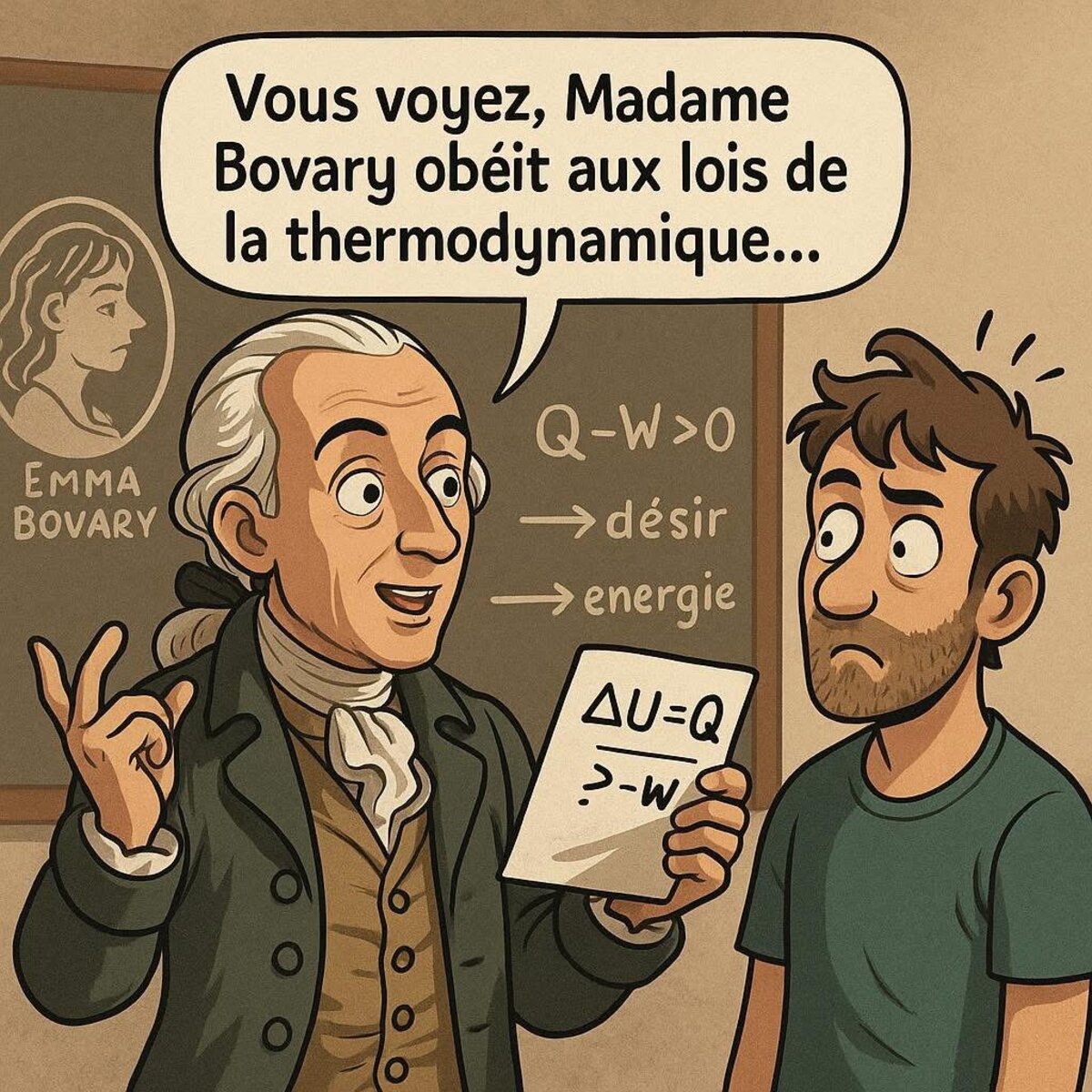
Agrandissement : Illustration 1
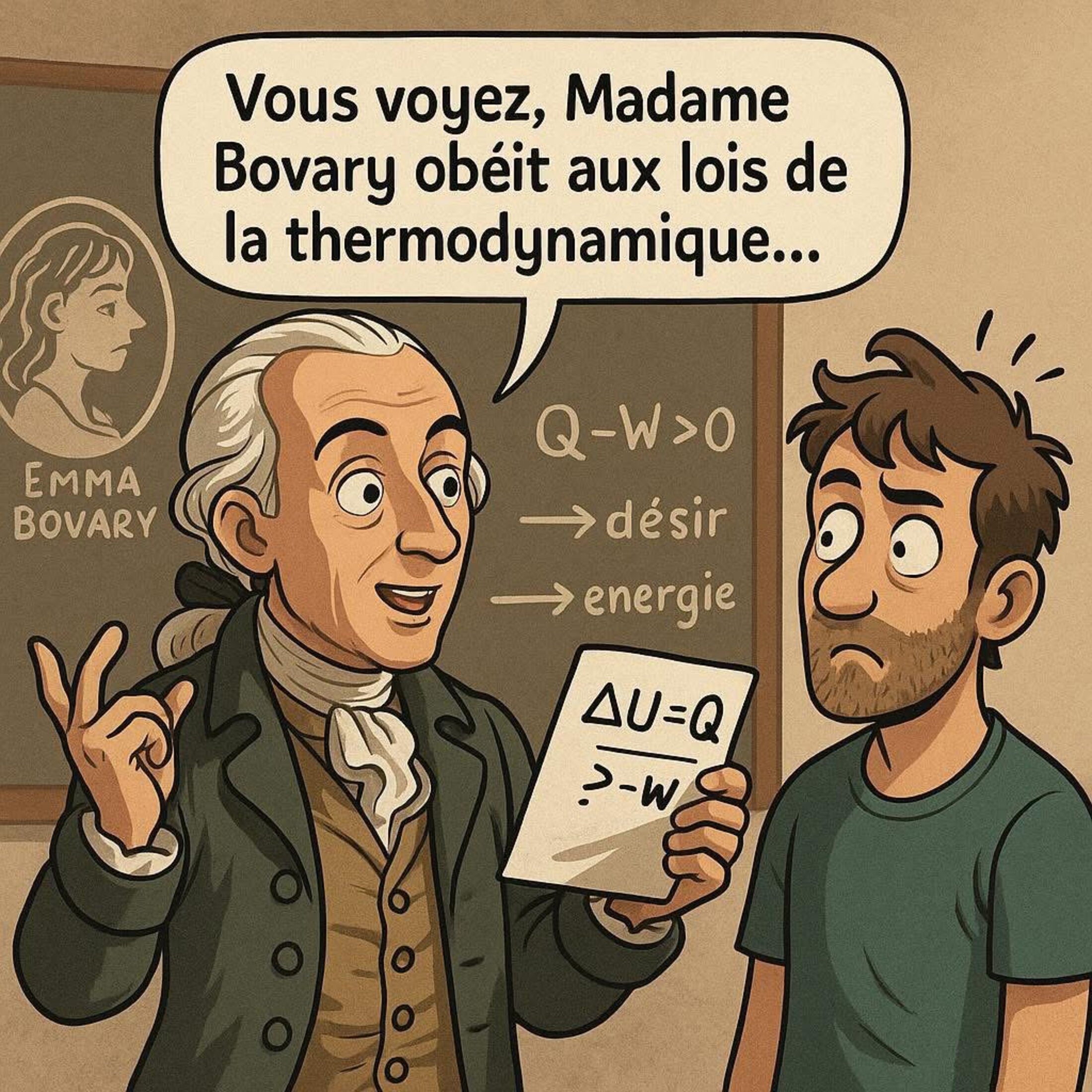
Il y a des lois qui traversent la matière et les âmes avec la même rigueur. Celle de Lavoisier « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » semble, à première vue, appartenir au domaine de la physique. Pourtant, elle décrit peut-être plus justement que toute théorie morale la mécanique invisible du désir humain. Ce que l’on n’a pas vécu ne disparaît pas, cela se condense, s’accumule, se déplace. Ce que l’on croit créer n’est souvent que la transformation d’une énergie ancienne, métamorphosée par le temps, la culture ou la peur. Le lien humain, comme la matière, obéit à une thermodynamique, toute passion tend à la dissipation, tout amour à la conversion, toute absence à la restitution.
Cette analogie, assumée comme modèle heuristique plutôt que comme équivalence scientifique, propose une lecture physique du lien affectif. Les concepts de F pur et de H pur, empruntés et détournés d’Otto Weininger, ne désignent ici ni des essences ni des identités, mais des vecteurs symboliques, deux formes d’énergie affective, l’une transformatrice (le féminin), l’autre dissipative (le masculin). Ces pôles, envisagés comme des dynamiques plutôt que des natures, permettent d’interroger la circulation contemporaine du désir sa conversion, sa déperdition, ou sa stagnation dans un monde où la profusion d’images et d’options dissout la rareté du sens.
La métaphysique du féminin devient alors un champ d’observation de cette loi de transformation. Non pas la célébration d’une pureté idéale, mais la tentative de comprendre comment l’énergie du lien se maintient, se pervertit ou s’épuise. Le féminin, dans ce cadre, incarne la force de densité, la présence, la fidélité au réel, la résistance à la dispersion. Le masculin, lui, figure la force d’expansion, la projection, la conquête, mais aussi la fuite. L’une concentre, l’autre dissipe. Entre les deux s’écrit la tragédie moderne, celle d’un monde où le désir circule plus qu’il ne se transforme, où la liberté se confond avec la perte d’énergie symbolique.
C’est ce déséquilibre qu’incarne Emma Bovary. Flaubert n’y peint pas seulement une femme adultère, mais une énergie bloquée dans un système clos, celui du mariage de raison, de la bourgeoisie thermiquement stable, du simulacre sentimental. L’adultère, dans cette perspective, n’est pas faute mais conversion tentative de rétablir le flux vital du désir dans un environnement saturé de signes et vide de sens. Le drame d’Emma n’est pas l’excès, mais l’étouffement, elle veut transformer l’énergie du manque en vie, dans une société où tout s’achète sauf le réel.
De la province de Flaubert à l’ère des applications de rencontre, la structure n’a guère changé, la technologie promet l’amour comme abondance, mais produit l’entropie du lien. Plus d’options, moins d’intensité ; plus de circulation, moins de transformation. Ce que Lavoisier appelait équilibre devient déséquilibre moral, et ce que Baudrillard nommait “transparence” devient fatigue.
Dès lors, comment le féminin, conçu non comme essence mais comme puissance de transformation, peut-il réintroduire une loi de conservation du sens dans une société où le désir s’épuise en flux ?
Pour y répondre, il faudra d’abord comprendre la logique énergétique du lien et la manière dont le F pur s’oppose à la dissipation. Puis, observer comment cette loi se dramatise dans le cas d’Emma Bovary, figure du désir empêché et de la transformation impossible. Enfin, confronter cette dynamique à notre époque algorithmique, où la profusion d’options produit une entropie affective sans précédent, et esquisser une possible réinvention du lien symbolique.
Quand les sociétés cessent de transformer l’énergie du désir en symboles, elles la dissipent en simulacres. Et quand l’amour ne se perd plus, il s’éteint.
De la matière du lien : F pur ou l’énergie transformée
Le désir ne s’éteint jamais, il change d’état. Ce que l’on croit perdu ne disparaît pas ; cela s’accumule dans l’ombre des corps et des consciences comme une énergie latente, prête à se transformer. À l’image de la matière, le sentiment obéit à une loi de conservation. Une caresse interrompue, une parole retenue, un rêve inachevé, tout cela ne meurt pas, mais se déplace, se condense, se convertit. Il n’y a pas de disparition de l’affect, seulement des passages d’un état à un autre du réel au fantasme, du souvenir au symbole, de la présence à l’absence. La physique du lien n’est pas différente de celle du feu, ce qui brûle en nous n’est pas la passion, mais la résistance qu’elle rencontre.
Dans la logique thermodynamique du cœur, rien ne se crée non plus. L’amour n’apparaît jamais ex nihilo , il naît dans un contexte d’initiation, d’éducation, de codes. Le féminin, plus que le masculin, est formé dans une tension historique entre intériorité et convention. Le temps qui lui manque celui de la maturation, du choix, de la parole libre est le premier bien symbolique qu’on lui dérobe. Ce « temps volé », selon l’expression de Bourdieu, fonde une subjectivité inachevée qui se cherche dans la répétition des mythes et la lutte contre le vide.
Mais tout se transforme. Ce que la société empêche d’exprimer, l’âme le métabolise. Le désir devient énergie, le manque devient forme. Chaque frustration, chaque attente refoulée, produit une condensation de sens qui cherche à se libérer. Eva Illouz l’a montré, le capitalisme affectif a su transformer cette énergie du manque en valeur marchande, convertissant la nostalgie en produit, la douleur en esthétique, le sentiment en flux. Ce que nous appelons romantisme n’est souvent que la circulation d’un excédent émotionnel qu’aucune structure symbolique n’a su contenir.
C’est ici qu’intervient la figure du F pur. Non pas la grâce immobile décrite par Weininger, mais la tension qui transforme. Là où le masculin se projette, le féminin recueille ; là où l’un disperse, l’autre condense. Le F pur n’est pas la pureté, mais l’intensité, il concentre l’énergie de la présence contre la dispersion du spectacle. Camus l’aurait dit autrement, le féminin, c’est la fidélité au réel, la mesure dans un monde qui s’égare dans les simulacres. Quand cette énergie est bloquée par un mariage imposé, une temporalité contrainte, une éducation de façade elle ne s’éteint pas ; elle se mue en résistance. Ce qu’on appelle “sélectivité féminine” n’est pas caprice mais instinct de survie symbolique : une manière de préserver la valeur du sens dans un univers qui le dilue.
Mais notre époque a inversé Lavoisier. La société du flux ne transforme plus, elle dissipe. Là où l’amour était passage, il devient circulation ; là où il était métamorphose, il devient consommation. Le féminin y est falsifié réduit à une surface de signes, à une interface de désir. Baudrillard l’avait prédit, la féminité moderne est devenue un médium, non un mystère. Ce qui se donne n’a plus de profondeur ; ce qui s’expose perd sa densité. Dans la transparence généralisée décrite par Byung-Chul Han, la visibilité remplace la présence, et la grâce se change en stratégie. Le F pur, devenu performatif, se disperse dans le champ numérique, il n’incarne plus, il apparaît. L’énergie d’incarnation se convertit en énergie d’exposition chaleur perdue, entropie du sens.
Nous vivons dans un monde où la transformation a cédé la place à la diffusion, où la lumière du lien s’épuise en clignotements d’écran. Et pourtant, malgré cette dissipation, une loi demeure, l’énergie affective ne disparaît jamais, elle cherche toujours son point d’équilibre. C’est cette tension, précisément, que Flaubert avait pressentie dans le destin d’Emma Bovary, une femme prise dans un système clos, où la chaleur du désir s’accumule jusqu’à l’explosion. La suite de ce parcours partira de là de cette économie du manque où l’innocence se change en désordre, et où la passion devient la seule manière, pour un être empêché, de rétablir le mouvement du monde.
L’économie du manque : Madame Bovary ou la conversion de l’innocence
Emma Bovary n’est pas une héroïne romantique ; elle est une chambre close où s’accumule l’énergie du désir empêché. Avant d’être l’histoire d’une femme adultère, Madame Bovary est le récit d’un système thermiquement stable, un monde où rien ne circule, où la passion s’asphyxie sous le poids de la bienséance. L’éducation d’Emma au couvent en constitue le premier acte, enfermée dans une formation sentimentale saturée de lectures pieuses et de romans, elle apprend à désirer sans agir, à rêver sans pouvoir transformer. C’est là, dans ce vide structuré, que s’installe la première loi de sa vie, le manque comme moteur. Son cœur, comme un réacteur clos, accumule une énergie potentielle qu’aucune expérience réelle ne viendra convertir.
Son mariage avec Charles parachève cette mécanique. Union de raison, sans passion ni réciprocité, il ne crée rien ; il détourne simplement l’énergie affective vers l’inertie. Ce que Flaubert peint avec une précision chirurgicale la fadeur des repas, la lenteur des jours, la parole qui ne répond à rien correspond à une privation symbolique de temps, celui de la maturation intérieure, celui où le désir apprend à devenir regard. Emma se trouve enfermée dans une temporalité gelée : elle vit dans la répétition sans transformation. Bourdieu l’a montré dans La domination masculine, le mariage bourgeois n’est pas un refuge, c’est une machine de reproduction du vide, une institution thermiquement close qui recycle les formes sans jamais produire du sens.
La province, cadre du roman, agit alors comme un microcosme du simulacre. Tout y est régulé, stable, ordonné ; rien n’y brûle, rien n’y circule. Le désir d’Emma s’y heurte à un environnement saturé de normes et de médiocrité, la société de Yonville est un monde à basse température symbolique, un système où la vie ne s’élève plus que par à-coups. C’est ce différentiel entre l’énergie du rêve et la stagnation du réel qui enclenche la crise, dans la logique de Lavoisier, ce qui ne peut se transformer s’accumule jusqu’à l’explosion.
L’adultère surgit alors non comme faute morale, mais comme phénomène physique, une conversion d’énergie. Ce que le mariage a réprimé, le corps le rétablit ; ce que la parole n’a pas pu dire, le geste le traduit. L’adultère devient une équation de compensation, la passion qui déborde du cadre conjugal cherche un espace où s’incarner. Emma ne trahit pas son mari, elle rétablit la circulation symbolique dans un système saturé. Sa transgression n’est pas vengeance, mais restitution, elle rend au monde ce que la norme lui avait confisqué, l’expérience du vivant.
L’énergie du manque se transforme alors en mouvement. À chaque rencontre, à chaque regard, elle tente d’atteindre cette température affective où la matière du lien devient fusion. Mais la société de Flaubert, structurée comme une machine froide, ne supporte pas la chaleur, elle condamne Emma, non pour son excès, mais pour sa tentative de conversion. La dette qu’elle contracte auprès de ses amants et de ses marchands n’est que la métaphore économique de la dette symbolique, celle d’un désir qui veut se rétablir. Dans cette lecture thermodynamique, Emma n’est pas coupable ; elle est système régulateur, elle dissipe le trop-plein d’une énergie que la bourgeoisie ne peut contenir.
Mais cette énergie, faute de structure, s’épuise à son tour. La société du simulacre bourgeois ne transforme pas, elle recycle. L’amour, l’apparence, la morale, tout y devient capital du paraître. Les dettes, la mode, la séduction, chaque signe d’amour est un signe d’échange. Le manque devient marchandise, la passion devient consommation. Comme l’écrit Eva Illouz dans Why Love Hurts, le romantisme moderne s’est construit sur la frustration elle-même, non plus pour la résoudre, mais pour l’entretenir comme condition du marché. Emma est la première victime de cette économie du manque, elle consomme des signes de passion comme d’autres consomment des produits de luxe. Son malheur n’est pas d’aimer trop, mais d’aimer dans une société qui a transformé l’amour en valeur d’exposition.
Sous la surface morale du roman, Flaubert déploie un diagnostic, la stabilité n’est qu’un camouflage de l’entropie. L’ordre social se veut solide, mais il ne repose que sur des forces mortes ; la vertu proclamée n’est que la couverture d’un désordre intérieur. Emma n’est pas rebelle ; elle est symptôme. Elle révèle la décomposition d’un monde où tout s’épuise sans se transformer, où le mariage, la foi, la morale ne produisent plus de symboles, seulement des répétitions. Sa chute n’est pas tragédie individuelle, mais effondrement systémique, celui d’un univers thermiquement saturé.
Ainsi, Madame Bovary n’est pas le récit d’une faute, mais celui d’un transfert, comment une énergie spirituelle devient passion, comment la passion devient dette, comment la dette devient mort. Dans cette spirale, Flaubert met en scène la loi de conservation du désir, rien ne se perd, même la souffrance se recycle. Emma, dans sa déréliction, accomplit la loi de Lavoisier mieux que ses juges, elle ne crée rien, ne détruit rien, elle transforme.
Et c’est précisément ce mouvement, à la fois désespéré et lucide, qui annonce notre époque, la sienne, close sur la morale ; la nôtre, ouverte sur le flux. Là où Emma cherchait la chaleur dans le simulacre bourgeois, l’homme moderne la cherche dans la transparence numérique. Ce passage de la province à l’écran, du bal au swipe, de la lettre au like, marque le basculement du désir dans l’entropie. C’est là que s’ouvre la troisième étape de cette traversée, celle du monde contemporain, où le H pur et le F pur ne s’affrontent plus dans la chair, mais dans l’algorithme.
Entropie du désir moderne : H pur, F pur et la thermodynamique algorithmique
Le monde numérique a transformé le désir en donnée. Ce que la province de Flaubert enfermait dans le silence, nos écrans l’ont libéré sous forme de flux. Tout circule, tout s’expose, tout s’offre à l’infini. Mais cette abondance n’est pas un gain, c’est une perte de densité. Chaque swipe, chaque profil accepté, chaque micro-interaction dilue un peu plus la valeur symbolique de l’élection. L’homme numérique, persuadé d’exercer son pouvoir de choix, ne fait qu’abolir la rareté de ce qu’il désire. Il se croit libre, il devient entropique. Barry Schwartz l’avait observé, plus les options augmentent, moins la satisfaction survit. L’amour, devenu marché, obéit à la logique de la saturation une inflation du possible qui détruit la profondeur du réel.
Ainsi, le H pur contemporain est un être de dispersion. Il ne conquiert plus, il collecte. Il ne veut plus une femme, mais la somme des possibles. Son énergie, naguère projetée dans la création ou la fidélité, s’éparpille dans la statistique. La loi de Lavoisier s’inverse, tout se perd, rien ne se transforme. Ce qui autrefois brûlait devient bruit de fond excitation sans direction, désir sans objet. L’homme moderne n’est plus sujet du lien, il est interface. Sa virilité se mesure en mouvements de pouce, sa solitude en notifications. Dans cette ère du flux, l’amour ne produit plus de chaleur, il mesure la température d’un vide collectif.
Face à cette dissipation, le F pur tente de résister. La femme, dans l’économie du flux, redevient gardienne de la rareté non par domination, mais par instinct de survie symbolique. Elle oppose au déluge du choix la mesure du tri. Choisir, ici, c’est créer un différentiel d’énergie, c’est rétablir une hiérarchie de sens dans un monde horizontal. La sélection féminine n’est pas une crispation, c’est une tentative de réintroduire la physique du désir, sans rareté, pas de valeur ; sans distance, pas de tension. Elle incarne la loi de conservation dans un univers dissipatif.
Mais cette résistance, à son tour, s’expose au piège de la performance. Dans les plateformes du lien, la rareté se met en scène ; la lenteur devient stratégie. Le F pur, imitant le H pur, se transforme en version narcissique de lui-même ,tri algorithmique, mise en valeur de soi, économie du regard. Les études de Rosenfeld sur les matching markets l’ont montré, les plateformes reproduisent les hiérarchies sociales du désir les mêmes codes de classe, d’âge, de visibilité. La résistance féminine se fait miroir du système qu’elle voulait subvertir. La tension se rejoue, mais sans transcendance. Ce qui devrait transformer se contente désormais de filtrer.
Reste alors à repenser la structure même du lien. Toute relation, laissée sans renouvellement de sens, tend vers l’entropie affective, c’est la loi d’inertie symbolique. L’amour n’échoue pas par lassitude, mais par absence de transformation. Comme chez Kelsen, la fidélité n’est pas une morale mais une structure, une Grundnorm silencieuse qui ordonne les forces en présence. Être fidèle, c’est maintenir l’équilibre énergétique du lien, préserver sa forme malgré les variations de matière.
Camus l’avait pressenti, la véritable révolution n’est pas dans l’ivresse du sublime, mais dans la constance du banal. Aimer, aujourd’hui, c’est réapprendre la lenteur. Dans un monde où le temps se contracte, la durée devient une forme de courage ; la continuité, un acte politique. Gilles Vernet dirait que la lenteur est la dernière ressource non numérisable, une résistance intérieure à la vitesse algorithmique. Là où les flux brûlent l’attention, la fidélité redevient une écologie du cœur.
Ainsi se referme la boucle commencée avec Lavoisier. Le désir moderne n’est pas mort, il s’est dissipé. L’enjeu n’est plus de le moraliser, mais de le retransformer. Entre le H pur dispersé et le F pur performé, il reste à réinventer une thermodynamique du sens, un art de la transformation lente, où chaque regard, chaque silence, chaque présence retrouve son poids de matière. Rien ne se perd à condition d’avoir encore le temps de le vivre.
Pour conclure, on peut dire que le désir humain n’a jamais cessé d’obéir à la physique. Il cherche son équilibre, il s’échauffe, se consume, se transforme. Ce que la morale juge, la thermodynamique l’explique, la passion n’est pas un désordre, mais une tentative d’équilibre. Le féminin force de densité et de fidélité au réel conserve le feu du monde là où le masculin le dissipe. Ensemble, ils constituent le cycle même de la vie, tension, échange, transformation. Si notre époque échoue à aimer, c’est parce qu’elle a confondu mouvement et agitation, transparence et clarté, choix infinis et chaleur du lien. Il ne s’agit plus de retrouver la pureté, mais la mesure ; non plus de réenchanter le désir, mais de le réaccorder à la lenteur du temps. L’amour, au fond, n’est pas une exception à la loi de Lavoisier, c’est sa plus belle démonstration. Rien ne s’y perd, rien ne s’y crée ; tout s’y transforme à condition d’accepter de brûler sans se dissoudre.
Il reste peut-être à écrire une véritable physique du lien humain, où les lois du mouvement, de la gravité et de la conservation trouveraient leurs équivalents symboliques dans l’histoire des sentiments. Après tout, si l’univers entier se mesure en énergie, pourquoi le cœur y échapperait-il ? La prochaine révolution ne sera pas technologique mais thermodynamique, celle d’un monde qui apprendra de nouveau à transformer sa chaleur en sens.



