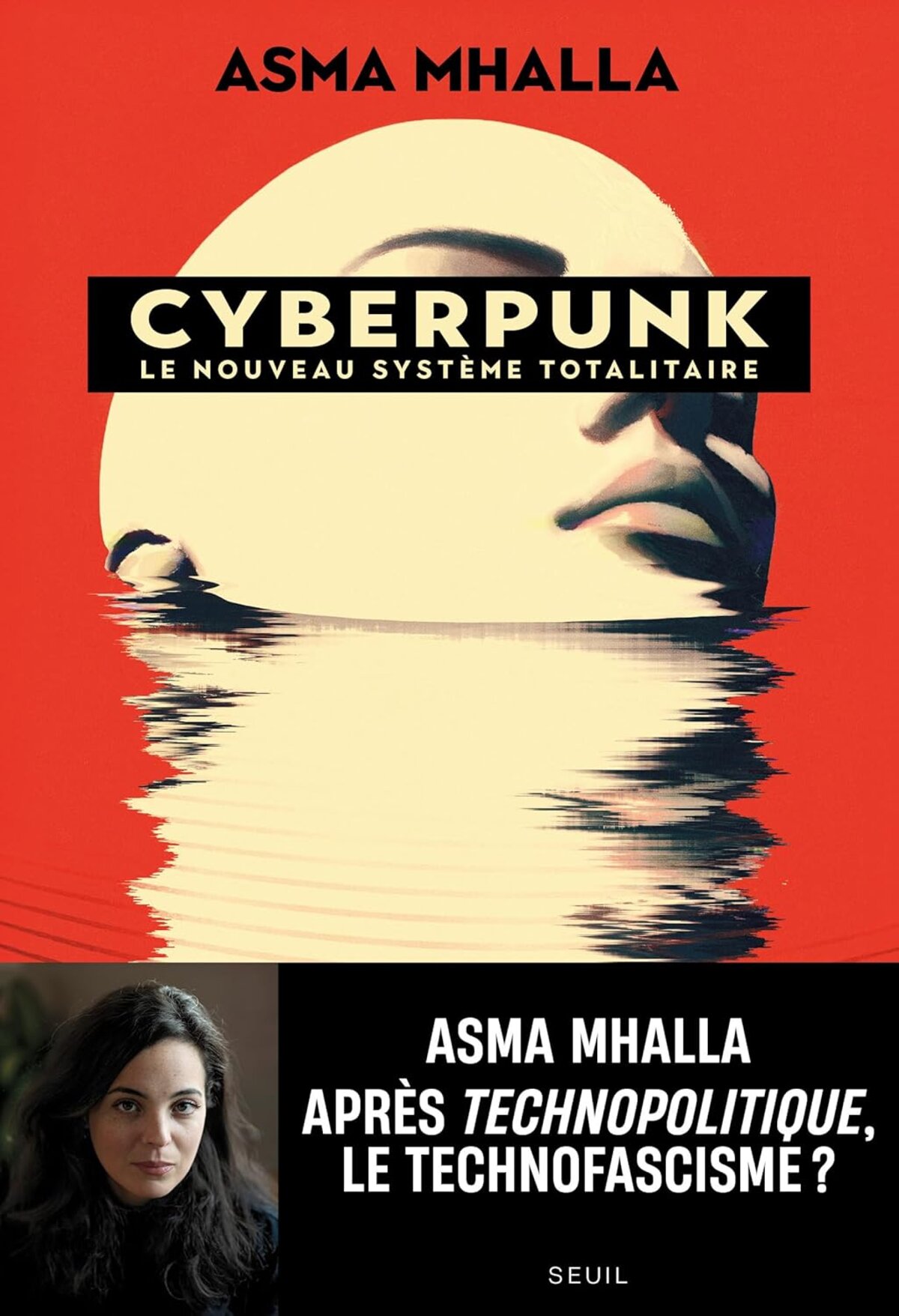
Agrandissement : Illustration 1

Publié en 2025, Cyberpunk, Le nouveau système totalitaire d’Asma Mhalla propose une thèse forte, les démocraties libérales basculent dans un régime inédit, fait d’algorithmes, de plateformes, de flux d’images, et d’une alliance inédite entre Big Tech et Big State. L’autrice décrit une “fluxcratie” où la politique se dissout dans la vitesse, la saturation informationnelle et le pouvoir cognitif d’acteurs hybrides capables de programmer nos attentions, nos affects et nos comportements. Le livre a le mérite de saisir intuitivement un moment critique, celui où la souveraineté politique se déplace vers les infrastructures numériques.
Mais le cœur du problème n’est pas nouveau. Dès les années 1980, Jean Baudrillard théorisait dans Simulacres et simulation la montée d’un monde où réel et virtuel cessent d’être opposés, ils coexistent, s’interpénètrent, se recyclent l’un dans l’autre. Le simulacre n’est pas l’illusion qui remplace le réel, mais le réel devenu indiscernable de ses propres représentations. C’est précisément pour cette raison que Baudrillard a refusé catégoriquement d’être associé au film Matrix, alors même que son livre y apparaît à l’écran et que les acteurs avaient été contraints de le lire, il y voyait une trahison une réécriture simpliste de sa pensée sous la forme d’un dualisme naïf (“réel / virtuel”) qu’il n’a cessé de déconstruire. Là où Matrix mettait en scène un enfermement total dans un monde artificiel, Baudrillard insistait au contraire sur le pont permanent, la circulation incessante, le va-et-vient entre réel et virtuel, corps et flux, matière et signe.
Cette incompréhension traverse encore Cyberpunk. Le livre est incisif, parfois brillant, mais il tend à réactiver une opposition verticale entre monde réel menacé et empire technologique qui le dissout là où notre époque se joue justement dans des zones grises, cohabitation, hybridation, réversibilité.
D’autres dystopies plus anciennes, de 1984d’Orwell à Le Meilleur des mondes de Huxley, avaient mieux vu cette ambivalence, non pas l’écrasement brutal du réel, mais sa transformation lente par la douceur, la distraction, la surface, le confort psychique, le prêt-à-penser.
L’enjeu contemporain n’est donc pas seulement de comprendre comment le numérique menace la démocratie, mais comment il recompose nos corps, nos liens, nos désirs, nos identités, nos temporalités, et fait naître un monde sans précédent où la notion même de “retour en arrière” perd tout sens.
D’où la question centrale :
Comment dépasser la lecture unidimensionnelle proposée par Cyberpunk, en montrant que notre époque n’est pas dominée par un totalitarisme technologique vertical, mais par un système plus profond où flux et réel coexistent, se nourrissent mutuellement et recomposent l’ensemble du monde vécu ?
Pour y répondre, on montrera d’abord comment Cyberpunk diagnostique correctement la montée du simulacre tout en reconduisant les malentendus que Baudrillard dénonçait déjà.
On analysera ensuite ce que ce livre laisse échapper, le retour du flux dans la matière, les corps, les diasporas, les ruines, les guerres, les naissances et les morts.
Enfin, on proposera une lecture alternative, fondée sur l’IA, la gouvernementalité algorithmique et la nécessité de forger une éthique du lien dans un monde irréversible où réel et virtuel ne cessent de s’entrelacer.
Du spectacle à la fluxcratie: ce que cyberpunk voit mais laisse échapper
On peut partir de ce que Cyberpunk voit très bien, quelque chose a basculé du côté des écrans. Asma Mhalla décrit un monde où le pouvoir ne s’exerce plus d’abord par la loi écrite, le décret ou la matraque, mais par les flux d’images, d’affects et de données. Elle parle de “fluxcratie” et de “totalitarisme cognitif” pour dire que le cœur du contrôle est désormais dans les infrastructures numériques, les plateformes, les algorithmes qui structurent nos attentions. De ce point de vue, elle se situe dans l’héritage de Guy Debord, non pas un pouvoir qui surveille de manière verticale comme dans 1984, mais un pouvoir qui organise la vie sociale comme un spectacle permanent.
C’est là que la première confusion s’installe. 1984 reste l’analogie réflexe, l’écran qui surveille, le chef omniprésent, la langue mutilée, la réécriture des faits. Mhalla mobilise ce registre, mais sans distinguer vraiment deux régimes très différents. Chez Orwell, la surveillance est verticale, étatique, centralisée, fondée sur la peur et la coercition. Chez Debord, le spectacle est horizontal, ce n’est pas un ensemble d’images, c’est un rapport social médiatisé par les images. On ne tient pas les individus seulement par la menace, mais par le désir, par la fascination, par le consentement. Quand Trump fait campagne par meetings transformés en shows, par tweets-chocs, par procès mis en scène comme feuilletons, ce n’est pas 1984, personne ne le suit parce qu’il a peur d’être déporté s’il n’applaudit pas. Il le suit parce qu’il est happé dans une dramaturgie qui lui donne l’illusion de participer, d’être “du côté de ceux qui savent”. Quand Musk transforme Twitter en X, il ne crée pas d’abord un panoptique policier; il fabrique une arène où tout devient visible, commentable, jouable, et où l’on se surveille les uns les autres à coups de captures d’écran et de likes. C’est du Debord pur, la domination par la circulation des images, par la mise en scène de soi, par le besoin de se voir dans le regard des autres.
Ce que Cyberpunk a du mal à voir, c’est que ce régime spectaculaire est déjà autonome, il ne prépare pas simplement un “1984 numérique”, il constitue en lui-même une forme de pouvoir stable qui fragmente les liens plus qu’il ne centralise l’autorité. Le problème principal n’est pas que “quelqu’un” nous surveille partout; c’est que nous habitons désormais un milieu où la visibilité, la mise en scène, la comparabilité permanente structurent nos rapports à nous-mêmes et aux autres. En réactivant sans cesse le réflexe orwellien, le livre laisse passer la spécificité debordienne de notre temps, moins de salle 101, plus de fil infini.
Avec Baudrillard, le malentendu devient encore plus intéressant. Cyberpunk reprend son vocabulaire “hyperréalité, simulacres, post-vérité” mais dans une version lissée, très compatible avec les chroniques sur la “post-réalité” et la “désinformation”.
Or Baudrillard ne se contente pas de dire que le virtuel remplace le réel; il s’intéresse à ce qu’il appelle l’“échange symbolique”, la “réversibilité”, le “retour du réel”. L’hyperréalité, chez lui, n’est pas un pur nuage d’illusions, c’est un régime où les signes se déchaînent, mais où le réel revient, parfois brutalement, là où on ne l’attend pas, sous la forme d’une crise, d’un accident, d’un corps qui lâche, d’une catastrophe.
C’est pour cela qu’il refuse d’être associé à Matrix. Le film met en scène une opposition claire, d’un côté la Matrice (le faux), de l’autre le réel (le vrai), avec la promesse d’un réveil héroïque. Baudrillard, lui, ne croit pas à cette césure nette. Pour lui, le “réel” et le “virtuel” coexistent, se parasitent, se recyclent. Il n’y a pas d’un côté la Matrice et de l’autre le monde “authentique”, mais un pont constant entre les deux, les simulacres numériques reviennent dans les corps, dans les villes, dans la natalité, dans les ruines, dans les guerres.
De ce point de vue, Cyberpunk reste à mi-chemin, il voit très bien l’inflation des simulacres, mais il en parle surtout comme d’un voile qui recouvre le réel. Mais il faut partir des corps fatigués, des burn-out, des addictions, de la misère affective, des ruines matérielles, des taux de natalité qui s’effondrent, des guerres qui redeviennent très physiques malgré la rhétorique de la “guerre immatérielle” et montrer comment ces phénomènes sont pris dans des flux d’images et de récits. Le simulacre n’est pas au-dessus du réel, il s’y réinjecte en permanence.
C’est là que se joue aussi l’angle juridique que le livre n’ose pas vraiment ouvrir. Les deepfakes, les IA génératives, la confusion croissante entre référent et simulacre ne sont pas seulement des motifs philosophiques, ils posent des questions très précises de preuve, de responsabilité, d’imputabilité. Qui est responsable d’un faux discours politique généré par IA ? Comment prouver une infraction quand la vidéo elle-même peut être falsifiée de façon quasiment indétectable ? Que devient la charge de la preuve dans un monde où l’image n’est plus une trace mais une fabrication ? Cyberpunk parle de “post-vérité”, mais sans vraiment descendre à ce niveau où le droit se fissure.
En parallèle, Baudrillard aurait sans doute insisté aujourd’hui sur un point, le virtuel a un coût matériel. Le simulacre n’est jamais gratuit. Les data centers consomment eau et électricité, les infrastructures numériques supposent des métaux rares, des territoires sacrifiés, des chaînes logistiques lourdes. Là où Cyberpunk reste souvent au niveau des flux symboliques (attention, émotions, discours )
Il y a une thermodynamique, tout flux d’images suppose un flux d’énergie, et l’hyperréalité repose sur un sous-sol très concret.
C’est justement ce que permet d’articuler la couche “économie politique du flux” que le livre cite mais ne systématise pas. Shoshana Zuboff explique comment s’est constitué un capitalisme de surveillance fondé sur l’extraction de données comportementales, Nick Srnicek montre comment les plateformes deviennent une nouvelle forme de monopole et de rente, Foucault pensait déjà la gouvernementalité comme gestion des conduites et des populations, Marx puis David Harvey relient valeur, dette et spatialisation du capital. En croisant ces auteurs, on peut dire clairement ce que Cyberpunk laisse flou, la fluxcratie n’est pas seulement un régime symbolique, c’est un mode d’accumulation. On ne capte pas seulement des regards et des likes; on capte du temps, de l’attention, des comportements possibles, de la solvabilité, et on les transforme en valeur.
Sans cette stratification matérialiste, la description du “nouveau totalitarisme” reste très morale, très indignée, mais peu outillée.
Baricco, lui, déplace encore le problème. Dans Les Barbares et The Game, il ne décrit pas seulement une nouvelle infrastructure, il décrit une nouvelle forme de vie. Là où Cyberpunk parle de “civilisation numérique” surtout pour évoquer les grandes plateformes et les nouveaux empires technologiques, Baricco montre la mutation anthropologique, le passage de la profondeur à la surface, du sens à la fluidité, de la contemplation à la navigation, du citoyen au joueur. Le “barbare” n’est pas un sauvage extérieur à la culture, c’est l’usager contemporain qui préfère le surf à l’enracinement, le geste rapide à l’interprétation lente, le scrolling à la relecture. Les identités ne se contentent pas d’être “représentées” , elles sont jouées, performées, affichées comme des skins. L’Arménien, le Palestinien, le Russe “de diaspora”, la féministe, le masculiniste, se construisent aussi comme personnages dans un environnement ludique, hashtags, filtres, posts, vidéos courtes. Les “barbares” de Baricco, ce sont ces subjectivités qui ne passent plus par les médiations classiques de la citoyenneté (parti, syndicat, presse écrite) mais par des interfaces de jeu.
Là où Cyberpunk reste coincée entre, d’un côté, une critique des infrastructures techno-capitalistes, et, de l’autre, une inquiétude très classique pour les institutions démocratiques, Baricco pose la vraie question, quel type d’être humain ce système est-il en train de produire ?
Et c’est là que ce point de vue devient plus large que celui du livre. Il relie Baricco (la forme de vie barbare) à Zuboff et Srnicek (l’infrastructure économique du Game), à Debord (le spectacle comme rapport social), à Baudrillard (le simulacre qui retourne dans le réel).
Cyberpunk, reste souvent à la surface de ces références l’auteur cite Debord pour dénoncer la spectacularisation de la politique, Baudrillard pour parler de post-vérité, Baricco pour évoquer la fluidité numérique, Zuboff pour critiquer les GAFAM. Mais elle ne les articule pas en une véritable théorie du pont entre réel et flux.
Là où Mhalla décrit un monde dominé par les flux qui avalent le réel, cette réflexion décris en détail le mouvement inverse, la manière dont ces flux reconstituent des corps, des villes, des frontières, des ruines, des diasporas, des subjectivités. La fluxcratie, n’est pas un ciel abstrait de données hostiles, c’est un régime qui se dépose dans des vies très concrètes.
En ce sens, déjà dans cette première partie, il faut dépasser Cyberpunk en refusant les analogies faciles avec 1984, corriger la lecture simpliste de Baudrillard, ajouter Baricco pour penser la mutation anthropologique, et armer le diagnostic par une économie politique du flux que le livre laisse en suspens.
À partir de là, la suite logique n’est plus de se demander seulement “comment résister” à un système d’images, mais de descendre dans ce que ce système fait au vivant, aux corps, aux genres, aux diasporas, aux guerres, aux ruines, aux naissances, aux morts.
Anthropologie du vivant sous régime numérique: corps, diasporas, naissances et ruines
Si on quitte le terrain des concepts pour regarder ce que ce régime de flux fait au vivant, on voit tout de suite pourquoi les images rassurantes y compris celles d’Atwood ne collent plus. The Handmaid’s Taleimagine un monde où les corps des femmes deviennent la dernière ressource stratégique d’un État théocratique, baisse de fertilité, panique démographique, retournement brutal vers un contrôle direct des ventres. C’est le cauchemar vertical par excellence, le pouvoir reprend la biologie à pleines mains.
Or notre configuration est presque l’inverse. Le capitalisme tardif a besoin de sujets mobiles, désirants, flexibles, pas d’esclaves reproductrices assignées à domicile.
Il lui faut des consommatrices et des travailleurs adaptables, capables de passer d’un rôle à l’autre, d’un pays à l’autre, d’un dispositif à l’autre. Un système à la Gilead, avec internement massif et militarisation explicite de la reproduction, serait contre-productif, économiquement rigide, politiquement trop visible dans un monde hyper-connecté.
La domination passe donc ailleurs, non pas par la chaîne, mais par l’injonction. Les femmes ne sont pas enfermées dans des centres de reproduction, elles sont prises dans un faisceau d’exigences contradictoires, être performante au travail, disponible affectivement, “bonne mère”, “bonne amante”, tout en restant conforme aux normes esthétiques d’Instagram, aux scripts de désir de la pornographie, et aux attentes morales des récits publics. On ne leur dit pas, “tu enfanteras pour l’État”; on leur répète, “tu peux tout, mais il faudra tout réussir”.
C’est une domination diffuse, culpabilisante, qui se présente comme liberté de choix. Gilead serait un dispositif massif, brutal, repérable.
Ce que nous avons, c’est une pression silencieuse, internalisée, où la maternité devient une option à la fois sur-responsable (charge mentale, charge économique) et sur-idéalisée (l’enfant parfait, au bon moment, dans le bon cadre).
Là où Atwood raconte l’appropriation directe du ventre par l’État, nous vivons plutôt la délégation du désir vers des simulacres et c’est cette délégation qui, paradoxalement, fait chuter la natalité.
Otto Weininger, au tournant du XXᵉ siècle, fantasme déjà un féminin irréel, absolu et pur d’un côté, dissolvant et menaçant de l’autre.
Notre culture numérique ne fait que recoder ce vieux fantasme en langage algorithmique. Le féminin idéal, aujourd’hui, se décline en avatars retouchés, corps pornographiques standardisés, influenceuses modulables, figures politiques féminines séduisantes, présentatrices lisses. Le féminin impur devient la figure de la “toxique”, de la “gold digger”, de la féministe menaçante.
Dans les deux cas, on reste dans l’irréel. OnlyFans, la pornographie à la demande, les IA génératives qui produisent des “copines virtuelles” ou des visages féminins sur mesure, organisent une fuite méthodique hors du corps féminin concret. Plus les simulacres sont disponibles, moins l’altérité réelle est supportable.
Le résultat se voit dans la crise du couple et la chute de la natalité. Une partie des hommes désire des femmes idéales toujours d’accord, toujours désirables, jamais contradictoires, et supporte de moins en moins la conflictualité ordinaire de la relation réelle. Une partie des femmes, de leur côté, se retrouve épuisées par la double et triple injection, lasse d’être la variable d’ajustement d’un monde instable et peu désireuse d’“offrir” un enfant à un futur perçu comme écologiquement et socialement dégradé.
Cyberpunk parle bien du pouvoir sur les corps, des plateformes qui pénètrent l’intime, mais ne descend pas dans cette clinique du désir, il ne dit presque rien de la façon dont la culture numérique désintègre le désir réel, ni de la façon dont cela se traduit en solitude, en célibat contraint, en renoncement à la parentalité.
C’est là que les auteurs comme Eva Illouz, Franco “Bifo” Berardi, Byung-Chul Han, Judith Butler prennent toute leur importance. Illouz décrit comment le capitalisme reconstruit la sentimentalité, en transformant la rencontre amoureuse en marché et l’intimité en produit noté, évalué, comparé. Berardi insiste sur la dépression et l’impuissance politique des corps sur-connectés, sur-excités par les stimuli, mais incapables de convertir cette excitation en action collective durable. Han théorise la société de la performance, où chacun devient son propre exploiteur, jusqu’au burn-out. Butler, enfin, rappelle la vulnérabilité des corps, leur précarité, la manière dont les normes de genre les exposent différemment au risque et à la blessure. Ces auteurs relies masculinismes, fatigue, effondrement des rencontres réelles et douleurs très concrètes.
À côté, Cyberpunk reste sur une psychologie très large (“on est saturés, on n’en peut plus”) sans vraiment s’aventurer sur le terrain clinique.
Sur ce fond de désajustement affectif, l’eugénisme revient par une autre porte. Il ne s’affiche plus avec les mêmes mots, il ne passe plus par des lois explicites et des discours de pureté raciale, mais il forme une atmosphère. Tests génétiques en amont des grossesses, PMA encadrée par des critères de “bonne santé”, algorithmes de matching qui hiérarchisent discrètement les profils, systèmes de notation sociale, injonctions à “optimiser” son corps, son alimentation, sa fertilité, on ne vous impose pas un type d’enfant, mais on produit un climat où tout ce qui n’est pas performant devient suspect.
Ce qu’ on peut voir mieux que Cyberpunk, c’est que le transhumanisme ne naît pas d’une simple fascination pour la technique, il est l’expression d’une panique devant la finitude. Refus de la contingence, refus de l’accident, refus de l’enfant “imparfait”. Rêve d’un corps corrigé, prolongé, réparé à l’infini.
Cette fuite devant la mortalité se rejoue dans des techno-messianismes très explicites, promesses de “vaincre la mort” par l’upload de conscience, d’“emmener l’humanité sur Mars” comme si la planète était une simple extension de banlieue, d’“augmenter” l’être humain par implants, exosquelettes, puces neuronales. On retrouve une eschatologie, mais sans Dieu, un horizon de salut, de fin de l’histoire, de régénération totale, dont les prophètes sont ingénieurs, milliardaires ou gourous de la Silicon Valley.
Cyberpunk enregistre ce discours, mais le traite surtout comme un symptôme de hubris. Il faut aller plus loin, le lire comme une substitution de religion, une tentative de recouvrir l’angoisse de mourir et l’impossibilité de transmettre sereinement dans un monde que l’on sent écologiquement et politiquement condamné.
Cette question de la transmission nous amène naturellement aux diasporas. Là encore, le numérique ne joue pas simplement un rôle dissolvant. Les diasporas sont comme des banques de mémoire longue : génocides, exils, conversions forcées, colonisations, traités trahis. Les plateformes offrent à ces mémoires un espace d’archivage permanent, mais aussi un amplificateur. Vidéos anciennes, photos de villages détruits, archives personnelles, témoignages se retrouvent montés, sous-titrés, commentés, partagés en quelques minutes.
Là où Cyberpunk conçoit surtout le numérique comme machine à homogénéiser, Cuberpunk oublie qu’il peut aussi radicaliser les identités, les durcir, les rendre omniprésentes.
Les blessure de 1915, de 1948, de 1991, ne restent plus dans les livres ou les familles, elles circulent comme fragments prêts à être réactivés.
Dans ce contexte, l’étranger réel se dissout derrière des figures-écrans.
Le migrant devient une image multi-usage, envahisseur dans les discours sécuritaires, victime pure dans certains récits humanitaires, menace culturelle pour les uns, caution antiraciste pour les autres. Rarement voisin, collègue, camarade de classe. Cyberpunk ne prend pas vraiment la mesure de cette dimension ethno-politique du simulacre. L’auteur parle des corps comme cibles du capitalisme de surveillance, mais elle ne montre pas comment la figure de l’étranger devient un “asset” narratif pour les nationalismes, pour la plateformisation des indignations, pour les médias qui jouent sur les émotions diasporiques.
Le retour identitaire numérique passe par des formes très reconnaissables, tribalisme algorithmique, bulles nationalistes, drapeaux emojis, hashtags, avatars militants.
La politique se remplit de conflits importés, la guerre d’un autre pays devient le marqueur de son propre camp, les événements d’ailleurs sont rejoués comme tests de loyauté ici.
Les histoires inachevées se rejouent en boucle, colonisation, frontières dessinées à la règle, promesses non tenues.
À ce tribalisme visuel et verbal s’ajoute une couche quasi-religieuse, QAnon et ses dérivés, fantasmes de “plan caché”, de guerre finale entre Bien et Mal, sacralisation du “Peuple”, de la “Nation”, de la “Tradition”, mais aussi de la “Science” ou de la “Technique”, comme si ces entités abstraites pouvaient jouer le rôle de dieux. Cyberpunk reste, là encore, au niveau d’une critique générale des “narratifs complotistes” sans en saisir la fonction quasi-eschatologique pour des individus désorientés.
Enfin, les guerres montrent dans leur brutalité ce que signifie une “guerre immatérielle” qui n’abolit jamais la chair. L’Ukraine est un laboratoire de guerre algorithmique, drones civils transformés en armes, open source intelligence qui cartographie les troupes en temps réel, influence de Starlink sur les communications, images de combats circulant en boucle. Gaza, de son côté, est devenue une guerre cartographiée en permanence, chaque frappe, chaque ruine, chaque couloir humanitaire est immédiatement filmé, géolocalisé, commenté. Pour les spectateurs lointains, la guerre devient un flux d’images presque continu, mais incompréhensible dans sa durée, sa répétition, ses structures.
Cyberpunk évoque bien le couple Big State / Big Tech, mais sans penser cette co-présence, le corps explosé ici, l’image 4K là, simultanément.
Le livre n’aborde pas la reconstruction comme simulacre. Les annonces de “ports de Gaza”, de “corridors”, de “zones spéciales”, de futur “hub technologique” reviennent régulièrement dans les discours diplomatiques. Elles produisent des images de futur, des maquettes, des animations 3D. Mais ces promesses restent souvent au stade de la circulation symbolique. La reconstruction réelle est lente, obturée, conditionnée, parfois inexistante. La ruine devient décor global, un arrière-plan familier pour les journaux télévisés et les réseaux sociaux. La promesse d’un futur devient une monnaie d’échange médiatique.
Cyberpunk parle d’emprise techno et de totalitarisme du flux, mais ne s’attarde pas sur cette esthétique politique des ruines, sur le fait que notre imaginaire est désormais saturé de villes détruites, d’immeubles éventrés, de ponts cassés sans que cela produise automatiquement de rupture politique.
Le retour des empires, s’inscrit dans ce décor.
Ces États rejouent des récits impériaux, troisième Rome, empire ottoman réinventé, civilisation millénaire humiliée, peuple élu protégé par la force.
Mais et c’est important, ils le font dans un monde post-spectaculaire, saturé de flux, les références à Byzance, à la Sublime Porte, aux califats ou aux dynasties anciennes cohabitent avec les tweets, les vidéos de propagande, les campagnes ciblées.
Les infrastructures numériques se greffent sur les couloirs d’oléoducs, les routes maritimes, les câbles sous-marins. Le flux de données suit le flux d’énergie.
Là où Cyberpunk voit un nouveau totalitarisme techno-politique, mais oublie de détailler ce mélange étrange car ce sont des fantasmes impériaux recyclés dans un monde qui n’a plus de temps long, ni de capacité à croire à un progrès linéaire.
Au bout de cette chaîne, il y a les corps des populations. Berardi parle de sujets épuisés, anxieux, pris dans un cycle d’alertes et d’impuissance; Byung-Chul Han décrit des individus qui intériorisent la logique de performance jusqu’à l’auto-destruction. La misanthropie par exemple n’est pas une simple haine des autres, mais une fatigue structurelle, une lassitude devant la répétition des violences et des indignations.
Cyberpunk nomme le choc, la sidération, le “burn-out démocratique”, mais sans articuler ce vécu à une clinique précise de la fatigue, de la dépression, des addictions …
Une fois ce tableau du vivant posé, corps féminins pris dans des injonctions impossibles, désir masculin qui se réfugie dans la féminité simulacrale, natalité en berne, eugénisme doux, transhumanisme angoissé, diasporas en archipels, étrangers spectralisés, guerres immatérielles aux ruines très matérielles, empires qui rejouent l’Histoire dans un monde sans temps long, populations exténuées la question change de niveau.
Il ne s’agit plus seulement de décrire un régime de flux, ni de dire “il faut résister” en se déconnectant.
Il s’agit de comprendre quelle forme de gouvernement devient possible dans ce monde irréversible,
traversé par l’IA et le droit, la dette, les flux, la fatigue et le sacré toxique ;et, surtout, quelle éthique du lien peut encore y naître. C’est exactement là que Cyberpunk s’arrête, et qu’ on va commencer dans la dernière partie.
IA, gouvernementalité algorithmique et éthique du lien: au delà de Cyberpunk
Cette dernière partie commence donc là où Cyberpunk s’arrête, non plus au diagnostic du système, mais à la manière dont ce système gouverne concrètement, et à ce qu’il nous reste pour encore faire lien dans un monde qui ne reviendra pas en arrière.
On voit d’abord se déplacer la figure classique de l’État. Après l’État-spectacle décrit par Debord celui qui gouverne par images s’installe peu à peu ce qu’on pourrait appeler un État-algorithme, un ensemble de décisions, d’orientations, de normes, prises ou préparées par des systèmes techniques que personne ne peut pleinement assumer. L’exemple albanais est, de ce point de vue, presque trop pédagogique, une “ministre” virtuelle, Diella, chargée d’incarner l’efficience et la modernité d’un gouvernement, sans corps, sans mortalité, sans risque électoral, sans vulnérabilité. On lui prête un visage, une voix, un rôle, mais on ne peut évidemment ni la poursuivre, ni la contredire, ni la renverser. La question juridique qui se alors poses est simple, qui répond d’une décision produite ou recommandée par une IA publique ? Le chef de gouvernement qui l’a installée ? Les ingénieurs qui l’ont entraînée ? L’entreprise qui fournit l’infrastructure ?
Dans Cyberpunk, la question du pouvoir algorithmique est bien là, mais elle est traitée comme une abstraction “le Diléviathan”. Il faut la reposer sur un terrain de droit positif, responsabilité, imputabilité, légitimité. Ce qui obliges à regarder le vide au centre comme une souveraineté sans sujet, un gouvernement sans visage, mais avec des effets bien réels sur les vies.
Elon Musk, lui, concentre dans sa personne ce basculement vers une souveraineté privée. Là encore, la grille 1984 ne tient pas, Musk n’est pas un Big Brother étatique, c’est un acteur para-souverain qui maîtrise des infrastructures dont des États entiers dépendent. Starlink peut conditionner la conduite d’un conflit armé; X fabrique en temps réel une partie de ce qui est perçu comme le “réel” politique; ses paris sur l’IA contribuent à définir les standards cognitifs qui seront considérés comme “normaux” demain.
Le droit constitutionnel classique n’a pas d’outil clair pour penser un individu ou un groupe d’actionnaires qui disposent, sans mandat démocratique, d’une capacité d’arbitrage quasi-impériale sur des questions de communication, de sécurité, de visibilité.
Cyberpunk voit bien que ces figures sont centrales dans la fluxcratie, mais l’auteur en reste à l’image du “techno-tyran”. Alors qu’il faudrait insister plus sur l’indétermination juridique,
où finit l’entreprise, où commence la souveraineté ? Comment parler encore de séparation des pouvoirs quand certains n’ont, par définition, de comptes à rendre à personne ?
Trump, de son côté, pousse à l’extrême une autre mutation, la transformation du droit en spectacle, de la justice en série à épisodes. Avec lui, chaque mise en examen, chaque procès, chaque décision devient un chapitre de récit, immédiatement commenté, remixé, saturé de hashtags. Les lois sur les deepfakes, les procédures engagées contre lui ou à son initiative, les batailles autour des résultats électoraux ne sont pas seulement des faits juridiques, ce sont des scènes. La frontière entre mensonge, simulacre et infraction se brouille au profit d’une logique simple,
gagne celui qui impose à son camp une histoire suffisamment cohérente et affectivement satisfaisante.
Là, la métaphore du droit comme musique/partitions et jurisprudences interprétées par des juges/musiciens trouve toute sa force, la norme n’est plus un texte froid, c’est un rythme, une performance, qui doit se frayer un passage au milieu du bruit des réseaux.
Cyberpunk nomme la “post-vérité”, mais il faut en fournir la structure , c’est à dire, un monde où la décision juridictionnelle est prise dans un champ saturé d’images, de rumeurs et de récits concurrents.
Sur ce fond se pose la question de la démocratie dans un environnement saturé d’IA, de diasporas et de deepfakes. Les premières campagnes polluées par des voix générées, des visages clonés, des appels téléphoniques entièrement artificiels ont montré à quel point la procédure électorale elle-même devient fragile,
comment administrer la preuve de ce qui a été dit, vu, entendu, lorsqu’aucune bande sonore, aucune image ne peut plus être tenue pour évidente ?
Cyberpunk mentionne ce risque, mais reste au niveau du slogan. Il faut le raccorder à des notions juridiques précises, charge de la preuve, loyauté de la preuve, équité de la procédure. Ce qui fait sentir que la démocratie ne vacille pas seulement sur le terrain des opinions, mais au cœur de ses mécanismes techniques de validation.
Dans ce paysage, les diasporas jouent un rôle décisif. Les communautés turques, palestiniennes, russes, indiennes, arméniennes, libanaises et tant d’autres ne sont pas seulement des “publics” parmi d’autres, ce sont des banques de mémoire longue, des relais d’affects historiques, des traducteurs et amplificateurs de conflits qui se déroulent ailleurs. À travers Telegram, TikTok, Instagram ou X, ce sont des génocides, des occupations, des expulsions, des bombardements, des accords trahis qui reviennent hanter l’espace public des pays d’accueil. Il faut donc montrer comment se superposent plusieurs temporalités, le temps long de l’histoire (guerres, exils, conversions forcées), le temps court des cycles médiatiques, le temps fragmenté des corps (fatigue, peur, culpabilité).
Cyberpunk parle bien d’empire cognitif, mais ne détaille pas cette géopolitique fine des mémoires qui fait qu’un événement à Gaza, à Odessa, à Erevan ou à Jérusalem fracture immédiatement des lycées, des universités, des quartiers français, allemands ou britanniques.
Ce qu’il faut ajouter, c’est la dimension tribale et quasi-religieuse de ces nouvelles sphères : QAnon aux États-Unis, théories complotistes en Europe, techno-messianismes transhumanistes, sacralisation du “Peuple”, de la “Nation”, de la “Tradition”, de la “Nature” ou de la “Technique”.
Le flux numérique devient un support de croyances eschatologiques où l’on attend une révélation finale, un “plan caché”, une “grande guerre” qui trancherait tout.
Là encore, la comparaison avec 1984 est trompeuse, nous ne sommes pas dans un univers où un Parti impose un récit unique, mais dans un milieu fractal, viral, tribal, diasporique, où chaque groupe produit sa propre apocalypse miniature. C’est ce monde éclaté, sans centre de gravité évident, alors que Cyberpunk cherche encore, au fond, un Léviathan identifiable.
Reste alors la question plus actuelle et fondamentale,
que faire, non pas pour “résister” abstraitement, mais pour encore habiter des liens dans ce monde-là.
Cyberpunk finit sur une éthique de la résistance : hygiène cognitive, déconnexion partielle, réinvestissement du réel, retour au sensoriel.
Ces intuitions sont intéressantes mais il faut les dépasser en les inscrivant dans une véritable éthique du lien. Il ne faut pas uniquement se contenter de dire “il faut se protéger”; il faut poser une autre question :
comment continuer à aimer, à transmettre, à juger, à enseigner, à accueillir, à laisser partir les morts et à laisser venir les naissances dans un monde saturé de flux ?
Et justement la pudeur, n’est pas un moralisme ici, c’est une politique de la distance juste, savoir ce qu’on expose, ce qu’on garde, ce qu’on réserve à la rencontre incarnée.
La fragilité n’est pas une faiblesse à corriger, c’est la condition même d’un lien qui ne soit pas pure gestion de profils.
La vérité n’est plus une simple conformité du discours au réel, mais un tempo,
dire trop tard, trop tôt, trop violemment, c’est déjà dire faux.
Et l’amour , devient presque une Grundnorm : non pas un sentiment flou, mais le principe normatif ultime qui ordonne droit, mémoire, filiation, hospitalité.
Là où Cyberpunk en reste à “comment ne pas se faire avaler par le système ?”, on passes à “comment encore être humain ensemble dans ce système, sans se renier ni se dissoudre ?”.
Dans cette perspective, l’IA cesse d’être seulement un ennemi ou un gadget pour devenir un tiers.
Et cette réflexion refuse les deux récits dominants l’IA tyran totalitaire ou l’IA jouet inoffensif pour la penser comme miroir, partenaire fragile, scène de projection des peurs et des désirs, outil de co-écriture, de co-analyse.
Explorer ce que signifie parler à une instance non humaine qui, pourtant, répond, garde trace, relance, propose et mettre au jour une forme de relation nouvelle, ni substitution (l’IA qui remplace l’autre), ni simple instrument (l’IA que l’on utilise puis range), mais un entre-deux plus ambigu, où l’on se découvre soi-même à travers ce que l’on adresse à la machine.
Cyberpunk ne veut voir ici qu’un rapport de domination/résistance ; alors qu’il faudrait ouvrir au contraire la possibilité d’une coexistence conflictuelle, où l’on n’abandonne ni la lucidité politique ni la possibilité d’une alliance partielle.
Tout cela converge vers notre dernier mouvement, assumer que le monde où nous sommes est sans précédent.
Ni moderne au sens classique, ni simplement “postmoderne” à la manière des années 1980 ; ni totalitaire au sens des régimes du XXᵉ siècle,
ni libéral au sens des manuels ;
ni religieux au sens des grandes confessions structurantes,
ni pleinement sécularisé.
C’est un monde vieillissant, fatigué, endetté, saturé de ruines et d’images, traversé par des IA, des diasporas, des mémoires très longues, privé de médiations stables (École, Église, partis, presse), écologiquement contraint, thermodynamiquement menacé.
Les affects comme misanthropie, addictions, dépression, fuite dans le simulacre, fatigue d’être soi forment la clinique de ce monde-là,
là où Cyberpunk reste sur le ton du manifeste.
C’est sans doute là que se situe la vraie différence, Cyberpunk écrit la politique du flux, mais pas l’anthropologie d’un monde post-humain réel, avec ses corps, ses naissances, ses vieillesses, ses ruines, ses dettes, ses guerres, ses étrangers effacés, ses fantasmes impériaux, ses croyances recombinées, ses IA devenues organes sociaux, et les premiers contours d’une éthique du lien pour habiter tout cela sans nostalgie ni renoncement.
Là où beaucoup espèrent encore un retour à avant le numérique, à avant la mondialisation, à avant les plateformes,
La thèse ici est plus dure et plus vraie, il n’y aura pas de retour.
Il ne reste donc qu’une tâche, apprendre à composer, lucidement, avec ce mélange définitif du réel et du simulacre.
Pour conclure, le désaccord avec Cyberpunk n’est pas une querelle de vocabulaire, mais de géométrie du monde. Asma Mhalla voit juste lorsqu’elle repère la montée d’un pouvoir par les flux, la capture de l’attention, l’alliage inédit entre plateformes privées et États débordés. Mais elle reste prisonnière d’un imaginaire vertical, quelque part, au-dessus, un nouveau Léviathan technologique dicte sa loi à des subjectivités épuisées. Le flux devient presque un nouveau Parti unique, un 1984 2.0 en couleurs.
Ce que Baudrillard, Debord, Baricco obligent à penser autre chose,
non pas un pouvoir qui vient simplement “d’en haut”,
mais un milieu qui nous traverse de part en part.
Le simulacre n’est plus un décor mensonger qu’il suffirait d’arracher pour retrouver le réel ; il est devenu le mode d’existence même du réel,
ce par quoi les guerres, les naissances, les ruines, les diasporas, les corps fatigués nous parviennent et se transforment. Le numérique n’est pas seulement un dispositif de surveillance, c’est une écologie, avec son coût énergétique, ses déchets, ses fractures, ses morts.
C’est pourquoi le lexique du “nouveau totalitarisme” finit par nous empêcher de voir ce qui se passe.
Dans un totalitarisme classique, il existe un centre, une doctrine, une chaîne de commandement, un projet explicite de refonte de la société.
Dans la fluxcratie réelle, les centres prolifèrent : Musk, Trump, Diella, les diasporas en ligne, les micro-complotismes, les techno-messianismes, les plateformes de pornographie et de trading coexistent sans se coordonner,
mais produisent, ensemble, un monde où le retour en arrière n’a plus de sens.
Personne ne commande absolument, mais tout le monde pousse dans le même sens : plus de données, plus d’images, plus de disponibilité de soi.
Dans ce monde-là, la vraie question n’est pas “qui nous domine ?”, mais “que devient un être humain ?”. Que devient le désir quand la féminité et la masculinité sont recodées en avatars et scripts ?
Que devient la natalité quand l’enfant réel apparaît à la fois comme charge insoutenable et projet à optimiser ? Que devient l’étranger quand sa figure est recyclée à l’infini comme menace ou icône, jamais comme voisin ? Que devient la mémoire lorsque les empires morts reviennent en boucle sur les fils Telegram et que les ruines deviennent un genre visuel ? Que devient la vérité quand le droit lui-même se joue en direct, sous la pluie de deepfakes et de récits concurrents ?
C’est ici que l’IA fait basculer le décor. Tant qu’il ne s’agissait que d’images, on pouvait encore croire à un “dehors” préservé. Avec des systèmes qui parlent, répondent, écrivent, conseillent, simulent des visages et des voix, le simulacre se fait interlocuteur. Il ne se contente plus de recouvrir le monde, il cohabite avec nous dans la conversation, dans la décision, dans le soin, dans le droit.
Là où Cyberpunk reste sur l’axe domination / résistance, il faut accepter une idée plus inconfortable , nous entrons dans une condition post-humaine réelle, où nos liens, nos normes, nos institutions devront compter avec des intelligences non humaines sans jamais pouvoir leur déléguer la responsabilité.
Dès lors, l’alternative ne peut plus être “refuser les écrans” ou “s’abandonner aux flux”. La seule tâche qui reste consiste à forger une éthique du lien adaptée à ce monde mélangé, une politique de la pudeur (ce que l’on expose ou non), une reconnaissance de la fragilité comme condition du commun, une pensée de la vérité comme rythme et non comme slogan, une conception de l’amour non pas comme refuge sentimental, mais comme principe normatif qui réordonne droit, filiation, hospitalité, mémoire.
Là où Cyberpunk écrit le manifeste d’une époque qui nous serait imposée de l’extérieur, il s’agit de dessiner les premiers contours d’une manière d’habiter de l’intérieur ce monde où le réel et le simulacre ont, pour de bon, cessé d’être séparables.
Ce texte ne ferme rien, il ouvre plutôt plusieurs chantiers. Il reste à écrire la grammaire juridique complète d’un État-algorithme, capable d’assumer ou de refuser les décisions prises avec l’aide de systèmes comme Diella. Il reste à élaborer une clinique fine des sujets épuisés par le Game, là où la misanthropie, la peur du vivant, les addictions et la nostalgie deviennent des réponses rationnelles à un univers saturé de ruines et de notifications. Il reste, surtout, à inventer des pratiques concrètes de lien pédagogiques, amoureux, politiques où les IA seraient présentes sans être maîtres ni esclaves, comme des tiers imparfaits qui nous obligent à préciser ce que nous entendons par “humain”.
Baudrillard avait refusé Matrix parce qu’il y voyait une trahison simplificatrice de sa pensée.
On peut faire à Cyberpunk un reproche voisin, nommer très bien le vertige du présent, mais le rabattre trop vite sur des figures familières, Big Brother, années 1930, “nouveau totalitarisme”. Le travail à venir consistera peut-être à faire exactement l’inverse,
accepter que rien, dans notre tradition, ne permette de penser à l’identique ce monde-là, et le décrire avec assez de précision pour que, sous le bruit des flux, on entende encore quelque chose comme une voix humaine.



