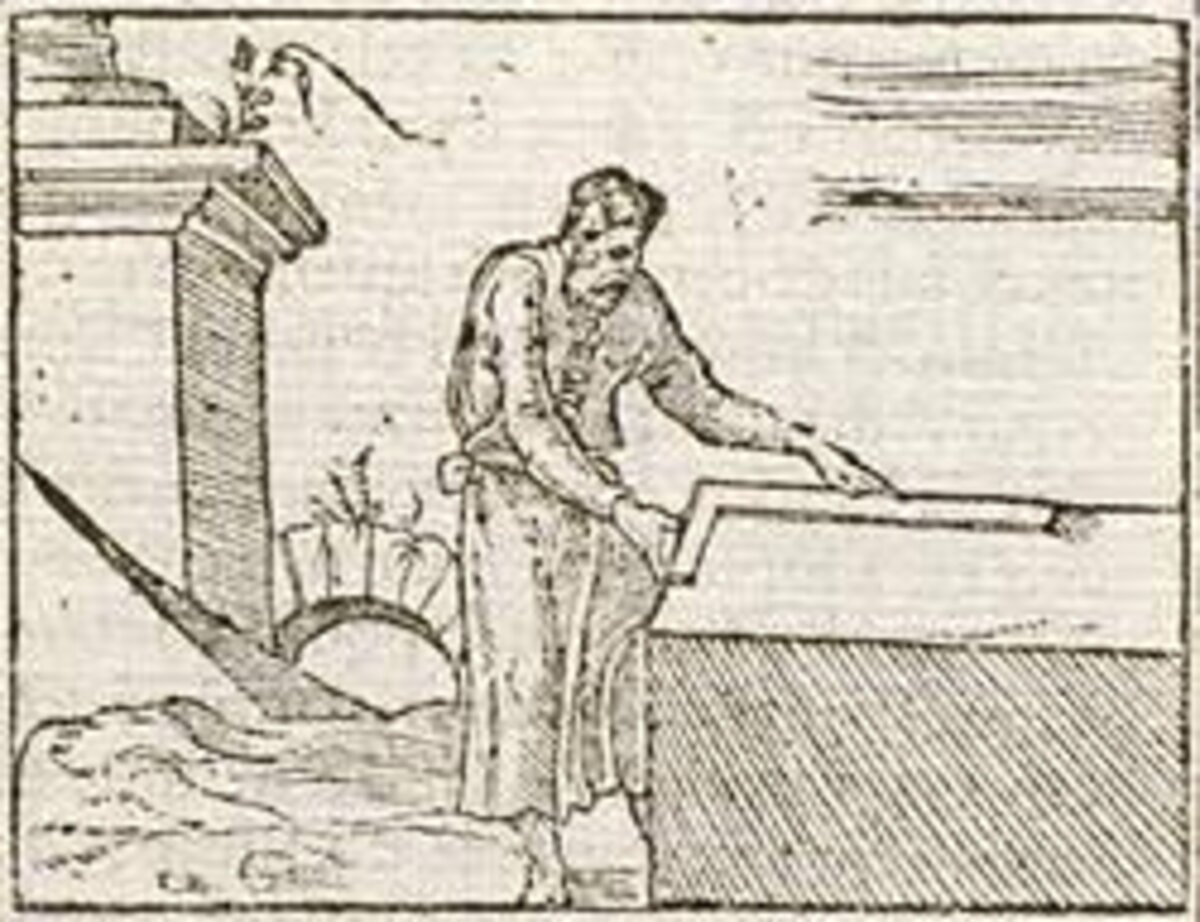
Au départ est le cri, la colère de celui qui sombre dans le ressentiment parce qu'invisible aux yeux de la justice.
C'est, je pense, ce que nous vivons avec le mouvement des gilets jaunes : la disparition de l'individu derrière un vêtement mettant de côté toute distinction constitutive de son "soi" nous renvoie ainsi à une logique où l'universalisme est dénoncé comme négation de la reconnaissance d'un "soi" collectif ou singulier. Cette non prise en compte de l'individu c'est le "sort" par exemple, qu'il n'a pas choisi. Il est, comme on l'entend souvent, victime du système. C'est pourquoi il cherche du sens en attribuant des causes à son état, soucieux d'une reconnaissance. Peu importe la nature de ces causes. Ce qui lui importe c'est de substituer le sens à l'insensé de la situation.
La question de la violence est ainsi loin d'être réglable par le seul recours au législatif. Elle résulte de l'absence d'un critère de rétribution qui soit équitable.
Quand l'Etat produit trop de lois cela a pour conséquence d'affaiblir les lois nécessaires à la vie commune. Les décrets, la jurisprudence peuvent certes affiner la généralité de la loi, mais à trop les multiplier, on oublie qu'une loi relève d'abord d'un travail d'interprétation.
Car ce qui fait que tout n’est pas défini dans la loi, c’est qu’il y a des cas d’espèce pour lesquels il est impossible d’établir une loi : en sorte qu’il faut avoir recours au décret. Car, de ce qui est indéterminé la règle aussi doit être elle-même indéterminée, comme cette règle de plomb, dont les constructeurs de Lesbos se servent : de même que la règle épouse les contours de la pierre et n’est pas rigide, ainsi le décret est adapté aux faits. » [Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, Ch. 14, 1137a-1138, d’après la trad. Gauthier Jolif, Louvain-Paris, 1958]
Ainsi le juge a pour objectif de faire coïncider le plus exactement possible, le délit et la peine. Cette approche est une reconnaissance des limites de la loi, et en même temps son extrême souplesse pour garantir la justesse de la mesure.
Cette approche algébrique et asymptotique de la loi nous renvoie au calcul - au sens de ratio - et dans un même temps à une réflexion sur la juste proportion à établir entre la loi et son application. C'est ce que l'on nomme "équité". L'équitable corrige la loi dans sa trop grande généralité, voire son universalisme qui négligerait la singularité de chacun. Ainsi l'équité est elle la proposition faite à l'individu pris dans sa différence.
Là où cela bloque, c'est que dans notre République, le principe de rétribution de chacun selon un critère de vérité est flou, voire inexistant. Pascal écrivait :
Il n’est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime ; mais il est nécessaire que je vous salue. Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l’une et à l’autre de ces qualités. Je ne vous refuserai point les cérémonies que mérite votre qualité de duc, ni l’estime que mérite celle d’honnête homme. Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferais encore justice ; car en vous rendant les devoirs extérieurs que l’ordre des hommes a attachés à votre naissance, je ne manquerais pas d’avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit (Trois Discours sur la Condition des Grands).
Rompre ce pacte de reconnaissance c'est rendre incompréhensible le critère de distribution des honneurs ou des peines. La non rétribution fait cesser la justice distributive.
Alors tout devient frontal. La violence s'installe. On renonce à la justice et le cri demeure.



