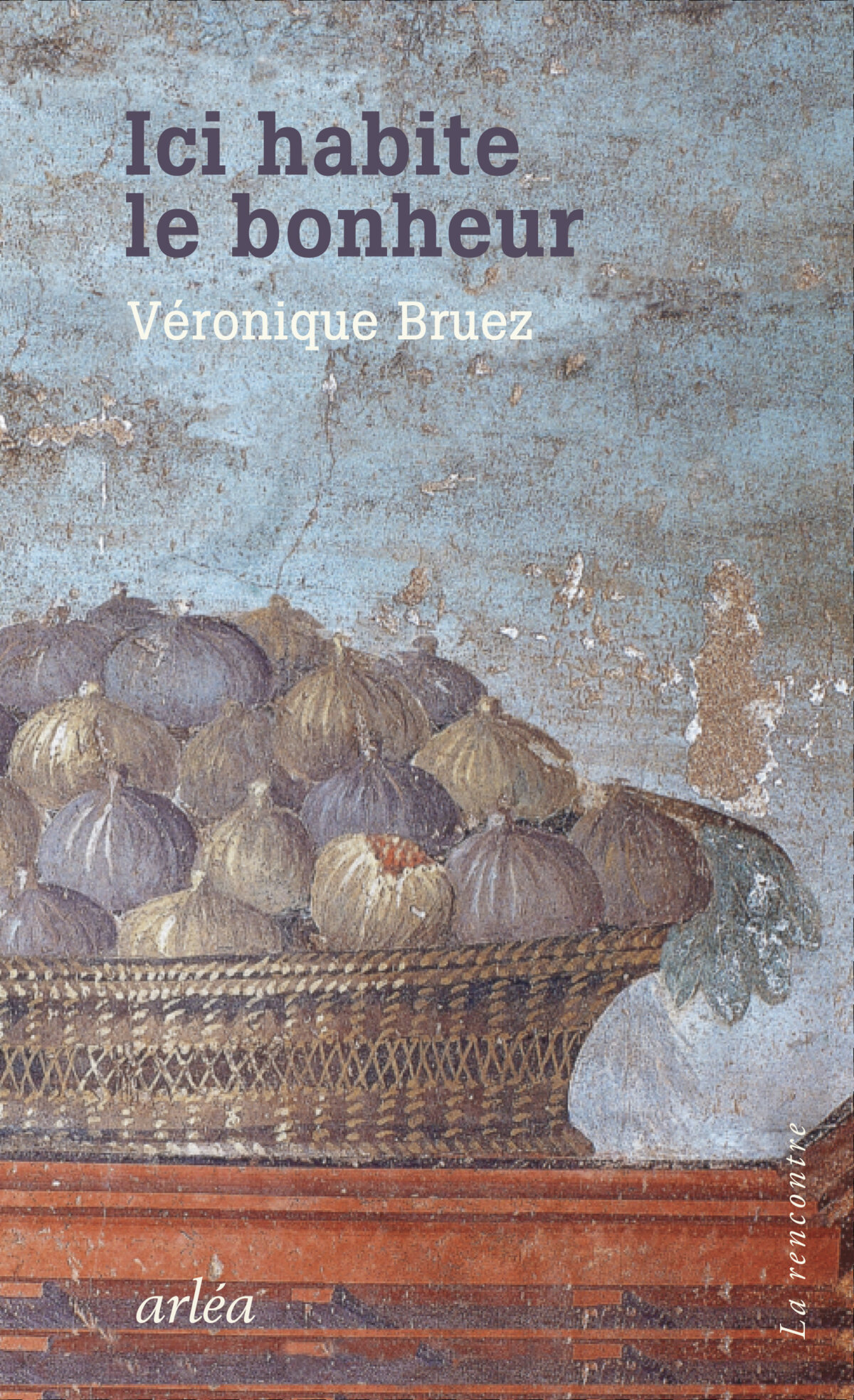
Agrandissement : Illustration 1
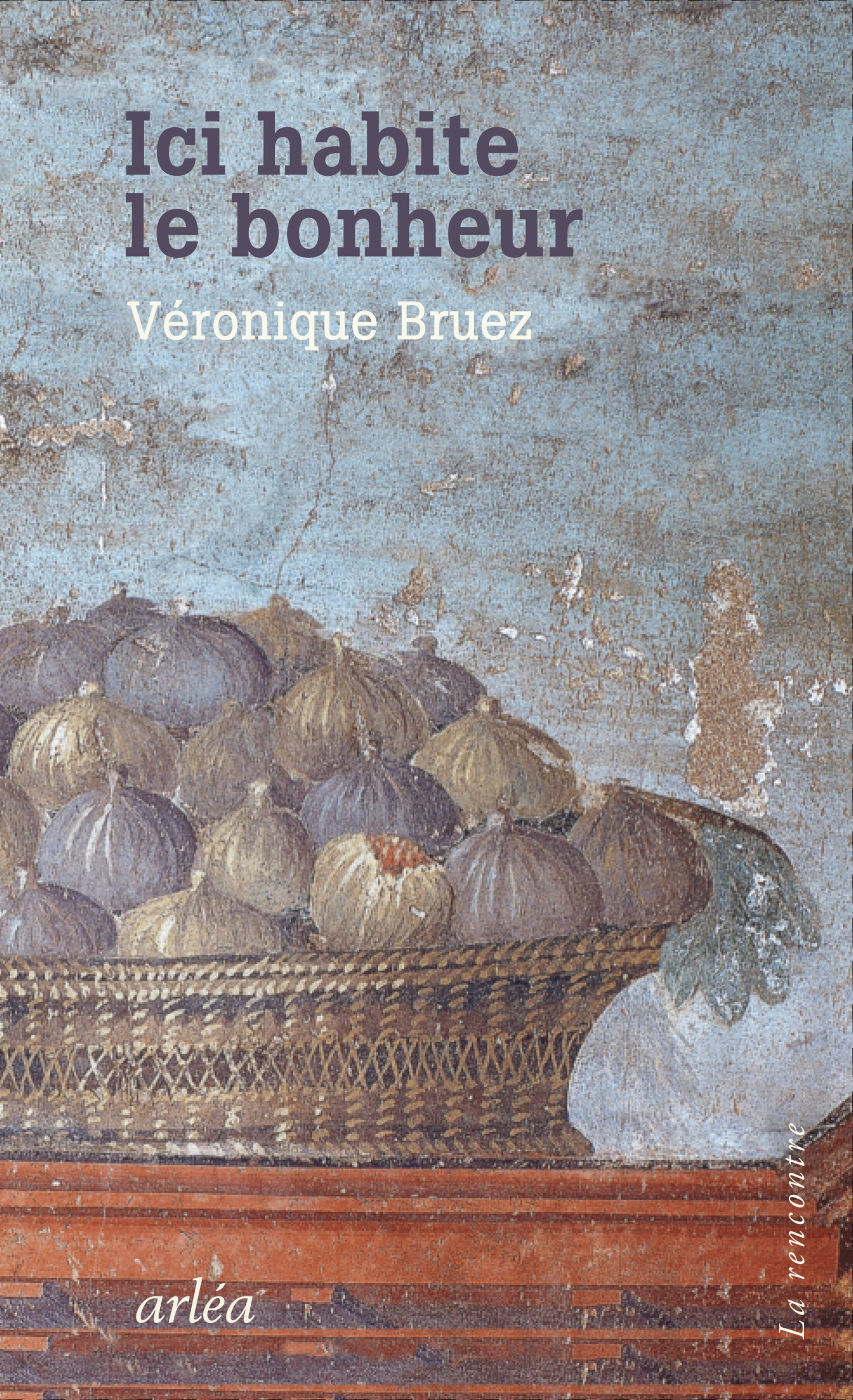
Un ici qui n’est pas un là-bas, dans un horizon qui recule sans cesse, mais ici, près de moi, en ce lieu si proche que je ne le vois pas, en ce livre que j’ai en main, il y a tous ces mots qui sont tout autant des présages.
Ils servent, tous ces mots, à contrer l’inhumain. Les mondes antiques étaient cette « civilisation de la révolte contre la fatalité »((p.211)), se battant pour la liberté, plaçant l’homme au cœur de ses valeurs. De Pompéi recouverte par la lave, il demeure des traces de l’humain, des graffiti, ces mots jetés sur les murs faisant écho à notre modernité en circulant dans le livre de Véronique Bruez.
Le grec et le latin ne sont pas des langues mortes mais portent en elles la vitalité de ces fleurs « autour desquelles virevoltent des insectes »((p.19)). Les mots présentent au lecteur étonné, la force de ces éruptions qui font surgir des profondeurs de la terre des semences.
Il n’y a pas de langue « morte », seulement un va et vient entre le passé et l’avenir qui parle avec la voix du présent. Mots graffiti dont ce livre est la trace.
Vivre au milieu du vacarme et du sang » serait-ce cela « vivre bien » ?Cette question peut très vite perdre de sa pertinence, être l’occasion d’un exercice de style, une mondanité de la pensée, un travail d’érudits bien éloignés de l’exercice spirituel auquel se livraient les philosophes de l’Antiquité. Loin d’être un pensum, le livre de Véronique Bruez se présente comme une poétique du quotidien, une collecte de mots déployant un univers de significations selon un mode expansif voire entropique. Oscillant entre l’index et l’aphorisme, le récit et l’énigme, le mot se met en scène dans une figure de l’instantané, en un lieu, le cabinet de curiosité. Lieu de l’étonnement, du tonnerre qui réveille l’homme engourdi.
Fureter, renifler puis cueillir les mots et les associer en une sorte de florilège ou les rassembler dans un livre, liber en latin, mot qui se traduit par liberté aussi, c’est le projet qui anime Véronique Bruez. Ce livre est un « cabinet de curiosité », un lieu de retrait, espace intime où on garde ses choses précieuses »((p11)). Ce cabinet est la mémoire de ces mots qui nous éloignent du quotidien, de ce qui nous semble connu, pour finalement nous y ramener, réveillent ces récits du quotidien, mettant en œuvre « une poétique du réel », «ne permanence entre la proximité et l’étrangeté absolue ». Semblables en cela aux graffiti de Pompéi jaillissant de la mémoire de l’auteure.
La rhyparographie antique s’attachait à la représentation des sujets considérés comme manquant de noblesse. Elle trouve sa source à Pompéi.
Pris au pli de la mémoire, le mot est d’abord un récit dont il finit par se détacher, rompant ainsi avec sa première signification. Mais demeure en lui le tout d’un monde, une histoire. Le mot « Ciao » n’oublie pas qu’il vient du latin « esclave »((p.196)). « Tête à claques » : « Lucius Veranus était toujours suivi d’un esclave portant un sac de pièces ; il dépensait son argent dans les claques. Quand l’envie de gifler quelqu’un lui prenait, il ne se gênait pas((p.189)) ». Cueillir l’instant et le retenir dans ce lieu. Tu n’es qu’un homme disait un esclave à l’imperator sur son char les jours de triomphe. Rien ne dure. Cette évanescence de la durée invite à l’hédonisme.
Il n’y a là nulle nostalgie. En nous attachant aux mondes que nous découvre l’image d’un réel en tension, en nous laissant aller à la curiosité de ces diverses formes réveillant leur énigme, il s’agit de réaliser une collecte, avec une variété de formes qui nous transporte d’un lieu à un autre lieu. Du temps qu’il fait, au temps qui passe, Véronique Bruez nous dit de cueillir l’instant, de nous réjouir en entrant dans ce monde de l’instantané où l’image prend diverses formes, faisant de la métaphore ce qui nous transporte de joie, dans l’oubli du concept et de la logique de la raison.
Au sens littéral, le verbe carpere qui donne carpe diem, signifie « brouter, déchirer ». l’image est première, bien avant le concept. Le sens imagé et la métaphore ne viennent qu’après. Les Romains chassaient l’année à coup de bâtons : « A Naples, le 31 décembre, on continue de jeter ce qu’on ne veut plus par les fenêtres»
Les mots sont semblables à ces graffitis retrouvés à Pompéi. Recouverts par les événements du passé, ils découvrent l’énigme du futur



