
Agrandissement : Illustration 1

Enjeux 1 : penser la mobilité à partir des nouveaux modes de déplacements dans la construction du commun et des capacités à être mobile tout en partageant l'espace public.
Plus rapides que la marche à pied, moins contraignants qu’un scooter, plus souples que les transports en commun, les EDPM offrent une alternative intéressante pour les petits trajets quotidiens et viennent concurrencer largement la bicyclette. Hausse des carburants et crise énergétique, un report modal sur les micro-mobilités s'opère dans cette phase de bifurcation climatique et de généralisation de l'assistance électrique. Issus de nouvelles générations d'usagers et de changements de pratiques, les trottinettes électriques, les monoroues et autres « engins de déplacement personnel motorisés » ont été intégrés au code de la route depuis octobre 2019.
Ce mode de déplacement doux représente une alternative propre à la voiture, accessible à tous et de nature à fluidifier le trafic mais génère des incivilités et fait l'objet pour beaucoup d'une connotation fortement négative à cause du comportement accidentogène de certains et la non-conformité des engins (dangers d'utilisation et vitesse excessive). L'organisation par la Mairie de Paris le 2 avril 2023 d'un référendum, « pour ou contre les trottinettes en libre-service » a médiatisé la place de la micro-mobilité dans l'espace public en particulier avec le caractère invasif du free-floating. Peu de votants se sont déplacés (moins de 8% des inscrits), mais ceux qui ont voté se sont prononcés massivement contre (à 89%) au regard des nuisances de leur présence sur la voie publique. Le sentiment d’insécurité est aussi en hausse chez les usagers de trottinettes et de vélos selon le baromètre Axa : près d' 1 trottinettiste sur 2 se sent en insécurité sur la route en 2022, 56% des cyclistes le vivent au quotidien. C'est pourtant devenu un choix économique pour de nombreux français, d'insertion professionnelle pour certains et d'enjeu écomobile.
Révolution lente et empreinte sociétale modérée
Le partage de l’espace public qui induit le respect de l’ensemble des usagers est l'enjeu majeur dans cadre de la transition mobilitaire décarbonée. Les autorités (AOM) peuvent mettre en place différentes solutions pour préserver la sécurité et le confort des plus vulnérables, par la création de pistes cyclables, l’instauration de zones de rencontre pour les piétons, le lancement de campagnes de sensibilisation et de prévention.
L'observatoire de la micro-mobilité créé en mai 2024 a notamment vocation à publier des datas objectives sur l’usage et l’impact environnemental des EDPM. Copiloté par la DGITM, le Cerema, l’Ademe et l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), cet observatoire permet le partage des connaissances sur ce mode de déplacement qui occupe aujourd'hui largement l'espace urbain et fait l’objet depuis 2023 d’une réglementation qui régule leur utilisation (en 2023, on comptait 2,5 millions d’utilisateurs contre 640.000 en 2020, avec une augmentation significative des accidents).
L'EDPM présente l'avantage de faciliter l'intermodalité : un trajet sur cinq effectué en trottinette électrique combine plusieurs types de mobilité, dans 62 % des cas, il est associé avec des transports en commun. Dans un contexte de perte de pouvoir d’achat, l’usage des EDPM augmente, la hausse du coût des carburants a un impact direct en renforçant leur utilisation. Recours aux transports publics ou au co-voiturage en plus de la marche et du vélo, la hausse des prix de l’énergie a une incidence sur les déplacements des usagers, en particulier sur les courts trajets. Pour autant, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km continuent à se faire en voiture. (sources INSEE- cf article d'O.Razemon)

Agrandissement : Illustration 2

Accès à l'émancipation sans émission
Dans une société du tout-voiture, les modes de transport alternatifs disposent cependant d’une belle marge de progression, encore faut-il parvenir à sécuriser ces mouvements en les sociabilisant ! La cohabitation vertueuse pour l'ensemble des usagers de la route induit l'apprentissage des règles de bonne conduite et de sécurité à respecter pour un déplacement qui responsabilise l'acteur (cf éducation routière et traumatologie à Antibes).
La trottinette (musculaire) est un outil de formation et d'initiation afin d'acquérir l'équilibre et coordonner les mouvements, on peut d'ailleurs découpler la gestion de l'équilibre et le pédalage. Dans un souci de réduction des inégalités sociales et spatiales, elle peut accompagner les premiers pas dans le processus de développement de la motricité intégré au "continuum éducatif" visant l'autonomisation de la personne. C’est devenu un palier d’accès à la mobilité de nombreux jeunes et salariés qui sortent de leur insularité et élargissent leurs loisirs et recherches d’emploi. Encadrer l’utilisation des EDPM par la prévention pour objectifs de réduction de la fracture mobilitaire, contre l'exclusion. La maîtrise du guidon et de l'engin peut être une étape vers le VAE (vélo à assistance électrique) grâce à la gestion de la propulsion. L'aspect ludique et fonctionnel du 2 roues gagne à s'accompagner d'un objectif d'exercice physique. La culture de l'effort doit pouvoir retrouver sa place pour des questions de pratique sportive (et de santé). En effet, les EPDM rejoignent des finalités de déplacement 0 carbone même s'ils ne s'associent pas aux mêmes objectifs de santé publique (et d'endurance cardiaque). Coexister sur la chaussée, c'est aussi vivre ensemble un itinéraire de circulation apaisée et de transformation sociale et écologique.

Agrandissement : Illustration 3

1-Contribution au débat AES le 16/11/2024 (Paris) : "Transports du quotidien : quelles réponses écologiques et sociales ?" https://alliance-ecologique-sociale.org/
TROTTINETTE et MODES ACTIFS, inclusion sociale et territoriale
Parmi les modes actifs, il faut réserver une place à part à la trottinette électrique. Un des cœurs de la population des utilisateurs est constitué de jeunes adultes, des hommes surtout mais également de jeunes femmes, positionnés sur les franges précaires du marché de l’emploi. Ces adeptes de la trottinette vivent, travaillent et circulent sur des territoires combinant les quartiers de la géographie prioritaire, les premières couronnes périurbaines et les zones d’activités ou industrielles. Les moments de la pratique comptent aussi et, sans exagérer le portrait, les trajets se font souvent très tôt le matin (entre 4h et 6h) et tard le soir, à 21 heures passées.
On reconnaît là les espaces-temps des emplois métropolitains fragmentés, ceux de la logistique et de la sécurité, du nettoyage industriel et des services à la personne. La trottinette électrique présente de nombreux intérêts pour cette population. Le faible coût d’abord, la vitesse relative et donc la portée du déplacement, jusqu’à 40 kilomètres voire un peu plus selon les modèles. Les éléments symboliques sont cruciaux, ceux de l’enjeu motorisé, rapide, offrant une posture superbe à son pilote qui fend la route… L’accidentologie doit tempérer les ardeurs mais l’usage se développe sur les pourtours des grandes agglomérations partout en France.
Cette trottinette électrique de jeunes actifs précaires se positionne sur ce qui a été longtemps le marché de la « voiture du pauvre »1. La trottinette électrique offre le même type de service que la « voiture du pauvre » dont les capacités sont réduites alors que ses coûts sont élevés. Elle a également l’intérêt d’être moins polluante qu’un vieux diesel acheté, parfois, en garage associatif et bricolé en pied d’immeuble. Il ne serait pas inintéressant de développer des parcs de trottinettes électriques sur les espaces de couronne en lien avec les marchés de l’emploi précaire mais intégrateur pour de jeunes gens peu qualifiés. La location ou la vente s’accompagnerait d’une formation à la sécurité de soi et des autres usagers de la route.
Du péri-urbain à la conquête rurale ?
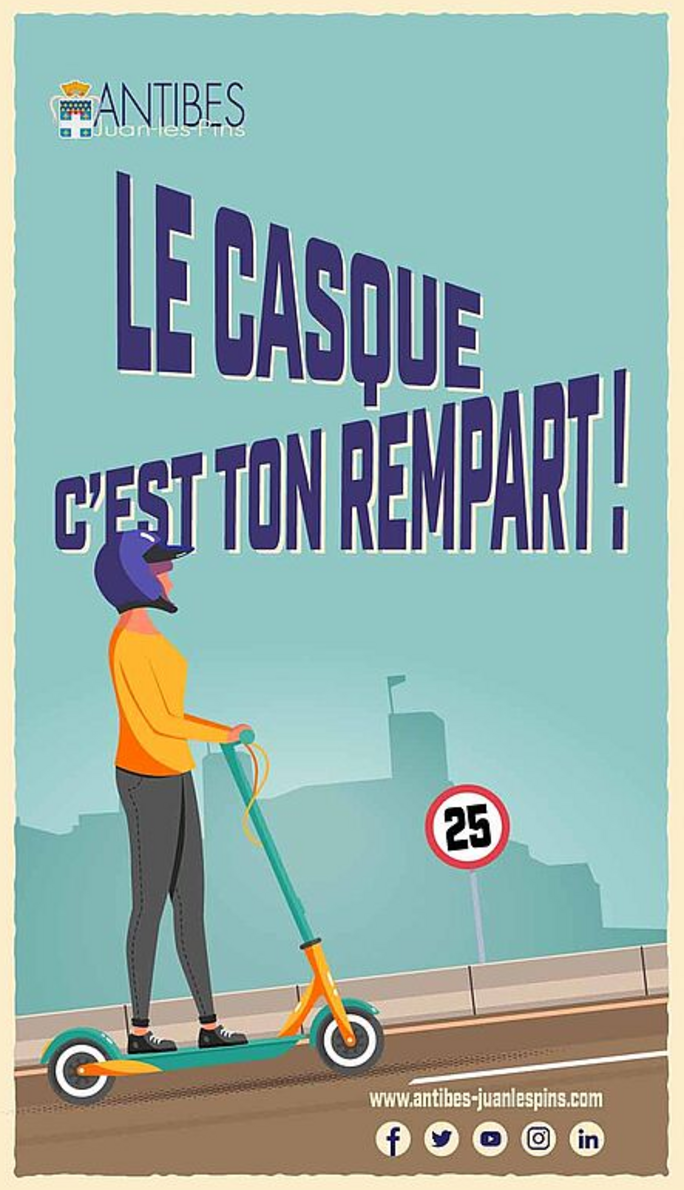
Agrandissement : Illustration 4
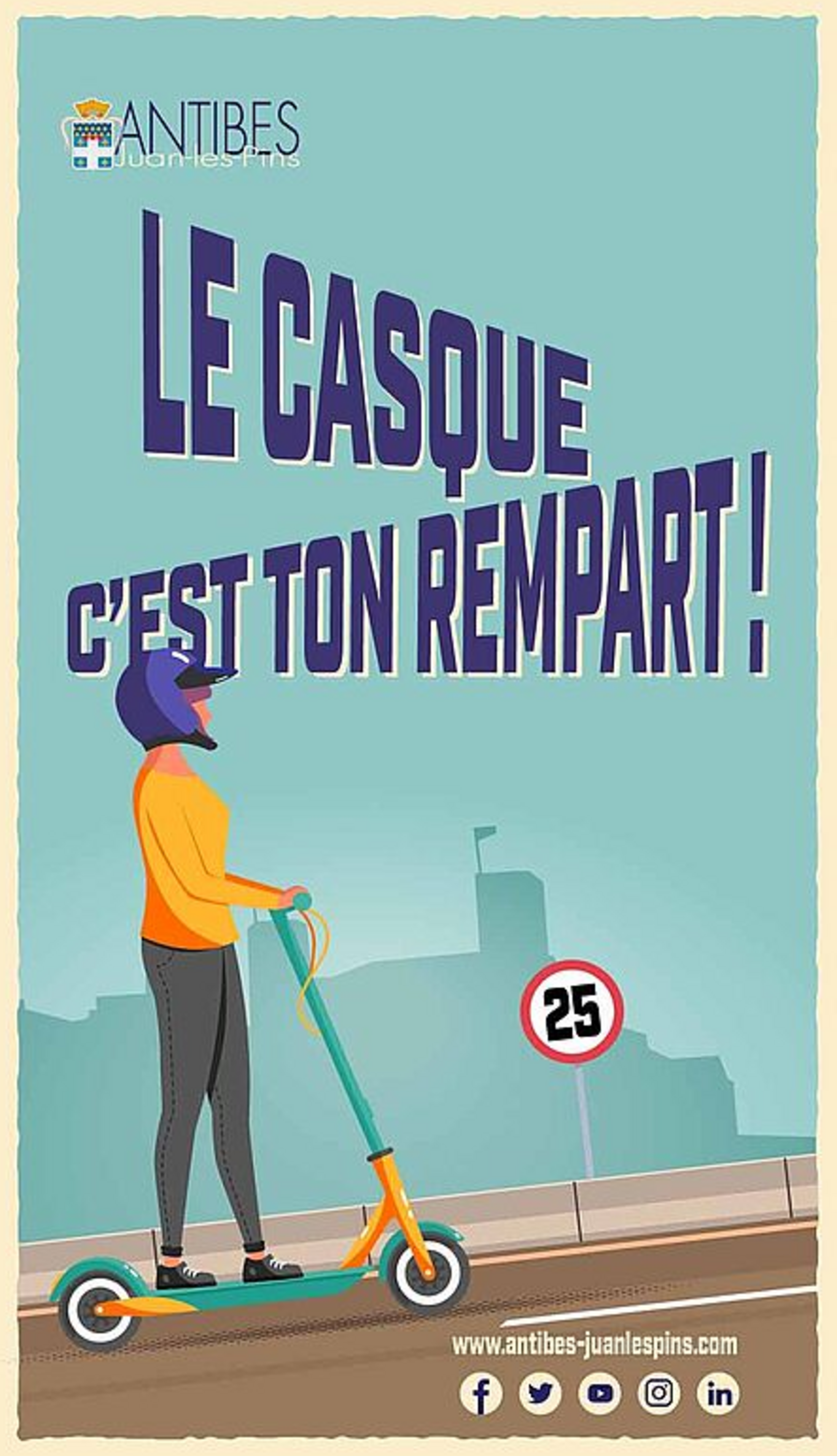
L’évocation des mobilités actives et/ou douces oriente toujours le regard vers les cœurs de villes et cœurs des agglomérations. C’est là qu’on trouve à la fois les concentrations de populations, les territoires denses et les hauts niveaux d’expertise privés et publics nécessaires aux politiques ambitieuses en matière de plateau piéton et de réseau cyclable. Nous avançons pourtant qu’il faut déplacer le chantier des mobilités douces des centres vers les couronnes et au-delà, vers les espaces ruraux.
Il faut d’abord accepter l’idée d’un rééquilibrage de l’effort d’innovation mobilitaire. Voilà cinquante ans que la totalité des innovations sont concentrées sur les espaces centraux. La liste est longue : les transports collectifs, les beaux lieux-mouvements, gares et autres lieux intermodaux, les applis et les sites, les réseaux piétons et cyclables, les associations et les boutiques de vente et d’entretien des vélos, toutes les signalétiques, etc. Ce n’est pas une exagération de dire que les couronnes et les espaces ruraux n’ont rien et d’autant moins que les cars et les trains ont été démantelés. Les Gilets Jaunes ont rappelé avec vigueur que l’équité doit aussi exister dans le champ de la mobilité. Bien sûr, « on peut toujours faire mieux » dans les espaces centraux : mieux aménager, mieux équiper, mieux interconnecter… On peut aussi partager.
Mais cette revendication du partage et du rattrapage repose sur deux autres arguments. D’abord un argument de développement durable. A quoi cela sert-il d’avoir des mobilités actives efficientes dans les centres d’agglomération si les périphériques et autres rocades sont embouteillées du matin au soir ? C’est bien sûr en amont de ces espaces qu’il faut opérer un transfert de la voiture vers d’autres modes. Le chantier est hautement complexe – raison de plus pour l’ouvrir sans tarder. Les couronnes et les territoires ruraux ne sont pas totalement démunis. Bien des bourgs ont d’ores et déjà déployé, sur le modèle des centres-villes, des espaces piétons et cyclables mais ceux-ci sont toujours réduits, concentrés autour de l’école maternelle et de la place de la mairie. Sitôt sorti du bourg, la voiture conserve sa position monopolistique. D’autres collectivités ont également commencé, avec différents moyens, de réserver des routes de campagne aux vélos ; dans les couronnes urbaines et les banlieues des itinéraires sont tracés à travers les ensembles résidentiels, les zones d’activités et les espaces verts. Il faut renforcer, systématiser et déployer partout ces initiatives pionnières. Pour ça, il faut du portage politique, il faut de l’argent bien sûr. Il faut surtout des experts dans les services des collectivités locales et des opérateurs divers et variés. C’est d’abord l’expertise qui fait défaut. Et si chaque collectivité ne peut recruter sur son budget propre les personnels nécessaires, la mutualisation sous forme d’agences de mobilité, sur le modèle des agences d’urbanisme ou de développement économique, offre une solution intéressante.
Le second argument au déploiement des modes actifs dans les couronnes et les espaces ruraux est d’ordre social. Faciliter la marche, le vélo et la trottinette électrique ou non ouvre des possibilités à un large ensemble d’habitants : des jeunes, des femmes, des personnes âgées mais aussi des actifs à condition de procéder de manière informée, sur la base d’enquêtes des fonctionnements des territoires – on retrouve la question de l’expertise. Les couronnes et les territoires peu denses ont leurs polarités : des écoles, des collèges, des entreprises, des espaces de sport… C’est à partir d’eux qu’il faut mailler les modes actifs peu à peu, en associant les acteurs, en accompagnant très finement les pratiques. Facile, difficile, là n’est pas la question. Mais on sait que ce sera long car tout est long en matière de mobilité. Mais l’avenir dure longtemps.
1 Chevallier M., Une liberté sous contraintes pour les personnes et ménages à faibles ressources. Automobilistes pauvres et automobilité de personnes à faibles revenus dans les agglomérations de Grenoble et de Lyon, 2002.
par William Élie, technicien de la mobilité et du tourisme en IDF
et Éric Le Breton, sociologue à Rennes 2




