Comme directeur de collection chez MkF Éditions, je suis régulièrement approché par des auteurs qui souhaitent me présenter leurs projets. Parfois, c’est moi qui leur suggère une idée ou qui partage avec eux une envie. À l’occasion d’un dîner au Café de l’Industrie avec mon ami Yves Winkin durant l’été 2021, je lui ai redit combien j’aimerais qu’il écrive enfin un livre sur le sociologue Erving Goffman dont il est un des plus éminents spécialistes. Un livre qui fêterait les 100 ans de sa naissance (1922) et les 40 ans de sa disparition (1982). Peut-être pas une biographie au sens fort. Mais un livre qui parle de lui. Yves s’est exécuté et quelques mois plus tard, il m’est revenu avec un texte ciselé sur Goffman en représentation ou en performance (si on voulait mobiliser une notion centrale de la terminologie goffmanienne). Le résultat est D’Erving à Goffman. Une œuvre performée ? qui vient de paraître. À l’occasion de sa sortie en librairie, je me suis entretenu avec Yves Winkin.
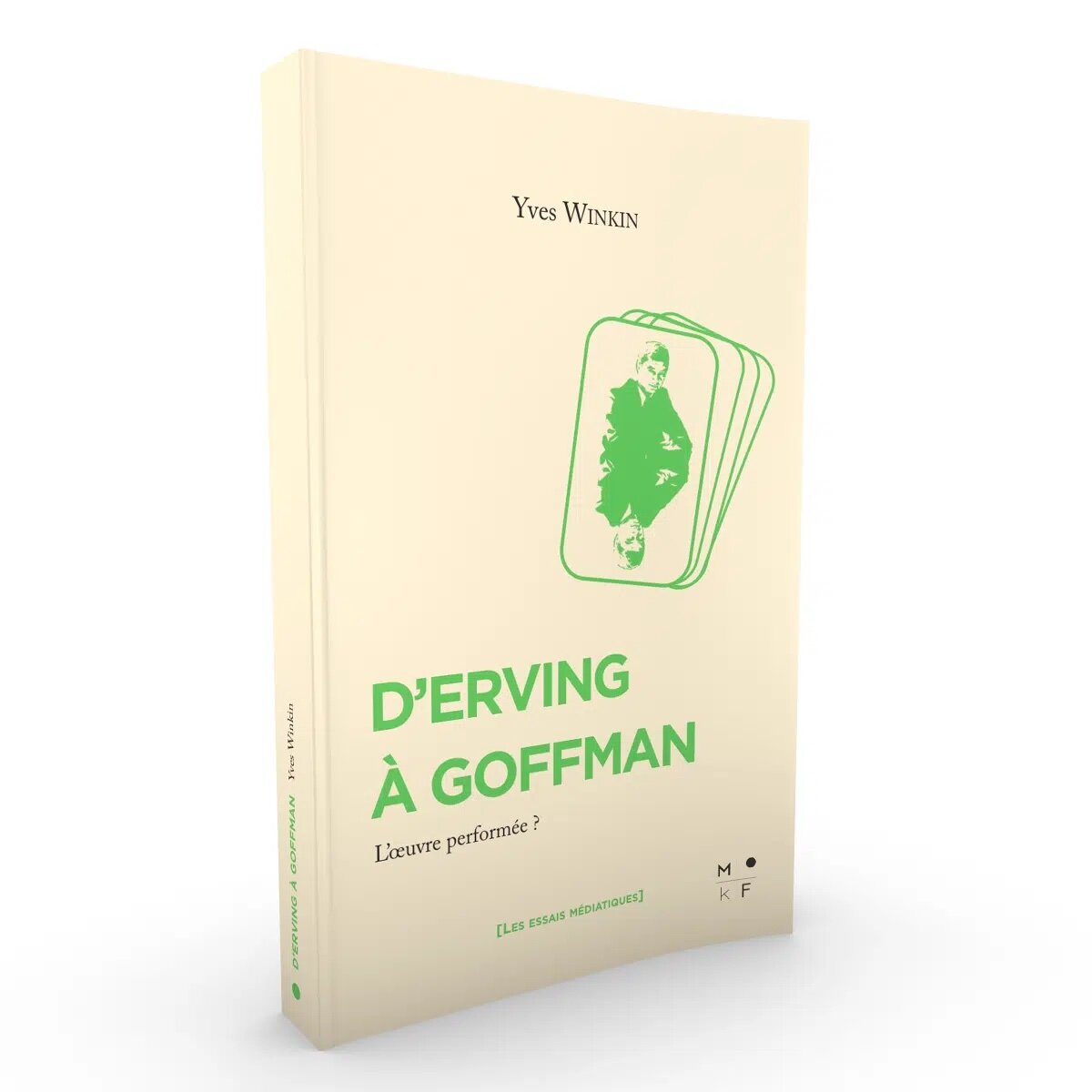
Agrandissement : Illustration 1
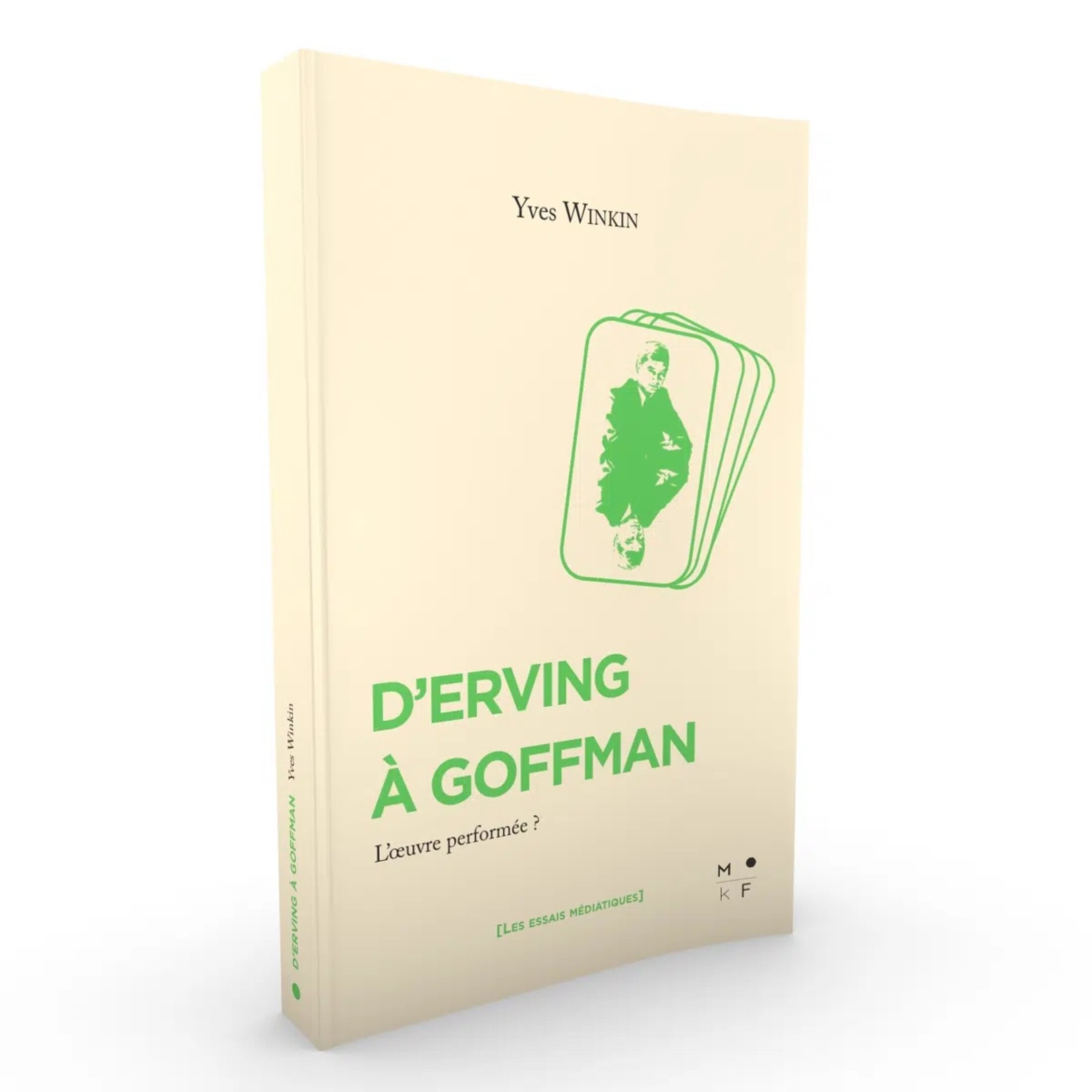
Michaël Bourgatte (MB) : Pour commencer, peut-on revenir sur le projet qui a conduit à l'écriture puis à la publication de ce livre ?
Yves Winkin (YW) : Il y a une raison circonstancielle : Goffman est né il y a cent ans et décédé il y a quarante ans. L’année 2022 est donc une année particulière pour les « études goffmaniennes ». Car ce terme existe bel et bien, du moins en anglais (Goffman Studies). L’éditeur anglais Routledge a sorti un Handbook of Goffman Studies[1] et l’éditeur allemand Metzler, un Goffman Handbuch[2]. Mais il y a pour moi une autre raison, plus personnelle. Je travaille depuis nombre d’années sur une biographie de Goffman. Je voulais faire un point d’étape : à la fois ramasser sa vie en un texte de synthèse, offrir de nouveaux horizons sur son œuvre orale, et réfléchir à l’ultime impossibilité de jamais finir une biographie. Trois livres en un, en quelque sorte, en veillant à ne jamais être trop lourd, à la fois dans le style et dans la réflexion. Sous peu, je me remettrai à la tâche, cette fois avec Greg Smith, mon collègue anglais. Il s’agira de proposer une biographie complète, non définitive bien sûr, avant le 150 ème anniversaire de la naissance de Goffman…
MB : Pourquoi vous être intéressé de la sorte et aussi intensément à Goffman tout au long de votre carrière ?
YW : Il y a une part rationnelle dans cette "quête" : Goffman est un des sociologues anglophones les plus étonnants du XXème siècle, par sa liberté de ton, par sa créativité intellectuelle, par l’intensité de ses terrains. Il méritait bien une biographie. Mais sa veuve savait qu’il n’en aurait pas voulu. Elle m’a donc très explicitement dit, dès 1983, qu’elle ne m’aiderait pas : pas d’entretiens, pas d’accès aux documents, etc. Et du coup, je me suis entêté, comme si je voulais relever un défi. C’est devenu un peu irrationnel, comme un collectionneur qui cherche toujours une pièce de plus. C’est cette "folie" qui m’a donné l’énergie pour une recherche qui dure depuis quarante ans. En même temps, je suis resté lucide, en veillant à ne pas faire une biographie purement chronologique et descriptive. Je voulais proposer une biographie construite, construite comme doit l’être tout objet scientifique. C’est en cela que la pensée de Bourdieu m’a servi de garde-fou.
MB : Puisque vous en parlez… Pierre Bourdieu a publié Goffman dans sa collection aux éditions de Minuit, ce qui a participé à sa mise en visibilité et à son succès en France. Comment l’a-t-il découvert ? Quelles relations avez-vous entretenues avec les deux hommes ?
YW : C’est Robert Castel, qui travaillait à l’époque entre Foucault et Bourdieu, qui a fait découvrir Asiles de Goffman à celui-ci[3]. Bourdieu a lancé la traduction dans sa collection et a demandé une introduction à Castel. Bourdieu a ensuite découvert l’ensemble de l’œuvre de Goffman lors de son séjour à l’Institute for Advanced Study en 1972. Il lui a alors rendu visite à Philadelphie et le courant est tout de suite passé entre eux. Bourdieu va d’abord proposer Goffman comme fellow à l’IAS (mais sa proposition sera rejetée avec perte et fracas, ce qui le secouera beaucoup). Il va ensuite lancer la traduction à jets continus de la plupart des livres de Goffman dans sa collection aux Editions de Minuit. Si bien qu’aujourd’hui encore, Goffman est le sociologue américain le plus traduit en français. Et Bourdieu reste le plus américain des sociologues français. Lorsque j’ai osé aborder Bourdieu à l’issue de son dernier séminaire de l’année 1975-76 pour lui dire que j’allais faire un master à l’Université de Pennsylvanie, il m’a dit d’aller voir Goffman, ce que j’ai fait, avec quelque appréhension. Mais Goffman m’a toujours bien reçu et j’ai ainsi assuré une sorte de "navette" entre lui et Bourdieu pendant quelques années. Bourdieu restait assez formel dans ses relations épistolaires avec Goffman, tandis que celui-ci se montrait prêt à être plus détendu (« Dear Pierre »).
MB : Est-ce que vous pouvez me dire un mot du tempérament de Goffman et du type d’échanges que vous avez eus avec lui ?
YW : Je n’ai pas assisté à son séminaire au cours de l’année 1976-77 parce que je voulais suivre celui de l’anthropologue Ray Birdwhistell, qui avait placé son enseignement exactement aux mêmes heures, le même jour. Mais Goffman m’a reçu à plusieurs reprises à son domicile, d’abord pour discuter de mon programme de cours, ensuite pour discuter de mon projet de mémoire de master, enfin pour discuter de son propre parcours. Des notes de ce dernier entretien ont été publiées après sa mort dans Actes de la recherche[4]. Il avait la réputation de s’énerver rapidement, et je dois avouer que je suis toujours resté sur mes gardes. Mais tout s’est toujours bien passé. Sauf au moment où j’ai par mégarde parlé d’interactionnisme symbolique à son propos. Sa réaction a été immédiate : « arrêtez de me mettre dans une case ! » (stop pigeonholing me). Je l’ai revu une dernière fois à Lyon en mai 1982 et j’ai assuré au pied levé la traduction de son intervention. Quand il m’a vu, il n’a manifesté aucune surprise. Au contraire, on aurait dit qu’il s’attendait à me voir : « Hi buddy ». On n’était plus dans un strict rapport professeur-étudiant.
MB : Entre Goffman et Birdwhistell, vous vous étiez initialement tourné vers Birdwhistell… Qu’est-ce qui vous a finalement attiré chez Goffman pour que vous lui consacriez une part si conséquente de votre vie et de vos travaux ?
YW : Birdwhistell était très spectaculaire, à la fois dans son expression et dans sa pensée. Je n’avais jamais entendu parler de la notion de communication en de tels termes. Je voulais lui consacrer un livre, mais personne n’en voulait en France. Pour réussir à le présenter, j’ai fait la concession dans mon premier livre, La Nouvelle Communication, de présenter deux écoles de pensée, celle de Philadelphie et celle de Palo Alto[5]. Au début des années 80, cette dernière commençait à avoir le vent en poupe en France, avec des auteurs comme Gregory Bateson et Paul Watzlawick, dont les Éditions du Seuil vont traduire plusieurs ouvrages. Mais pour moi, l’école de Philadelphie, avec Birdwhistell et Goffman, était bien plus excitante. Finalement, j’ai placé Birdwhistell au cœur de mon Anthropologie de la communication, et j’ai investi sérieusement dans une contextualisation de la pensée de Goffman[6]. Au fur et à mesure que j’avançais dans la collecte de matériaux, notamment des entretiens avec ses amis et ses collègues, une centaine au total, j’ai découvert une œuvre toujours plus complexe, plus audacieuse, plus subtile. Je me suis mis à son service et je ne suis pas encore près de rendre mon tablier.
MB : Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l’école de Philadelphie : son identité et ses éléments distinctifs ? La place particulière que Goffman y tient également ?
Le maître-mot de l’école de Philadelphie est celui d’ethnographie, non au sens traditionnel français de collecte de données "exotiques", mais dans le sens anglo-saxon contemporain de démarche "naturaliste", en quelque milieu que ce soit, fondée sur l’observation (participante ou non), aidée ou non par des enregistrements audio-visuels. Tandis que l’école de Palo Alto travaille essentiellement en milieu restreint (le plus souvent le cabinet du psychiatre), afin de soigner des personnes ou des familles qui en ressentent le besoin, l’école de Philadelphie veut évoluer "in vivo", avec une finalité qui n’est pas d’abord thérapeutique mais scientifique. Sans doute, les observations dans les écoles, par exemple, peuvent conduire à des recommandations concrètes en matière de pédagogie, mais le but premier n’est pas le soin. Goffman est au cœur de cette pratique de l’ethnographie (lui-même emploie plutôt le mot fieldwork, mais peu importe) : il m’a ainsi recommandé de prendre un cours d’observation au zoo de Philadelphie. L’école de Philadelphie repose sur quelques foyers à l’université de Pennsylvanie (le département de folklore, le département de linguistique, l’Annenberg School of Communications) et à l’université Temple (le département d’anthropologie). Elle brille de tout son éclat au cours des années 1970, puis s’étiole avec le départ de grandes personnalités comme Dell Hymes, qui irrigue successivement de sa puissance intellectuelle le département d’anthropologie, le département de folklore puis l’école des sciences de l’éducation de l’université de Pennsylvanie. Il forme un binôme particulièrement percutant avec Goffman tout au long des années de celui-ci à Philadelphie (1968-1982).
MB : Quels sont les apports essentiels de Goffman à cette école ? Les faits les plus marquants dans son travail qui puissent être associés à cette école ?
YW : Au début des années 70, Goffman se consacre à la publication de livres en gestation depuis les années 60 : Strategic Interaction, Relations in Public, Frame Analysis[7]. Puis il va se lancer sur deux terrains nouveaux, stimulé par ses pairs au sein de ce qu’on peut appeler l’école de Philadelphie. D’une part, il va étudier un corpus d’images publicitaires dont sortira Gender Advertisements[8]. On peut y voir son intérêt pour l’anthropologie visuelle, représentée par Sol Worth à Penn, par Jay Ruby et Richard Chalfen à Temple. D’autre part, il va s’investir dans l’analyse de plus en plus "pointue" des interactions verbales, qu’il présentera dans son dernier livre, Forms of Talk[9]. On peut y voir la présence d’un petit cercle d’interlocuteurs : l’anthropologue Dell Hymes, bien sûr, mais aussi le linguiste Bill Labov, avec qui il animera des séminaires et une autre linguiste, Gillian Sankoff, qui deviendra son épouse. Si l’on doit résumer son apport à cette école de Philadelphie d’un mot, c’est celui de pontage entre l’ethnographie de la parole proposée par Hymes et la sociolinguistique variationniste élaborée par Bill Labov. Tous les trois restent fidèles à des collections de données langagières sur le terrain. On reste dans le paradigme ethnographique. Alors qu’on pourrait penser que Goffman est entré en conflit avec l’analyse conversationnelle de Sacks, Schegloff et consorts, il me paraît qu’il faut d’abord le voir comme entré en dialogue avec les sociolinguistes et les anthropologues du langage de l’université de Pennsylvanie.
MB : Vous me dites là que Goffman a marqué de son empreinte l’école de Philadelphie par son analyse des interactions langagières ou verbales, mais Goffman n’est-il pas aussi le spécialiste des interactions corporelles et physiques ?
YW : Je parle bien du dernier Goffman, celui qui a effectivement réduit la voilure en se concentrant sur les interactions verbales. C’est ce qui caractérise son travail au sein de cette école de Philadelphie, par opposition à son travail antérieur au sein de ce qu’on appelle la seconde École de Chicago. Dans les années 50 et 60, Goffman évoque tout autant les interactions non-verbales que les interactions verbales. On se souvient, dans Behavior in Public Places (en français : Comment se conduire dans les lieux publics), qu’il écrivait que le corps ne pouvait pas se taire[10]. Dix bonnes années plus tard, le corps s’est apparemment tu, et Goffman se concentre sur les seules interactions verbales. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à prôner une méthodologie fondée sur l’observation, à l’exclusion d’une approche par entretiens. Sa dernière doctorante à l’université de Pennsylvanie, Carol Brooks Gardner, a écrit ainsi que Goffman lui interdisait de mener des entretiens avec les jeunes filles qu’elle observait en train de circuler dans l’espace public.
MB : Dans votre livre, vous vous intéressez à la performance goffmanienne, au Goffman performer, à cet homme qui se met en scène lorsqu’il est en conférence. Quelle place, quel équilibre, quelle relation avez-vous donné à la question du verbal et à celle du non-verbal chez Goffman dans votre écriture ?
YW : J’avais en fait très peu de données à ma disposition, sinon quelques photos, que j’ai insérées dans le livre, mes souvenirs des quelques prestations publiques de Goffman auxquelles j’avais pu assister entre 1976 et 1982, et quelques commentaires dispersés ici et là dans les entretiens que j’ai menés depuis fin 83. Mais Goffman lui-même a laissé un texte assez fabuleux, sous-utilisé alors qu’il est publié dans son dernier livre, Forms of Talk (en français : Façons de parler) : c’est « La conférence », issu d’une conférence qu’il a donnée en 1977 sur le thème de la conférence[11]. Goffman, en conférencier expérimenté, livre là mille et un petits détails sur l’articulation entre le verbal et le non-verbal, mais il faut parfois les saisir au vol. Ainsi, il va parler du conférencier qui « descend de son cheval » pour faire un aparté. L’image est superbe, parce qu’elle parvient à rendre ce mouvement, fait de verbal et de non-verbal entremêlés, que produit un conférencier lorsqu’il mime la confidence envers son public (il enlève ses lunettes, par exemple, tout en changeant de ton et de niveau de voix). Au travers de l’emploi de cette image apparemment toute simple, le performer Goffman montre ainsi toute la maîtrise de son art.
MB : Vous qui avez côtoyé Goffman, qui avez lu ses textes, mené des entretiens avec ceux qui l’ont connu… Diriez-vous qu’il y a un Goffman privé et un Goffman public ou est-ce autre chose qui se joue ?
YW : C’est autre chose. Il y a un Goffman intensément privé, qui refuse d’être photographié sans son accord (qu’il donne rarement) et il y a un Goffman qui ose faire des performances publiques, très calibrées et très maîtrisées, au cours desquelles il met se en scène. Mais il y a aussi le Goffman de la « Folie dans la place », un texte incroyablement personnel, qu’on n’aurait jamais attendu d’un auteur qui a toujours refusé de se révéler, que ce soit dans son œuvre ou lors d’entretiens. Cet article a été donné à la revue Psychiatry, dont Goffman connaissait bien la secrétaire de rédaction (en français, le texte se trouve tout au bout du livre la Mise en scène de la vie quotidienne, tome 2 : les Relations en public)[12]. On a rapidement compris que Goffman parlait, sans la nommer, de la descente de sa femme dans un état maniaco-dépressif très grave, et de la façon dont il tentait de gérer la situation. Sans prétendre connaître toute la littérature, je dirais que seul Goffman a osé aller aussi loin dans l’autoethnographie. Apparaît ainsi en public un Goffman très privé, qui est aussi un Goffman très émouvant.
Références :
[1] Jacobsen, Michael H. & Smith, Greg (Eds.), The Routledge international handbook of Goffman studies. Abingdon (UK), Routledge, 2022.
[2] Lenz, Karl & Hettlage, Robert (Hg.), Goffman Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, Berlin, J.B. Metzler, 2022.
[3] Goffman, Erving, Asylums, 1961, traduction française : Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968.
[4] Winkin, Yves, “Entretien avec Erving Goffman », Actes de la recherche en sciences sociales, N°54, 1984, pp. 85-87 ; repris dans Erving Goffman, Les Moments et leurs hommes, Paris, Editions du Seuil/Editions de Minuit, 1988, pp. 280-288 (Edition « Points » N°797).
[5] Winkin, Yves, La Nouvelle Communication, Paris, Editions du Seuil, 1981 (Edition « Points » N°136).
[6] Winkin, Yves, Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Paris, Editions du Seuil, 2001 (Edition « Points » N°448).
[7] Goffman, Erving, Strategic Interaction, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1969. Pas de traduction française ; Goffman, Erving, Relations in Public (1971) ; traduction française : La Mise en scène de la vie quotidienne, tome 2 : Les Relations en public, Paris, Editions de Minuit, 1973 ; Goffman, Erving, Frame Analysis (1974) ; traduction française : Les Cadres de l’expérience, Paris, Editions de Minuit, 1991.
[8] Goffman, Erving, Gender Advertisements, New York, Harper & Row, 1979 ; traduction française partielle dans Erving Goffman, Les Moments et leurs hommes.
[9] Goffman, Erving, Forms of Talk (1981) ; traduction française : Façons de parler, Paris, Editions de Minuit, 1987.
[10] Goffman, Erving, Behavior in Public Places (1963) ; traduction française : Comment se conduire dans les lieux publics, Paris, Economica, 2013.
[11] Goffman, Erving, « La conférence », in Façons de parler, Paris, Editions de Minuit, 1987.
[12] Goffman, Erving, « La folie dans la place, in La Mise en scène de la vie quotidienne, tome 2 : Les Relations en public, Paris, Editions de Minuit, 1973.



