Bien que la Lune soit l’astre le plus proche de nous, elle conserve encore une bonne dose d’inconnu. Même l’explication de son origine n’est pas une question définitivement résolue, comme l’ont constaté les spécialistes réunis lors d’un récent symposium à Londres, dont un compte rendu est publié par Science. Les participants à cette réunion ont réexamoné la théorie qui a aujourd’hui la faveur des astronomes : celle de « l’impact géant », selon laquelle la Lune serait issue d’une collision entre la Terre et une planète de la taille de Mars ; ce choc, qui se serait produit quelque dizaines de millions d’années après la naissance du système solaire, aurait pulvérisé les deux astres et dispersé les fragments dans l’espace proche ; puis la Terre se serait reconstituée, et aurait été entourée d’un disque de débris qui, par accrétion, aurait finalement formé la Lune.
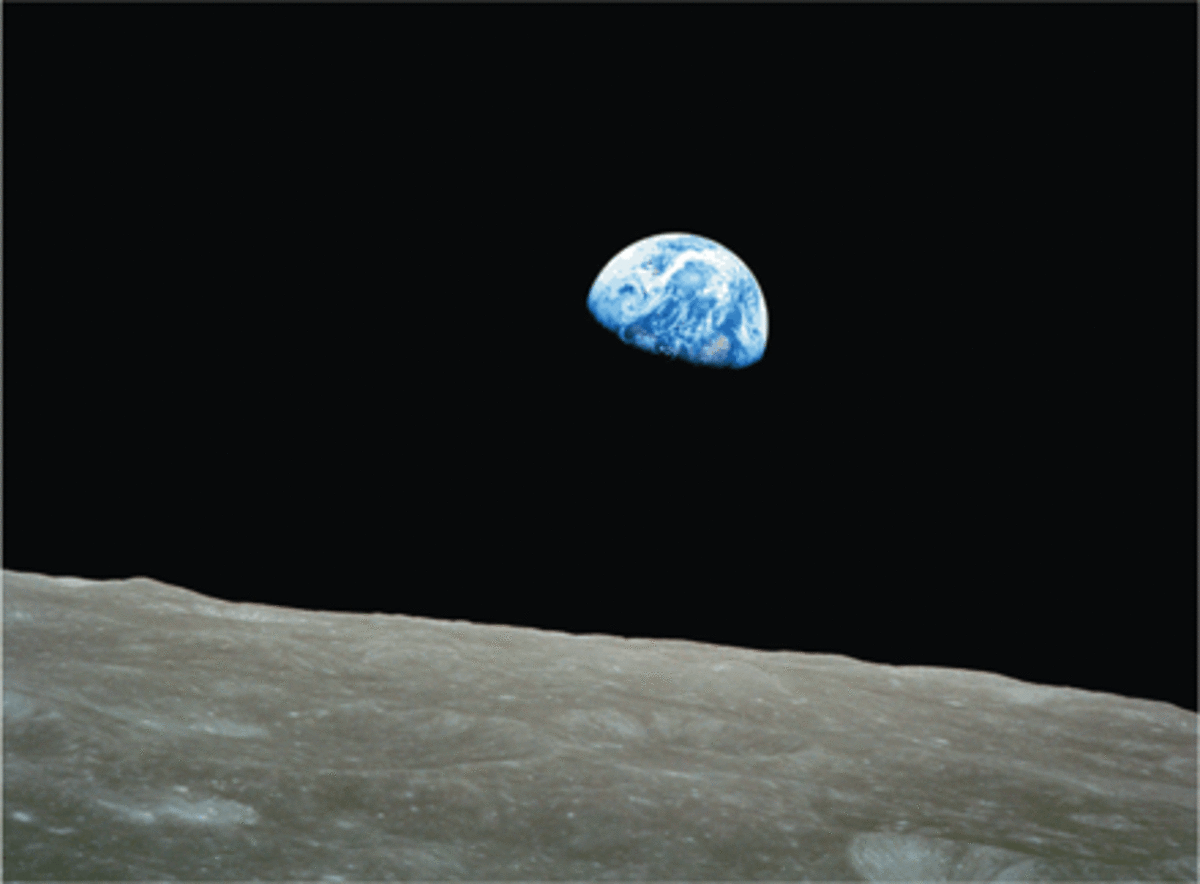
La théorie de l’impact géant a été avancée en 1975. Bien qu’un peu surprenante, elle est apparue plausible : le système solaire à ses débuts contenait une multitude de protoplanètes qui auraient pu frapper la Terre ; et un choc avec un corps céleste d’environ un dixième de la masse terrestre aurait suffi à disperser assez de matière dans l’espace pour former la Lune. La théorie a été confortée par les analyses effectuées sur les 382 kilos de roches lunaires recueillies au cours des missions Apollo. Elles ont montré que la Lune était à peine plus jeune que la Terre, et que la répartition des isotopes de l’oxygène et d’autres éléments était presque la même dans les roches lunaires et dans les roches terrestres. Au contraire, on observe de grande différences de répartition isotopique entre les météorites venant de diverses régions du système solaire.
Ces observations s’accordaient avec un impact géant survenu peu après la formation de la Terre ; les scientifiques pensaient qu’au cours de l’impact, les matériaux de la Terre et ceux de la planète qui l’avait percutée s’étaient mélangés. Il était donc logique de retrouver des similarités chimiques entre la Terre et son satellite, formé avec les débris de la collision.
Qui plus est, les observations du programme Apollo montraient que la Lune avait été très chaude dans son jeune âge, ce qui était aussi en accord avec la théorie de l’impact géant. Cette théorie a donc été adoptée par les astronomes, qui l’ont consacrée en 1984, à l’occasion d’un colloque tenu à Kona, à Hawaii.
Tout allait donc pour le mieux, jusqu’au moment où des chercheurs ont tenté de simuler l’impact géant sur ordinateur. Ainsi, une simulation très précise réalisée en 2004 au Southwest Research Institute à Boulder, Colorado, a montré que si le scénario était juste, la Lune aurait dû être composée à plus de 80% du matériau issu de l’impacteur. Et par conséquent, elle n’aurait pas due être aussi proche chimiquement de la Terre, sauf à supposer que la Terre et l’impacteur aient eu la même composition.
Cela nécessiterait que la Terre et l’impacteur se soient formés dans des conditions similaires et dans la même région du système solaire. Mais même en admettant cela, la Terre étant beaucoup plus massive que l’impacteur, elle devrait rassembler des matériaux provenant d’une zone plus étendue. Et de ce fait, il devrait exister des différences de composition entre elle et l’impacteur. Par conséquent, la ressemblance chimique entre la Terre et la Lune pose un sérieux problème à la théorie de l’impact géant.
Comme on l’a vu, le problème vient de ce que les observations sur les météorites ont montré que la répartition des isotopes variait fortement d’une région à l’autre du système solaire. Cette impression résulte en grande partie du fait que les météorites martiennes présentent une répartition isotopique en oxygène très différente de celle des roches terrestres et lunaires. Mais Mars est un cas un peu particulier, et il est possible qu’en-dehors de la planète rouge, les variations isotopiques soient moins importantes dans l’ensemble du système solaire.
Une manière de tester l’hypothèse serait d’analyser une roche provenant de Vénus, la « sœur jumelle de la Terre ». Ensemble, la Terre et Vénus contiennent 80% de la matière qui se trouve entre le soleil et la ceinture d’astéroïdes. Si la composition isotopique de Vénus est proche de celle de la Terre, il est beaucoup plus plausible qu’un impacteur ressemble aussi chimiquement à notre planète.
Mais comment recueillir un échantillon de roche vénusienne ? La surface de cette planète a une température de 500°C et la pression qui y règne est 92 fois celle de l’atmosphère terrestre. A moins de découvrir une météorite vénusienne… mais la méthode pour l’identifier n’est pas encore au point.



