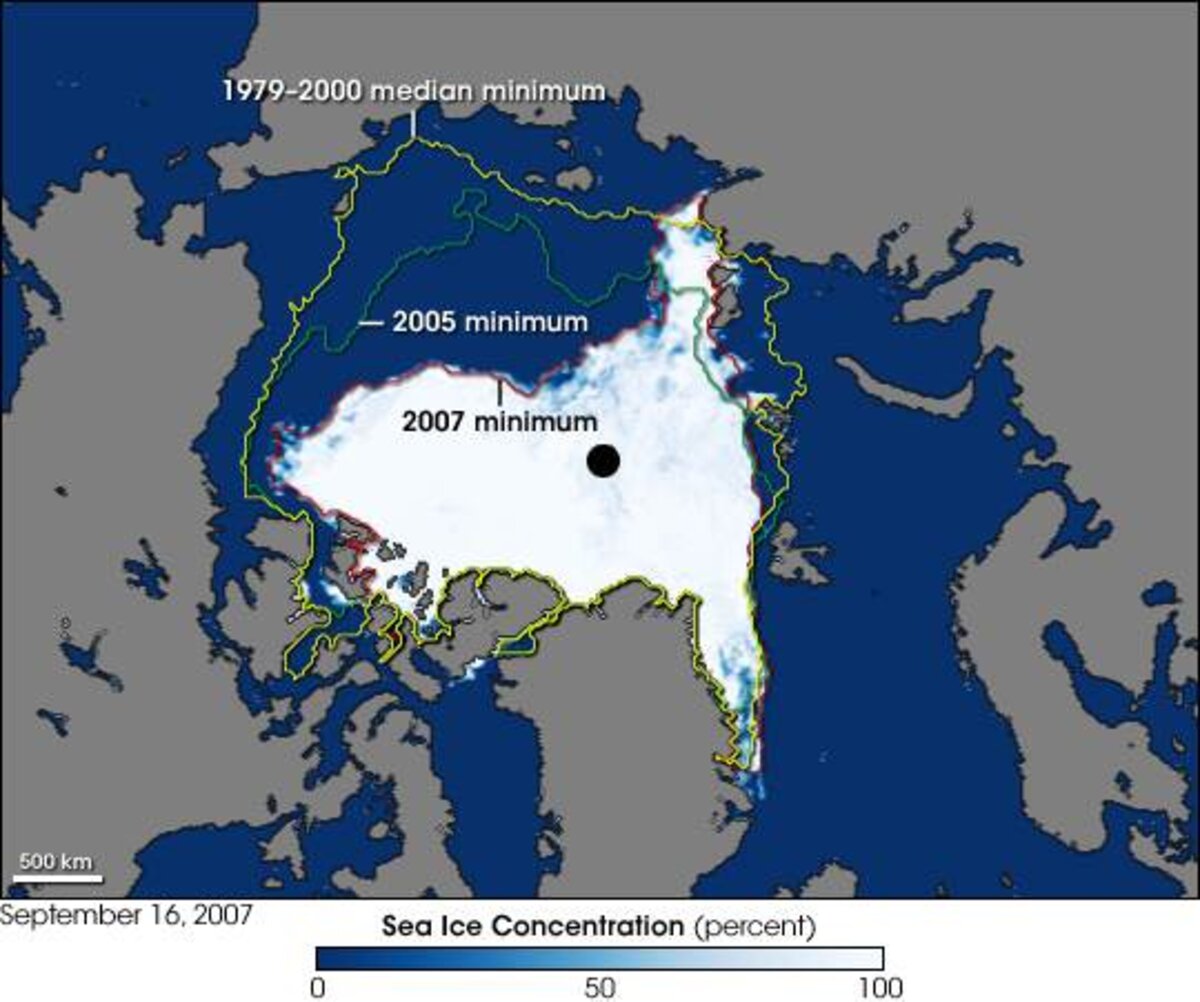
Les modèles climatiques nous permettent de savoir que d’ici 50 ou 100 ans, la planète sera dans l’ensemble plus chaude, le niveau des océans plus élevé et les calottes glaciaires moins abondantes. Les prévisions météo nous indiquent de manière assez fiable la couleur du ciel à une échéance d’une ou deux semaines. Mais peut-on prévoir le temps qu’il fera à une échelle intermédiaire ? Savoir, par exemple, si 2018 nous réserve un été pourri ou s’il y aura de la neige à Noël en 2022 ?
Selon un article paru tout récemment dans la revue Nature, nous sommes entrés dans l’air de la prévision climatique à dix ans, qui pourrait permettre « à l’humanité de se préparer à la décennie à venir, comme les météorologues aident les gens à choisir leurs vêtements pour la journée. » La modélisation du climat à l’échelle de quelques années intéresse un nombre croissant de chercheurs, même si elle se heurte encore à de grandes difficultés. Une quinzaine d’équipes dans le monde ont effectué des modélisations destinées à prévoir l’évolution du climat à une échelle de dix ans. Ces travaux seront intégrés au prochain rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat), dont la première partie doit être publiée en septembre prochain.
L’un des premiers scientifiques à s’être intéressé à ce nouveau domaine est le Britannique Doug Smith, du Centre météorologique Hadley à Exeter (Royaume-Uni). Depuis 2007, il a développé un système de prévisions climatiques décennales, DePreSys. A l’époque, Smith et ses collègues ont publié des prévisions détaillées de l’évolution du climat pour les dix années à venir. D’après les calculs de l’équipe britannique, le réchauffement global devait accélérer rapidement et entraîner des records de chaleurs en quelques années.
Pour établir ces prévisions, l’équipe de Smith a hybridé l’approche des modèles climatiques standards avec celles des météorologues. Les projections climatiques à long terme visent à décrire les grandes tendances du climat, et s’appuient sur des données anciennes, souvent largement antérieures à l’ère industrielle. A l’inverse, les météorologues partent du présent et multiplient les simulations à partir de conditions initiales légèrement différentes ; cela permet d’obtenir un éventail de résultats statistiquement valides, bien que l’évolutiuon du temps soit un phénomène intrinsèquement chaotique.
Smith et ses collègues ont appliqué une méthode similaire, mais sur une échelle de temps plus longue. Ils ont rassemblé un ensemble de mesures climatiques concernant la température de l’air, la vitesse et la direction des vents, la pression atmosphérique, la température et la salinité de l’océan, et cela pour vingt jours de l’année 2005. Ils ont alors initialisé le modèle climatique utilisé par le Centre Hadley avec ces données de 2005, et ils ont fait « tourner » le modèle sur une décennie.
L’idée était intéressante, mais elle n’a pas très bien marché. Le modèle de Smith a donné des prévisions correctes pour 2008, mais le réchauffement spectaculaire qu’il annonçait ne s’est pas produit. Il s’agit d’ailleurs d’un constat général : bien que l’activité humaine introduise de plus en plus de gaz à effets de serre dans l’atmosphère, la température moyenne de la planète n’a guère augmenté depuis une décennie. Certes, on a enregistré 1998 et aujourd’hui les dix années les plus chaudes de l’histoire. Mais le climat planétaire semble avoir atteint une sorte de plateau, et le réchauffement ne s’accélère plus.
Il existe au moins deux pistes pour expliquer ce plateau : d’une part, les variations naturelles ; d’autre part, le rôle des océans, qui absorbent peut-être plus de chaleur qu’on ne le croit. Si l’atmosphère contrôle en grande partie les variations météorologiques quotidiennes, les océans ont une forte influence à l’échelle d’une année ou plus. Mais leur action sur le climat est complexe et difficile à modéliser.
En 2008, un groupe de climatologues conduit par Noel Keenlyside (université de Bergen, Norvège) a réalisé une modélisation intégrant les effets de la température de surface de l’Atlantique. Le modèle prédisait que d’ici 2030, la circulation d’eaux chaudes entre les tropiques et l’Atlantique-nord allait ralentir. Il en résultait une stabilisation ou même un refroidissement des températures pour les années à venir.
Cette prédiction a été fortement contestée, et a suscité une polémique très médiatisée sur le point de savoir si le réchauffement global s’était arrêté. Peu après sa publication, l’étude a été critiquée par Stefan Rahmsdorf, océanographe à Postdam, en Allemagne, qui a parié 5 000 euros que les prédictions de Keenlyside ne se réaliseraient pas. Sagement, Keenlyside n’a pas relevé le défi : de fait, les températures ont été plus élevées qu’il ne l’avait prédit.
Malgré ces échecs, les chercheurs poursuivent leurs efforts pour modéliser l’évolution climatique à court terme, et commencent à mieux comprendre les paramètres à prendre en compte, principalement le rôle des océans. Il semble de plus en plus plausible que ces derniers, notamment l’Atlantique et le Pacifique tropical, ont ralenti le réchauffement en absorbant une grande quantité de chaleur dans leurs eaux profondes. Mais il reste beaucoup de travail à faire avant que les modèles décennaux aboutissent à des prédictions correctes. Les spécialistes eux-mêmes estiment qu’il faudra sans doute dix ans de mise au point avant que cette recherche se révèle payante. Dans dix ans, on pourra prédire s’il y aura de la neige à Noël en 2033.



