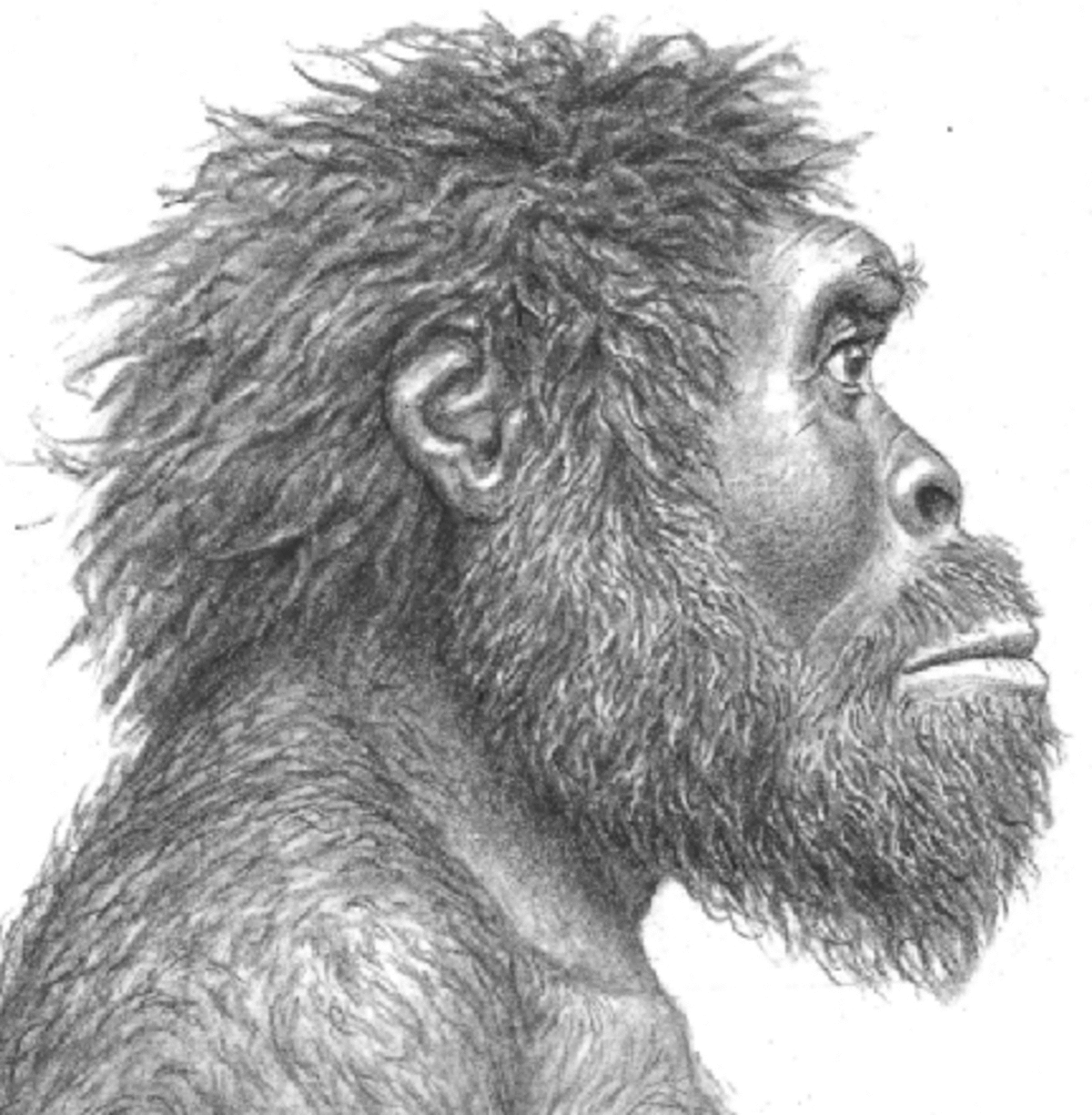
C’est une découverte paléontologique majeure : un crâne du genre Homo, vieux de 1,8 millions d’années, exhumé à Dmanisi, en Géorgie, présente des ressemblances frappantes avec les plus anciens Homo erectus africains. Ce fossile, le crâne d’humain primitif le plus complet jamais retrouvé à ce jour, pourrait conduire à réviser l’histoire ancienne de l’humanité. Dans le sens de la simplification. La généalogie traditionnelle de notre espèce passe par une série d’embranchements : Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo ergaster… David Lordkipanidze, le découvreur du crâne géorgien, et ses collègues proposent une histoire plus simple, dans laquelle tous les Homo se représenteraient pas des espèces différentes, mais des variations au sein d’une lignée commune, qui serait apparue en Afrique et se serait répandue très tôt en Europe et en Asie.

Agrandissement : Illustration 2

Chercheur au Muséum national de Géorgie, David Lordkipanidze a étudié le crâne avec Marcia Ponce de Leon et Christoph Zollikofer, de l’Institut d’anthropologie de Zurich. Leur étude est présentée dans la revue Science du 18 octobre. Le fossile a été retrouvé dans une tanière de carnivore, où il a probablement été enterré par un tigre à dents de sabre ou un machérode. Sa première caractéristique intéressante tient à ce qu’il est pratiquement complet. Il permet de voir comment le visage (mâchoire comprise) était orienté par rapport à la boîte crânienne. Lorsqu’ils l’ont examiné, les chercheurs ont été frappés par le fait que ce crâne avait un aspect primitif : une mâchoire supérieure saillante, simienne, et une petite boîte crânienne, capable de loger un cerveau à peine plus grand que celui d’un australopithèque.
Pourtant, il s’agissait indiscutablement d’un représentant du genre Homo. Le site géorgien de Damnisi abrite les plus anciens fossiles d’humains primitifs en-dehors de l’Afrique. Nos ancêtres vivaient dangereusement : sur le même site et à très peu de distance du lieu où Lordkipanidze a découvert son fameux fossile, on a retrouvé quatre autres crânes d’Homo, eux aussi dans des tanières de grands carnivores. Cette circonstance exceptionnelle a permis aux chercheurs de comparer les cinq crânes, notamment à l’aide de méthodes numériques en 3D.
Ils en ont conclu que les cinq crânes appartiennent à la même espèce, bien qu’ils présentent des différences morphologiques assez importantes. En effet, le degré de différence entre ces crânes n’est pas plus important que ce que l’on trouve si l’on compare les variations morphologiques entre des humains actuels.

Tout en faisant partie d’une espèce unique, les cinq crânes présentent d’importantes différence de taille et de morphologie. Le « crâne 5 », celui qui nous intéresse ici, a un côté plus primitif, comme on l’a vu : la boîte crânienne est plus petite, et il ressemble au plus ancien fossile d’Homo connu, un Homo habilis de 2,3 millions d’années retrouvé en Ethiopie. D’après les calculs des chercheurs, le possesseur du « crâne 5 » devait mesurer entre 1,46 et 1,66 m et peser de 47 à 50 kilos. Il avait une petite tête mais, par sa taille, il aurait quasiment pu être un homme moderne, quoique petit.
Le « crâne 5 » a aussi des points communs avec des Homo erectus,moins anciens que le fossile éthiopien. Et les autres crânes de Dmanisi sont moins primitifs. Ce qui conduit à l’idée que dans la même espèce, les variations morphologiques peuvent faire que certains individus aient un aspect plus « primitif » que d’autres. Mais lorsqu’on trouve dans deux sites différents deux fossiles dont l’un paraît plus primitif que l’autre, on a tendance à les classer dans deux espèces, et à supposer que celle du plus primitif est la plus ancienne.
A l’inverse, Lordkipanidze et ses collègues pensent que les différentes espèces d’Homo pourraient représenter simplement l’éventail des variations à l’intérieur d’une lignée unique. Ce que conforte l’analyse de la forme des crânes de Dmanisi effectuée par Marcia Ponce de Leon et Christoh Zollikofer : elle montre que les cinq crânes présentent autant de variation entre eux que les fossiles africains habituellement classés dans les trois espèces erectus, habilis, et rudolfensis.
Marcia Ponce de Leon, interrogée par Science, observe que si les fossiles de Dmanisi, au lieu d’être découverts côte à côte, avaient été retrouvés sur des sites différents en Afrique, ils auraient pu être classés dans des espèces différentes. En poursuivant le raisonnement, si les Homo habilis, erectus et autres rudolfensis avaient été découverts ensemble, on les aurait peut-être regroupé dans la même espèce.
Ainsi, la situation d’exception offerte par le site de Dmanisi, où coexistent cinq membres de la même espèce, offre-t-elle une nouvelle perspective sur les Homo anciens. Pour Lordkipanidze et ses collègues, la diversité morphologique observée chez les fossiles d’Homo africains remontant à environ 1,8 millions d’années représente simplement les variations au sein d’une même espèce, Homo erectus. La ressemblance entre les fossiles de Dmanisi et ceux d’Afrique plaide en faveur d’une continuité génétique entre les humains primitifs africains et ceux d’Eurasie.
Cela revient à dire qu’assez tôt après son apparition en Afrique, Homo erectus a commencé à rayonner en Europe et en Asie. Cette expansion précoce du genre Homo n’a pas nécessité une étape préliminaire d’augmentation de la taille du cerveau : apparemment, les premiers Homo erectus étaient déjà assez évolués pour voyager d’un continent à l’autre. Ils sont sortis d’Afrique, se sont établis en différents points d’Europe et d’Asie, puis ont continué à évoluer, à migrer et à se mélanger entre populations, bien longtemps avant l’apparition des hommes modernes. Nous descendons tous d'Homo erectus, par des chemins multiples qui restent à découvrir.



