
Le sourire énigmatique de Mona Lisa a fait couler des fleuves d’encre. Mais même si l’on a souvent qualifié l’expression de la Joconde d’indéfinissable, tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il s’agit bien d’un sourire. Ce qui tendrait à suggérer que les expressions du visage constituent un langage universel, compréhensible par tous les êtres humains, au-delà de leurs différences culturelles.
Cette hypothèse d’universalité a été formulée pour la première fois en 1872 par Charles Darwin dans L’expression des émotions chez l’homme et les animaux, que l’on peut considérer comme l’un des ouvrages fondateurs de l’éthologie.
«Le même état d’esprit s’exprime dans le monde entier avec une uniformité remarquable ; et ce fait est en soi intéressant en tant que témoignage et preuve de l’étroite similitude de la structure corporelle et de l’organisation mentale de toutes les races humaines », écrit Darwin.
A la fin des années 1960, le psychologue américain Paul Ekman a reformulé l’hypothèse de Darwin sous une forme plus schématique. Selon Ekman, il existe six émotions élémentaires qui s’expriment de la même manière dans toutes les cultures humaines : le bonheur, la surprise, la peur, le dégoût, la colère et la tristesse.
Cette idée, qui a remporté un grand succès, vient d’être remise en cause par l’équipe écossaise de la psychologue Rachael Jack (université de Glasgow). Dans une étude publiée par Pnas, la revue de l’académie des sciences des Etats-Unis, Rachael Black et ses collègues montrent que les expressions du visages ne sont pas universelles : les auteurs ont comparé les réactions de trente observateurs, quinze Européens et quinze Chinois, à des expressions faciales élémentaires visualisées sur un écran d’ordinateur.
La conclusion est claire : il y a une différence entre les deux groupes, même si elle est assez subtile. Lorsque les Européens regardent un visage exprimant le dégoût ou la colère, ils s’intéressent davantage aux mouvements de la bouche, alors que les Chinois sont plus attentifs aux yeux.
Ce n’est pas tout. L’équipe écossaise a modélisé les expressions élémentaires avec un programme informatique, et les a déclinées en 4800 visages virtuels, 800 pour chaque émotion élémentaire. Les observateurs européens et chinois ont été invités à classer les visages virtuels selon l’émotion qu’ils exprime et le degré d’intensité de cette émotion (sur une échelle à cinq degrés allant d’une intensité « très basse » à « très haute »).
Si les six émotions étaient réellement universelles, les deux groupes d’observateurs devraient retrouver les même six catégories, avec des niveaux d’intensité similaires pour chaque expression. Or, ce n’est pas ce que l’on constate. Les Européens retrouvent bien les six catégories ; les Chinois, eux, s’accordent sur les sourires, mais ne retrouvent pas clairement les catégories correspondant à la surprise, la peur, le dégoût ou la colère.

Le sourire de la Joconde serait donc bien universel… mais pas les six émotions de base définies par Ekman. Selon Rachael Jack, le répertoire d’émotions élémentaires des Chinois pourrait comporter d’autres expressions de base comme celle de la honte, de la fierté ou de la culpabilité.
Quoi qu’il en soit, ce qui est remis en cause, c’est l’idée que l’expression des émotions est entièrement déterminée par la biologie. Dans l’espèce humaine, elle a manifestement une composante culturelle. Faut-il en conclure que Darwin se trompe lorsqu’il affirme que « le même état d’esprit s’exprime dans le monde avec une uniformité remarquable » ?
Darwin s’est pourtant appuyé sur une enquête poussée. Il a demandé à des correspondants dans le monde entier d’aller observer les expressions faciales dans les peuples les plus divers, des Fuégiens aux Malais en passant par les habitants de Calcutta, les Cafres ou les Fingos. Les observateurs devaient apporter la réponse à un questionnaire en seize points, méticuleusement formulé, comme l’illustre la question n°10 :
« Le dégoût se manifeste-t-il en abaissant la lèvre inférieure et en retroussant légèrement la lèvre supérieure, avec une brusque expiration, comme dans un début de vomissement ou dans un crachement ? »
Malgré son souci du détail, Darwin n’a pas discerné les nuances entre les cultures humaines. Par exemple, dans la question n°16, il demande si l’on hoche la tête de haut en bas en signe d’affirmation, et de droite à gauche en signe de négation. Il suffit d’avoir séjourné au Liban pour savoir que la négation peut s’exprimer en levant la tête de bas en haut.
Pourtant, si Darwin s’est trompé en sous-estimant les nuances qui distinguent les cultures humaines, son intuition initiale n’était pas fausse : il pensait que la manière dont nous exprimons nos émotions avait une origine biologique. Cette intuition lui avait été inspirée par l’observation des animaux et en particulier des grands singes proches de l’espèce humaine.
Ainsi, dans une lettre écrite à sa grand-mère, le 1er avril 1838, Darwin raconte à quel point il a été impressionné, lors d’une visite au zoo de Londres, par une jeune femelle orang-outang baptisée Jenny.
« J’ai vu l’orang-outang en grande perfection : le gardien lui a montré une pomme, sans la lui donner ; là-dessus elle s’est jetée sur le dos en donnant des coups de pied et en pleurant, comme un enfant capricieux […]. Le gardien lui a dit : « Jenny si tu t’arrêtes de brailler et que tu te montres bonne fille, je te donnerai la pomme. » Elle a certainement compris chaque mot et, bien que, comme un enfant, elle ait eu du mal à s’arrêter de pleurer, elle a fini par y arriver et par obtenir la pomme. »
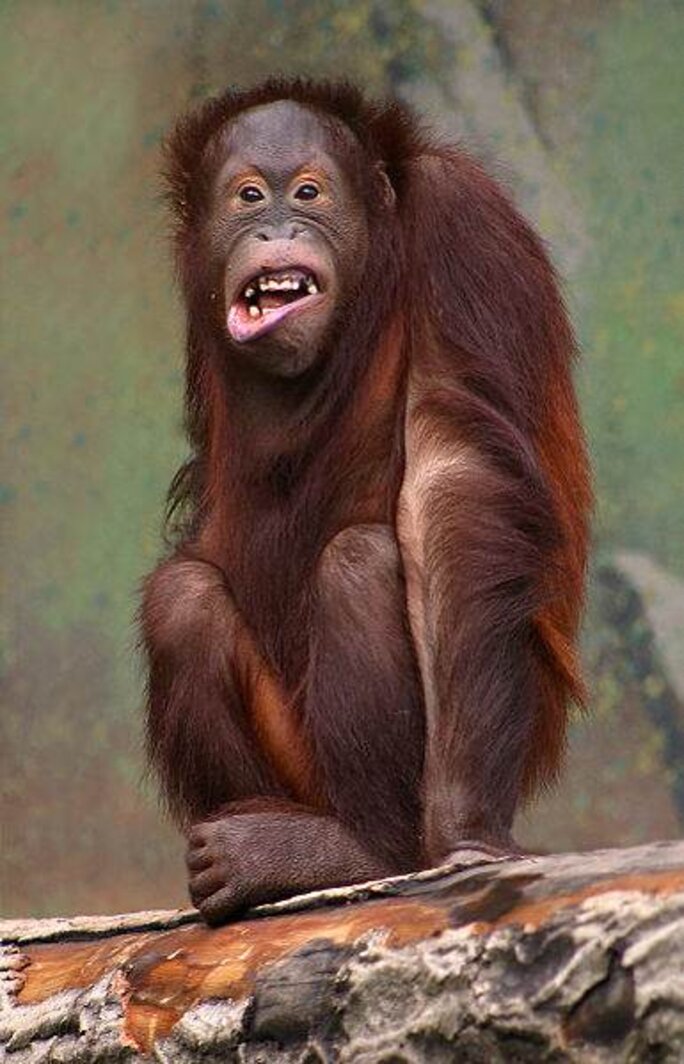
A l’époque, Darwin n’a pas encore trente ans, il vient de rentrer de son voyage de cinq ans à bord du Beagle, et il commence à élaborer sa théorie de la sélection naturelle. Dans son enthousiasme, le naturaliste prête au grand singe des expressions et des émotions proche de celle d’un enfant. Bien qu’elle manque de rigueur, cette description anthropomorphique n’est sans doute pas dépourvu de pertinence.
Darwin systématise son intuition dans L’expression des émotions chez l’homme et les animaux. Il défend l’idée que les émotions s’expriment de manière similaire chez l’homme et chez les primates les plus proches de notre espèce, et que cette ressemblance traduit une évolution commune.
Darwin soutient en particulier que le rire n’est pas le propre de l’homme. Il mentionne le fait que « si l’on chatouille un jeune chimpanzé – et ses aisselles sont particulièrement sensibles au chatouillement, comme c’est le cas chez nos enfants, il pousse une sorte de gloussement ou de rire… ».
Cette observation a été largement confirmée par une étude de la primatologue Marina Davila Ross, de l’université de Portsmouth, publiée en 2009 dans Current Biology. L’étude repose sur un ensemble de plus de huit cents enregistrements de jeunes chimpanzés, bonobos, gorilles et orangs-outangs subissant des chatouilles sur le cou, sous les bras ou sur la plante des pieds.
L’analyse acoustique des sons enregistrés ne laisse aucun doute : selon Marina Ross, il est indéniable que nos cousins quadrumanes peuvent rire. Elle précise même que «les orangs-outangs ont des éclats brefs et sonores, tandis que les gorilles, chimpanzés et bonobos ont des séquences de rire plus longues.»
Et les deux espèces les plus proches de la nôtre, le chimpanzé et le bonobo, sont aussi celles dont le rire ressemble le plus à celui des humains. Ce qui confirme l’idée de Darwin selon laquelle la similarité des expressions émotionnelles entre l’homme et les primates reflète le parcours de l’évolution.
« Le fait que certaines expressions soient communes à des espèces distinctes quoique apparentées, comme les mouvements des mêmes muscles faciaux pendant le rire chez l’homme et chez divers singes, devient un peu plus compréhensible si nous croyons qu’ils descendent d’un ancêtre commun », écrit Darwin.
Il faut ajouter que selon Darwin, les expressions de base du visage ont une fonction adaptative. Pour prendre un exemple simple, les pleurs du bébé lui servent à la fois à soulager son malaise et à envoyer un signal à sa mère. Ils sont donc doublement utiles à sa survie.
Par conséquent, les mimiques par lesquelles nous exprimons un sentiment de mal-être, de colère ou au contraire de contentement s’enracinent dans la biologie. Mais si cette prémisse est juste, l’erreur consiste à pousser le raisonnement un cran plus loin, en supposant que les expressions du visage prennent la même forme dans toutes les cultures humaines.
En d’autres termes, ce n’est pas parce que nos gestes élémentaires ont une origine biologique qu’ils sont entièrement déterminés par la biologie. La dimension culturelle introduit des variations qui ne se réduisent pas à l’évolution et aux nécessités de l’adaptation. Si, globalement, l’homme ressemble à l’orang-outang, il n’empêche que les peuples humains se distinguent entre eux par de subtiles nuances.
En soulignant l’étroite parenté entre l’homme et les grands singes, que ses contemporains préféraient ignorer, Darwin a sous-estimé les différences humaines. Il avait à moitié raison et à moitié tort. Les plus grands esprits peuvent avoir du mal à saisir d’un même mouvement les contradictions que fait surgir toute tentative scientifique de décrire le monde.



