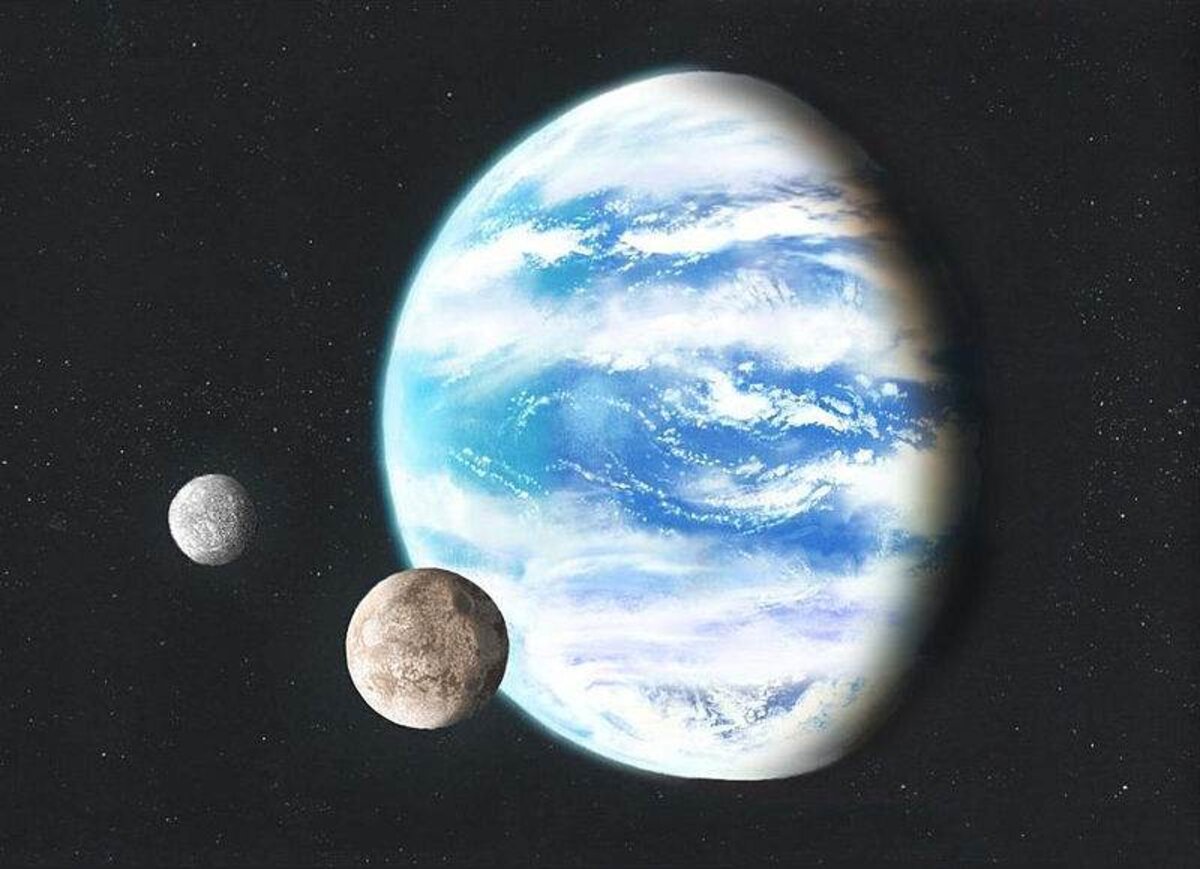
Agrandissement : Illustration 1

Dans 1,75 milliard d’années, le Soleil brillera assez fort sur notre planète pour faire évaporer toute l’eau des océans. La Terre s’assèchera et deviendra définitivement inhabitable, à supposer que cela ne se soit pas produit avant. S’il reste des habitants, ils auront toujours la possibilité de se replier sur Mars, dont la température sera alors assez clémente pour permettre la présence d’eau liquide, condition nécessaire à l’épanouissement de la vie. Mars à son tour deviendra trop chaude environ 4,5 milliards d’années plus tard, mais il restera la possibilité de quitter le système solaire : il existe au moins une exoplanète, appelée Gliese 581d, qui devrait rester potentiellement habitable pendant les 45 milliards d’années à venir, ce qui laisse un peu de marge (mais elle se trouve à une vingtaine d’années-lumière, ce qui n’est pas la porte à côté).
Ces estimations sont tirées d’une étude publiée le 19 septembre par des chercheurs britanniques dans la revue Astrobiology. Andrew Rushby, de l’université d’East Anglia, et ses collègues ont conçu un modèle qui permet de calculer la durée pendant laquelle une planète peut rester habitable. Une planète est supposée habitable si sa température de surface permet l’existence d’eau liquide. Ce qui suppose qu’elle ne soit pas trop loin de son étoile, car elle sera alors trop froide et n’hébergera que de la glace. Mais pas trop près non plus, parce qu’elle sera alors trop chaude et toute l’eau se transformera en vapeur avant de s’échapper dans l’espace.
Autour d’une étoile donnée, la région de l’espace dans laquelle ces deux conditions sont réunies s’appelle la « zone d’habitabilité ». L’étendue de cette zone dépend du rayonnement de l’étoile, qui lui même dépend de la masse et de l’âge de cette étoile. La Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil, et elle est la seule planète du système solaire dans ce cas. Cette circonstance a permis l’existence de la vie sur notre planète.
Mais les limites de la zone habitable ne sont pas constantes, parce que le rayonnement de l’étoile change au cours de la vie de l’astre. Schématiquement, pendant la plus longue partie de sa vie, une étoile telle que le Soleil grossit et émet de plus en plus de lumière. De ce fait, la région trop chaude autour de l’étoile s’étend, ce qui fait reculer les frontières de la zone habitable. Ainsi, d’après les calculs d’Andrew Rushby et ses collègues, la zone habitable du Soleil se décale vers l’extérieur d’environ un mètre par an. Pour l’instant, la Terre se trouve dans cette zone, mais Mars est trop loin. D’ici 1,5 milliard d’années, Mars la limite extérieure de la zone habitable commencera à englober l’orbite de Mars, et d’ici 1,75 milliards d’années, la limite intérieure de cette zone habitable se trouvera au-delà de l’orbite de la Terre.
Le modèle de Rushby et ses collègues est destiné à calculer la durée pendant laquelle une planète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Il faut bien comprendre que la planète reste toujours sur la même orbite, ce sont les limites de la zone habitable qui se déplacent. La « durée de vie dans la zone habitable » dépend de la masse de l’étoile : en effet, le rayonnement des étoiles plus massives augmente plus vite au cours du temps, de sorte que la zone habitable se décale plus rapidement que pour les petites étoiles. Par conséquent, les planètes qui orbitent autour de petites étoiles peuvent rester plus longtemps dans la zone habitable.
La durée de séjour dans la zone habitable est un paramètre important pour évaluer la possibilité d’existence de formes vivantes sur une planète, comme l’explique Andrew Rushby sur son blog : « Une planète avec une longue période d’habitabilité a plus de chance d’héberger des organismes complexes, dont l’évolution demande plus de temps », du moins si l’on suppose que l’évolution fonctionne de la même manière sur les expolanètes que sur Terre.
Partant de ce principe, les chercheurs britanniques ont quantifié la durée de vie dans la zone habitable de 7 exoplanètes et de 27 objets considérée comme des planètes candidates (c’est-à-dire qu’elles pourraient être des planètes, mais qu’on n’en est pas encore sûr). Pour chacun de ces objets, les chercheurs ont estimé l’âge de l’étoile et ont modélisé son évolution de manière à déterminer la vitesse à laquelle se décale la zone habitable. En connaissant la distance de l’orbite de la planète par rapport à l’étoile, il est alors possible de quantifier la durée de séjour de la planète dans la zone habitable. Le but de la démarche est d’identifier des planètes où il pourrait être intéressant, dans l’avenir, de mener des explorations plus poussées en vue de rechercher une vie extra-terrestre. L’idée de Rushby et ses collègues est de sélectionner des planètes habitables et qui l’ont été au moins aussi longtemps que la Terre, ou plus longtemps. Cela, afin d’augmenter la probavilité qu’une vie complexe ait eu le temps de s’y développer.
Cette démarche repose sur des hypothèses restrictives : le seul critère d’habitabilité pris en compte est une température de surface compatible avec la présence d’eau potable ; et rien ne dit que la vie, si elle apparaissait sur une autre planète, évoluerait au même rythme que sur la Terre. Le modèle suppose aussi que les autres planètes ont une atmosphère et une géologie similaires à celles de la Terre. Bref, la démarche consiste plus ou moins à rechercher une deuxième Terre ailleurs, ce qui est une approche assez limitative. En théorie, il pourrait exister quelque part dans l’univers une forme de vie ne correspondant pas du tout aux critères que nous connaissons. Mais partir de ce que l’on connaît pour tenter d’en savoir un peu plus n'est pas la pire manière d’approcher l’inconnu.



