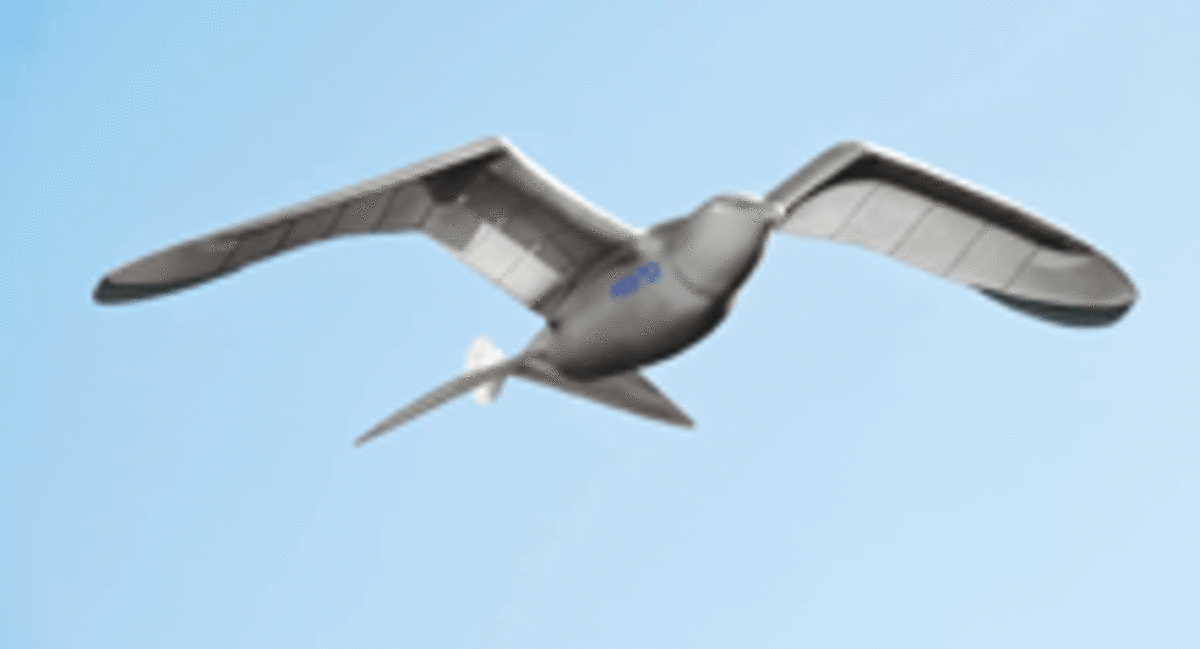
Si, en entrant dans un immeuble, vous constatez que vous êtes suivi par une sorte de gros moineau au vol un peu saccadé, deux hypothèses : a) vous avez consommé une substance hallucinogène ; b) le plus petit avion espion du monde est sur votre trace.
Explication : en 2011, Aerovironment, la société créée par Paul MacCready, l’auteur en 1979 de la première traversée du Channel à bord d’un avion à propulsion humaine, dévoilait sa dernière création, appelée Nano Hummingbird. Ce nom, qui signifie littéralement «nano colibri», désigne un objet en réalité sensiblement plus gros qu’un colibri, même s’il s’agit d’une merveille de miniaturisation. Nano Hummingbird est un ornithoptère, un robot ayant l’aspect d’un oiseau de 17 centimètres d’envergure et d’un poids de 19 grammes, qui vole en battant des ailes. Il peut faire du surplace en l’air comme un véritable colibri, et voler dans toutes les directions, y compris en arrière, avec une vitesse de pointe de 18 km/h.
Nano Hummingbird est le chef de file d’une nouvelle génération d’objets volants miniaturisés apparus depuis une décennie. En 2002, l’université de Toronto a mis au point une sorte de libellule électrique capable de voler en surplace comme un phélicoptère miniaturisé. A sa suite, l’université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, a construit Delfly, également sur le modèle d’une libellule, mais équipée d’une caméra. La dernière version pèse 3 grammes pour une envergure de 10 centimètres.
Ces oiseaux et libellules électriques ressuscitent une tradition inaugurée dans les années 1870 par le Français Alphonse Pénaud, qui fit voler entre 1870 et 1874 des modèles réduits d’hélicoptères et de «petits oiseaux artificiels», mus par la «détorsion d’une lanière en caoutchouc».
Avant Pénaud, Leonard de Vinci a dessiné des engins volant sur le principe du battement d’ailes des oiseaux. L’idée de copier la nature pour s’élever dans les airs est même bien antérieure, puisqu’elle apparaît dans la mythologie grecque, avec Icare et Dédale. Une vingtaine d’année après Pénaud, Otto Lilienthal s’est inspiré du vol des oiseaux pour construire des sortes de deltaplanes avec lesquels il a effectué deux mille vols planés, avant de faire une chute fatale causée par une rafale de vent.
Clément Ader, le premier à avoir fait décoller un engin motorisé plus lourd que l’air, en 1890, a été littéralement obsédé par la forme de l’aile de la chauve-souris, qu’il s’est efforcé de reproduire. En fait, on n’est pas certain que son Avion III ait réellement volé, même s’il a effectivement décollé sur une courte distance.
Quoi qu’il en soit, ce sont les frères Orville et Wilbur Wright qui réaliseront le premier vol motorisé et contrôlé en 1903, avant de réaliser des vols de plusieurs dizaines de kilomètres les années suivantes.
Au-delà de la controverse sur la question de savoir qui est vraiment le premier aviateur, un point incontesté est que la solution technologique des frères Wright s’est imposée : à la différence de leurs prédécesseurs, les deux pionniers américains de l’aviation n’ont pas imité la nature, mais s’en sont au contraire éloignés. Leurs Flyer I, II et III sont des biplans équipée d’une gouverne de direction, d’un moteur et d’une hélice. Le profil des ailes n’est pas conçu en cherchant à copier les oiseaux ou les chauve-souris, mais en faisant des essais en soufflerie.
En un mot, les frères Wright ont une démarche d’ingénieurs. Or, dans l’histoire du vol humain, c’est cette démarche qui a triomphé, dès le début du XXème siècle, et qui a permis que l’avion devienne un moyen de transport ordinaire. L’homme a décollé du sol non pas en essayant de devenir un oiseau, mais en au contraire en s’émancipant du modèle naturel. On pourrait dire que l’aile d’avion est à celle de l’oiseau ce que la roue de l’automobile est à la patte du cheval.
Or, par un intéressant retournement de situation, les progrès de l’électronique et de la miniaturisation ouvrent aujourd’hui la voie à une nouvelle génération d’oiseaux artificiels. Les engins miniaturisés cités au début de ce billet représentent une direction de recherche. D’autres constructeurs ne se focalisent pas sur la miniaturisation, mais sur les performances qualitatives du vol.
Depuis quelques mois, la société allemande Festo, installée à Esslingen, près de Stuttgart, a lancé dans les airs l’ornithoptère le plus sophistiqué jamais construit. Appelé Smartbird, il a l’allure d’un gros goéland de deux mètres d’envergure et pèse un demi-kilo. Il peut décoller et s’élever dans les airs de manière autonome en battant des ailes, voler, planer et se poser. Ses inventeurs affirment même que les vrais goélands sont très intrigués à son passage…C’est peut-être exagéré, mais la vidéo ci-dessous montre que le résultat est assez impressionnant.
http://www.youtube.com/watch?v=nnR8fDW3Ilo
Les constructeurs de Smartbird – auquel la revue Science a consacré un article dans son édition du 23 mars – expliquent sur le site de la société que leur projet était de construire un «oiseau artificiel inspiré du goéland argenté». C’est donc bien le vieux projet de Leonard de Vinci qui renaît, mais en faisant appel à la fibre de carbone, aux piles au lithium, à un moteur électrique miniaturisé et à un microprocesseur.
En dehors de l’intérêt scientifique de mieux comprendre comment fonctionne le vol des oiseaux, à quoi peuvent servir les nouveaux ornithoptères ? Ces engins volants sont capables de remarquables performances en terme de consommation d’énergie ; dans l’avenir, si ce n’est déjà le cas, leur agilité en vol et leur capacité à manœuvrer dépassera celle des avions miniaturisés classiques.
On comprend sans peine qu’ils intéressent fortement les militaires, pour qui l’ornithoptère pourrait être le drone du futur. Le DARPA, l’Agence de recherche duy ministère de la défense des Etats-Unis, investit des millions de dollars dans ce nouveau domaine.
Les engins miniaturisés sur le modèle de Nano Hummingbird pourrait, dans l’avenir, servir d’avions espions ou de systèmes de reconnaissance. Ils pourraient aussi être utilisés sur les lieux d’une catastrophe, par exemple pour rechercher les victimes d’un tremblement de terre ou pour explorer une centrale nucléaire accidentée.
Il y a cependant encore pas mal de progrès à faire. Nano Hummingbird n’a que 11 minutes d’autonomie, ce qui serait un peu court pour faire le tour de la centrale de Fukushima. Et si les ornithoptères savent décoller et atterrir, ils leur reste à apprendre à se percher sur un arbre comme un véritable oiseau. Alors seulement, les oiseaux électriques seront vraiment branchés…



