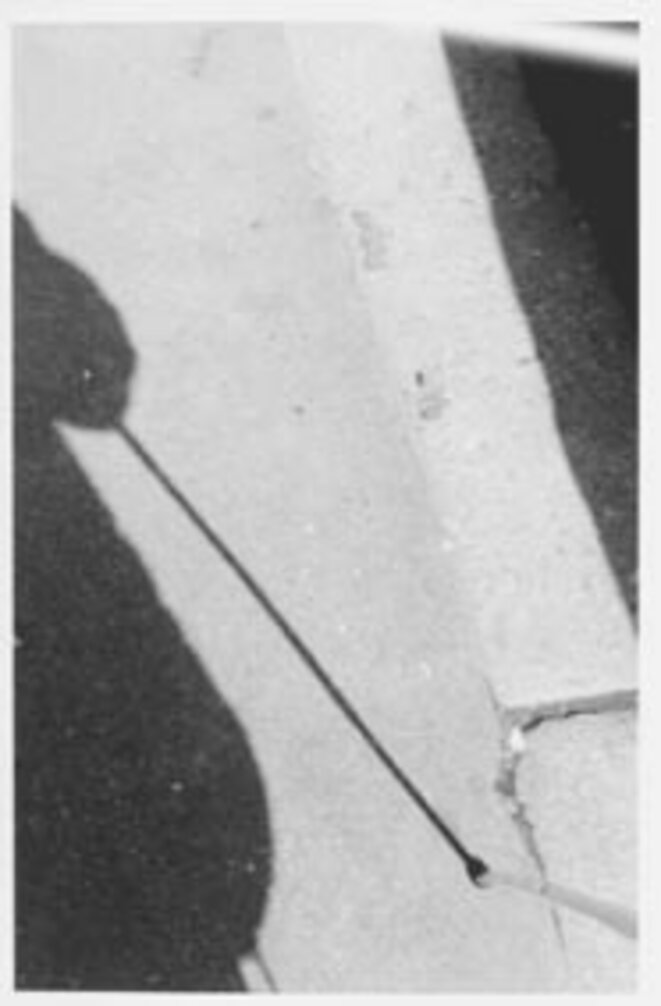80 photojournalistes témoignent de ce que fut l’aventure de l’agence de presse Sipa fondée par Göksin Sipahioglu, son mythique patron décédé en octobre 2011. Un très émouvant beau livre.
« A ceux qui ne connaissent pas l’univers de la presse, le nom de Sipahioglu ne dira pas grand-chose. C’est celui d’un homme qui a profondément marqué toute une génération de journalistes et de photographes à travers le monde et dont Sipa, l’agence qu’il a créée, est le diminutif. » Michel Setboun
Le mercredi 5 octobre 2011, à 9 heures du matin, un appel téléphonique m’a appris la mort du « grand turc ». Comme pour toute la profession, ce fut un choc. On le croyait immortel. Depuis qu’il avait été écarté de sa chère agence, Göksin Sipahioglu promenait sa haute silhouette dans quelques vernissages d’expositions photo. On le voyait également à ses propres expositions en particulier à Visa pour l’image où Jean-François Leroy lui rendit un bel hommage en accrochant son « Mai 68 ». Celui que l’on appelait « le grand turc » était né à Izmir en 1926. Champion de basket dans son pays, il y avait également créé un quotidien avant de se lancer dans la chasse aux scoops, où il fit merveille toute sa vie.
En 1969, Hubert Henrotte alors patron de l’agence Gamma lui refuse un départ en reportage. Il quitte Gamma et commence à créer Sipa press qui ne le fut officiellement qu’en 1973. « Le turc » n’était pas un gestionnaire avisé comme son homologue de Gamma puis de Sygma, Hubert Henrotte ; néanmoins il fut le dernier des trois « A » (Gamma, Sygma, Sipa) à être chassé de son agence par les fonds d’investissement. C’était un séduisant et habile meneur d’hommes.
Rapidement dans les années 70, Sipa s’imposa aux côtés de Gamma et Sygma pour se disputer le marché de la presse internationale en profitant de l’inertie d’alors des agences dites télégraphiques (AFP, Reuters, AP). Entre les trois « A » la concurrence fut d’une extrême rudesse que les hommes aujourd’hui ont tendance à minimiser. Pourtant les coups bas ne manquaient pas.
Dans l’entretien qu’il a accordé aux auteurs, Hubert Henrotte dit : « Göksin s’est révélé en tout cas un redoutable concurrent, notamment sur le front de la rapidité. Et souvent, il nous a coiffés au poteau. Comme les journaux achetaient au premier arrivé (quelquefois au second, si les images étaient meilleures), tous les moyens étaient bons pour franchir la ligne en tête. À ce titre, nos relations étaient très tendues : Gamma, Sygma et Sipa se livraient une lutte sans merci. Des paquets ont même disparu mystérieusement, comme à la mort d’Allende
en septembre 1973, quand les films de notre photographe sont parvenus à Sygma avec 48 heures de retard… »
Cette concurrence sauvage eut des conséquences désastreuses pour le statut des photographes. Le non respect des droits sociaux par les trois agences dominantes les amenèrent, bien avant la crise de la presse, à laminer les photographes indépendants et les petites agences. Un constat que les enfants de « l’âge d’or du journalisme » oublient la plupart du temps de prendre en compte.
Là où Gamma, sous la houlette de Raymond Depardon et surtout de son rédacteur en chef Floris de Bonneville, jouait la qualité des images, Göksin Sipahioglu lançait des hordes de jeunes aventuriers à la conquête du graal : le scoop. Ils étaient parfois une dizaine – voire plus - sur « les coups », mais en final Sipa press avait toujours une exclusivité à proposer à Paris Match, à Time, à Stern ou à Newsweek.
« Je n’ai jamais connu quelqu’un qui m’ait aussi mal payé et à qui je dois autant. » Patrick Chauvel
Lors d’un émouvant hommage que lui a rendu la presse au théâtre de l’Odéon, Patrick Chauvel a bien résumé ce que tous les photographes pensaient de Göksin Sipahioglu : « Je n’ai jamais connu quelqu’un qui m’ait aussi mal payé et à qui je dois autant. »
La force de Göksin Sipahioglu fut de faire rêver ces bandes de jeunes gens. De les faire rêver et de les faire partir en reportage. Parmi eux, certains sont restés anonymes, d’autres comme Abbas, Patrick Chauvel, Alain Mingam, Yan Morvan, Patrick Robert et beaucoup d’autres sont vraiment devenus des photojournalistes, aujourd’hui reconnus.
Michel Setboun, qui fut l’un de ses fils spirituels, a lancé l’idée incongrue de faire un livre avec les souvenirs des photographes... C’était le jour de cet hommage au Théâtre de l’Odéon. Moins d’un an après, avec la collaboration de Sylvie Dauvillier, et quelques mésaventures, il publie aux éditions de La Martinière « 40 ans de photojournalisme, génération Sipa ». C’est un très beau livre d’histoires sur l’Histoire qui a demandé un travail considérable à Michel Setboun pour une « petite pige ». Mais après l’école Sipa, on est habitué à travailler beaucoup, pour peu.
« Göksin, le Turc, Monsieur Sipa… Nous sommes des centaines à travers le monde à qui il a ouvert la voie. Nous sommes de la génération Sipa. Nous en sommes fiers. » Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l’image
De 1973 à 2011, 80 photographes témoignent sur la vie de l’agence, sur les évènements qu’ils ont couverts et sur les petites histoires qui émaillent les reportages.
Il y a des grandes photos, ce qu’on appelle des « plaques » et puis il y a des photos de faits divers, de people, un florilège du flux ordinaire de la production de l’agence. Tout cela est agrémenté d’anecdotes qui racontent bien la vie d’une agence de presse photo au siècle dernier.
Au delà des souvenirs, Michel Setboun a ponctué le livre d’entretiens plus fouillés. Phyllis Springer qui fut la compagne de Göksin Sipahioglu, sa collaboratrice et sa femme, nous émeut par les détails de sa vie avec Monsieur Sipa. « Impossible de ne pas remarquer Göksin. Grand et bel homme, cheveux noirs et regard bleu, il dégageait beaucoup de charme. Fils d’une bonne famille bourgeoise d’Istanbul, il avait en plus hérité des manières du Vieux Monde, avec cette exquise politesse. À la fin du vernissage, il m’a invitée à dîner. Mais comme je refusais parce que j’étais venue avec des amis, il a aussitôt proposé qu’ils nous accompagnent. Et la soirée s’est achevée dans un petit restaurant, avec vingt-trois personnes, toutes invitées par Göksin qui prenait des photos. Pendant deux mois, j’ai tenté de lui résister. D’autant que je le savais séducteur-né. Mais tous les soirs, au cours de cette période, il m’a téléphoné de n’importe quel pays. »
« Je ne sais pas si le photojournalisme est mort, mais le marché, lui, n’existe plus. » Peter Howe, photographe, picture-éditor, écrivain
Guillaume Clavière, l’actuel « patron » de la photo à Paris Match, souligne ce qui a changé dans ce métier : « C’est certainement plus difficile pour les photographes d’avoir les moyens de travailler à l’étranger et d’obtenir des parutions. Récemment, Pascal Maître, un excellent photographe, m’a proposé un sujet magazine sur le retour à la vie de Mogadiscio en Somalie, après le départ des islamistes Shebab. Il a pris le risque financier d’y aller et, à son retour, j’ai pris son reportage, mais pour un comme celui-ci, je vais peut-être en refuser dix, alors qu’hier, on en aurait accepté quatre ou cinq. »
Pour Jim Colton, picture éditeur américain notamment de Newsweek, le métier est devenu très difficile : « La prolifération et la disponibilité des images que la révolution numérique a engendrées ont tué le marché. Tout le monde est photographe de nos jours, y compris avec des IPhone. »
« La technologie a engendré une profonde mutation du métier !» renchérit Peter Howe un photographe devenu dans les années 1980 éditeur photo du New York Times Magazine et de Life, avant d’être vice-président de Corbis, l’agence fondée par Bill Gates. « Tout a changé, non seulement la manière de prendre des photos, mais aussi la façon de penser. Le marché n’est plus le même. En outre, aux États-Unis, la culture de la célébrité a pris le contrôle de presque tous les aspects de la vie et transformé le regard. Il y a quelques années, j’ai écrit un livre, Paparazzi : And Our Obsession With Celebrity (Artisan Publishers, 2005). Les paparazzi sont désormais les photojournalistes qui ont le plus de succès. Que l’on soit d’accord ou pas, il faut admettre qu’ils produisent ce que les gens attendent aujourd’hui, loin des histoires que nous publiions à l’époque. Je ne sais pas si le photojournalisme est mort, mais le marché, lui, n’existe plus. J’ai commencé à être photographe dans les années 1970 et je mesure l’incroyable différence avec le paysage actuel. »
Incongru dans cet hommage à Goksin Sipahioglu, l’ancien photographe du Figaro, Hubert Henrotte « l’un des acteurs clés de l’âge d’or du photojournalisme. Fondateur de l’agence Gamma puis de Sygma, ce monstre sacré à l’allure austère et au regard bleu acier fut le concurrent direct de Göksin Sipahioglu. Deux profils radicalement différents animés par une même passion. » HH reste étonnement le plus optimiste : « En 1988, en lien avec la cassure économique aux États-Unis, un jour, la directrice de Sygma New York me fait part d’un vent de panique outre-Atlantique après que Time a refusé d’accorder un assignment pour un reportage. C’est le début de la fin, en Amérique puis en Europe. Le passage au numérique au début des années 1990 a aussi impliqué de lourds investissements pour les agences françaises, sous-capitalisées. Une fragilité qui a entraîné leur rachat par les Américains. En revanche, il est faux de penser qu’Internet est à l’origine du déclin. Le Web a, au contraire, fourni une chance de visibilité aux photographes et pourrait produire demain une économie nouvelle. »
Au total, « 40 ans de photojournalisme, génération Sipa » est un très bel hommage à Göksin Sipahioglu, un très bel album de souvenirs pour cette déferlante de photographes de l’après mai 68 qui atteint aujourd’hui un âge qui n’est plus d’or, et où il devient difficile de courir.
« Ce livre est destiné aux jeunes photographes qui n’ont pas eu la chance de connaître cette époque où tout était possible, car tout nous semblait possible. » écrit Michel Setboun dans l’introduction avant d’asséner sa vérité à la jeunesse : « Ce livre est destiné à ces jeunes qui pénètrent le monde de la photo, bardés de diplômes après des années d’école et qui ne trouvent pas d’espace où exercer leur talent.»
Le pessimisme de la génération des rescapés de l’âge d’or va faire sourire les enfants de la photo numérique, ceux qui inlassablement poursuivent l’œuvre de leurs pères en allant, sans garantie, sans assignment, à leurs frais, chasser l’information là où l’Histoire s’écrit. Ils ne cassent plus « la machine à café de l’agence », mais leur tirelire pour embarquer à Roissy.
A la génération de l’âge d’or, succède une génération de jeunes photojournalistes tout autant talentueux et audacieux. Courez camarades, le vieux monde est derrière vous !
Michel Puech
Article publié le 3 septembre 2012 dans Le Journal de la Photographie
Référence
40 ans de photojournalisme - Génération Sipa
De Michel Setboun et Sylvie Dauvillier
Création graphique et mise en page : Grégory Bricout
© 2012, Éditions de La Martinière
239 pages – 39 euros
Lire
- Tous les billets du blog concernant Göksin Sipahioglu
- Les "bonnes feuilles" du livre publiées par Le Journal de la Photographie
- Photos de Gôksin Sipahioglu par Geneviève Delalot
- Vidéos des hommages rendus à Göksin Sipahioglu au Théatre de l'Odéon en octobre 2011
A voir
- http://www.editionsdelamartiniere.fr
- http://www.goksin.com
----------------------------------------------
« www.a-l-oeil.info » ?
« A l’œil » s'intéresse essentiellement au photojournalisme, à la photographie comme au journalisme, et à la presse en général. Il est tenu par Michel Puech, journaliste honoraire (carte de presse n°29349) avec la collaboration de Geneviève Delalot, et celle de nombreux photographes, journalistes, iconographes et documentalistes. Qu'ils soient ici tous remerciés. Tous les textes et toutes les photographies ou illustrations sont soumis à la législation française, en particulier, pour les droits d'auteur. Aucune reproduction même partielle n'est autorisée hormis le droit de citation.
Pour nous écrire, cliquez LA - Abonnez-vous pour recevoir notre courriel d’alerte à chaque publication.