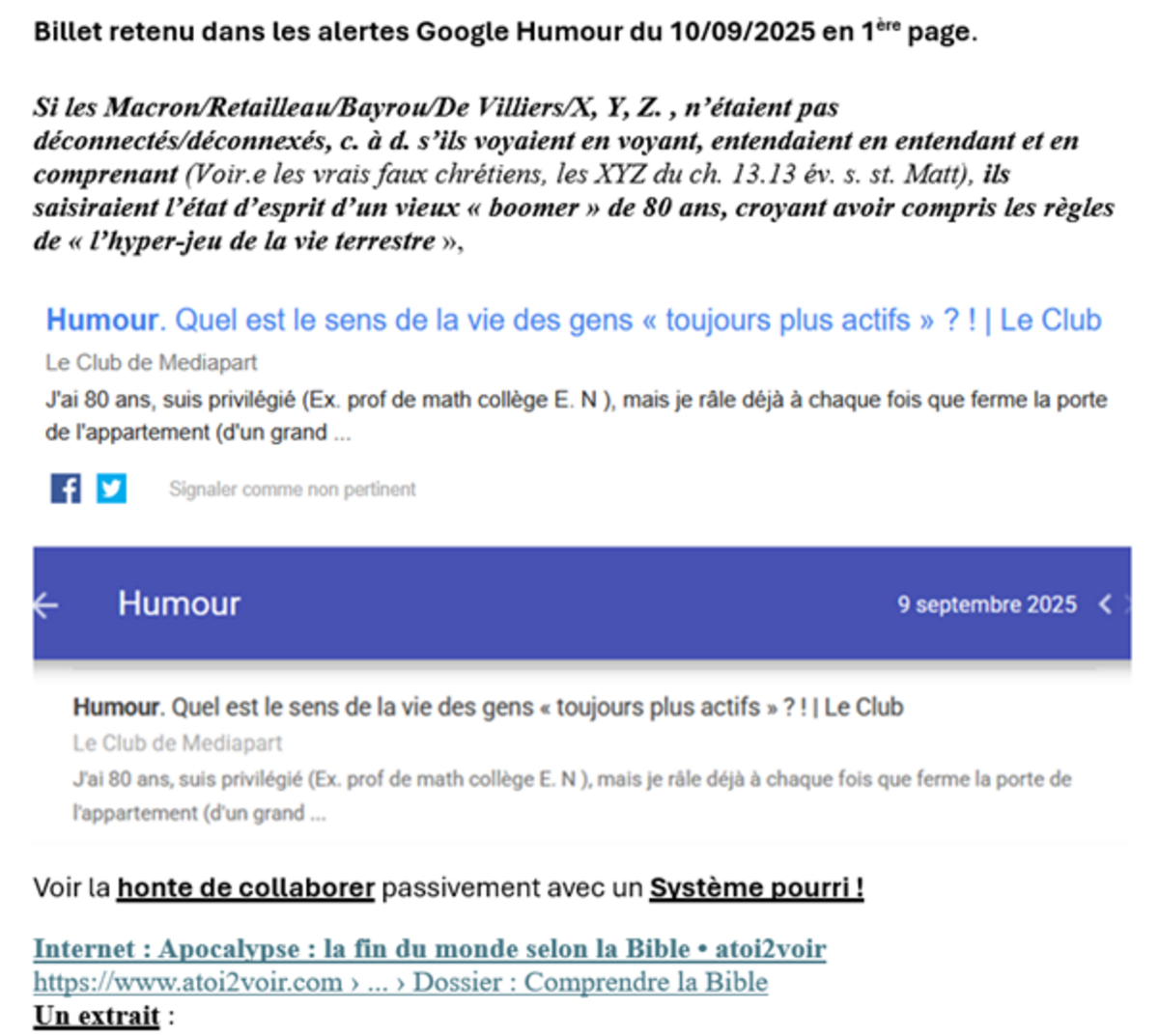
Agrandissement : Illustration 1
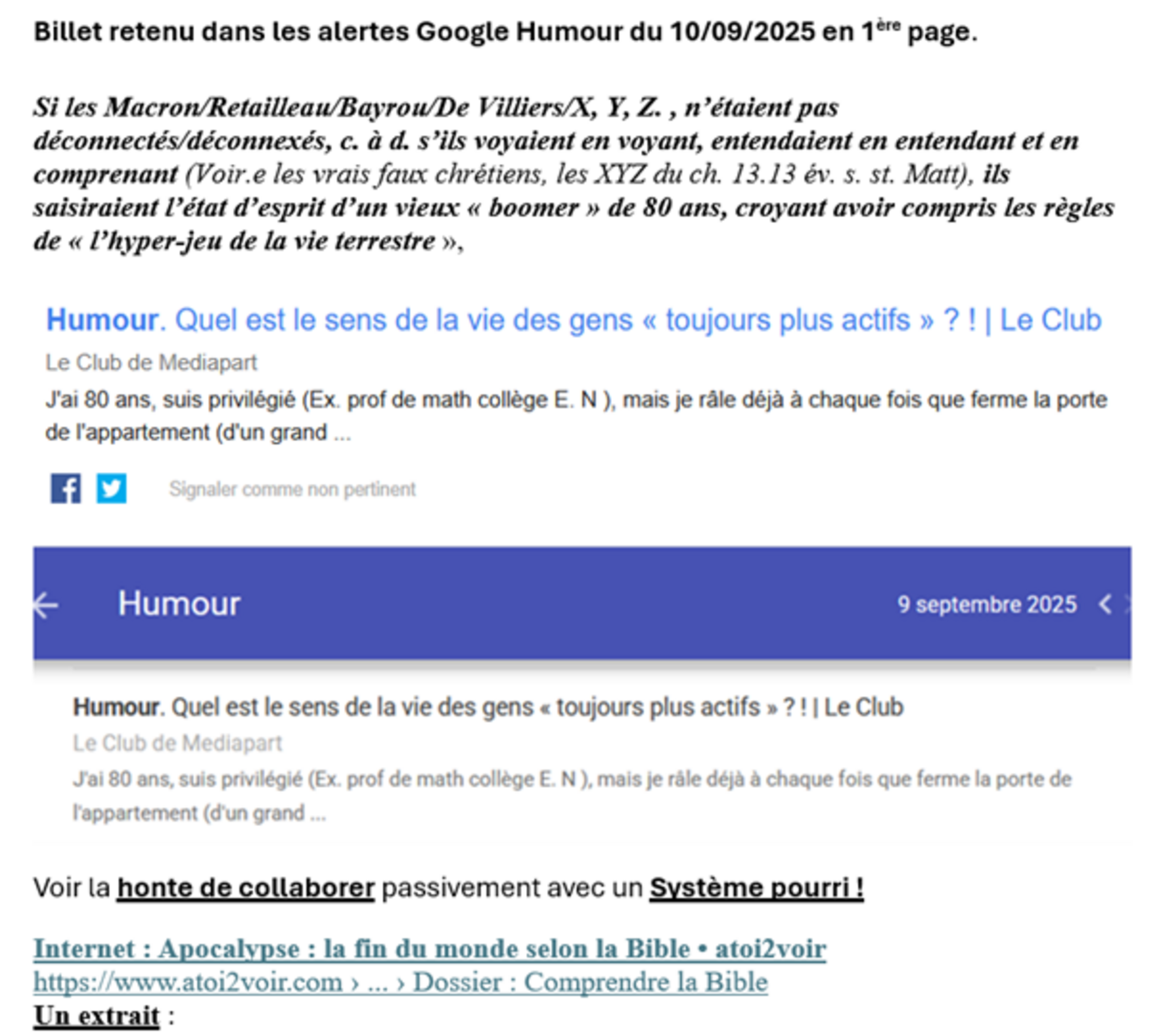
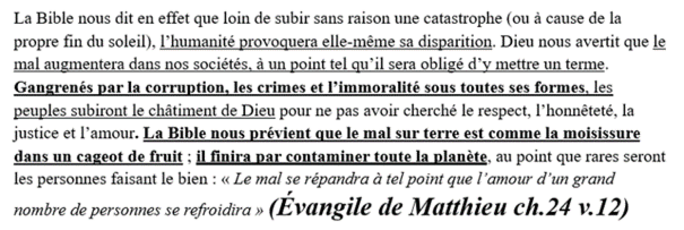
Agrandissement : Illustration 2
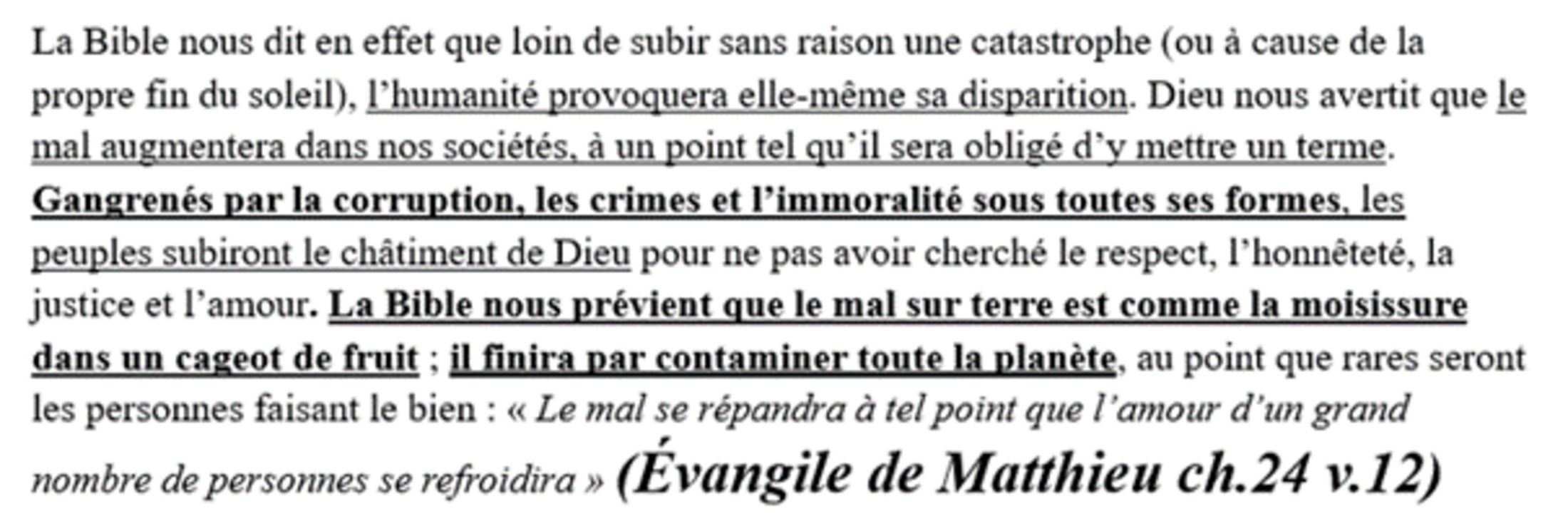
J’ai 80 ans, suis privilégié (Ex. prof de math collège E. N ), mais je râle déjà à chaque fois que ferme la porte de l’appartement (d’un grand ensemble) ! J’ai un trousseau de x clés ! Et celle de la voiture, n’est-elle pas imposante ? ! Tout s’embrouille …
Les ascenseurs sont formidables, mais à condition qu’ils ne tombent pas en panne !
Le jour où je descends du 4ème pour aller à un rendez-vous chez ma médecin (Suite à une inscription via Doctolib, 1 mois à l’avance), je ne prends pas l’ascenseur !
En 1970, on prenait la voiture, comme un vélo ! Et on allait, par ex. se promener !
Je n’ai plus aucune envie de sortir de la ville. Depuis plus de 10 ans !
En ville, les SDF, ou les personnes faisant la manche, sont présent.es !
CHAQUE MATIN, A LA RADIO, OU DANS LES MÉDIAS, QUE VOIT/ENTEND, COMPREND-ON ? ! (Si ………… !)
N’EST-CE PAS QUE DES ÉVÉNEMENTS PLUS QUE NÉGATIFS ? !
J’ai honte de collaborer passivement en ne me suicidant pas !
En acceptant de vivre dans « l’indignité » !
Vous, cela ne vous fait rien de vous complaire dans l’indignité générale « planétaire » ? !
Moi, je plains les jeunes qui n’ont pas la liberté/possibilité de s’exprimer et-et agir sans se faire virer !
Ce que sais aussi, c’est que des cathos réacs bloquent tout ! vivent encore au 19/20ieme siècles ! ou/et des bobos !
Ne suffit-il pas d’écouter les animateurs et personnes qui se précipitent sur CNews ? ! ! !
Ils pensent tous que Mai 68 n’aurait pas dû exister ! A été une régression dont on ne s’est jamais remis !
Ils sont tous pour la « méritocratie »
Pas la peine d’en dire plus devant M. Retailleau, feu M. Bayrou, M. Macron, etc.
Si je n’ai pas envie de prendre x fois la voiture pour aller en Belgique ou en Suisse, si demain il suffisait de passer a l’hosto de Dunkerque pour accéder au cycle suivant, avant de connaître la guerre nucléaire, via une anesthésie générale ou euthanasie, j’irais demain !
......................................................................
Horaires, durée et qualité du trajet domicile-travail, vie de famille… 80 % des Français se déclarent fatigués. Le professeur et chercheur Philippe Zawieja publie un essai éclairant sur ce sujet.
8 min • Quentin Périnel
L’excès de sommeil fatigue », lit-on dans L’Odyssée d’Homère. Le sommeil et notre rapport à celui-ci font couler de l’encre depuis la nuit des temps. Dans son petit ¬essai La Fatigue, publié dans la collection « Que sais¬-je ? », ce spécialiste de la ¬santé au travail, interroge notre rapport culturel à la ¬fatigue des travailleurs.
LE FIGARO. - LE FIGARO. - En quoi la fatigue est-elle un fléau de notre temps ?
- PHILIPPE ZAWIEJA - D’abord, parce qu’elle semble omniprésente. Pas un domaine de notre vie n’y échappe : la fatigue est tour à tour, et parfois simultanément, physique, psychologique, cognitive, morale, spirituelle, informationnelle, démocratique, sociale… Dans un récent sondage, près de 80 % des Français se déclarent fatigués ! La mécanisation a pourtant, depuis la révolution industrielle, considérablement repoussé les limites de l’effort physique imposé à l’homme, ce qui a eu pour effet paradoxal de rendre de plus en plus illégitime la fatigue physique à mesure que la machine nous évitait de la ressentir. Dans le même temps, l’essor de la psychologie, de la psychanalyse et de la pédagogie, à partir de la fin du XIXe siècle, a mis en lumière les fatigues de l’esprit, qui ont fini par supplanter les fatigues physiques.
- Le deuxième fait marquant que je retiendrai, c’est que la fatigue est devenue un sujet de plainte. C’est une autre forme de son omniprésence - qui fait que les discours sur la fatigue finissent pour certains par devenir fatigants : pas une conversation informelle au travail, pas une consultation médicale, pas une phrase captée au hasard dans la rue qui n’en fasse état… Dans les siècles passés, la fatigue faisait partie d’un ordre du monde qui, soutenu par la puissance de la religion, faisait sens et était partagé et accepté : l’effort physique, le labeur étaient inhérents à la condition humaine et avaient pour contrepartie la fatigue. Il suffisait de se reposer et de respecter les rythmes de la Nature pour y remédier.
- Ce schéma fonctionne bien pour les fatigues physiques du quotidien, qui forment l’archétype des « bonnes fatigues » : corporelles et localisables (à un muscle…), explicables (par l’effort) et solubles (par le repos). Le modèle n’est plus opérant pour les fatigues psychiques, surtout si on ne les aborde qu’au prisme de la mélancolie, comme l’histoire de la médecine et des représentations tend à le faire depuis quelques ¬décennies : la fatigue mentale n’est ni ¬localisable, généralement pas attribuable à une cause claire et unique, et aucun repos n’y remédie, de sorte qu’elle tend à durer… - Cette « mentalisation » de la fatigue explique à mon sens qu’elle soit perçue comme une caractéristique - un fléau, pour reprendre votre terme - de notre temps. Notre époque est en effet prompte à dissimuler sa quête d’un sens général derrière une agitation généralisée et son culte de l’urgence, du changement, et de la superficialité intellectuelle et langagière, en même temps que de la performance et de l’excellence…
« Au travail, la fatigue mentale est devenue plus intense que la fatigue ». Le Figaro 09/09/25 !
LE FIGARO. - Le sommeil a-t-il mauvaise presse dans le monde professionnel ?
- Oui, et dans l’ensemble de notre culture ! Le sommeil, parce qu’il constitue le dernier temps mort, a longtemps constitué le dernier espace d’improductivité, d’où l’hostilité du capitalisme. Une bataille d’ailleurs toujours en cours, avec la prolifération des activités marchandes accessibles de nuit : salles de sport, magasins, livraisons, etc.
- Dans le monde professionnel, le statut de la fatigue est sans doute plus nuancé. D’un côté, elle est associée à une moindre productivité, à un risque accru d’incidents et d’accidents, parfois gravissimes, ou à une exacerbation des tensions relationnelles. Mais, de l’autre, en tant qu’elle est le signe d’un manque de sommeil, la fatigue permet aussi de mesurer la résistance, l’endurance et, pour tout dire, le sens du sacrifice des collaborateurs, des cadres, notamment. D’où l’apparition de formes de vantardise, que les Anglo-Saxons appellent « fatigue bragging », où il s’agit de mettre en scène son manque de sommeil…
- Enfin, la généralisation des discours de fatigue, en lien avec le travail : burn-out, bore-out, etc., apparaît comme une forme de critique sociale à peine larvée, précisément parce qu’elle rend directement responsable de son état d’épuisement non le salarié qui n’aurait pas les épaules assez larges pour affronter une situation, mais le travail dont les exigences physiques, émotionnelles et morales seraient trop importantes.
LE FIGARO. - On crée des salles de sieste dans beaucoup d’entreprises… Est-ce un écran de fumée ? Des salles qui ne servent à rien ?
- Physiologiquement, la pratique de la sieste de courte durée a indubitablement un sens. Encore faut-il que les salariés souhaitant s’y adonner aient le temps de le faire, dans des conditions de silence, de lumière et de détente qui soient compatibles avec le repos, et sans culpabilité ni culpabilisation ou moqueries… Enfin, la présence de salariés fatigués peut aussi inviter à rechercher des causes et des ¬solutions plus structurelles : horaires de travail, durée du travail, durée et qualité du trajet domicile-travail, parentalité, aidance… face auxquelles la sieste n’est qu’un palliatif.
LE FIGARO. - Y a-t-il des secteurs professionnels dans lesquels le sommeil est particulièrement négligé, voire mal vu ?
- Spontanément, j’en identifie au moins trois. Le premier est celui des activités ou des équipes majoritairement masculines, car la résistance à la fatigue et à la douleur est un marqueur fort des approches masculines traditionnelles, par exemple dans les forces de l’ordre, les pompiers, les militaires…
- Le deuxième secteur est celui du soin, notamment à l’hôpital. L’endurance face au manque de sommeil, la capacité à prendre de bonnes décisions malgré l’épuisement et le stress ont longtemps fait partie de la formation des jeunes médecins et infirmiers, et le recours à -diverses substances psychostimulantes, donc dopantes, comme la caféine, la ¬nicotine ou les amphétamines aidait à entretenir ce phénomène.
- Enfin, les métiers traditionnellement associés à la nuit : par sens de la fête ou par désynchronisation, ou par association avec un chronotype de type vespéral, c’est-à-dire avec une structure de personnalité et un fonctionnement général s’épanouissant en fin de journée et la nuit - en clair, les gens du soir, par ¬opposition à ceux du matin. Or, ce chronotype est parfois associé avec certains traits de personnalité comme une moindre ouverture aux autres, ce qui favorise l’épanouissement dans des activités autorisant la mise à distance, comme les jeux vidéo, l’e-gaming ou l’e-sport.
LE FIGARO. - Quid de la France par rapport aux autres pays ? Y a-t-il différentes cultures de la fatigue et du sommeil ?
Nul doute que chaque culture et chaque civilisation a un rapport à la fatigue et au sommeil spécifique, même si ces particularités tendent à s’estomper en raison de la mondialisation et des contaminations culturelles. - Quitte à schématiser à outrance, rappelons que la sieste, que nous mentionnions tout à l’heure, est une pratique plutôt propre à certaines cultures d’Europe du Sud… Les pays de tradition anglo-saxonne et protestante auraient eux plutôt tendance à promouvoir les comportements d’endurance et de résistance à la fatigue, ou de persévérance dans le travail en tant que contribution à la prospérité de la communauté et qu’expression de la valeur individuelle.
LE FIGARO. - Comment changer les mentalités ?
- L’omniprésence de la fatigue est justement le signe que les mentalités sont en train de changer ! On l’a abondamment répété depuis le Covid, notre rapport au travail est en train de changer, et nos exigences vis-à-vis de lui, de s’élever : épanouissement professionnel, développement de soi, autonomie, flexibilité des horaires et des lieux… Plus profondément, et en assumant un certain conservatisme, j’ai tendance à penser que c’est notre rapport à l’effort qui est en train de changer, avec des exigences de résultats plus immédiats, plus égocentrés, plus « instagrammables »…
LE FIGARO. - La tech peut-elle nous aider ?
- La technologie - certaines applications, notamment - peut certes nous aider à gérer nos apports caloriques, notre ¬activité physique ou notre sommeil, donc en théorie à conserver le contrôle sur notre fatigue.
Mais ces technologies sont surtout considérées comme l’une des causes principales de la dégradation de notre sommeil, en quantité et en qualité : nos smartphones, ¬notamment, sont accusés de retarder notre endormissement, ou de nous maintenir dans un état d’alerte quasi constant, à l’affût des notifications qui pourraient nous parvenir durant la nuit ou la ¬sieste…
- Honnêtement, je ne crois pas à l’efficacité de ces prothèses technologiques. Car ce que la fatigue souligne, c’est in fine que nous avons dans une certaine mesure perdu cette capacité à rester connecté à notre propre corps et aux rythmes de la nature : le cycle jour-nuit, l’alternance des saisons, etc. Il ¬serait tout de même paradoxal que ¬cette connexion ait besoin d’être supervisée par un dispositif technique !
POURQUOI CES X. Y. Z. ? !
N’EST-CE PAS PARCE QUE NOTRE SOCIÉTÉ VIT SOUS L’ADDICTION « TOUJOURS PLUS »
L’enfant qui découvre le monde, a envie naturellement de « toujours plus » de l’explorer !
Rien de plus logique (V. la biologique et la psychologique !)
L’ADOLESCENCE EN EST L’EXTREMUM !
PUIS VIENNENT LES CONFRONTATIONS AVEC LA RÉALITÉ !
ET, NORMALEMENT, UNE NOUVELLE MISE AU POINT, UN RÉFÉRENTIEL AMÉLIORÉ PREND LA RELÈVE ! ! !
MAIS NON ! Les études dans les grandes écoles ont demandé l’installation d’un logiciel mental axé sur la compétitivité et-et le « TOUJOURS PLUS » !
LA PHILOSOPHIE N’EST SURTOUT PAS ÉTUDIÉE ! A MOINS QUE CE NE SOIT QUE DE LA PSEUDO… !
Inutile d’ajouter quoi que ce soit !
Comme Coluche, je me marre t. p. !
Pierre Payen (Dunkerque)



