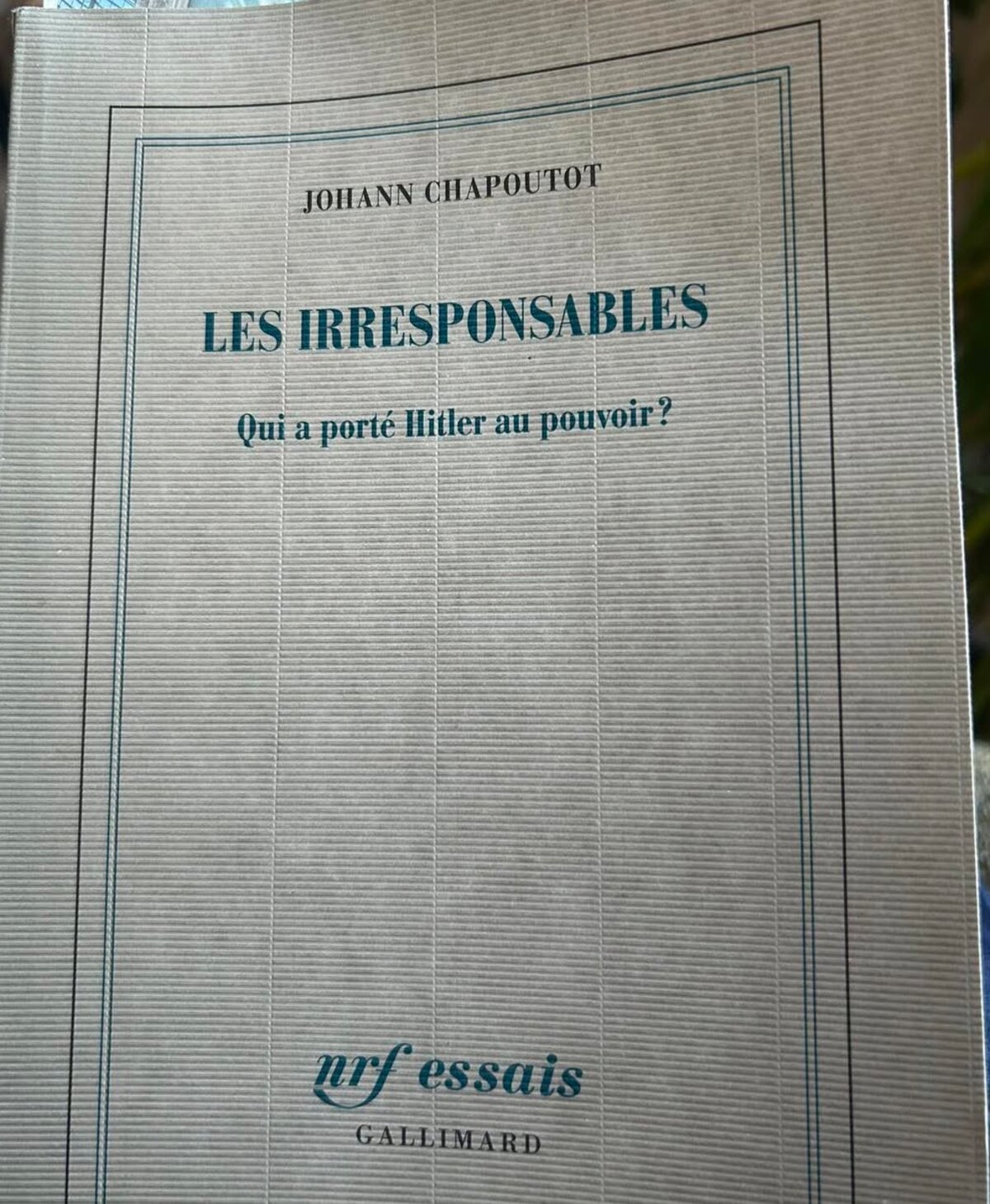
Agrandissement : Illustration 1
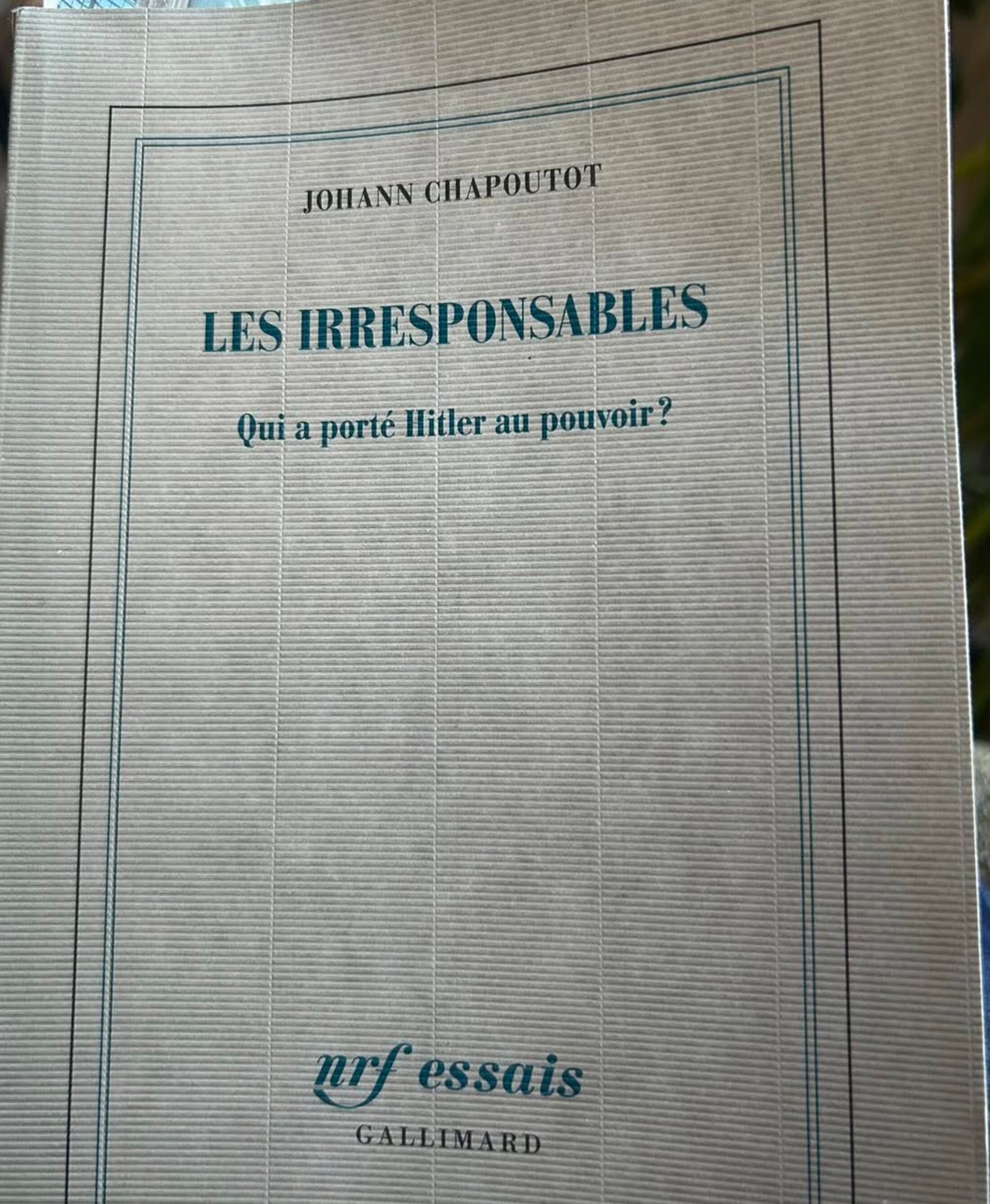
Alors oui, ça fait peur. Pas à cause du prix, mais à cause de la distance. Tous nous répètent qu’il faut aller voter. Comme si la démocratie tenait dans ce geste unique, ce petit trait de crayon censé réparer tout ce que le système ne parvient plus à entendre.
Mais avant de nous demander de parler, il faudrait peut-être commencer par dire d’où l’on parle. Car la parole institutionnelle ne vient pas du même monde que celle qu’elle sollicite. Elle vient d’un espace protégé, où les contraintes matérielles sont amorties, où le temps se mesure en mandats, en commissions, en calendriers électoraux. Elle vient d’une position qui exige de maintenir la machine en marche, même quand la machine tourne à vide. Ce n’est pas une faute morale. C’est une position sociale, comme l’aurait dit Bourdieu. Une position qui façonne le discours, qui détermine ce qu’on peut dire, ce qu’on doit dire, ce qu’on ne voit même plus.
Pendant ce temps, le pays réel vit dans d’autres temporalités :celle du travail qui manque ou déborde, celle des factures qui arrivent avant les fins de mois, celle des vies qui se réparent sans subventions, sans cabinets, sans tribunes. Alors oui, on nous demande de voter. Mais voter pour quoi, si la distance ne cesse de s’élargir entre ceux qui parlent et ceux à qui l’on parle ? On ne reproche pas aux élus d’être tous payés grassement : on constate qu’ils sont séparés.
Séparés des conditions ordinaires, séparés des conséquences concrètes, séparés du bruit du monde.La crise n’est pas une crise de participation.C’est une crise de position.Et tant que le système ne dira pas d’où il parle, tant qu’il ne reconnaîtra pas la distance qu’il a lui-même produite, il pourra bien multiplier les appels au civisme :la parole ne portera plus. Car pour qu’une démocratie vive, il ne suffit pas que le peuple parle. Il faut aussi que ceux qui le représentent sachent d’où ils parlent, et à qui.
Les prix qu’on ne voit plus.
Il y a des moments où ceux qui parlent depuis l’institution annoncent des chiffres qui ne tiennent pas debout :l’essence à huit euros le pain au chocolat à dix centimes, l’inflation à 1 %. Le coût de la vie réduit à une ligne dans un dossier. Ce ne sont pas des erreurs comptables.Ce sont des révélateurs.Car pour se tromper à ce point, il faut déjà avoir quitté le sol. Il faut vivre dans un monde où les prix ne sont plus des expériences, mais des abstractions. Un monde où l’on parle en milliards, où les déplacements sont pris en charge, où les repas sont protocolaires, où les factures ne sont plus des événements mais des documents.Pendant ce temps, le pays réel vit dans une autre gravité.
Le prix de l’essence, c’est la semaine qui se tend.Le prix du pain, c’est le matin qui commence. Le prix de tout, c’est la vie qui se calcule au centime près. Alors quand une voix institutionnelle se trompe massivement, cela produit un effet immédiat :la peur.Non pas la peur du prix annoncé, mais la peur de la distance. La peur que ceux qui décident ne sachent plus ce que coûte la vie. La peur que les décisions soient prises depuis un monde où l’on ne sent plus le poids des choses. Ce n’est pas une question de gauche ou de droite. Ce n’est pas une question de personnes. C’est un effet de système.
Un système qui, à force de se protéger, finit par ne plus voir. Un système qui, à force de parler, finit par ne plus entendre. Un système qui, à force de se légitimer, finit par perdre le contact avec ce qui le fonde : la réalité matérielle des gens. Et c’est là que la peur naît. Dans cet écart entre deux mondes qui ne se croisent plus. Dans cette fracture silencieuse où les mots ne recouvrent plus les choses.
La crise n’est pas dans les prix. Elle est dans la perception des prix. Dans la capacité — ou l’incapacité — de ceux qui parlent au nom du pays à sentir ce que coûte une vie ordinaire. Tant que cette distance persistera, les discours rassurants ne rassureront personne. Car on ne peut pas gouverner un pays dont on ne connaît plus les prix.
Ps: ma retraite maintenant est pratiquement multipliée par trois dans le pays ou je suis soit: 2800 euros, et sans payer de loyer, mais je sais qu'un pain qui coute 27 centimes, ( 400 grammes ),c'est très cher pour le peuple.



