
Agrandissement : Illustration 1

Le 23 mars, Christian Estrosi faisait le tour des plateaux pour clamer à qui voulait bien l’entendre qu’il faisait confiance au Pr. Raoult après avoir été traité lui-même par de la chloroquine. La veille, il annoncait sur Twitter avoir « obtenu satisfaction » avec la décision du CHU de Nice qui autorise désormais la chloroquine pour traiter les personnes atteintes par le coronavirus. Traiter des problèmes politiques que soulève cette affaire passe nécessairement par une étude épistémologique préliminaire des travaux du Pr. Raoult.
La chloroquine est-elle efficace pour traiter le coronavirus ?
Avec un article intitulé « Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19 : results of an openlabel non-randomized clinical trial », le Pr. Raoult et son équipe entendent démontrer l’efficacité de la chloroquine dans le traitement du coronavirus. Si cette étude fait tant polémique ce n’est pas pour ses résultats mais pour les conditions dans lesquelles ils ont été obtenu :
- Le nombre de patient·es est trop faible pour espérer monter un effet statiquement significatif : l’étude a été mené sur 42 patients·tes. 16 faisant parti du groupe de contrôle (non traitées par la chloroquine) et 26 faisant parti du groupe traité par la chloroquine.
- Les charges virales des patient·es ne sont pas communiquées de manière systématique. Or, cela est important car « les patients ne sont pas au même stade de l'infection au début de l'étude, certains sont en train de guérir naturellement et d'autres attendent encore le pic infectieux. Sans ces mesures de charge virale, il est impossible de savoir si la "guérison" est due au traitement ou simplement au système immunitaire des patients. » [Olivier Belli, 2020].
- Lors de l’expérience, 6 patient·es du groupe traité par la chloroquine ont été exclus de l’étude réduisant l’effectif du groupe testé à 20 personnes. Ces personnes ne sont pas prises en compte dans les résultats, pourtant, parmi ces 6 personnes : trois ont été transférées en soin intensif, une a quitté l’hôpital après avoir été testée négative au COVID-19, une a arrêté le traitement pour cause des nausées provoquées par effet secondaire de la choloroquine, une est décédée.
Ainsi l’étude du Pr. Raoult ne correspond pas aux critères de scientificité admis et requis dans les publications en virologie. Or, le respect de ces critères est la condition sine qua none pour prétendre à l’obtention d’un résultat scientifique. En l’état, le résultat n’est ni juste, ni faux, il n’est simplement pas scientifique. Il est donc impossible, pour le moment, de répondre scientifiquement à la question de l’efficacité de la chloroquine pour traiter le coronavirus.
Ce qui choque finalement n’est pas tellement l’article en lui-même mais la communication faite autour de ce dernier. En effet, au regard du nombre de mort·es causé·es par la pandémie, une piste de traitement ne peut qu’être une bonne nouvelle, mais en aucun cas le Pr. Raoult ne peut décemment, comme il le fait, clamer avoir trouvé une solution au coronavirus, du moins pour le moment. Cette attitude a su attirer sur ces travaux une attention médiatique et politique importante dont ne jouissent pas les autres essais cliniques.
Une attitude lourde de conséquences
Cette stratégie n'est pas anodine parce qu’elle commence à orienter des ressources afin de se procurer massivement de la chloroquine comme c’est le cas à Nice aujourd’hui et sûrement dans d’autres villes demain. Elle n'est pas anodine parce qu’en mobilisant publiquement sa parole « d’expert » de manière si catégorique, dans une situation qui mérite de la retenue, le Pr. Raoult participe à l’apparition des cas d’intoxication pour cause d’automédication à la chloroquine dans de nombreux pays. La chloroquine est un médicament déjà très présent au marché noir en Afrique et Asie du Sud Est du fait de son efficacité contre la malaria et donc facile d’accès, loin de toute forme de contrôle et de précautions médicales. Le tout alors, qu’à ce stade, rien n’indique que ce traitement sera plus efficace qu’un autre essai clinique, ou même que le traitement sera efficace tout court.
Le savant est le politique
Dans une interview donnée à BFM TV le 23 mars, Christian Estrosi, testé positif au COVID-19 et traité par la chloroquine revient sur son traitement et sur la confiance qu’il accorde au Pr. Raoult :
« J’ai le sentiment d’être guéri, je suis en pleine forme tout simplement. J’ai décidé de faire confiance au professeur Raoult pour plusieurs raisons. D’abord parce que je le connais bien, j’ai été à la fois ministre de l’industrie de notre pays et j’ai travaillé avec beaucoup d’infectiologues. J’ai été président de cette région et en tant que président du conseil de surveillance du CHU de Nice c’est un homme auquel j’ai le devoir de faire confiance parce que toute sa carrière prouve que toutes ses recherches ont été à la fois porteuse d’espoir et de résultats. ».
Cette confiance qu'accorde, à titre personnel, Christian Estrosi au Pr. Raoult s’est traduite par une décision de politique scientifique le 22 mars, date à laquelle le CHU de Nice a décidé d’autoriser la chloroquine pour traiter les personnes atteintes par le coronavirus sous « l’impulsion » (sûrement un euphémisme) de Christian Estrosi. Cette décision et leurs motivations posent tout un tas de problèmes.
Un maire omniscient et omnipotent
Tout d’abord, un·e maire·sse ne devrait pas pouvoir décider des traitements appliqués dans sa ville à la place des autorités sanitaires. Cette décision, au-delà du fait de briser le principe d’égal accès aux soins entre les citoyenn·es inaugure une jurisprudence inquiétante. A Nice, utiliser la chloroquine se fait d’ailleurs contre l’avis de l’OMS qui condamne « l’usage de médicaments sans preuve de leur efficacité ».
Estrosi est président du conseil de Surveillance du CHU de Nice, certes. Cela dit le conseil de surveillance d’un CHU a pour vocation de « se prononcer sur les orientations stratégiques de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur sa gestion et sa santé financière ». Le projet médical est quant à lui approuvé par « Le directoire ». Il est donc étonnant, pour ne pas dire choquant, que l’avis d’Estrosi sur le projet médical pèse si fortement sur les décisions, d’autant qu’il est assez clair pour tout le monde que sa présence dans les instances du CHU n’est clairement pas due à ses compétences scientifiques. Cette décision soulève de vraies questions sur l’indépendance du comité médical au sein du directoire du CHU niçois et pose plus globalement la question de l’ingérence du politique dans le domaine scientifique.
Nous n’avons pas besoin de faire confiance au professeur Raoult
Ici nous allons aborder l’argument d’Estrosi qui consiste à dire qu’il faut « faire confiance » au Pr. Raoult. Il faudrait lui faire confiance car Estrosi, qui ne manque pas de rappeler qu’il a été ministre, le considère comme un grand chercheur auquel il fait lui-même fait confiance. Ce type d’argument, quoi que l’on pense d’Estrosi finalement, n’est absolument pas pertinent pour juger de la scientificité des travaux du Pr. Raoult.
La situation est identique à celle que nous avons vécus il y a quelques mois lorsque ministres et député·es ont fait le tour des plateaux pour nous expliquer que Jean-Paul Delevoye était « de bonne foi » alors que celui-ci était accusé de ne pas avoir déclaré certaines activités dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La tribune de Clément Viktorovitch avait alors été synthétique : « l’argument de la « bonne foi » de Delevoye est tout simplement irrecevable. La seule chose qui compte c’était d’une part les faits, d’autre part le droit, et en aucun cas leur ressenti personnel ». Le constat est le même ici à propos de la confiance qu’accorde Estrosi au Pr. Raoult. La seule chose qui compte dans cette affaire c’est d’une part l’article écrit par le professeur et son équipe et d’autre part les règles scientifiques propres à ce champ d’étude.
Je ne dis pas qu’Estrosi à tort de faire confiance au Pr. Raoult, je ne dis pas non plus qu’il a raison, je dis simplement que cette considération n’a pas lieu d’être et qu’elle est irrecevable pour juger de la scientificité des travaux du Pr. Raoult.
Finalement, concernant l’argument qui consiste à dire que lui s’est fait traité par cette méthode et qu’il « se sent guéri » … Il est assez évident que cet argument ne peut pas faire office d’argument scientifique. Si c’est si évident c’est justement parce que nous avons tous et toutes une connaissance ne serait-ce que minime des règles scientifiques qui peuvent prévaloir en médecine. Ces critères de scientificité existent justement pour pouvoir faire la différence entre ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas.
Mieux vaut prévenir que guérir
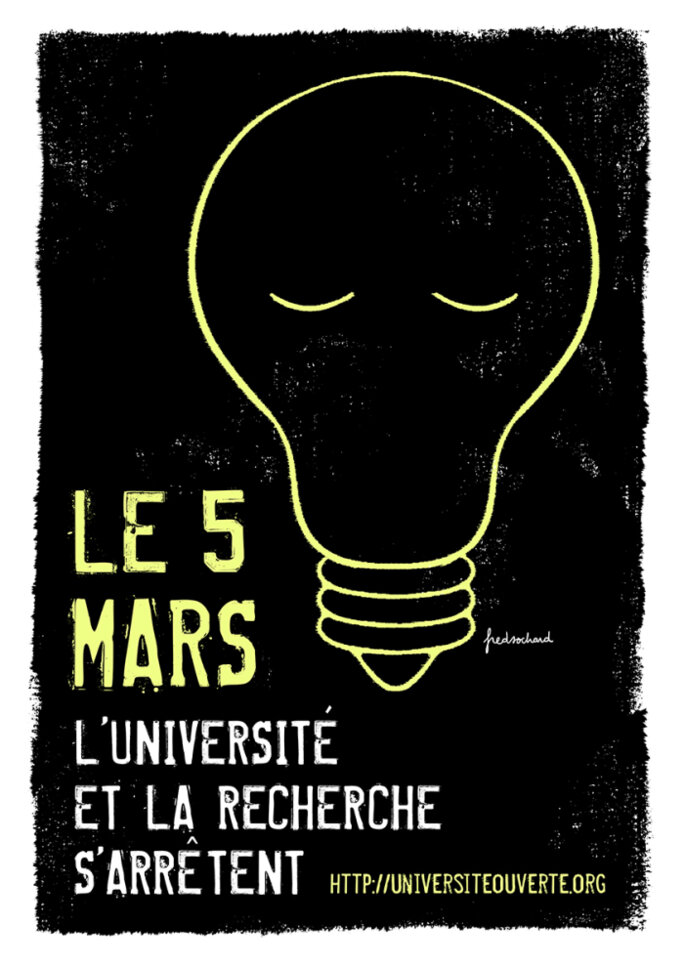
Agrandissement : Illustration 2
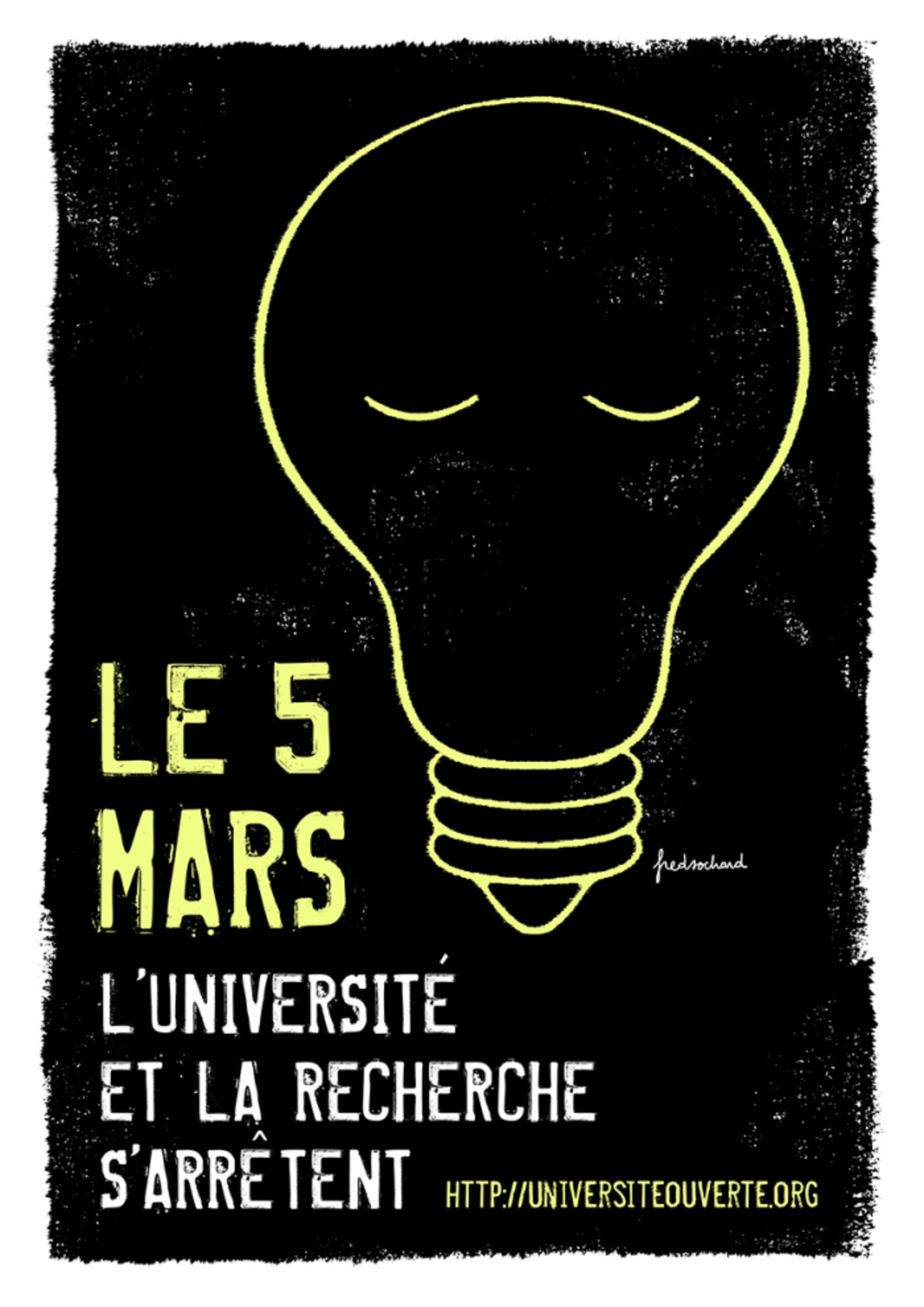
Enfin, il n’est pas possible de conclure ce billet sans parler de la gouvernance de la recherche. Hasard du calendrier, peu de temps avant le début de la pandémie le monde de la recherche était largement mobilisé contre un projet de réforme (appelé « Loi de programmation pluriannuelle de la recherche »). Ce mouvement dénonce entre autres le manque de moyens de la recherche et les conditions de travail notamment des jeunes chercheurs et chercheuses en France. C’est justement ce que dénonce Bruno Canard (directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille, dont l’équipe travaille sur les virus ARN dont font partie les coronavirus) dans un billet de blog intitulé « la science ne marche pas dans l’urgence » qu’il faut lire absolument.
Evidemment que l’on pourrait espérer des politiques et des scientifiques à la hauteur de la crise. Mais pour ne pas devoir reposer sur ces espoirs et pour éviter ce genre de situation où un scientifique joue au sauveur, où un politique joue au scientifique, le tout dans un tourbillon médiatique rendu possible par cette période de crise, la meilleure solution reste d’anticiper ces crises. Pour cela il nous aurait fallu en amont une bonne politique de gouvernance de la recherche et des institutions politiques saines. Une fois la crise arrivée nous ne pouvons que constater les dégâts, et les subir alors que les responsables appellent à l'unité nationale.



