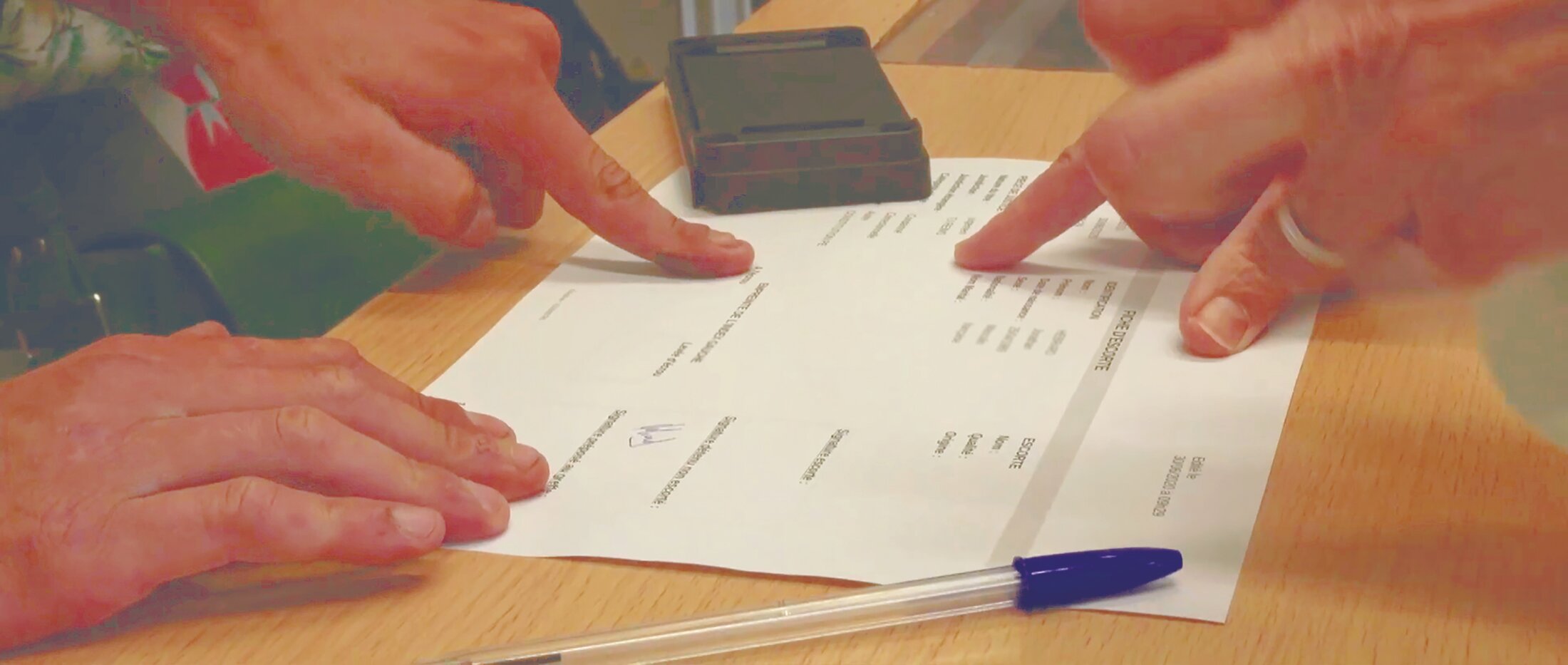« Comparé à la détention, on est libre, mais seulement à moitié », tente de résumer Romain[1], placé à l’extérieur pendant six mois aux Foyers Matter, à Lyon. Comment rendre compte de cette peine ambiguë, dépourvue de barreaux mais qui impose de respecter de soi-même un certain nombre d’obligations ? Les réponses sont aussi nombreuses que les individus. « Je suis dehors, ça n’a pas de prix », balaie Cédric, suivi depuis trois mois par le Casp-Arapej à Aulnay-sous-Bois. Marion, résidente de la ferme Emmaüs de Baudonne (voir p. 30), tranche quant à elle : « Si je ne peux pas me permettre d’aller boire un verre avec une copine à Bayonne et d’y rester jusqu’à trois heures du matin, je suis toujours en prison. »
Les contraintes du placement à l’extérieur sont en partie énoncées par le juge : interdiction de paraître sur un certain territoire, de voir certaines personnes, obligation de soins… Les autres résultent du cadre de la structure d’accueil. La plupart du temps, la mesure est construite autour de contraintes horaires et du suivi d’un planning d’activités ou de démarches à entreprendre : rendez-vous avec l’éducateur ou le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (Cpip), travail, recherche d’emploi, de formation ou de logement, suivi psychologique… Mais l’étendue de ces contraintes varie considérablement d’une structure et d’un individu à l’autre. Certaines personnes ne peuvent sortir que sur une plage horaire et un périmètre géographique restreints, quand d’autres ont seulement l’obligation d’être présentes au logement à partir d’une certaine heure le soir. Selon les cas, cette présence peut être vérifiée par des visites ou des appels téléphoniques, à heure fixe ou de façon aléatoire… Il est d’ailleurs fréquent que le cadre évolue, en fonction du comportement ou du temps passé.
Beaucoup de personnes placées le disent : la perception de ces contraintes, elle aussi, évolue avec le temps. Pour celles qui sortent de détention, au départ, le changement semble radical : ne plus être réveillé par les cris des autres personnes détenues, pouvoir contempler un horizon ouvert, accéder à davantage d’intimité et d’autonomie… « Dans un premier temps, c’est l’euphorie, la libération, se souvient Romain. Mais à la longue, on oublie les bénéfices et on ne voit plus que la bride. On n’est pas comme les autres, on doit rentrer à 19h pendant que tout le monde va faire un barbecue… » S’imposer des restrictions de mouvement alors qu’aucune barrière physique n’y oblige, rendre compte en permanence de son emploi du temps et de nombreux aspects de sa vie, peuvent alors rapidement devenir insupportables. Et ce, d’autant plus pour ceux qui ne sont pas passés par la case prison (voir p.31).
Comment les personnes placées expliquent-elles malgré tout s’en accommoder ? De la conscience d’être toujours en train de purger une peine à l’ancrage dans une routine cadrée, en passant par l’intégration d’une prime au « mérite », les facteurs invoqués varient mais se recoupent fréquemment. L’ombre de la prison continue de planer : si les choses tournent vraiment mal, c’est elle qui est au bout du chemin. Mais domine souvent le sentiment d’une période tendue vers la préparation de la suite, durant laquelle il importe de rester concentré sur ses objectifs en s’appuyant sur l’accompagnement proposé. « Je suis focus sur ma vie, le fait de reprendre vraiment les choses en main », explique Cédric. Un projet qui dans l’immédiat impose la patience, et s’ancre souvent dans une volonté de stabilité liée à l’âge : « Avec dix ans de moins, je ne suis pas sûr que j’aurais supporté les choses de la même manière, note Romain. Avoir un peu de cadre au début, ça me balisait la route, ça évitait les écarts. Et quand les choses réussissent, ça passe mieux : j’ai pu trouver un logement, un travail… Le placement à l’extérieur m’a aidé, rien à dire. Mais ça marche à la confiance, et j’ai été correct. »
Cette idée d’un contrat à honorer, voire d’une chance à saisir, revient régulièrement. Car le placement à l’extérieur donne aussi accès à un soutien multiforme, souvent favorablement comparé aux autres aménagements de peine – à commencer par la possibilité de trouver un toit hors de la prison. « En semi-liberté, tu peux rentrer et sortir, mais tu n’es pas dans ton cocon. Alors que là, tu as des horaires, mais tu as ta chambre, tu peux te poser à la fenêtre le soir pour regarder dehors… » décrit Cédric. Beaucoup disent avoir mis à profit cette période pour trouver des ressources sur lesquelles s’appuyer. Après un contrat de réinsertion, Romain a obtenu un CDI dans une autre entreprise, et il reste hébergé aux Foyers Matter en attendant de trouver un logement. Marion, quant à elle, a décroché un stage et une formation dans le domaine qui lui plaît. Et avant d’en arriver à ces résultats tangibles, « le fait de savoir que l’on n’est pas seul, qu’il y a des gens qui sont là pour vous aider, c’est rassurant », souligne Romain.
Mais le placement à l’extérieur est aussi décrit comme un moment de profond bouleversement intérieur. Pour ceux qui sortent de détention, la réadaptation progressive à la vie en société, l’acquisition de nouveaux repères, peuvent représenter de sérieux défis, tout comme la confrontation aux traces invisibles de la prison que beaucoup disent porter en eux. Dans tous les cas, c’est une période de transition marquée par un saut dans l’inconnu et de multiples remises en question. Et tous le disent : « Il faut être prêt. » « J’ai tout calculé avant de me lancer, je me suis dit que ça n’allait pas être simple, raconte Cédric. Mais il ne s’agit pas de revenir à la case départ. »
[1] Les prénoms ont été modifiés
Aller + loin - Pour les structures d’accueil, une position ambiguë
Conventionnées par l’État pour accueillir des personnes placées sous main de justice, les associations qui encadrent les placements à l’extérieur s’engagent à rendre compte aux autorités de certains de leurs agissements. « D’un côté, on noue un lien de confiance avec les personnes qu’on accompagne, et de l’autre, on doit faire remonter les incidents au Spip [service pénitentiaire d’insertion et de probation] et au juge. Cette double casquette n’est pas du tout évidente à porter », souligne Marion Moulin, déléguée générale de l’association Possible et longtemps impliquée dans le développement des fermes d’insertion Emmaüs. Une ambiguïté que tous les professionnels reconnaissent, et qu’ils disent souvent gérer en étant clairs dès le départ et en restant dans leur rôle. « Quand j’en réfère au Spip, je le dis toujours aux personnes suivies. Mais c’est toujours un cas de conscience, c’est pourquoi la responsabilité est prise au niveau de la coordination ou de la direction », explique Justine Baranger, directrice Justice du Casp-Arapej en Île-de-France. « Être clair fait partie du respect que nous nous devons. Et l’expérience m’a fait évoluer, je considère désormais qu’en placement à l’extérieur, le contrôle fait partie intégrante du travail éducatif », assume quant à elle Nora Hannou, directrice adjointe du pôle socio-judiciaire d’Apremis dans la Somme.
Tout dépend souvent des relations établies avec les Spip et les magistrats. Lorsqu’elles sont confiantes et que tout le monde partage la même vision du placement, l’information circule d’autant plus facilement que les responsables associatifs ne craignent pas qu’elles débouchent sur des conséquences inappropriées. « Les Jap [juges de l’application des peines] ne prennent jamais de décision sans nous consulter, nous et le Spip », témoigne l’un d’eux. Mais à l’inverse, les obligations de surveillance des structures d’accueil et la gestion des incidents peuvent constituer des points de friction récurrents quand les partenaires se connaissent mal ou n’en ont pas la même vision. « Chaque structure négocie avec ses interlocuteurs judiciaires et pénitentiaires locaux, et certains, inquiets, peuvent avoir des demandes assez déraisonnables par rapport aux capacités de la structure ou au sens de la mesure », pointe Marion Moulin, qui donne l’exemple de velléités de faire interdire toute consommation d’alcool.
Autant de facteurs qui peuvent faire considérablement varier les obligations de surveillance et la rigidité de leur interprétation d’une structure à l’autre. La redéfinition d’un socle commun compte parmi les chantiers ouverts actuellement par la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap) et les fédérations nationales d’associations qui encadrent des placements à l’extérieur.
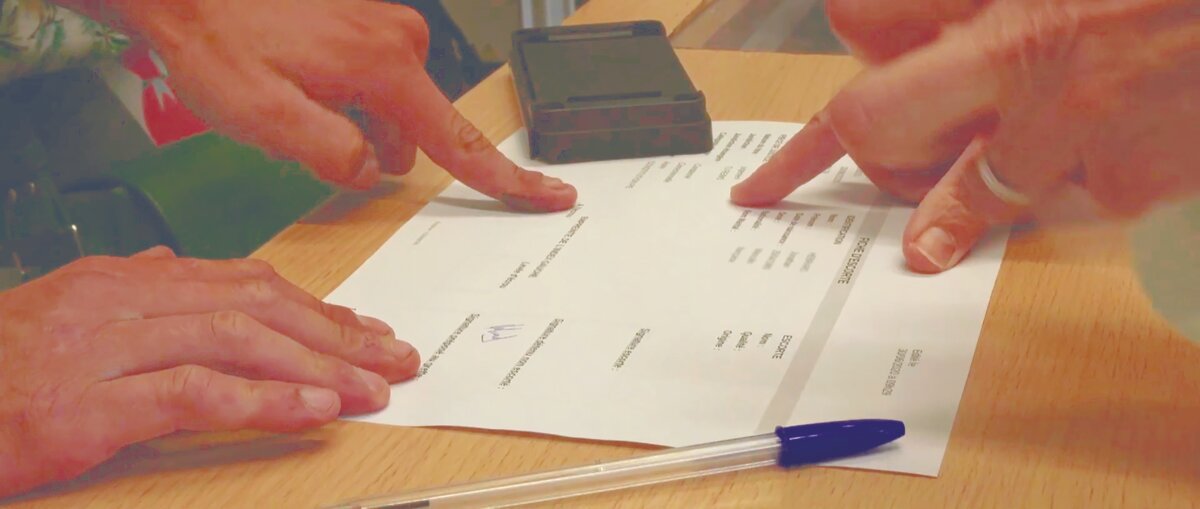
Agrandissement : Illustration 1