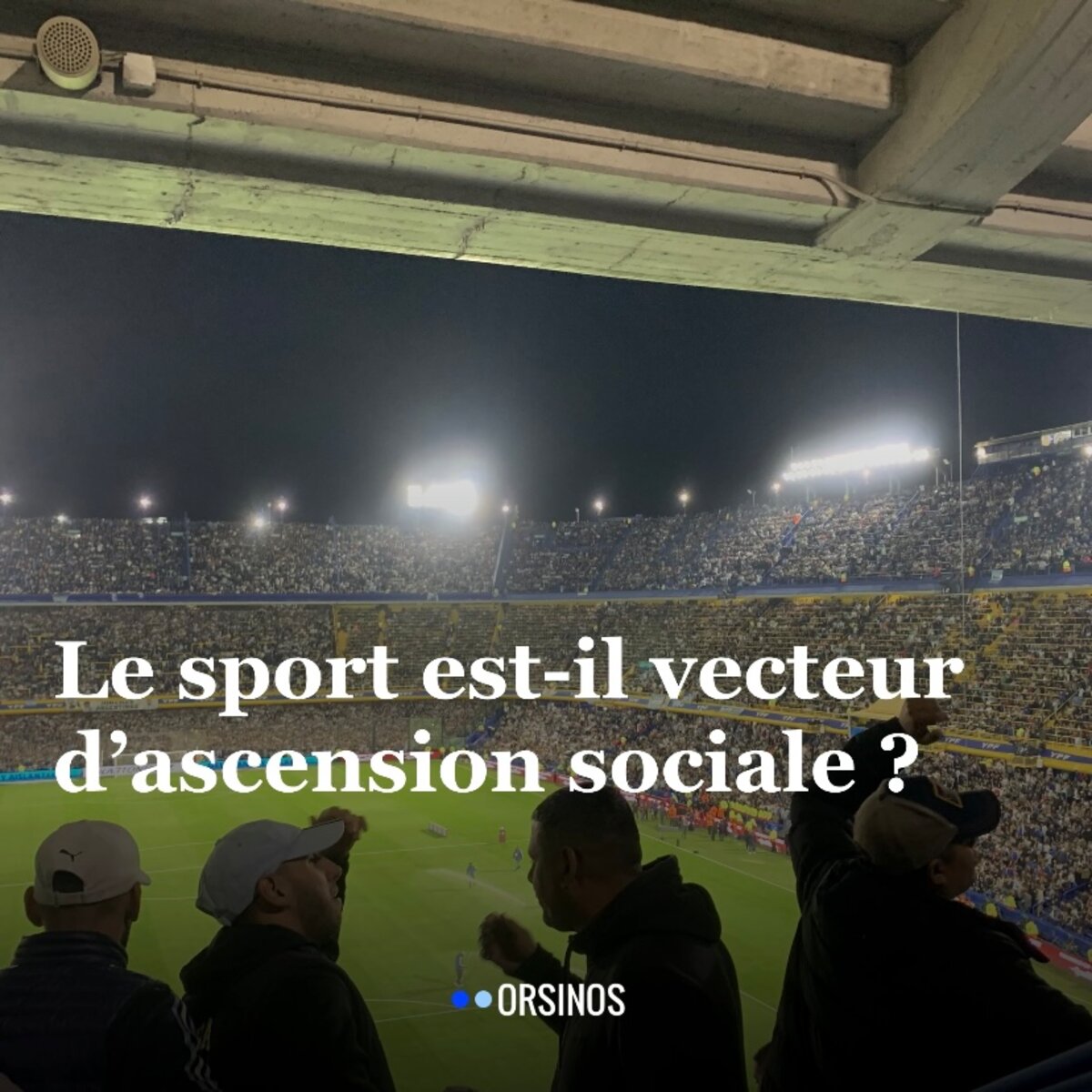
Agrandissement : Illustration 1
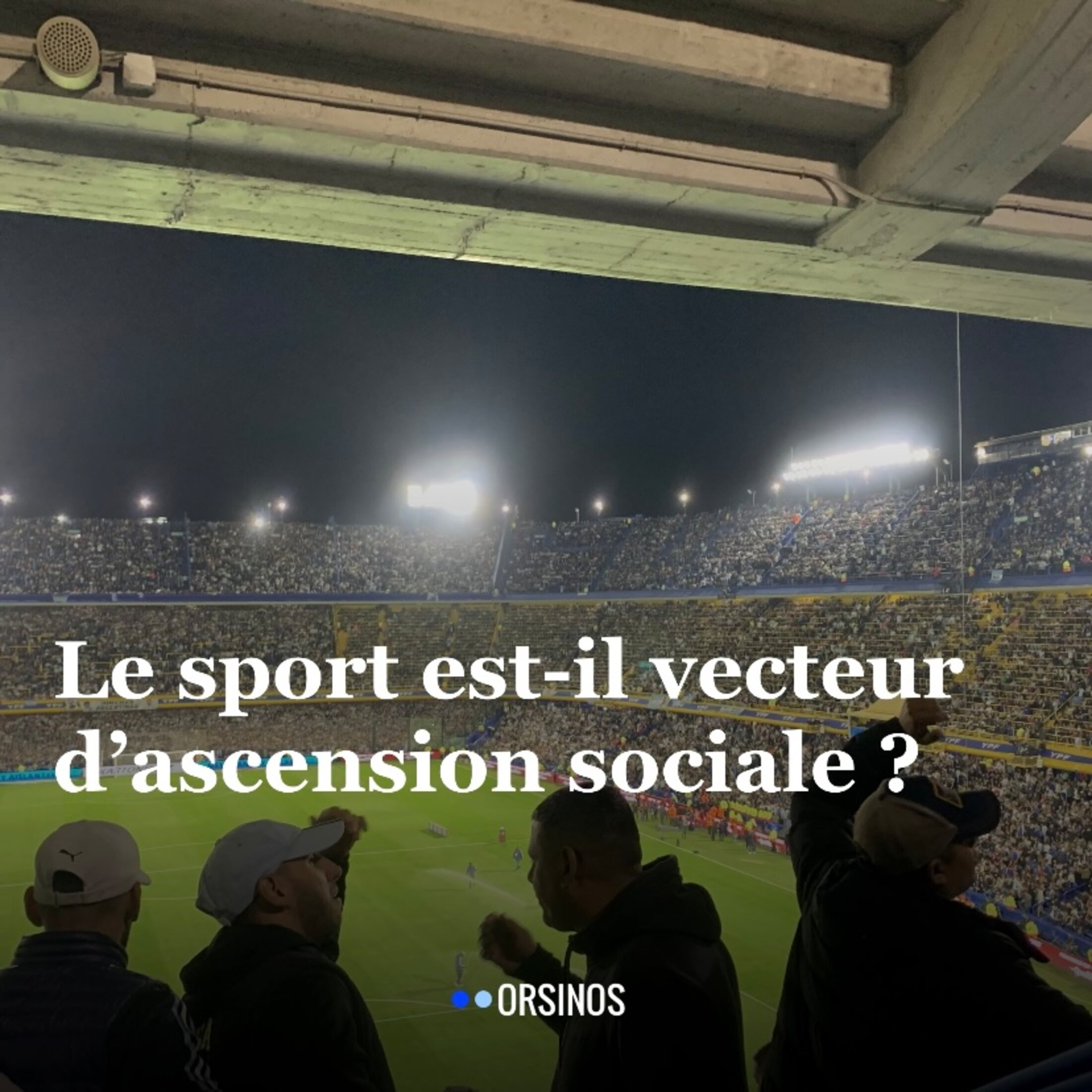
Une thèse régulièrement reprise dans les unes de nombreux journaux qui alimentent sans cesse cette idée et participent à la faire entrer dans nos imaginaires communs. Le sport, par nature, serait synonyme d’égalité de toutes et tous. Il neutraliserait au maximum les inégalités au départ d’une compétition pour les constater seulement à l’arrivée. Par le sport serait alors créée une hiérarchie fondée exclusivement sur le mérite ; par le biais de cette seule pratique ; et qui n’aurait en rien à voir avec le social. Les grandes figures du sport sont ainsi régulièrement présentées comme des symboles de mérite et comme des archétypes de réussite sociale ; les grands champions français, issus de milieux précaires et/ou de générations d’immigrés incarnerait « l’égalité républicaine».
Par le sport nous ne considérons pas les pratiques individuelles non encadrées (celles-ci étant reconnues comme activités physiques et non comme sport), mais bien la pratique sportive compétitive et institutionnalisée.
Sport et culture de classe
Le sport est une pratique historiquement réservée à quelques-uns. Il passe son temps à entretenir des différences sociales sur la base de discriminations et son accès n’est aujourd’hui toujours pas égalitaire. Si, sur la ligne de départ d’une compétition, ce biais social n’est pas apparent, c’est bien dans l’envers du décor que celui-ci existe. Il ne s’agit pas ici d’empêcher de rêver, mais de s’interroger sur le poids des dispositions sociales dans la réussite sportive.
Le sport, une pratique de cadre qui augmente plus nous sommes haut dans la société
Le sport, sociologiquement, s’adresse aux classes sociales les plus élevées. Plus notre position sociale est haute, plus les chances de faire du sport augmentent. La pratique sportive augmente aussi avec un diplôme. Plus celui-ci est élevé, plus nous avons de chance de pratiquer. De la même manière, les élites sportives sont souvent issues de familles « sportives » favorisant le développement de l’excellence. Plusieurs études se sont intéressées au rôle de la famille dans la réussite sportive et convergent toutes vers ce constat : plus les ressources économiques des familles, les configurations familiales et les dispositions temporelles sont importantes, plus les chances de réussite sportive le sont en conséquence.
Dans une société dominée par une logique libérale qui fait du sport un lieu d’expression seulement individuelle et non d’expression sociale, il paraît nécessaire de mettre à distance l’idée du sport comme vecteur d’ascension sociale. Le sport est avant tout l’expression d’une hiérarchie de classes. Le passage à l’élite, quant à lui, reste conditionné par le groupe social.
L’entrée dans l’espace professionnel
Les études portées sur le sujet font part des inégalités perçues dans le processus de sélection des professionnels. Notamment dans les centres de formation, les pôles espoir où les sections sportives (la réussite sportive y étant fortement favorisée même s’il n’est pas obligatoire d’y passer). Là encore, les dispositions sociales impactent fortement les chances d’entrer dans ce type d’institution. Là où l’on pourrait croire que seules les performances sportives agissent, on découvre que le poids des systèmes sociaux, la sphère familiale et les institutions sportives influent sur le processus de sélection des sportifs. La majorité des jeunes sportifs de haut niveau proviennent ainsi de classes sociales favorisées, quand moins d’un jeune sur cinq pourrait provenir des classes populaires.
« Je peux parler pour le PSG, je peux parler aussi pour Le Havre, […] je vois les effectifs de jeunes et je ne vois pas de discrimination. […] S’il y a bien un milieu où il n’y a pas de discrimination, s’il y a bien un milieu où l’ascenseur social est possible, c’est le foot en particulier, le sport collectif en général. »
Là encore, selon Damien Degorre en 2018, chroniqueur dans l’émission L’Équipe Du Soir sur la chaîne TV L’Équipe 21, les effectifs des clubs français, pour la pratique du football, démontreraient l’absence de toute discrimination sociale dans le sport. Les effectifs des jeunes du PSG ne permettent cependant pas de faire des généralités quant à l’égalité des chances dans le milieu sportif. Le rêve du sport est loin d’incarner une réponse sociale viable pour les populations qui en ont le plus besoin. L’égalité des chances dans le sport n’existe pas, pas plus que dans toute autre sphère sociale.
L’ascenseur social par le sport est quant à lui possible, pour une petite marge de la population seulement. Il est vrai que certains sports populaires comme le football ou le basket-ball s’adressent plus facilement aux classes sociales précaires et permettent en conséquence une mobilité sociale. Faire de ce constat une généralité quant à la mobilité sociale par le sport ne reste cependant qu’un biais de pensée. Le sport, structurellement, ne permet pas cette ascension sociale, parce que la réussite sportive est une réussite de la marge, loin d’être égalitaire. Damien Degorre illustre ici le parfait décalage entre les idéaux et la réalité objective portée au sport.
Rédaction François Perdriau, Orsinos.



