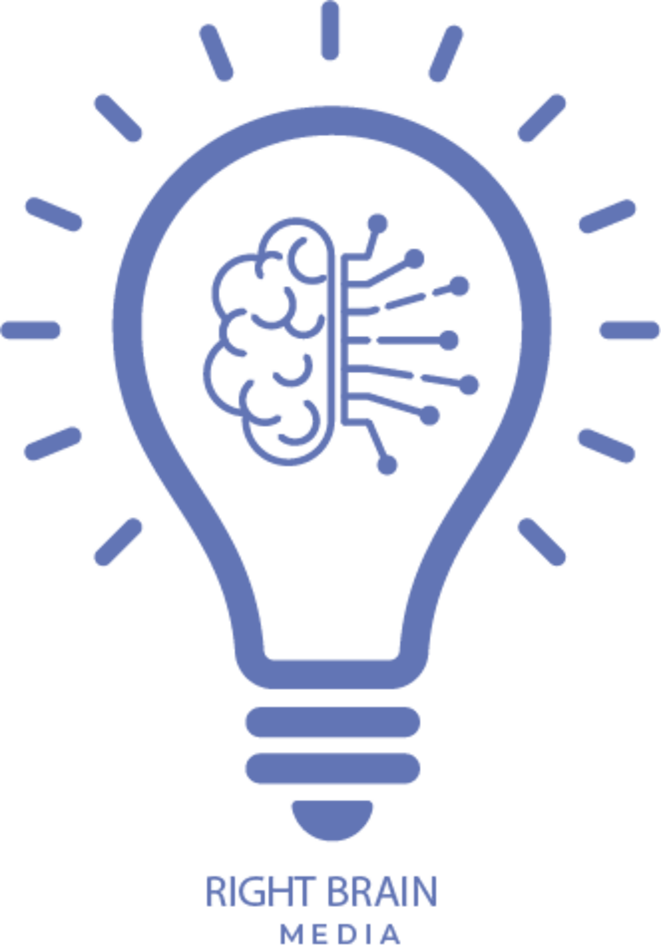Nous sommes en octobre 2007. Je suis en classe de CE2. La veille, l’institutrice demande à tous les enfants de la classe d’utiliser un compas. L’exercice consiste à le déplacer sur une feuille, afin d’obtenir un rond à 90° sur un triangle. À la différence des autres élèves, je ne rendrai jamais cet exercice à faire chez soi. À l’hôpital, l’ergothérapeute me voyant tous les mercredis tente tout pour que je réussisse l’exercice : mettre un sous-main, faire l’exercice devant moi. Rien n’y fait. Je n’y arrive pas. Aujourd’hui, une trentaine d’intelligences artificielles m’aide au travail pour découper le magazine que vous tenez entre les mains, ajuster les marges ou tracer les diagrammes des pages financières du journal. Ces méthodes de travail, basées sur l’utilisation de logiciels coûteux, vont totalement à l’encontre de celles adoptées dans le groupe où travaille Aurélie Devalée.
Un ancien directeur de département de l’école Bellecour, à Lyon, témoigne dans le livre Le Cube de Claire Marchal : « On a des salles où les jeunes n’ont même plus la place de s’asseoir, ils restent debout ou sur les tables pendant le cours, c’est n’importe quoi. » Ce cadre évoque un effectif de 450 étudiants pour une capacité réglementaire de 300 dans un bâtiment ERP 4. Dans ce contexte, il est impossible d’identifier les besoins spécifiques des personnes autistes ou dyspraxiques que j’accompagne tous les jours. Leurs besoins sont détaillés par Bernard Jumel dans son livre Aide-mémoire – Troubles des apprentissages. Pour ces derniers, l’espace d’apprentissage constitue une extension du corps, une interface structurante. Jumel insiste sur l’importance de l’organisation de l’espace en trois dimensions – hauteur, profondeur, largeur – en écho au schéma corporel. « Le corps est au point de départ de l’action ; elle s’ordonne à partir de lui, et il impose à cet espace extérieur ses propres coordonnées », écrit-il. Quel repère peut-on construire quand les salles sont surchargées, quand les professeurs ne peuvent même plus circuler ? Aucun.
Mise à l’écart
L’entreprise d’Aurélie Devalée, propriétaire de plusieurs établissements privés, n’est pas seulement inadaptée d’un point de vue sensoriel. Elle l’est aussi du point de vue cognitif. Jumel, dans sa définition de la dyspraxie, parle de « défaut du schéma corporel » et de « précarité du fonctionnement posturo-moteur ». Il écrit que « le développement mental du dyspraxique montre qu’il peut y avoir rupture entre le graphisme du dessin et celui de l’écriture cursive ». Autrement dit, le risque d’échec de ces étudiants dans un cours de dessin à Bellecour, ou de programmation informatique dans l’une des écoles de jeu vidéo détenues par Galileo, est énorme.
Lorsque ces échecs scolaires se répètent, l’école adopte des méthodes radicales. Comme l’écrit Claire Marchal, « les élèves les plus mauvais ne sont pas présentés à la certification […] on ne leur donne que le diplôme d’école, un document en carton ». Il ne s’agit pas d’un accompagnement, mais d’une mise à l’écart dissimulée sous le vernis d’une stratégie commerciale. Face à l’autisme ou la dyspraxie, qui est définie dans la CFTMEA R-2012 comme « un trouble du geste en relation avec un trouble de l’intégration de l’image du corps et des représentations spatiales », on ne peut se contenter d’un encadrement standardisé. Jumel met en garde : « Le schéma corporel est précarisé, les limites du corps sont floues », ce qui implique des besoins spécifiques dans un cours consacré à l’apprentissage du dessin, à la conception de logos sur Illustrator ou à tout autre acquis pédagogique pouvant être demandé dans les écoles Galileo.
« L’école est devenue une machine de guerre destinée à presser le citron », écrit un ancien professeur dans Le Cube, avant d’ajouter qu’on y sélectionne les élèves non pas en fonction de leur potentiel, mais de leur capacité à ne pas faire baisser les statistiques. Le cynisme de l’entreprise transparaît jusque dans les propos de ses cadres. Lors d’un comité de direction, un directeur de pôle aurait déclaré en riant : « Les piou-pious, tu les serres, ils couinent un peu au début, mais ça passe ! »
Dans ce contexte, que vaut une prise de parole d’Aurélie Devalée sur l’inclusion ? Il est légitime de se demander quelle est la sincérité d’une ancienne ergothérapeute ayant cautionné de telles dérives pédagogiques.
Comprenons leurs difficultés
Rien n’y est prévu pour des profils ayant besoin de logiciels coûteux et d’une aide humaine ; rien n’est adapté à l’organisation mentale spécifique de ces étudiants pour qui, comme l’écrit Bernard Jumel, « la reproduction des figures est d’autant plus difficile que le modèle est présent ». La pédagogie de la démonstration par saturation, qui repose sur des visuels constants, des planches PowerPoint projetées sans filtre, voire des cours enregistrés à l’avance dans le pire des cas, est d’une violence cognitive à leur encontre.
Ainsi, les méthodes pédagogiques décrites dans Le Cube favorisent les évaluations non différenciées, les surcharges d’emploi du temps et les injonctions paradoxales. Dès le cours préparatoire, ils identifient mal certaines règles de calcul ou la structure grammaticale d’une phrase. Aujourd’hui, mon entreprise investit dans les IA mises à disposition par Adobe pour que des numéros soient générés automatiquement sur notre journal print. Il arrive aussi que deux paragraphes identiques soient insérés dans ces maquettes. Jumel écrit que « les enfants présentant des traits de la série dyspraxique offrent quasiment un tableau en miroir de ceux présentant de très gros retards en lecture ».
Au lieu de répondre à ces difficultés par l’ajustement pédagogique, Galileo répond par la production industrielle. L’accompagnement que méritent ces jeunes passe par une pédagogie du détour, des évaluations sans surcharge spatiale ni graphique. « Les étudiants sont considérés comme des produits », comme l’écrit Claire Marchal. Les méthodes de Galileo ne relèvent donc pas de l’improvisation managériale : elles sont, sur le plan clinique, contraires aux besoins définis pour les plus fragiles à Rightbrain Magazine. Nous n’avons aucune information sur les méthodes d’Aurélie Devalée pour simplifier les consignes données par les professeurs de Bellecour ou de l’école d’art Lisaa. Il ne s’agit donc pas d’un défaut d’adaptation, mais d’une incompatibilité radicale.
Souhaites-tu que je le mette aussi en HTML ou dans un fichier téléchargeable ?