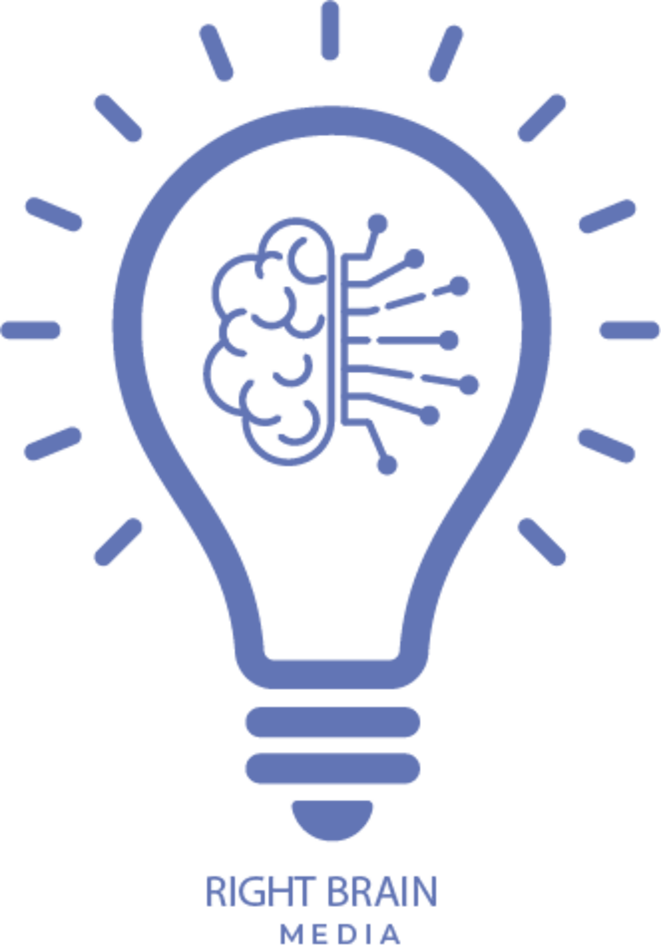Macron et les défenseurs de l'enseignement privé
Dans cette tourmente politique où les révélations fusent et où les accusations de mensonge planent, le nom d'Amélie Oudéa Castéra résonne désormais au cœur d'une polémique qui fait grand bruit. Selon les dires de la ministre, son fils aîné aurait subi un nombre considérable d'heures non sérieusement remplacées dans l'école publique voisine, justifiant ainsi le recours à l'établissement privé parisien Stanislas. Cependant, cette justification a été rapidement démentie par l'ancienne institutrice de son fils, jetant un doute sérieux sur la véracité des propos de la ministre, qui n'aurait pas accepté que l'institutrice de Vincent, né en 2006, ne le juge pas assez mature pour passer en moyenne section. La polémique prend une ampleur particulière lorsque l'on considère le contexte de la politique éducative en France. Dès 2017, le premier ministre "macroniste" de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait créé une controverse en nommant au poste de directeur de son cabinet Christophe Kerrero. Dans un livre intitulé École, démocratie et société, cet ancien conseiller de Luc Chatel, laissait peu de doutes sur ses préférences pour l'école privée. Kerrero comparait ouvertement l'école publique à un "paysage éducatif miné par le pédagogisme". Le ministre lui-même, dans ses déclarations publiques, ne cachait pas son orientation, exprimant son attachement à l'école publique tout en reconnaissant qu'il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer du privé, des très onéreuses écoles Montessori pour les plus jeunes, voire de modèles étrangers, tout en mettant en avant la valeur de la liberté dans l'éducation. Cette polarisation du débat autour de l'école privée, associée à une rhétorique qui oppose "pédagogisme" et "égalitarisme", met en lumière les clivages profonds au sein du monde éducatif français.
Liberté ou égalité, laquelle doit primer ?
Comme la famille Oudéa-Castéra, de nombreux Français estiment que l'égalité doit être au cœur de l'éducation, tandis que d'autres considèrent que la liberté bien conçue peut favoriser l'égalité. Au cœur du débat sur l'éducation privée en France, les positions des ministres de l'Éducation d'Emmanuel Macron, ayant majoritairement scolarisé leurs enfants dans le privé, méritent une attention particulière. En effet, dès 2017, Jean-Michel Blanquer a apporté un soutien franc à des initiatives privées telles qu'Espérance Banlieues, une organisation qui gère des écoles hors contrat visant à offrir une éducation de qualité dans les quartiers défavorisés, tout en discriminant des étudiants issus de la diversité, comme l'a révélé Mediapart il y a quelques mois. Lors du premier quinquennat macronien, l'ancien directeur de l'Essec avait même qualifié cette réalisation de "digne de son soutien", affirmant que cela "correspondait à la direction que le secteur public et privé devrait prendre pour contribuer à l'intérêt général et à la réussite de tous les élèves du pays." Ce soutien sans équivoque à des initiatives privées comme Espérance Banlieues, coordonnée par de grands patrons français pour familiariser des jeunes issus de l'immigration avec une sorte de patriotisme à la française, n'a pas échappé à l'attention du monde éducatif. Cette prise de position, audacieuse pour un ministre de l'Éducation, peut être interprétée comme une dérive de notre modèle éducatif à la française ou, depuis 1881, l'école de Jules Ferry, publique, gratuite et laïque, a toujours été valorisée dans le débat public par les partis progressistes . De plus, dans sa quête pour affirmer ses idées sur l'éducation et se forger une réputation de "ministrable", Jean-Michel Blanquer avait publié des ouvrages plutôt favorables à l'enseignement privé, tels que L'école de demain, sorti en 2016 avec le soutien de l'Institut Montaigne, un think tank généralement qualifié de "libéral". Ces propositions pour une éducation nationale rénovée comprenaient des éléments tels que la large autonomie des établissements d'enseignement privé, des mesures que la gauche enseignante qualifie de "néolibérales" depuis plus de dix ans. Ainsi, cette convergence d'idées entre les ministres de l'Éducation d'Emmanuel Macron et des think tanks ayant des positions aussi libérales que l'Institut Montaigne soulève des questions sur les influences et les orientations idéologiques qui guident les réformes éducatives en France.
Sa démission souligne les tensions au sein du monde éducatif et l'inquiétude croissante concernant l'éducation privée
Sur les questions liées aux divergences public/privé, d'autres voix se font entendre, telles que celle de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Ce matin, des journalistes de Libération indiquaient qu'elle adopte une position plus nuancée en déclarant : "Je ne sais pas si elle a menti, je dis simplement qu'elle a expliqué pourquoi son fils a été scolarisé dans le privé." Cette réserve dans les commentaires montre que même au sein de la majorité, la question de l'éducation privée suscite des interrogations et des réticences. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, le débat s'intensifie également avec des figures influentes du domaine de l'éducation, comme Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes, qui a très rapidement démissionné. Dans un essai intitulé "Le Système Blanquer," Luc Cédelle, journaliste au Monde, affirme que Lussault a été cité par des journalistes comme une voix critique de la tendance à privilégier les élites dans l'éducation française. "Sa démission souligne les tensions au sein du monde éducatif et l'inquiétude croissante concernant l'éducation privée," indique Cédelle dans son ouvrage. Ainsi, la polémique autour des propos tenus vendredi par la ministre montre qu'il y a des réactions variées à l'égard de l'éducation privée, mettant en évidence l'ampleur du débat en cours en France. Cette controverse complexe soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'éducation dans le pays et sur la manière dont on peut répondre à une question simple, également posée par le journaliste de Mediapart David Perrotin lorsqu'il a enquêté sur le lycée Averroèes : Qu'est-ce qui doit primer entre la liberté de scolariser son enfant où on le souhaite, et l'égalité d'accès au savoir entre les enfants, quel que soit leur classe sociale ?