
Mickey et Charlot, et la fondation de l’AIT. Bakounine et Marx : la guerre déguisée
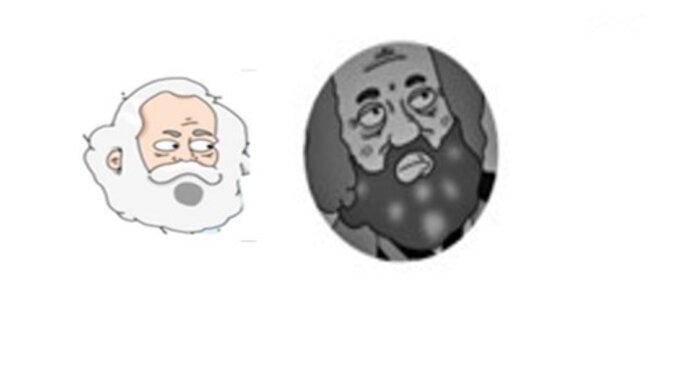
Mickey et l’AIT : une entrée tardive et difficile
Son histoire avec Charlot fut, comme pour Pierrot-Joé, celle d’un rapprochement, lent et avec des orages, mais sans aucun doute un rapprochement. Pierrot-Joé étant mort en 1865, juste après la fondation de l’Internationale en 1864 ; il ne restait plus que nos deux compères. Mickey dut se faire tirer l’oreille pour d’abord accepter le programme des coLibs, puis pour adhérer à l’AIT : il trouvait ce programme en effet réformiste, pour ne pas dire contre-révolutionnaire ; il pestait contre Proudhon d’avoir accepté cette alliance contre nature avec Charlot ; et il trouvait Charlot bien opportuniste et tendant vers le réformisme. Mais les Bakouniniens n’avaient plus beaucoup d’alliés ; seuls les blanquistes et les dissidents proudhoniens radicaux avec Eugène Varlin s’opposaient encore aux coLibs. Quant à faire des risettes à Freddy et à son groupuscule de cocos de Londres, c’était évidemment impossible.
Le chemin fut donc très long et n’aboutit à un accord qu’en 1867-1868 : plus de 15 ans après le Manifeste des coLibs, et plusieurs années après la fondation de l’AIT. Mais Mickey faisait souvent le voyage de la Friterie Charlot à Bruxelles, quand il n’était pas en prison ou en vacances en Sibérie, pour dire leurs quatre vérités à Charlot et Pierrot-Joé sur leur réformisme. Mickey et Charlot ne se mirent ainsi d’accord que très progressivement à partir de 1865, après la disparition de Pierrot-Joé, sur la question fondamentale de l’État dans la Révolution et la société à construire après. La question de l’État, c’était la seule question qui comptât vraiment ; les autres (l’organisation de l’AIT, syndicalisme sans politique ou avec politique) ne faisait qu’en découler. Comment est arrivé ce compromis (à la fin du Second empire) qui devrait pourtant se présenter comme une évidence ? Chacun y mit du sien.
Charlot : 1°/ ne parla plus de dictature du prolétariat (Charlot prononçait de temps en temps DP, rien que pour provoquer Mickey qui, en rigolant, faisait mine de lui tirer l’oreille) et accepta la proposition de Mickey selon laquelle l’État devait disparaître après une courte période transitoire où, mis dans les mains des révolutionnaires, il devait être détruit ; 2°/ laissa tomber définitivement sa proposition de gestion étatique de l’économie et accepta aussi que la production, après expropriation des grands propriétaires fonciers et des capitaux, devait être organisée en autogestion des salariés dans les entreprises industrielles et de service et sous forme de coopératives regroupant les petits paysans. Avec cependant une organisation technique de répartition des revenus entre ces organisations et entre rémunération du travail et retraites. En effet, les différences de fertilité en agriculture et de productivité dans les autres secteurs ne pouvaient qu’entraîner des inégalités sociales qu’il fallait évidemment réguler ; il en était de même entre générations, selon la retraite par répartition.
Mickey : 1°/ d’abord opposé à toute intervention d’un quelconque État, accepta l’organisation, mais transitoire et très courte, de la répression par la classe ouvrière et de la petite paysannerie contre la bourgeoisie et ses alliés, car ces derniers n’allaient pas se faire tondre la laine sur le dos sans résister ; 2°/ il était bien sûr d’accord avec une organisation décentralisée mais tiqua sur la régulation centrale qui sentait encore trop l’État.
Ce n’était pas gagné, mais on avait avancé : il ne restait plus qu’un problème de mot pour nommer la phase transitoire et sa durée et la question de la régulation. Les désaccords furent réglés par tirage au sort, par le jeu de la courte paille et au 421. Le tirage au sort donna un avantage à la régulation technique macroéconomique ; mais, c’était le jeu, Mickey accepta. On se mit également d’accord sur la non-suppression immédiate des échanges marchands et de la monnaie, cependant évidemment régulés. La courte période de répression fut nommée, en évitant de mettre en avant une classe sociale, la « Punition démocratique », infligée aux ennemis de classe, que tout le monde transforma en sigle, la PD, sigle plus rigolard que DP.
Mickey adhéra au mouvement des coLibs dont le Manifeste fut amendé en 1868, et à l’AIT où ce mouvement dominait ; avec Charlot, ils marginalisèrent le vieux coco Freddy. Le renoncement au concept de Dictature du prolétariat et son remplacement par la Punition démocratique faisaient hurler Freddy à Londres. Il insistait toujours dans ses discours sur « l’alliance contre nature germano-russe » des partisans de cette PD et des coLibs. Il eut même l’abject talent de faire comprendre dans toutes les langues de l’AIT ce que le terme PD, Pédé, signifiait en français ! Ce qui devint l’angle d’attaque favori de la minorité qui se désignait elle-même, par raillerie envers les coLibs, comme les cocos : « Communistes plutôt deux fois qu’une », pouvait-on lire sur leur drapeau rouge, orné de deux faucilles et de deux marteaux. La démocratie interne de l’AIT subsistait cependant, le droit de tendance était respecté et les minoritaires nommés les « minos cocos » continuaient leur activité. Dans ses multiples Appels de Londres, ses Adresses où Freddy, dans la minorité communiste de l’AIT, prétendait incarner la résistance au nouveau cours, Charlot était considéré comme un traitre : « L’AIT a perdu une bataille, mais elle n’a pas perdu la guerre », lançait-il. La guerre fut bel et bien perdue par les cocos.
Deux coqs dans l’AIT à partir de 1868 : Bakounine et Marx
Alors que le rapprochement que tenta Marx avec Proudhon (magouille quant à l’histoire de Karl Grün ou véritable tentative de rapprochement) fut un échec, celui entre Bakounine et Marx fut au départ un succès, bien sûr teinté d’une méfiance réciproque et chacun gardant sa spécificité : un anar qui détestait l’État et un coco qui ne parlait que de dictature du prolétariat.
Pour Bakounine, son entrée fut en effet tardive dans l’AIT. Nettement plus aventurier et radical que Proudhon, il adhère à ses idées politiques et, après la mort de ce dernier, à la Première Internationale dirigée par Karl Marx, mais bien après sa fondation en 1864 ; cette année-là, il passa par Londres, mais Marx ne le convainquit pas d’adhérer à l’Internationale. Il continua ses voyages et ses coups de feu et n’adhéra à cette Internationale qu’en 1868 ; un véritable tournant pour lui. Car, auparavant, il avait dirigé, à partir de 1863, une société secrète sur le modèle romantique qui fut courant dans l’Italie du Risorgimento ; mais tout commença pour lui par sa participation à une organisation pacifiste (la Ligue de la paix et de la liberté) après la bataille de Sadowa de 1866 où la Prusse vainquit l’Autriche, car les bruits de bottes s’amplifiaient en Europe. Cette Ligue allait se diviser et, avec ceux de gauche, donnera en 1868, au congrès de Berne l’Alliance internationale de la démocratie socialiste qui va se dissoudre dans l’AIT (à la demande de cette dernière) la même année.
C’est à ce congrès que Bakounine donne sa profession de foi libertaire, sa conception de l’État et sa critique du communisme la plus claire, où apparaît vraiment ce qu’il nomme le « collectivisme » : « Quelle différence, m’a-t-on dit, faites-vous entre le communisme et le collectivisme ? […] Je déteste le communisme parce qu’il est la négation de la liberté et que je ne puis rien concevoir d’humain sans liberté. Je ne suis pas communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l’État, parce qu’il aboutit nécessairement à la concentration de la propriété dans les mains de l’État, tandis que moi je veux l’abolition de l’État, l’extirpation radicale de ce principe de l’autorité et de la tutelle de l’État qui, sous le prétexte de moraliser et de civiliser les hommes, les a jusqu’à ce jour asservis, opprimés, exploités et dépravés. Je veux l’organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association, et non de haut en bas par le moyen de quelque autorité que ce soit »[1].
Pendant ce temps, l’AIT s’était divisée dès 1867 (au congrès de Lausanne) entre anarchistes proudhoniens (surtout des Français, mutuellistes) et communistes marxistes (surtout anglais et allemands). Eugène Varlin, anarchiste parisien[2], fera une sorte de pont entre l’anarchisme et le collectivisme marxiste : bain béni pour Bakounine, qui n’a donc rien contre le collectivisme, même s’il exècre l’État. C’est sur cette base, que Bakounine et sa Section jurassienne (les deux sections suisse et de Franche-Comté française) de l’AIT entreront à l’Internationale. Pour la première fois, une sorte d’équilibre entre les courants libertaire et autoritaire apparaît, Bakounine et Marx devenant les deux principaux coqs de l’AIT, un ex de Proudhon, Varlin, tentant la synthèse sur la base du slogan unitaire : « L’émancipation sociale des travailleurs est inséparable de leur émancipation politique ».
Bakounine écrit à Marx fin décembre 1868 : « Ma patrie maintenant, c’est l’Internationale, dont tu es l’un des principaux fondateurs. Tu vois donc, cher ami, que je suis ton disciple, et je suis fier de l’être ». À partir de cette période, Marx et Bakounine, qui se connaissaient depuis plus de vingt ans, mais, on l’a compris, sans une grande flamme réciproque, se regardent comme chien et chat. Deux coqs dans une basse-cour, c’est un de trop ; pas encore de clash, mais une méfiance réciproque. Marx, est persuadé que Bakounine est encore à la tête de son groupuscule propre ; il a du flair. Méfiant, il envoie en décembre 1868 une lettre à Engels où il écrit : « Monsieur Bakounine – dans les coulisses de cette affaire – condescend à placer le mouvement ouvrier sous direction russe ». Il rajoute, dans une autre lettre de juillet 1869 à son camarade préféré) : « Ce Russe, cela est clair, veut devenir le dictateur du mouvement ouvrier européen. Qu’il prenne garde à lui, sinon il sera excommunié ». De son côté, Bakounine est persuadé que Marx dirige lui-même le groupuscule de la Ligue des communistes (pas la peine, elle s’est fondu dans l’Internationale pour la diriger !) ; il est également prêt à lutter contre Marx et écrit dans une lettre d’octobre 1869 envoyée à Herzen : « Il pourrait arriver et même dans un très bref délai que j’engageasse une lutte avec lui […] pour une question de principe, à propos du communisme d’État. […] Alors, ce sera une lutte à mort ».
Tout baigne, pas dans l’huile mais dans le pétrole : 1869, n’est pas l’année érotique où aurait pu apparaître une alliance des communistes et des libertaires[3], mais année plutôt tournée vers Thanatos qui n’attendait que l’étincelle. Errico Malatesta, l’un des premiers futurs anarcho-communistes italiens, cependant alors pro-Bakounine, ne cacha pas, plus tard, le jeu de magouilles qui commençait entre anarchistes bakouniniens et marxistes. Il l’écrira, bien plus tard[4], en 1914 (dans son hebdomadaire Volonta).
Le rapport de force[5] en 1869 entre les courants au congrès de Bâle serait le suivant : deux tiers de bakouninistes (probablement avec les Français de Varlin ?) un petit tiers de marxistes, quelques pour cent de mutuellistes proudhoniens. On comprend ainsi mieux pourquoi, après la Commune de Paris, Marx dut batailler ferme au congrès de La Haye contre Bakounine, en éludant les questions de fond et en cherchant des poux dans la tête de son adversaire ; d’autant plus que les marxistes, peu ou pas présents à la Commune, n’y purent rien faire, le courant autoritaire dominant étant en France celui des blanquistes, dont Louise Michel et ses copains...
Pourtant, ce n’était pas encore plié avant la Commune. Auparavant, au congrès de Bâle de 1869, des débats de fond eurent lieu, notamment sur la socialisation du sol et l’héritage et, à l’unanimité, le congrès décida d’organiser les travailleurs dans des sociétés de résistance, les syndicats. Un vrai débat commença alors qui divisa : d’un côté, les partisans de Karl Marx, favorables à la gestion centralisée de l’AIT (pas folle, la guêpe[6]…) et à la création de partis politiques (conception évidemment liée à cette centralisation) ; de l’autre, les partisans de Bakounine prônant une gestion décentralisée avec prima du syndicalisme et contre la création d’un parti[7]. Mais pas de clash. Bakounine fera parfaitement ce rapprochement entre, pour les marxistes, la possibilité d’utiliser l’État (de dictature du prolétariat) et leur position du primat du parti politique pour ce qui est de la méthode d’organisation des travailleurs : « […] les communistes s’imaginent qu’ils pourront y arriver par le développement et par l’organisation politique des classes ouvrières […] tandis que les socialistes révolutionnaires […] pensent, au contraire, qu’ils ne peuvent atteindre ce but que par le développement et l’organisation de la puissance non politique, mais sociale, et par conséquent antipolitique des masses ouvrières. […] De là deux méthodes différentes. Les communistes croient devoir organiser les forces ouvrières pour s’emparer de la puissance politique des États. Les socialistes révolutionnaires s’organisent en vue de la destruction, ou, si l’on veut un mot plus poli, en vue de la liquidation des États. Les communistes sont les partisans du principe et de la pratique de l’autorité, les socialistes n’ont confiance que dans la liberté ».
Les différences d’angle des deux futurs catcheurs sont évidentes à ce congrès : Marx se contente d’évoquer une vulgaire prise de pouvoir au sein de l’AIT, par une simple question d’organisation ; Bakounine met donc en revanche en avant le problème de fond : la question centrale de l’État. Bakounine est en outre plus cool (joue-t-il les faux-culs ou est-il sincère ?) en ajoutant, au sujet de Marx : « Nous ne saurions méconnaître, moi du moins, les immenses services rendus par lui à la cause du socialisme, qu’il sert avec intelligence, énergie et sincérité depuis près de vingt-cinq ans, en quoi il nous a indubitablement tous surpassés ». Cette naïveté (probablement pseudo-naïveté…) d’un anar qui se refuse même à prendre le pouvoir au sein d’une organisation alors qu’il est sans doute convaincu (comme Malatesta, mais avec « la loyauté des moyens employés ») que le coco se donnera tous les moyens pour arriver à ses fins, le perdra.
Notes de bas de page
[1] Cité par Jacques Guillaume, L’internationale, Documents et Souvenirs, t.I., et re-cité par Leval (op. cit.).
[2] Il fondera bien plus tard le premier syndicat ouvrier qui sera bien à l’origine de la CGT anarcho-syndicaliste.
[3] Bref : les « coLibs », comme dans le « rêve » …
[4] « Nous voulions, par une action consciente, imprimer au mouvement ouvrier la direction qui nous semblait la meilleure, contre ceux qui croient au miracle de l’automatisme et aux vertus de la masse travailleuse… Nous qui dans l’Internationale, étions désignés sous le nom de bakouninistes, et étions membres de l’Alliance, nous criions très fort contre Marx et les marxistes parce qu’ils tentaient de faire triompher dans l’Internationale leur programme particulier ; mais à part la loyauté des moyens employés et sur lesquels il est maintenant inutile d’insister, nous faisions comme eux, c’est-à-dire que nous cherchions à nous servir de l’Internationale pour atteindre nos buts de parti ».
[5] Indiqué par Wikipédia dans son histoire de l’AIT, mais sans références ; cette proportion provient sans doute de Jean-Christophe Angaut, Le conflit Marx-Bakounine dans l’internationale : une confrontation des pratiques politiques, dans Actuel Marx, 2007 :
https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2007-1-page-112.htm
[6] Lénine ne fera plus tard que répéter cette tactique révolutionnaire, contre les narodniki.
[7] Le rapport entre État or not État et ces types d’organisation est, répétons-le, assez évident.



