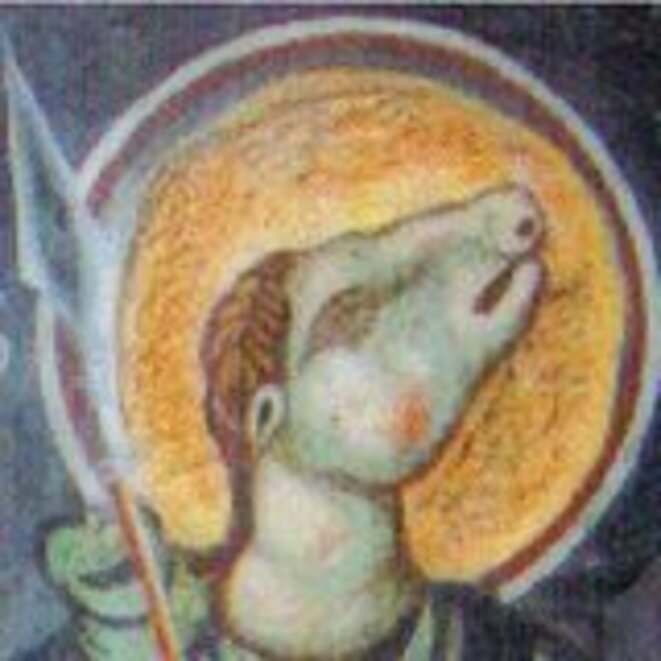Culture et propagande : Lille 2004, capitale européenne de la culture
« Notre enseigne fait beaucoup pour la culture régionale, nous sommes en train de relancer la fête de Saint Nicolas dans nos hypermarchés ».
(Daniel Bernard, ancien PDG de Carrefour lors de la cérémonie d’inauguration de Lille 2004, capitale européenne de la culture)
Prologue : choses vues à Lille 20041
Vernissage
L'inauguration de Lille 2004, « capitale européenne de la culture » commença par une cérémonie tout à fait républicaine avec moult invités et corps constitués. Le buffet était offert par une multinationale de l'hôtellerie2. Cette manifestation qui devait s'étaler sur l'année 2004 était la plus sponsorisée de toute l'histoire des politiques culturelles, ce dont ne manqua pas de se féliciter dans son discours d'introduction Martine Aubry, maire de Lille et présidente de Lille 20043. Elle céda aussitôt la parole au PDG de Carrefour qui, quelques mois plus tard, défraierait la chronique pour avoir été débarqué de son groupe, non sans un dédommagement de quelque 35 millions d'euros, soit la moitié du coût opérationnel total de Lille 2004. De quoi relativiser la générosité du mécène puisque la contribution de Carrefour à Lille 2004 s’élevait à un million d’euros. Outre les cadeaux qu'il se réservait dans sa hotte, ce Saint Nicolas sponsorisa des contes pour enfants dans les écoles primaires durant toute l'année 2004 et introduisit un jeton aux couleurs de l' « événement » servant à débloquer l'indispensable caddy qu'on remplirait des bonnes choses de la culture régionale sous le regard d’un « ambassadeur de Lille 2004 » posté dans tous les hypermarchés. Le mécène se fit aussi artiste : une rue fut « métamorphosée4 » par son agence de communication favorite en « rue Shangaï » à l'aide d'enseignes commerciales chinoises, dont bien sûr l’étendard de notre « champion de la France qui gagne » lancé à l’assaut des marchés mondiaux, ce qui ressemblait à une nouvelle guerre de l'opium. Tous les goûts n’étaient pour autant pas dans la nature du « mécène ». Il n’eut pas l’heur d’apprécier le travail d’une photographe, consacré au vol à l’étalage, et en obtint promptement le décrochage5.
L’allocution de Saint Nicolas fut directement suivie de celle d'un vendeur de téléphones portables qui vanta le téléguidage du public dans les expositions, que permettraient selon lui ses appareils, moyennant un nombre démocratique d'unités téléphoniques. En effet, SFR, également sponsor de l' « événement », avait dans ce rôle remplacé au pied levé son principal actionnaire, la Générale des eaux « métamorphosée » temporairement en groupe de communication mondial sous le nom de Vivendi-universal par un certain Jean-Marie Messier, haut fonctionnaire balladurien défroqué que la mise en scène de sa propre mégalomanie avait élevé dans la presse au rang d'artiste. Mais ce symbole fort d'une France industrielle se tournant résolument vers l'économie de la connaissance et du télécran était finalement revenu sur ses promesses pour cause de banqueroute malencontreuse, obligeant à réimprimer les affiches in extremis.
Un élu s'enthousiasma ensuite pour l'illumination de la gare de Lille Flandres, de « ce rose » qui évoquait si bien la couleur politique locale (on se souvint alors que des designers avaient un temps proposé au Pt Mitterrand cette couleur pour les rames du TGV Atlantique. Les courtisans, malheureusement pour eux, ignoraient qu'il préférait secrètement le bleu). S'avança enfin Jean-Jacques Aillagon, le ministre de la culture, dans le passé connu pour avoir transformé sous sa présidence le centre Georges Pompidou en machine à transformer les biens de consommation en oeuvres d'art6. Lui aussi était sur un siège éjectable et s’apprêtait à devenir conseiller de François Pinault, un milliardaire bien en cour, propriétaire de la FNAC, une des branches de l'oligopole de la distribution marchande des biens culturels, mais aussi d'une collection d’œuvres d'art alors promise à un musée privé à édifier à Boulogne-Billancourt sur les ruines de la mémoire ouvrière et des nationalisations, pour le plus grand prestige de la France.. Finalement le milliardaire ferait jouer la concurrence et installerait sa fondation à Venise, ce que justifierait son nouveau conseiller en dénonçant « les pesanteurs de l’état français »7. En attendant le ministre fut interrompu à plusieurs reprises par des jeunes gens lui reprochant d'avoir tranché dans le vif de l'économie de la culture en sabordant le régime d'assurance chômage des professions du spectacle, dans le même temps où il instaurait un bien généreux statut des fondations à l'usage de son ami milliardaire (pour être tout à fait exact, de cela les intermittents parlaient relativement peu). Devant un public impassible, plusieurs vagues d'importuns furent expulsés manu-militari : on vit même le préfet en costume d'apparat mimer virilement le coup de poing pour protéger la dignité républicano-affairiste. Le ministre finit les larmes aux yeux, réconforté heureusement par la standing ovation que lui offrit un public sélectionné par les entreprises partenaires, acquis à la cause du développement régional ; à la tribune les grands patrons et les dignitaires socialistes n' étaient pas en reste. La fille de Jacques Delors, génial inventeur du « Dialogue social », reprit sobrement la parole pour remercier le ministre de son héroïsme : « ce n'était pas facile, et c'est la preuve que vous êtes ouvert au débat ». Puisque aucun artiste ni responsable culturel n'avait été convié à s'exprimer et « la gastronomie faisant aussi partie de la culture régionale » , il fut bientôt temps de se restaurer. Tandis que les admirateurs du courageux ministre se ruaient sur le buffet de la multinationale hollandaise qui imposait peu à peu l'esthétique uniforme de ses hôtels à l'échelle mondiale, les grands patrons, le ministre et les politiques se mirent en appétit en visitant l'exposition consacrée aux fleurs dans l'art, sponsorisée par une entreprise de vente par correspondance et très à propos intitulée « flower power ». La fête pouvait commencer.
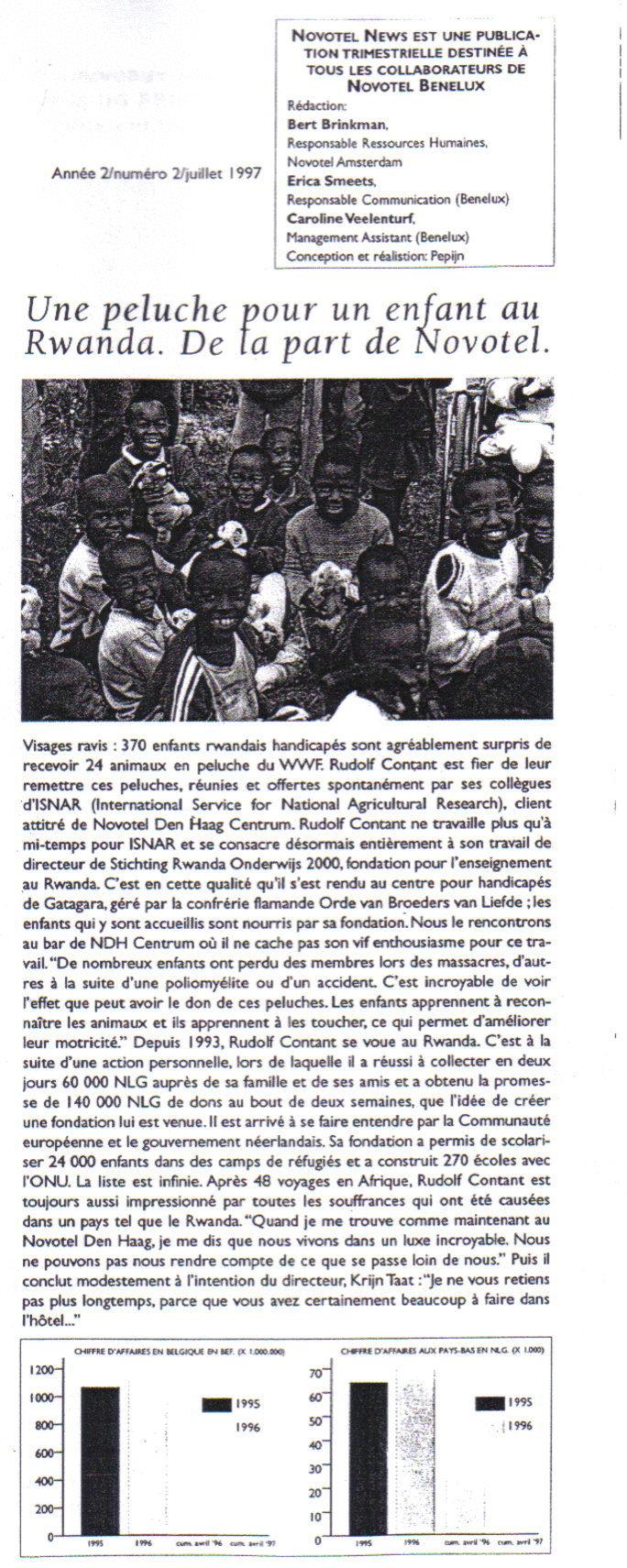
Agrandissement : Illustration 2
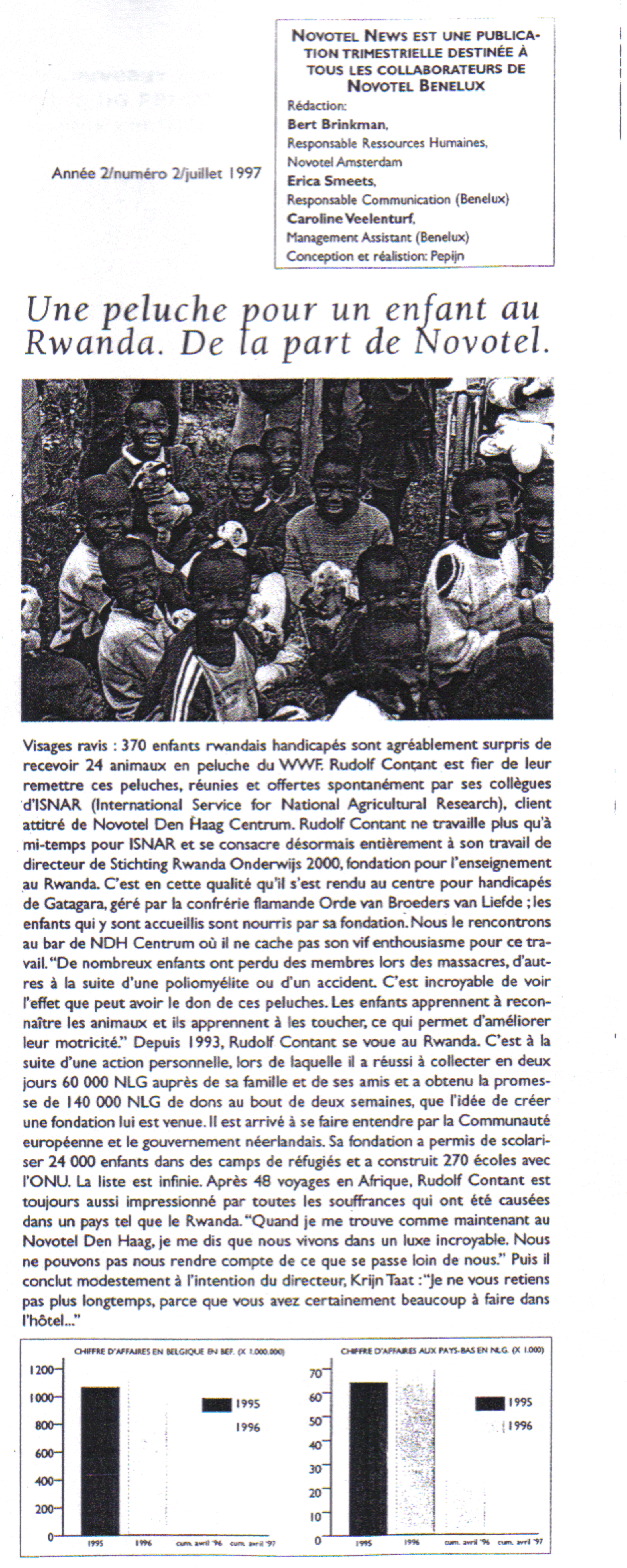
Le mariage de la culture et de l'affairisme fut total. Une exposition de voitures dont le constructeur, Renault, redevenu enfin une entreprise « normale », réécrivait l'histoire de France en fonction des dates de sortie de ses prototypes - plutôt que des avancées sociales arrachées de haute lutte par ses ouvriers-voisinait avec des démonstrations de robots japonais et des jeux vidéos. Les hommes et les femmes politiques, de droite comme de gauche, se félicitèrent des retombées locales du travail de promotion mondiale de « la marque Lille », derrière laquelle toute la population devait être mobilisée, sans distinction de sexe, de race et bien sûr de condition. Une part féminine non négligeable de cette population fut d'ailleurs « métamorphosée » en hôtesses à durée déterminée, égalité des chances oblige. Tout le monde s'habitua à ce que des déroulants vantent à la fois le prestige du fast-food de la gare de Lille Flandres et l'exposition Rubens. Parmi d'autres valeurs sûres à l'exportation, Daniel Buren, plus que jamais préposé à la redondance du « contexte », célébra la lumière et la vitesse avec l'aide d'EDF. Il faut dire que Renault, le sponsor pour lequel il avait réalisé quelques années plus tôt l'installation « Parking » à Beaubourg, mettant en scène des berlines de luxe en échange de quelques subsides consacrés à l’art pour l’art, s'était déjà débrouillé sans lui8.
Euralille über alles
Euralille, un gigantesque centre commercial à l'américaine séparé de la gare TGV Lille-Europe par une esplanade « François Mitterrand » hantée par des groupes de jeunes tenus à l'écart de la société de consommation par des armées de vigiles de leur âge, accueillit le centre de presse et certaines expositions, abolissant un peu plus la frontière entre l'art et les marchandises de toutes sortes qui s'offraient au chaland dans des enseignes franchisées spécialement bariolées aux couleurs de Lille 2004. Pour celle consacrée à « la ville européenne », le scénographe s'était d'ailleurs inspiré des rayonnages de l'hypermarché situé à l'étage en dessous pour présenter un vaste choix de produits urbains. Dans une vidéo, un architecte expliquait son concept révolutionnaire pour les montagnes du Tyrol. Accueillant de riches retraités collectionneurs, il ne doutait pas que cette région, si on savait s'y prendre, serait bientôt dotée des musées les plus riches du monde. Il suffisait de les construire « pro-activement » pour que, sentant leur fin prochaine, ces mécènes potentiels désireux de laisser trace de leur passage sur terre ouvrent leurs collections au public. En attendant, les bâtiments accueilleraient des supermarchés à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour ne pas être en reste, St Nicolas organisait d'ailleurs déjà des expositions d'art dans ses hypermarchés. Les conceptions urbanistiques des visionnaires étaient projetées jour et nuit sur des écrans plasma place de l'opéra. C'est dire que Buren était en phase avec l'harmonie générale puisque se succédaient sur les télécrans des flux de voitures circulant sur des échangeurs entrelacés à perte de vue, des trains lancés à pleine vitesse vomissant des travailleurs du tertiaire d'une gare à l'autre, des gratte-ciels dans l'alternance du jour et de la nuit. Des golfs aussi. Selon les organisateurs, qui avaient également commandé une installation en plastique à un dessinateur de science fiction des années 70, il était question d'« une sorte de futur antérieur de tout ce qu'on a rêvé et qui ne s'est pas produit, de tout ce qui va arriver demain et qu'on ne connaît pas aujourd'hui9» .
Entre « futur » et « futur antérieur », on éleva Euralille lors d’un colloque sur « la ville européenne », ni plus ni moins au rang de « mythe grec ». Son maître d'ouvrage avait construit l'opéra Bastille et, toujours à l'avant-garde politique, révéla qu'il s'apprêtait à diriger le chantier de la fondation Pinault. L'architecte Rem Koolhaas ne fut pas en reste, lui qui présentait au même moment, en candidat spontané au relookage d'une Union européenne en perpétuelle crise de légitimité, une exposition à Bruxelles sur l'histoire de l'Europe dans une scénographie pop à la gloire des règnes successifs des grands de ce monde (réduisant au passage la révolution française à la « construction médiatique » de la prise de la Bastille et à la terreur). L’immeuble de son collègue Portzanpac, en forme de botte, longtemps resté vide, avait visiblement inspiré les graphistes auteurs du logo de Lille 2004, représentant un petit poucet aux bottes de 7 lieues enjambant les grands espaces par la grâce du TGV, comme l'expliquait une vidéo didactique insistant sur la proximité nouvelle de Lille avec Paris Londres et Bruxelles grâce aux « Réseaux transeuropéens » (passant sous silence les 2h14 nécessaires pour rallier Boulogne en TER ce qui limitait quand même un peu « une liberté de choix devenant la substance même qui permet au désir d'atteindre sa plus grande vitesse10 »). Mais à Lille, on ne parlait jamais du petit poucet, encore moins de l'ogre bien évidemment, ni de l'envie qui vous prenait soudain de fuir à grandes enjambées. Non, le mot à la mode était « jumper ».
On expliqua qu’Euralille était ce symbole visuel fort, propre à frapper les populations pour les arracher aux mythes du passé, ceux de l'industrie lourde, du textile, de l'appropriation collective des moyens de production et du plein emploi. C'est que, depuis 1983, les chefs socialistes avaient opéré une audacieuse conversion en se vouant à une déesse Europe qu'ils essayaient de faire passer pour la Sainte Vierge, sans trop en subir de conséquences personnelles - à part quelques déconvenues électorales régulièrement interprétées comme des incidents de parcours. Cependant la population peinait un peu à les suivre dans ce syncrétisme rappelant furieusement à certains l'alliance du patronat et du goupillon et on pouvait craindre qu'elle mette une certaine mauvaise volonté à entrer de plein pied dans « la société de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du monde ». De ce point de vue, la statue de François Mitterrand, plantée dans un espace public déserté et battu par les vents, pointant son doigt vers une école de commerce par-delà une autoroute urbaine, son socle transformé en terrasse de bar triste par une jeunesse désœuvrée victime du chômage de masse, à l'évidence assez peu « mobile » malgré la proximité de Lille Europe, était en effet assez frappante…
Pour le dire tout net, la culture du « jumper », sautant d'emploi en emploi et de ville en ville, toujours plus mobile, toujours plus flexible, toujours plus créatif, toujours plus « pro-actif » peinait à s'imposer. Tant il est vrai que, pour reprendre les mots d'un voisin belge confronté aux mêmes difficultés, le Pt du Musée d'Art contemporain du Grand Hornu (ouvert grâce au fonds de développement régional de l'Union européenne dans un ancien charbonnage fermé cinquante ans plus tôt par son ancêtre, la Communauté Charbon Acier, après un siècle de paternalisme patronal) : « les gens sont encore trop souvent victimes de la façon dont ils organisent leur vie. C'est avant tout de culture dont ils ont besoin11 ». A défaut donc d'avoir obtenu les jeux olympiques, leur idéologie saine de la compétition, leur fort potentiel en matière de marketing urbain et leurs grandes infrastructures redynamisantes, « capitale européenne de la culture » ferait bien l'affaire comme avait su en convaincre le Pt de l'association « Grand Lille », PDG d'une entreprise de petits pois en boîte. Un journal local avait donc pu titrer avec un sens certain de l'a-propos : « les JO seront culturels ».
Idéopoles
La Commission européenne, qui s'était donnée pour mission de refaçonner le continent par la mise en concurrence des territoires et en générant une nouvelle culture indispensable à la « société de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du monde », c'est à dire au fonctionnement de l' « entreprise Europe », eut tout lieu d'être comblée de la grande foire aux objectifs de Lisbonne que lui servit sa capitale de la culture 200412. Pendant un an, celle-ci avait ripoliné son passé industriel un peu ringard d'un nouveau concept servilement décliné par des « créateurs » sous toutes les formes et dans toutes les dimensions afin que personne ne puisse y échapper, celui des «idéopôles13 ». Autrement dit des villes jouant pleinement la carte des « avantages comparatifs de l'Europe dans la compétition internationale », la « connaissance » et l' « innovation », laissant à d'autres peuples moins intelligents le soin de fabriquer les merveilles jaillies de nos concentrations de cerveaux en continuelle ébullition. Dans la région, cela s'était déjà traduit par la liquidation d’une grande partie de l'industrie textile, délocalisée au Maghreb pour la plus grande prospérité de ses habitants (Malheureusement les Tunisiens et les Marocains avaient à peine eu le temps de découvrir les joies de la fabrication de tee-shirts que la production était déjà en partance pour la Chine). Grâce au génie de nos modistes, c'était promis, la conception resterait en Europe, à condition d' « entrer de plein pied dans la société de la connaissance » et que l'Organisation mondiale du commerce protégeât la propriété intellectuelle de la perfidie de certains peuples qui n’hésitaient pas à copier les prédateurs exotiques que nous arborions fièrement sur nos polos14. A Roubaix, des arbres suspendus par les racines à 16 mètres de haut édifièrent les habitants sur l'avance créative considérable prise sur les Chinois, résultat de « trente années de révolution culturelle15 ». Partie intégrante d’une stratégie pour créer l'« environnement attrayant pour les travailleurs intellectuels » indispensable à ce que cent Silicone Valley fleurissent, cette « forêt suspendue » n’avait d’autre pour sponsor que notre fabricant de petits pois en boite, affirmant comme il se doit par ce soutien « sa volonté de s’inscrire dans une politique de développement durable ». Celui-ci se proposait ni plus ni moins « de regarder le monde autrement, de rêver la nature ». Comble de l’onirisme « la Fondation Louis Bonduelle, créée en octobre 2004, dont la mission est de promouvoir l’utilité publique des légumes » s’apprêtait à lancer « le jour du légume16 », afin d’améliorer les comportements alimentaires en Europe. Au même moment un autre rêve devenait réalité, « un marché porteur: celui des sandwiches » dont la conquête commencerait par « les stations service SHELL17 ».
Oecuménisme
A Lille 2004, il s’agissait aussi grâce à la culture de "mieux vivre ensemble" et de remettre sur les bons rails une société qui "a complètement perdu le sens collectif18". On mobilisa le carnaval, les géants, les beffrois, le hammam, et fit communier « sous les étoiles » plus de 20 nationalités sous l’égide du plus grand commun multiple, la création japonaise, lors du festival annuel de la soupe, afin de faire se « côtoyer la culture cultivée et la culture vécue. » ; « la culture vécue, c’est-à-dire le repas de famille ou avec ses voisins, la fête dans un quartier ou dans un village…19 ». L’idée n’était pas tout à fait neuve, en attestait le « succès » des « immeubles en fête » conçus sur le modèle de la « fête de la musique » à l’initiative de Jack Lang . Cela ne rendit en tous cas pas plus conviviale la préfecture qui se livrait jour et nuit à une véritable chasse à l’homme sur le littoral calaisien, traquant et terrorisant des candidats réfugiés majoritairement échappés d’Afghanistan ; traînant en justice aussi ceux des habitants révoltés qui osaient leur tendre la main sans avoir pris la précaution d’être labellisés par la Capitale européenne de la culture. Car à Lille 2004, on ne faisait surtout pas de politique. A l’occasion juste un peu d’évangélisation, trahissant par là une conception de la culture qui devait sans doute plus à la fréquentation de la messe que des archives de l’internationale socialiste. « L’accès à l’émotion, en regardant un tableau, en participant à un concert ou à une fête ensemble, en comprenant votre histoire, peut vous apporter beaucoup plus que d’acheter la dernière paire de Nike ou de regarder le dernier feuilleton télévisé.20 ». Dans ces moments-là, St Nicolas avait la délicatesse de regarder ailleurs.
Shiva indienne
Selon Martine Aubry, Lille avait gagné « dix ans de notoriété ». Une chose était cependant certaine, cet afflux de bienfaits n’était pas parvenu à « métamorphoser » l’idée un peu kitsch, très instrumentale et trempée d’eau bénite qu’un certain nombre de responsables se faisaient de la culture, faute sans doute de s’être inclus eux-mêmes dans la définition des publics cibles. Ceci fut malheureusement confirmé dès l’arrêt des festivités par le lancement de « Lille 3000 » marqué par l’apparition sur écran géant du « jumper-mascotte de Lille 2004 transformé en shiva indienne chaussée des fameuses bottes bondissantes et labellisatrices également portées par de bien curieuses vaches sacrées ». Toujours inspirée, Martine Aubry déclara, qu’« inviter cette grande culture (l’Inde en 2006), c’est vivre son énergie vitale » ajoutant « nous voulons réfléchir à la spiritualité ». « La religion, la citoyenneté, l’écologie... les enjeux majeurs de la civilisation » seraient de la fête. Comme l’écrivit la Voix du nord, il fallait : « se battre en rêvant pour que 70 des 100 plus grands tour-opérateurs continuent de placer Lille sur la carte des musts touristiques européens »21...
Notes critiques sur Lille 2004
Le principal « succès » de « Lille 2004, capitale culturelle de l’Europe » est d’abord d’être parvenu à désamorcer toute critique face à une instrumentalisation politique et économique de la culture à une échelle que ne connaît que le sport. Et ce n’est évidemment pas un hasard si les structures qui ont porté Lille 2004 avaient été mises en place pour préparer la candidature de la métropole aux jeux olympiques. Fondamentalement Lille 2004 répond aux mêmes objectifs principaux, voire secondaires : positionner la ville dans le réseau des villes mondiales pour y attirer les investisseurs, mener à bien de grandes transformations urbaines grâce à de nouvelles infrastructures, créer du consensus et mobiliser une part non négligeable de la population autour d’une conception de l’intérêt général dévoyée. L’organisation, faisant fortement appel aux deniers publics, associe des partenaires privés qui captent une part considérable de la plus-value symbolique pour un investissement dérisoire rapporté aux tarifs de la publicité. Il faut y voir clairement une volonté politique. Les mots de Karl Kraus, malgré la peur de l’excès, viennent naturellement aux lèvres : de Lille 2004 « je n’ai rien à dire… Mais il y a des maux face auxquels le front ne cesse pas seulement d’être une métaphore, et le cerveau, logé derrière et impliqué dans des actes de cette nature, n’est peut-être alors plus capable de la moindre pensée22 ». Et dans un premier temps, l’analyste est sans voix, il ne peut que compter les faits, comme dans ces « choses vues à Lille 2004 ». Combien de cerveaux se sont sentis « assommés » face à ce déferlement ? Ce n’est que quelques mois plus tard que la critique, confidentiellement, sourd23. Le récit de cette photographe d’abord, censurée par les pouvoirs publics pour ne pas déplaire au « partenaire » Carrefour. Auquel s’ajoute un dossier sur internet, qui n’évite pas la cuistrerie, mais face à « l’événement », sur le front, les étendards sont si peu nombreux… «Quand une rangée de CRS fonce sur la foule, le plus grand nombre sait encore comment réagir : on fait des barricades de fortune pour ralentir leur marche, on ramasse quelques pierres, des bouteilles et l'on se prépare à courir. Mais quand c'est un Lille2004-capitale-européenne-de-la-culture qui nous tombe sur le coin de la gueule - et ce pourrait aussi bien être un Genova2004-capitale-europea-della-cultura ou un Forùm-universal-de-les-cultures-Barcelona2004 -, nul ne sait trop comment s'y prendre… Quand nous entendons le mot " culture ", nous ne pensons pas encore à sortir notre revolver24. ». Des artistes nous parlerons peu : ils occupent un point aveugle, dont il est bien difficile de les faire sortir. Ne maîtrisant aucun des moyens de production, leurs œuvres prennent sens dans le contexte de l’exposition, sauf pour un public extrêmement restreint, dimension qui à de rares exceptions leur échappe complètement25, comme le fait que l’idéologie artistique du « créateur » échappant à toute détermination sociale est prédisposée à renforcer l’idéologie libérale26. Comment prétendre faire « œuvre » quand celle-ci sera déclinée de dossier de presse en site internet et en catalogue dans une maquette à l’esthétique publicitaire et avec des attendus des organisateurs qui donnent sens à l’ensemble de la manifestation ? Comment prétendre proposer une « vison du monde » quand l’espace urbain est envahi par l’esthétique publicitaire? L’insistance envers Daniel Buren a ses raisons : pape autoproclamé du « contexte » qu’a-t-il pourtant jamais montré des logiques sociales dans lesquelles s’inscrit sa pratique ? En quoi le fait de montrer ce qui a été conçu pour être vu, en général l’architecture, mérite-t-il que l’imbécile regarde le doigt ? Et on est bien obligé de voir de la servilité dans une installation, redondante par rapport à un contexte omniprésent, célébrant la lumière et la vitesse au cœur d’une manifestation mettant en scène l’idéologie d’une modernité dont le tempo est finalement donné par la volatilité des marchés financiers, c’est à dire la recherche du plus grand profit à court terme, en parfaite contradiction avec tout ce qui rend la culture, y compris Buren, possible27.
Monopolisation de la culture
De ce point de vue, le choix des sponsors est sans appel. Accor, multinationale de l’hôtellerie qui ne connaît de diversité culturelle que les différences préfabriquées entre ses différentes enseignes conçues pour offrir le même environnement partout dans le monde. Et Carrefour, qui après avoir détruit le commerce de détail avec quelques autres membres de l’oligopole de la distribution, étrangle aujourd’hui les producteurs28, ne rêvant que d’infliger aussi ce traitement aux producteurs culturels, sans oublier la domestication de la main d’œuvre sur les « nouvelles chaînes29 ». SFR enfin, né de l’ambition orwelienne de Jean-Marie Messier qui entendait avec Vivendi Universal fonder un trust maîtrisant tous les supports de diffusions et les contenus. Le choix de ces « partenaires » ne peut rien devoir au hasard : il s’agit bien d’une idéologie en acte. La grande distribution mérite une mention particulière tant elle a occupé un rôle idéologique et opérationnel central dans Lille 2004, avec l’omniprésence de Carrefour et la place donnée au centre commercial Euralille. La raison en est simple : pour les organisateurs, qui ne s’en cachent pas, la démocratisation de la culture passe désormais par la grande distribution qui serait seule à même de toucher les classes populaires30 et les techniques du marketing. D’où aussi la diffusion de nouvelles à prétention littéraire dans des présentoirs situés dans les bars parmi les prospectus. Il est évident que cette conception ne peut que réjouir des groupes voués à développer la consommation et pour qui les produits culturels constituent une nouvelle poule aux œufs d’or. Et plus trivialement si la promotion de la fête de St Nicolas (mais aussi de toutes les fêtes populaires transformées en fêtes commerciales) dans les hypermarchés peut-être évoquée lors de l’inauguration de Lille 2004 comme une contribution à la culture régionale, sans déclencher le moindre ricanement, tous les espoirs sont désormais permis pour les épiciers. Symptôme de cette idéologie, lors de la campagne référendaire de 2005, le parti socialiste édita un CD racontant, à la manière d’un conte pour enfants, le traité constitutionnel européen qui ne serait diffusé qu’en grande surface31. Après tout, si l’enfant est prescripteur d’achats comme tous les publicitaires le savent, peut-être pouvait-il être prescripteur de vote ?
Triomphe de la culture d’entreprise
Il y a déjà bien des années que les entreprises ne ménagent pas leurs efforts pour acquérir une légitimité culturelle permettant d’anoblir ou de dissimuler la trivialité de leurs pratiques économiques ou de conquérir des parts de marché. Cette stratégie fut longtemps l’apanage des grandes firmes visant par là un public élitiste, notamment à travers l’art contemporain32 (le groupe Pernod Ricard est ainsi devenu le premier acheteur de peinture d’avant-garde avec l’ambition de se défaire de l’image populaire associée à ses apéritifs qu’il cultivait jusqu’alors, devenu un des premiers groupes mondiaux d’alcools). Mais l’instrumentalisation de la culture cède peu à peu la place à la production d’une culture faite par et pour l’entreprise.
Symptomatiquement, le premier acte de politique culturelle de la Commission européenne après l’adoption du traité de Maastricht qui lui donna compétence dans ce domaine fut de co-financer le CEREC, un réseau d’agences nationales non-gouvernementales travaillant au « rapprochement de l’art et de l’entreprise ». Outre l’Admical en France, longtemps présidée par le PDG du groupe Danone, le CEREC a pour membre l’association britannique Art and Business à l’avant-garde dans son domaine d’activité depuis 1984. Tous les ans, Art and Business remet des prix aux entreprises pour les récompenser de leur « partenariat avec les arts ». En 2003 par exemple, Unilever (par ailleurs également sponsor d’un de ces prix dans la catégorie «personnalité de l'année ») fut récompensé sous l'égide du groupe Total pour avoir aidé la Tate Gallery à acquérir une série de sculptures « percutantes » d'Anish Kapoor : « depuis 1999, le partenariat d'Unilever avec la Tate a joué un grand rôle dans le renforcement de l'identité de la marque des deux organisations (...). Pour résultat, 74% du public cible d'Unilever identifie le groupe comme un soutien important à l'art et la marque est synonyme de créativité. »33. Une autre dimension est l’ « engagement social au travers des arts ». Group 4, société de sécurité privée gérant au Royaume-Uni des prisons pour mineurs sans-papiers a ainsi été gratifiée d'un « art and business award » pour avoir offert une initiation au théâtre à des enfants qu’elle maintenait sous écrou. Pour Art and Business, l’art doit aussi devenir partie intégrante de la « Responsabilité sociale des entreprises » (CSR). L’art ne doit pas être un « élément parmi d’autres de la CSR » mais son « instrument privilégié » : à la fois vecteur de communication, outil de management en interne, support indispensable de l’ « éducation tout au long de la vie » mais aussi catalyseur de « la cohésion sociale nécessaire à des performances économiques durables34 »… Cette idéologie trouve une expression imagée dans les réponses des partenaires d’Art and Business invités à imaginer « les rapports de l’art et de l’entreprise en 2023 ». « Le commerce et l'art ont toujours été des amants difficiles, mais ils couchent ensemble depuis des siècles. Mais en 2023, leur relation entrera dans sa maturité et prendra tout son sens. Le grand art sera en ménage avec le big business … Ne serait-ce pas enthousiasmant si en 2023 l'entreprise considérait les artistes comme un élément essentiel à la créativité commerciale, l'innovation et la compétitivité. Et si toutes les organisations artistiques se considéraient elles-mêmes comme des entreprises dépendant, plutôt que des subsides, de la qualité de leur service et de la satisfaction des consommateurs ? … Plus de compagnies créeront et financeront leurs propres événements artistiques, fournissant les artistes et l'argent pour les aider. Les entreprises sponsoriseront leurs propres programmes d'artistes en résidence. De plus en plus d'institutions artistiques seront associées au développement des marques. De grands artistes seront embauchés pour promouvoir des marques35 ».
Il faut noter qu’en France l’Admical, dont l’influence, et plus généralement celle des entreprises sur le champ culturel, se trouvera décuplée par la loi sur les fondations d’entreprises votée en 2004, rattrape peu à peu son retard sur Art and Business. Un jury présidé par le prix Goncourt Jean-Christophe Ruffin a ainsi remis en 2004 le prix du mécénat culturel à la fondation Ronald Mac Donald. La légitimation des marques par les instances culturelles est donc bien avancée. Au Lieu unique à Nantes, des artistes en résidence furent invités à créer de nouveaux habillages en série limitée pour canettes de Coca-Cola. Cette scène nationale subventionnée réécrivait au passage l'histoire de l'art en prétendant qu'Andy Warhol avait dessiné le logo de la marque36.
Lille 2004 ne constitue qu’un exemple particulièrement visible en raison de son échelle, d’une transformation de grande ampleur qui voit s’imposer la « culture d’entreprise » et la publicité comme culture unique et instrument de gestion des populations. Si la manifestation vise une « métamorphose » de l’image de la région à l’échelle internationale, toujours associée à son « passé » industriel, grâce à une stratégie de marketing urbain, elle ambitionne également de faire entrer les populations dans la « culture du management » et de la rééducation « tout au long de la vie » au service de la « société de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du monde ». L’esthétique pompier, produite par et pour l’entreprise qui s’est imposée dans la ville pendant un an est rigoureusement à l’image de cette idéologie. Circonstance aggravante, elle a été parée de légitimité culturelle par le biais du volet élitiste de la manifestation et le silence assourdissant des milieux artistiques face à un véritable coup d’état symbolique.
Si les mercenaires de la « société de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde », mobilisés pour donner forme urbaine à l’idéologie managériale de leurs commanditaires et une plus-value artistique, voire patrimoniale, à l’esthétique de la grande distribution ne s’attirèrent aucune critique, c’est sans doute que le travail de dépolitisation du champ artistique venait de loin. Elevant le concept d’exposition « entre amis », l’amitié et la convivialité au rang de « machine de guerre » contre les postures idéologiques, le catalogue de l’exposition « Amicalement vôtre », organisée par la faculté d’arts plastiques de Lille 3, remarquablement imperméable au tumulte environnant, reproduisait avec admiration des propos de l’artiste Daniel Spoerri datant des années 60 : « Certes, nous ne sommes pas des artistes comme Malevitch, Yves Klein, Agam, Constant ou Beuys (pour qui j’ai comme ami, beaucoup d’estime) qui de façon générale ne peuvent travailler que lorsqu’ils ont une théorie à laquelle ils croient. Dieu merci ce sont des artistes et pas des hommes politiques suffisamment puissants : ils nous interdiraient tout, ils nous gazeraient ou ils nous colleraient au frais, dans leur Etat fasciste où ils ne permettraient de croire qu’à une seule chose37 ». Force est de reconnaître que des artistes comme Spoerri ont aujourd'hui plus à craindre des artistes qui ont vendu leur oeuvre au capital et de ceux qui usurpent le nom d'artiste pour en assurer la propagande...
Le Peintre du Champ (première publication dans la Revue Agone n. 34, octobre 2005)
1Ce texte est l'introduction à la mise en ligne du happening proposé par Benoît Eugène et Angel Vergara, « Le mariage d'Art et Entreprise », en marge de Lille 2004, capitale européenne de la culture.
2 Le groupe Accor, sponsor officiel de Lille 2004
37 millions d'euros soit l'équivalent des dépenses de marketing et de promotion, pour un budget opérationnel de 70 millions
4 Les « métamorphoses » étaient l’un des thèmes de Lille 2004.
5 Lille 2004 ; la censure et le prince charmant ; http://lille.indymedia.org/article.php3?id_article=1159; 14 mars 2005.
6 Pendant les travaux, la façade du centre Beaubourg avait été recouverte d’une gigantesque bâche représentant des consommateurs affublés de montres Swatch dans des cadres dorés, avec pour titre « vous êtes notre collection permanente ». Elle fut présentée comme « la plus grande bâche culturelle du monde ».
7 Jean-Jacques Aillagon a été nommé à la tête de TV5-Monde le 6 avril 2005, fonction a priori incompatible avec son ancien statut de ministre de la culture et de la communication, assurant la tutelle de cette chaîne publique.
8« parking », installation dans le cadre de l’exposition « Le musée qui n’existait pas », Centre Georges Pompidou, 26 juin-23 septembre 2003.
9 Dossier de presse de Lille 2004
10. Ibid.
12 Les « objectifs de Lisbonne » constituent un programme de coordination des politiques des Etats membres visant à ce que l’Europe devienne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde »
13 On trouve notamment ce terme dans le rapport « Relever le défi, La stratégie de Lisbonne pour la croissance
et l’emploi »,Rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok, novembre 2004
14 Un accord sur la propriété intellectuelle à l’OMC fait partie intégrante des objectifs de Lisbonne.
15 L’installation « finit sa course dans un luxueux almanach publié par le quotidien « Libération » célébrant « trente années de révolution culturelle ». Abécédaire, Lille 2004, <http://www.lille2004.org>
16 <http://www.agrisalon.com/06-actu/article-14806.php>
17 <http://www.agrojob.com/actualite-agroalimentaire-61/BONDUELLE-poursuit-ses-innovations.aspx>
18Martine Aubry (ed.) ; Culture toujours… et plus que jamais !; Paris, éditions de l’Aube, 2004
19. Ibid.
20.Ibid.
22 Karl Kraus, « Troisième nuit de Walpurgis », Agone, Marseille 2005.
24 < http://lafeteestfinie.free.fr/>
25 Lire Benoît EUGENE, Pour sortir du jardin d’Hamois. Les jeunes plasticien face aux transformations du champ artistique », in Paul Dirkx « Langues, blancs, pouvoirs, inconscient », Réseaux, n° 85-86-89, 1999, Mons, < http://home.tiscali.be/bendyglu>
26 Luc BOLTANSKI, Eve CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalime, Gallimard, 1999
27« Est-il encore possible aujourd'hui, et sera-t-il encore longtemps possible de parler de productions culturelles et de culture? Ceux qui font le nouveau monde de la communication et qui sont faits par lui aiment à évoquer le problème de la vitesse, des flux d'informations et des transactions qui deviennent de plus en plus rapides, et ils ont sans doute partiellement raison quand ils pensent à la circulation de l'information et à la rotation des produits. Cela dit, la logique de la vitesse et du profit qui se réunissent dans la poursuite du profit maximal à court terme (avec l'Audimat pour la télévision, le succès de vente pour le livre - et, bien évidemment, le journal -, le nombre d'années pour le film) me paraissent incompatibles avec l'idée de culture. Quand, comme disait Ernst Gombrich, les «conditions écologiques de l'art» sont détruites, l'art et la culture ne tardent pas à mourir ». Pierre Bourdieu, Maîtres du monde savez-vous ce que vous faites ? Discours à la réunion annuelle du Conseil international du musée de la Télévision et de la Radio, le 11/10/1999, < http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/varia/maitres.html>
28Lire Christian Jacquau, « Producteurs étranglés, consommateurs abusés. Racket dans la grande distribution à la française », Le Monde diplomatique, décembre 2002
30 C’est vrai aussi de la « revitalisation » des banlieues. Les hypermarchés sont considérés comme employeurs et lieux de sociabilité et certains élus sont prêts à leur accorder des aides à l’installation, renforçant des monopoles qui ne sont pas pour rien dans la désertification des « banlieues ».
31 Unis dans la diversité, la constitution européenne [extraits choisis] racontée, 2005
32 Lire Pierre Bourdieu, Hans Haacke, Libre-échange, Le seuil, 1994
33<http://www.aandb.org.uk>
34Art And Business, Response to the European commission green paper on corporate social responsibility, Commission européenne COM(2001)366 final.
35<http://www.aandb.org.uk>
36 LU. Démantèlement d’un trafic de coca in’ , La lettre à Lulu, n°42, novembre 2003
37 Véronique Goudinoux, Marie Graftieaux, Fründs Friends Freunde und Freunde (1969). Enjeux et ambition d’une exposition, catalogue de l’exposition Amicalement vôtre », université Lille 3, école régionale supérieure d’expression plastique, musée des beaux-arts, Tourcoing, 2003