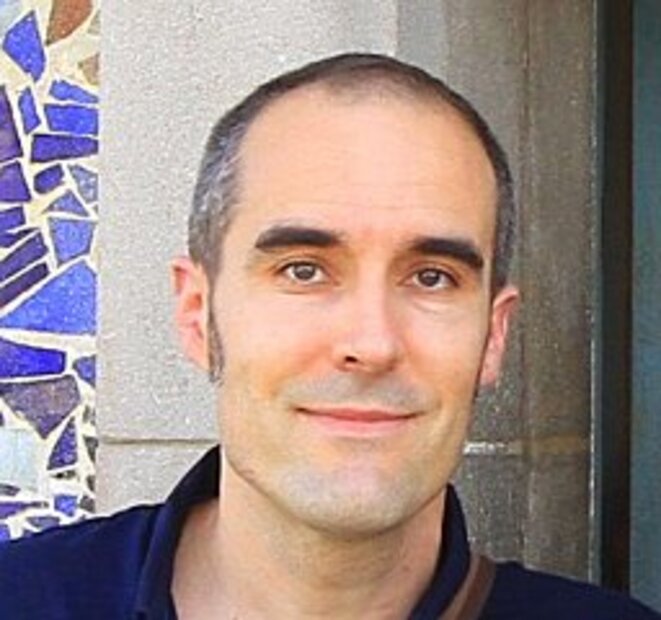Une tribune, publiée dans le Monde le 15/09/2025 et signée par un collectif d’enseignants-chercheurs, relate le boycott, par cinq chercheurs, du colloque Les histoires juives de Paris (Moyen Âge et Époque moderne) qui s’est tenu les 15 et 16 septembre à la Bibliothèque de l’Arsenal et au Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ). Elle enjoint « France Universités et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche [MESR] à condamner le principe de boycott académique » – en contradiction flagrante avec la liberté académique qu’elle prétend défendre.
Cette tribune, reprenant le communiqué du MAHJ, comporte d’abord des informations factuellement fausses, si l’on en croit le communiqué publié en réponse par la Société des professeurs d’histoire ancienne de l’Université (SoPHAU). Surtout, elle présente une conception erronée de la liberté académique qu’il convient d’urgence de rectifier, tant cette conception est hélas répandue en France, notamment dans les instances dirigeantes de l’Enseignement supérieur et de la recherche (voir par exemple l’avis du collège de déontologie du MESR, qui invoque paradoxalement la liberté académique pour forcer les établissements à coopérer, et politise cette liberté).
Faits alternatifs
D’abord, les chercheurs incriminés n’ont pas, comme l’affirme le MAHJ et le reprend la tribune, « annulé leur participation, au prétexte qu’un programme de recherche en histoire médiévale de l’Université hébraïque de Jérusalem [...] finançait la participation d’une doctorante » (quel absurde prétexte !), mais bien parce que « leur participation équivalait à soutenir le gouvernement israélien ». Le communiqué de la SoPHAU donne une information cruciale à cet égard : « Les cinq collègues se sont retirés du projet [...] quand une nouvelle version du programme montrait comme financeurs des organismes en lien avec des institutions gouvernementales israéliennes et le domaine militaire ».
La tribune semble par ailleurs nier le génocide commis par l’armée israélienne à Gaza. Il ne s’agit pas d’un « discours en vigueur dans certains de nos établissements d’enseignement supérieur » comme l’affirment ses auteurs, mais d’un fait documenté dès 2024 par le Human Rights Network, et reconnu depuis par de nombreuses organisations humanitaires (dont des organisations israéliennes), internationales (dont l’ONU) et par la communauté académique (notamment par l’International Association of Genocide Scholars qui fait autorité en la matière, et par des spécialistes de l’Holocauste, y compris israéliens).
Indépendamment de la qualification exacte des crimes commis par l’armée et le gouvernement israéliens, personne de raisonnablement sensé ne peut nier leur monstruosité, et l’obligation morale de ne pas y contribuer, de quelque manière que ce soit. Or, il est établi depuis longtemps que les universités israéliennes collaborent avec l’armée et participent actuellement à l’effort de guerre (voir par exemple les travaux de Uri Yacobi Keller, Nick Riemer, Maya Wind ou Neve Gordon). C’est la raison pour laquelle le boycott académique de ces institutions est moralement nécessaire, comme je l’écrivais il y a un an. Ce boycott n’a rien à voir avec Israël ou la judéité en tant que telles (n’en déplaise à ceux qui instrumentalisent les accusations d’antisémitisme), mais bien avec les actes commis par l’armée et ordonnés par le gouvernement israéliens – tout comme le boycott académique des institutions russes n’avait rien à voir avec la Russie en tant que telle, mais bien avec l’invasion russe de l’Ukraine. Il se distingue également du boycott de chercheurs ou projets individuels, qui doit être évalué au cas par cas.
La responsabilité des chercheurs, une question éthique et non pas politique
Contrairement à ce qu’essaient de faire croire les auteurs de cette tribune et du communiqué du MAHJ, le boycott ne relève absolument pas d’une question politique ou idéologique, mais d’une question purement éthique, qui a trait à la responsabilité morale des chercheurs en tant que chercheurs et plus généralement en tant que personnes.
Comme tout un chacun, les chercheurs ont la responsabilité de ne pas causer du tort à autrui à travers leur travail, ce qui inclut les collaborations professionnelles. Si celles-ci ont pour conséquence de nuire à la population civile (et dans le cas de Gaza, il s’agit pour le moins d’un euphémisme), alors ils ont la responsabilité d’interrompre ces collaborations.

Agrandissement : Illustration 1

Le Code européen pour l’intégrité de la recherche stipule notamment la « responsabilité » de la recherche pour ses « impacts sociétaux ». En particulier, les « bonnes pratiques de recherche » requièrent que « les chercheurs reconnaissent et soupèsent les potentiels méfaits et risques liés à leur recherche et ses applications, et atténuent les possibles impacts négatifs ».
Contre-sens sur la liberté académique
Que signifie alors, et comment s’applique dans ce contexte, la liberté académique ? En France, elle est malheureusement très peu évoquée dans la législation. Le code de la recherche n’en fait même pas mention. Seul le code de l’éducation mentionne, dans une formulation très vague, la « pleine indépendance » dont jouissent les enseignants chercheurs « dans l’exercice de leurs fonctions » (article L952-2). Que signifie alors exercer son « indépendance » ? À l’évidence, il ne peut s’agir d’être forcé (par son établissement ou son ministère de tutelle) de collaborer avec un établissement ou des chercheurs individuels. Bien au contraire, refuser de collaborer avec une institution, des chercheurs ou au sein d’un projet de recherche car cette collaboration aurait des conséquences éthiquement néfastes, représente un exercice de cette liberté académique. Un tel refus est d’ailleurs conforme au « droit de retrait » recommandé par le comité d’éthique du CNRS (institution dont sont du reste membres plusieurs signataires de la tribune trompeuse). Inversement, la condamnation par les autorités que la tribune appelle de ses vœux représenterait une restriction de cette liberté, et une infraction au code de l’éducation français ainsi qu’au code européen de la recherche.
Au moment où la post-vérité triomphe, et où nombre d’États, sociétés privées, médias et universités courbent l’échine devant Trump pour préserver leurs intérêts propres plutôt que la vérité et la justice, il faut plus que jamais défendre ces dernières.