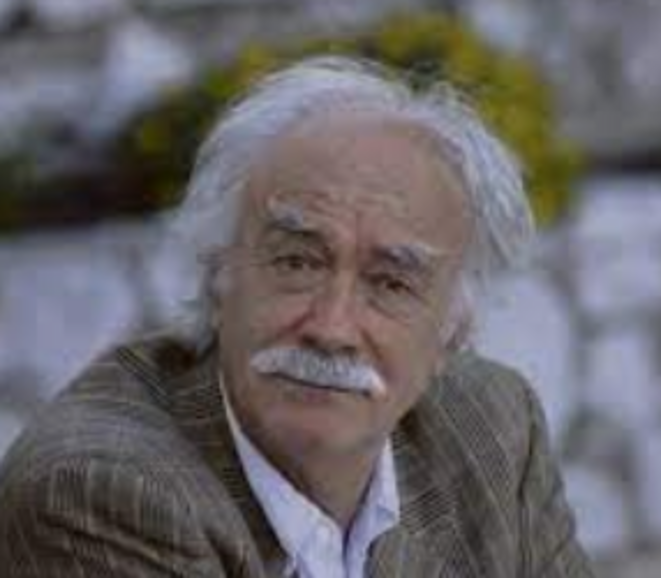Il y a des routes qui sortent de l’ordinaire. Et celle-ci, qui relie Erevan, la capitale de l’Arménie, à Megri, la ville frontière avec l’Iran, tout au sud du pays sur le fleuve Araxe en est une. Pour les Arméniens, c’est la M2. La voie magistrale n°2. Pour certains géopoliticiens, c’est un bout du grand axe Nord-Sud qui devrait un jour relier la Russie à l’Inde ( !) en franchissant le Caucase (par la route militaire de Géorgie et le col de la Croix) passer à Tbilissi, remonter vers Erevan, passer en Iran à Megri puis continuer à travers le réseau routier iranien (qu’on dit meilleur que celui du Caucase) vers le Pakistan et l’Inde. Souhaitons qu’il se réalise un jour ; ce sera le signe que le monde ne s’est pas fracassé comme le pont de Crimée.
Sauf que la situation au Caucase est loin d’être stabilisée. En septembre dernier, l’Azerbaïdjan a attaqué le territoire arménien, justement à un endroit, entre Goris et Kapan, où cette route non seulement longe la frontière mais pénètre quelques kilomètres en territoire azéri. Comment est-ce possible me direz-vous ? Mystères de la démarcation soviétique des frontières suivant tant bien que mal les aléas du relief et de la répartition de la population. En réalité, depuis l’indépendance en 1991, personne ne s’en était réellement préoccupé. Lors de la première guerre autour du Karabakh, les forces arméniennes avaient occupé tous les districts de l’Azerbaïdjan qui bordaient cette frontière. Et par conséquent, les Arméniens considéraient que toute cette région leur appartenait. Les cartes éditées à Erevan faisaient à peine la différence entre le territoire arménien proprement dit et les territoires pris sur l’Azerbaïdjan en dehors des limites de la Région autonome du Haut Karabakh (l’Artsakh des Arméniens). Erevan considère que ce sont des districts « libérés » ; Bakou, et la communauté internationale qui ne reconnait pas cette sécession, considèrent qu’ils sont « occupés ».
Mais tout change en 2020. Entre le 27 septembre et le 10 novembre, l’armée azérie, activement soutenue par la Turquie, reprend certains des territoires contestés et même une partie du Karabakh proprement dit dont la capitale historique, Choucha (Chouchi en arménien). Vladimir Poutine intervient tardivement pour négocier un cessez-le-feu qui ne satisfait personne. Bakou récupère une grande partie des districts « occupés » mais pas le contrôle du Karabakh dont le statut n’est pas mentionné dans l’accord. Les Arméniens perdent une grande partie des territoires obtenus en 1994 et craignent que ce cessez-le-feu ne soit qu’une étape dans un combat inégal. Forts de la victoire obtenue en 1994, ils n’ont pas réellement cherché à négocier un vrai traité de paix. Tiraillé entre des intérêts divergents, le groupe de Minsk (créé par l’OSCE) avec la France, les USA et la Russie comme co-présidents, n’a jamais réussi à dégager un accord définitif alors que les Azéris, qui n’ont jamais accepté cette perte de souveraineté, ont toujours fait savoir que faute d’un accord politique, ils reprendraient ces territoires par les armes.
C’est ce qu’ils ont fait en 2020 et en septembre 2022, ils sont revenus à la charge. Profitant du fait que la Russie était bien occupée en Ukraine et prétextant d’activités suspectes sur ces confins qui n’ont jamais été réellement démarqués, ils attaquent cette fois plusieurs villages en territoire arménien, le long de la M2 dont plusieurs secteurs sont désormais coupés. Immédiatement sollicitée au titre du Traité de défense collective de la CEI signé en 1992, la Russie n’intervient pas laissant sur le terrain une situation tendue.
Quand on quitte Erevan par le sud, on descend la haute plaine agricole dite de l’Ararat, majestueux volcan symbole des Arméniens mais qu’on ne fait que longer puisqu’il est en territoire turc. Après Yerash, la route fait un brusque coude vers l’est. On abandonne la voie la plus rapide qui permettrait de gagner l’Iran par le pont de Djoulfa mais ce trajet passe par le Nakhitchevan, une république autonome de l’Azerbaïdjan enclavée entre l’Arménie et la Turquie. C’est Staline qui en a décidé ainsi en 1924 et depuis 1991, cette voie rapide -car peu accidentée dans une vaste plaine- est coupée au trafic international. La M2 longe le Nakhitchevan sur plusieurs kilomètres et les Arméniens ont construit sur le côté sud de la route des sortes de digues en terre et en pneus destinées à empêcher d’éventuels snipers azéris de tirer sur les voitures qui l’empruntent. C’est ce qui est arrivé plusieurs fois au plus fort des tensions entre les deux pays. On quitte alors la plaine pour s’engager dans une série de défilés somptueux au cœur d’une montagne sèche entrecoupée de quelques oasis viticoles (Aréni, Arpi).La route est magnifique, sinueuse à souhait mais le plaisir des touristes qui vont visiter par exemple le splendide monastère de Noravank au fond d’une étroite gorge en cul-de-sac, n’est guère du gout des centaines de chauffeurs iraniens qui conduisent chaque jour leurs camions citerne ou porte conteneur, dans un ballet incessant entre Téhéran et la capitale arménienne.
Il s’agit bien d’une ligne de vie car une partie de l’approvisionnement de l’Arménie en mazout et autres produits essentiels passe par là. Le pays est totalement enclavé, les deux frontières côté azéri et côté turc sont fermées et le transport lui aussi actif par la Géorgie au nord dépend trop souvent des caprices de la relation entre Tbilissi et Moscou ou tout simplement de ceux de la nature quand la route militaire de Géorgie est coupée par des avalanches ou des glissements de terrain. Une partie de la M2 étant coupée, le trafic a été transféré sur une route secondaire qui rejoint Kapan en franchissant plusieurs cols. Les touristes apprécieront le passage par la gorge de Tatev que domine un remarquable monastère mais les chauffeurs de poids-lourds sont d’un tout autre avis. Dans les lacets de cette gorge, ils sont obligés à chaque tournant de couper toute la route en débordant sur leur gauche. Les autres véhicules qui arrivent en sens inverse sont invités alors à se déporter à l’intérieur du tournant sur leur gauche, une gymnastique assez extraordinaire que je n’avais encore jamais expérimentée. Personne ne sait ce qui va se passer cet hiver, quand la neige et le verglas vont s’en mêler.
Je suis allé jusqu’à Kapan, une ancienne ville industrielle (on exploite à proximité plusieurs gisements de cuivre) qui se retrouve tout d’un coup ville frontalière, d’une frontière fermée depuis 1991. Situation unique et quelque peu inquiétante. Sur la rive gauche du Voghji, la ville est surplombée par des collines où se déroule une bataille des drapeaux. Les plus proches sont arméniens mais juste à côté, sur la colline suivante se dresse fièrement un immense drapeau azéri. Et le petit aéroport local qui longe la rivière côté arménien est en bien mauvaise posture et fermé à tout trafic. Non seulement il est à portée de tir azéri mais les avions qui emprunteraient ses pistes sont dans l’obligation à cause du relief de passer au-dessus du territoire de l’Azerbaïdjan.
Au sommet de Prague, les dirigeants arméniens, azéris et turcs se sont rencontrés pour des négociations sous l’égide des dirigeants européens et du président français. Espérons que les pistes envisagées pour la mise au point d’un vrai traité de paix soient cette fois les bonnes. Aussi bien en Arménie qu’en Azerbaïdjan les opinions publiques sont méfiantes et fatiguées. Tous regardent avec inquiétude ce qui se passe en Ukraine et l’issue de ces multiples crises demeure bien incertaine. Les Arméniens sont plongés dans une angoisse existentielle : qui viendra à leur secours si le président Aliev décide de réattaquer ? Il aura certainement le soutien d’Ankara qui voit là la possibilité de réaliser un vieux rêve, relier par voie terrestre tout le monde turc, du Bosphore à Bakou et par-delà la mer Caspienne, jusqu’aux fin fonds de l’Asie centrale.
Cerise sur le gâteau ; sur la route du retour, quelque part en longeant l’Ararat, mon téléphone portable me prévient : « orange info : bienvenue en Turquie » ! Les Arméniens qui empruntent cette route font la grimace. De mon côté, j’y verrai presque un avantage si j’avais le temps. Les tarifs orange par le réseau turc sont plus de deux fois moins chers : 1,18 euros la minute d’appel vers Paris contre 2,90 en Arménie…
Jean Radvanyi, Erevan, 12 octobre 2022