Une psychanalyse infiltrée par l’idéologie
.... On admet cependant que, dans sa vie personnelle, le psychanalyste, retrouvant ses traits d’humanité, puisse s’engager à titre personnel, mais en toute discrétion et sans que cela vire à la surexposition médiatique. Cette opinion persiste, bien qu’aujourd’hui, de multiples figures de la psychanalyse, de quelque courant, école, ou orientation qu’elles se réclament, s’exceptent de cette place que lui prescrit une sorte de sens commun aristotélicien. Trois raisons au moins en sont à l’origine. Le fait que la psychanalyse accueille et traite du plus singulier en chacun ; que l’expression de « neutralité bienveillante » se soit divulguée dans un sens impropre[1]. Le fait que la psychanalyse se déroule dans un lieu privé. L’interprétation qu’elles induisent est que le général et l’universel ne peuvent rentrer dans les considérations de la psychanalyse et du psychanalyste ; que le psychanalyste ne doit pas se mêler aux débats publics et prendre position. Cette opinion a la vie dure, et procède certainement de l’idéal d’impassibilité et de silence placide et bienveillant qu’on attribue au psychanalyste, se tenant derrière le divan, et ses lunettes quand il en porte. Hélas cette opinion ignore que c’est là un des derniers ricochets de la polémique – sous braise aujourd’hui - qui s’est jouée entre Freud et les psychanalystes aux zetazunis , à son époque puis dans les années 50, 60 et a ensuite perduré. Ces derniers ont en effet rejeté ce que nous nommons « seconde topique », qui correspond en gros, chronologiquement parlant, à la dernière partie, de l’œuvre de Freud. Par là même ils ont ouvert la voie à la dilution de la théorie et de la pratique dans l’idéologie de la libre entreprise, qui a inondé cette zone géographique puis s’est insinué dans les « succursales » de l’IPA. Passons sur les détails. Jacques Lacan est passé par là, invalidant cet amalgame, en prodiguant un enseignement qui déjouera et déjoue encore aujourd’hui cette stérilisation, pour maintenir une psychanalyse vivifiée et inventive qui aujourd’hui et pour longtemps, féconde la formation des psychanalystes par le biais de l’Association Mondiale de Psychanalyse, et la procédure de la passe qui y est en fonction.
C’est cette répulsion même de la « seconde topique » qui va contribuer à installer durablement dans l’opinion cette idée du psychanalyste bienveillamment neutralisée.
Car avec le rejet de cette partie de la théorie de Freud, deux termes, deux concepts sont évacués : la pulsion de mort, et la psychologie des foules, celle-ci reprécisée par Freud sous l’angle psychanalytique. Déjà le texte Malaise dans la civilisation de Freud n’avait pas de son temps recueilli l’assentiment de ses suiveurs américains
C’est ici que nous retrouvons la politique et le sens qu’elle peut prendre pour le psychanalyste, s’il admet ces deux concepts qui en constituent des déterminants. D’une part, la pulsion de mort impliquée dans le plus singulier d’un sujet comme dans le particulier d’un ensemble spécifié de personnes, une foule, une famille, et dans les considérations générales que l’on peut avoir sur l’état du monde et des gouvernements aujourd’hui mais pas moins ceux hier, et donc dans l’histoire dans toute sa durée. La psychologie des foules, concerne elle l’individu pris dans la masse, Freud l’ayant spécifiée dans son sens psychanalytique, c’est-à-dire selon un curseur qui part de la relation amoureuse, en passant par l’hypnose, puis de la suggestibilité à l’œuvre pour un individu plongé dans un ensemble de personnes, une foule. Ce sont ces deux concepts, pulsion de mort et psychologie de la foule, qui nous servent ici dans la suite de notre propos pour faire ressortir quelques traits dont le relief est rendu possible depuis le belvédère de la clinique mise en œuvre dans les entretiens se déroulant dans le cadre de Souffrances Au Travail. Oserons-nous dire que, sous un certain angle, ces entretiens orientés par la psychanalyse sont une clinique de facto appliqués à la politique à travers le singulier?
Le désir, au cœur de la découverte freudienne.
Désir est un mot à la très belle, élégante, et éloquente étymologie latine. Desidere, c’est sortir de la sidération. Et en un certain sens, c’est ce qui peut nous réveiller de nos discours convenus et automatiques, dans la surprise d’un lapsus ou d’un acte manqué. S’agissant de certaines personnes reçues dans le cadre de Souffrances Au Travail, ce mot, concept aussi bien, condense on ne peut mieux le courant de fond qui irrigue la dynamique, dialectique, à l’œuvre dans les entretiens. Tel fut le cas pour cette jeune femme, dont le nom trônait quotidiennement en haut du tableau produit en réunion générale voulue par la direction de la société qui l’employait, tableau qui évaluait comparativement le chiffre d’affaire réalisé par chacun des responsables commerciaux. Jeune femme toujours citée en exemple, jusqu’à ce que son chiffre d’affaires subisse un fléchissement notable et qu’elle se voie mise à l’index devant l’ensemble de ses collègues en subissant des propos littéralement infamants. Du jour au lendemain. C’est en larmes qu’elle se présentera à SAT. Un détour par sa propre histoire lui rappellera qu’elle n’avait rien à voir avec cet objet de répulsion de l’Autre. C’est ainsi que, s’étant vite ressaisie, et déprise de cette situation de déréliction où on elle se retrouvait plongée, elle pourra retrouver une place chez un concurrent de cette entreprise.
Ici la période de « confusion »[2] aura donc été brève. Confusion, fusion ensemble de cette place de rebut qu’on lui assignait aujourd’hui avec cette place d’idéal où elle situait la direction de son entreprise et qu’elle avait intégrée et homologuée comme principe évaluateur. Ainsi le discours manifeste, en apparence valorisant, dissimulait-il une virtualité plus inquiétante qui ne manqua pas ici de se réaliser. Son statut d’instrument, versus instrument productif, s’étant soudainement révélé dans l’inappropriation aux objectifs fixés par l’entreprise qu’on lui faisait sentir, sans autre considération humaine subjective, ou même tout simplement humaine, dont elle croyait pouvoir bénéficier. La pulsion de mort recélée, tapie, dans la machine organisationnelle est ici logée dans le discours émollient de la culture d’entreprise, au cœur même de la perception stimulante qu’on pourrait en avoir. Cette confusion peut dans certains cas offrir une résistance à toute épreuve à la fonction authentique de la parole. Cette confusion est à l’œuvre dans beaucoup d’entretiens. Car au cœur de la plainte qui s’y déploie, d’où sourd, dès les premiers rendez-vous, le cri de l’être[3], agit toujours la force de cette captation par l’Autre, Autre dont le mensonge, la tromperie, la trahison, l’imposture, le leurre, la supercherie, la duperie, la méchanceté, laisse sans recours le sujet. Dans le quotidien du travail, elle est bien sûr la règle. Et ce n’est qu’à l’état virtuel que le risque de déchéance de chacun subsiste, ce qui laisse en suspens pour le sujet où et quand il en sera atteint, et de ce fait lui laisse espérer que ce ne sera jamais. Le contexte économique d’aujourd’hui rend ce risque plus présent à l’esprit.
Lien hypnotique, hypnose, hypnotisme.
C’est sous forme de question que nous en appelons à la notion de lien hypnotique. En quoi cet angle d’approche pourrait-il nous éclairer sur cette « confusion » que nous amenons ici à partir de la théorie de Lacan qui oriente notre pratique? D’autant que cette notion est un véritable kaleidoscope quand on s’attache à préciser les significations de l’hypnose et de l’hypnotisme au regard des différentes interventions sur le mental auxquelles elle donne lieu, sans oublier ses conséquences, ses effets pour le corps. Mais aussi du fait que le lien hypnotique soit partie intégrante du lien social tout court. La voix, le regard sont les puissants véhicules qui nous relient au désir de l’autre. Il semble donc qu’on puisse parler d’un lien hypnotique généralisé et d’une application hypnotique restreinte.
L’étymologie nous donne le centre de gravité de cette force attractive: hypnos, sommeil. Concernant le domaine médical, c’est Ambroise Auguste Liébault (1823-1904) médecin de son état, qui fut l’un des premiers à se pencher sur les effets thérapeutiques de l’hypnose, dans son livre Du sommeil et des états analogues considérés du point de vue du moral sur le physique. Et aujourd’hui, les applications de l’hypnothérapie sont nombreuses tant en chirurgie dans ses applications analgésiques en chirurgie dentaire ou obstétricale, qu’en psychothérapie.[4]Leur point commun est donc la mise en sommeil d’une fonction mentale, laissant le champ libre au praticien pour son intervention, dans le même temps ou l’individu est dessaisi de son rapport à lui-même. Il ne s’appartient plus. Cette neutralisation, partielle ou totale, n’est pas moins à l’œuvre dans le lien social qui procède de la relation d’un individu avec le collectif où il est plongé : foule (les supporters d’une équipe sportive), organisation de travail, parti politique, église, armée, association de consommateurs etc., nonobstant les spécifications de Jacques Lacan quand il aborde ce point et que nous l’aborderons pas ici[5]
Confusion
Freud quant à lui insère le lien hypnotique dans une série [6]: état amoureux, hypnose, suggestibilité de la foule, chacun de ces trois états s’éclairant des deux autres. L’expérience de la relation transférentielle, particularisée comme telle par Freud, lorsqu’il délaissa l’hypnose, n’y est pas étrangère. Le lien amoureux, le lien hypnotiseur/hypnotisé, sont des foules à deux comme il le rappelle dans son texte. Dans ces trois contextes est à l’œuvre un principe externe au sujet, principe qu’il investit selon des modalités différentes, de manière inattendu ou voulu ou par contagion, mais dans tous les cas dessaisi d’un certain jugement en tout ou partie. Dans ces trois situations il se met en position d’être le jouet de l’Autre. Il est à sa merci. Il est son objet. Mais non sans son consentement. Dans le cas de cette jeune mère, les choses ont commencé à se gâter dès son retour de congés maternité. Alors qu’un nouveau directeur de département venait il y a peu de prendre ses fonctions, et qu’elle sortait répétitivement en pleurs de leurs entretiens en réunion bipartite. Elle n’en campait pas sur une dénégation délétère, nocive pour elle « Il y a pire » pouvait-elle dire. Ce qui valait pour consentement. C’est ici un cas de confusion, confusion que nous voulions ici aborder, dont elle ne sortait pas. S’estimant objet de déconsidération par l’Autre, pour autant la force attractive de l’idéal qu’elle plaçait dans cette personne n’en était pas moins la plus forte, la plus puissante, ce qui l’amenait à prendre sur elle, et à endosser une certaine culpabilité. D’où la valeur relative de son propos qui relevait de paroles automatiques induites par cette idéalisation - par lesquelles on peut dire qu’elle était plutôt parlée- et non de paroles authentiques en concordance avec ce qu’elle éprouvait, pour en exprimer soit de la détresse, ou encore de la colère etc. Il y avait ici confusion. Et d’ailleurs cette personne n’était pas en mesure, par résignation, de faire appel à un tiers de recours. Le lien hypnotique à la foule que constitue celui d’une personne à une organisation de travail, par l’intermédiaire d’un de ses représentants, ici un supérieur hiérarchique, était le plus fort, cette personne s’aveuglant ainsi sur son propre état qui pouvait n’être pas sans conséquences sur sa santé. Cette position sacrificielle est-elle vraiment obligée ?
RENE FIORI
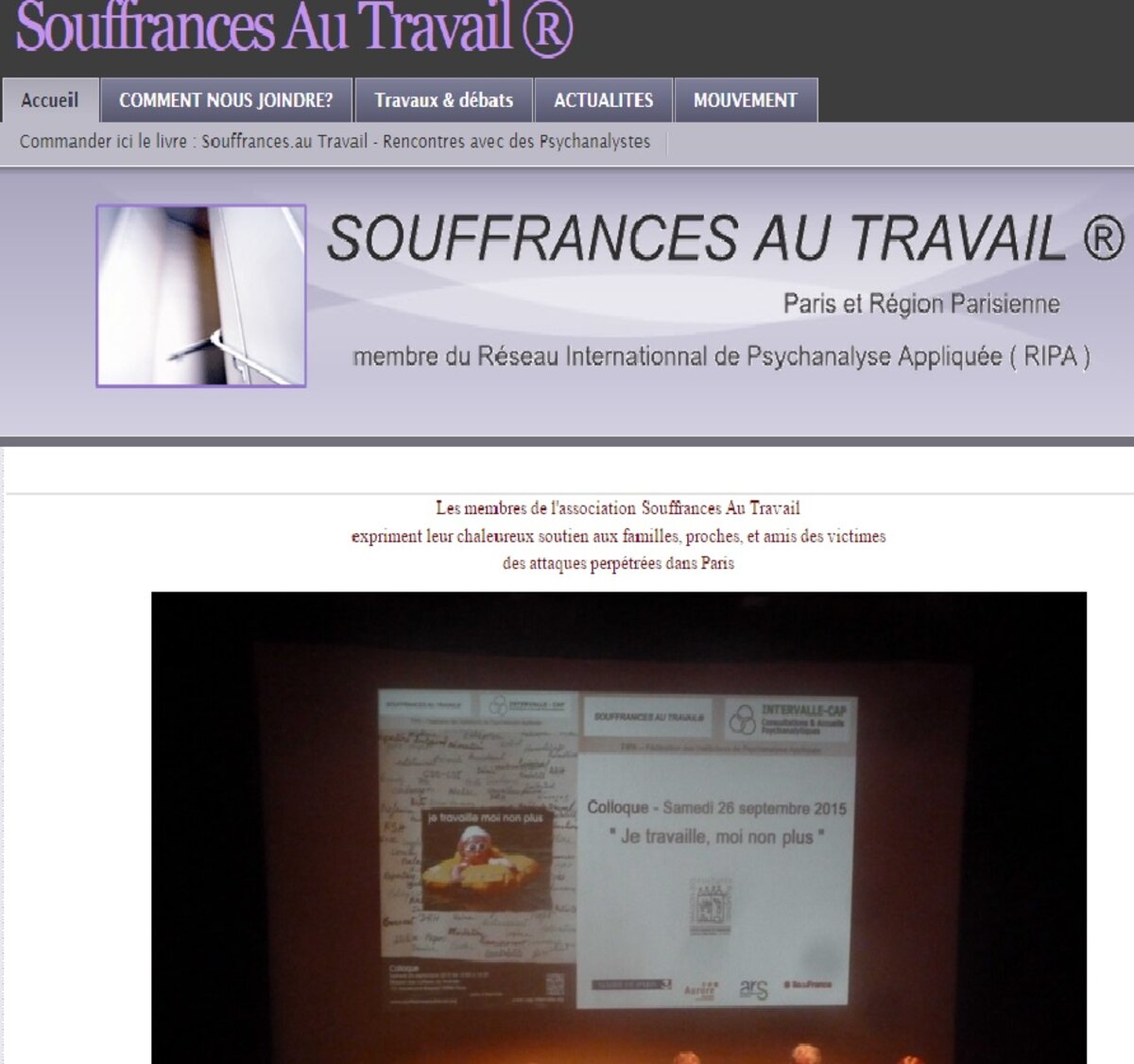
Agrandissement : Illustration 1

[1] Voir l’échange entre Jacques Alain Miller et Michel Onfray : www.radio-a.com
[2] Pour ce terme, voir Jacques Lacan, Le séminaire Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973 p.245.
[3] Leguil F., « Souffrances au travail et symptômes du malaise dans la civilisation », Souffrance au travail-Mise au travail de la souffrance, Fontenay –Le-Comte, Ed Lussaud, 2012 ; Doguet-Dziomba M-H, « Au travail, qu’est ce qui fait souffrir », Souffrances au travail-Rencontre avec des psychanalystes, Paris, ED SAT, 2012.
[4] Lettre de l’UNAFAM N°90, entretiens réalisés par Corinne Viennot. Entretien avec le Dr Nabil Hallouche, praticien hospitalier à Maison-Blanche en médecine générale ; Entretien avec le Dr Agnès Lefort, psychiatre, praticien hospitalier au GPS perray-Vaucluse.
[5] Lacan J., Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991.
[6] Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi », Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1985



