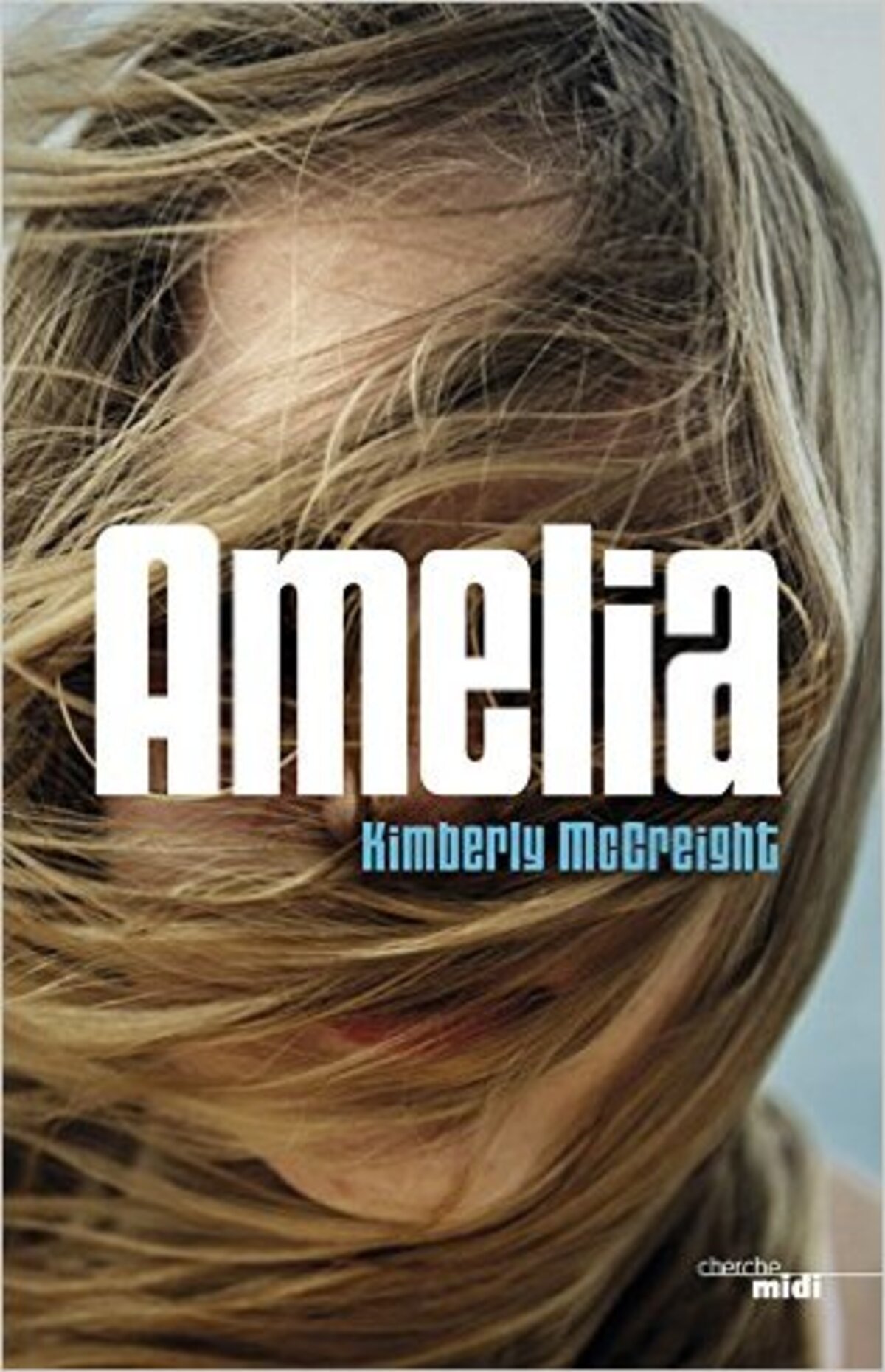C’est à la page 189 du roman de Kimberly Mc Creight[i] qu’arrive enfin le perspicace et pénétrant inspecteur Lew. Mais l’affaire est déjà bien entamée. Une sale affaire. Et la langue n’en est pas moins de la partie ! Pour sûr, ce roman va vous rendre venere ! Quel en est le héros? Kate, la mère. Le titre du livre ? Amelia, prénom de sa fille. Plus précisément, en langue originale : Reconstructing Amélia. Une reconstitution en fait dont le point de départ est l’ignorance de la mère quant aux agissements de sa fille adolescente et qui, laborieusement, dans la souffrance, reconstitue ce puzzle dont les pièces lui étaient restées inconnues. Fragments de son investigation qui s’assemblent dans le même temps où nous assistons à la lente dégradation irréversible de l’image virtuelle du sujet, sa fille, qui finit par rejoindre son image réelle[ii] au travers d’un fatal sentiment de dédoublement « J’ai l’impression d’avoir glissé hors de mon corps. Comme si je me tenais à côté de moi-même, en train de secouer la tête. », réalise t elle. « Comment étais-je devenue cette personne ? ». Amelia est alors, là, absolument comme parlée par l’Autre dessaisie, dépossédée d’elle-même. Mais est-ce un suicide, un meurtre, ou un accident dont il s’agit au final ? Lew et Kate mènent l’enquête. En exergue, à l’orée du roman, une citation de celui de Virginia Woolf, Les vagues, texte dont la découpe des chapitres a manifestement inspiré l’auteur. Leur enchaînement déplie un temps, non pas unidirectionnel, ni même cyclique, mais transverse. Les personnages sont hétéroclites. GRaCeFULLY, une feuille à potins dont l’auteur tient à garder l’anonymat. Amelia (ses textos). Facebook (La page d’Amelia). AMELIA (au présent). KATE.KATE (Sa grossesse)… Le déroulement du récit capte, assimile le lecteur, le digère. La fluidité du récit et de la langue, scandée par la partition des chapitres l’incorpore. Mais c’est un autre roman de Virginia qui transfile le récit : Vers le phare, au titre ici encore plus explicite en anglais : To the lighthouse. Oui, à l’issue du roman, se trouve en quelque sorte la maison de la lumière quand survient l’élucidation de la mort d’Amélia et l’événement de la reconnaissance tout droit sorti de la tragédie grecque, telle qu’Aristote en dresse les canons dans sa Poétique. Car qui peut bien être le père d’Amélia ? Il y a le décor enfin : le Grace Hall College de Brooklyn à la réputation immaculée, les parents bourges et leur décorum faussement décontracté, les clubs de jeunes au nombre desquels se compte le Magpies. Qu'est ce que le Magpies ? Une vingtaine de filles, les maggies, « mignonnes, bien fringuées avec un bon réseau ». Le Magpies ? C’est-à-dire « …les pies : ces beaux oiseaux cruels réputés pour arracher les yeux des gens à coups de bec ». La puissance du roman réside aussi dans son implacable déroulement diaphragmatique. Un diaphragme dont la mise au point semble tout du long relever de l’asymptote, tant la conclusion de l’intrigue nous glisse entre les doigts jusqu’à sa butée sur l’invraisemblable. « Tout est donné au départ et les courbes n’ont plus qu’à s’abattre les unes sur les autres comme elles peuvent »[iii], dit Lacan de la tragédie. D'emblée la focale est très précisément pointée: le désir de la mère, versus le désir d’enfant de la mère. Un désir d’enfant affadi, anémié, asthénique, bref débile. « J’ai fait huit test en tout […] Une part de moi […] se disait que le numéro neuf serait le bon. Mais non. Le médecin m’a dirigée vers un gynéco. Le gynéco a confirmé la « grossesse » à l’aide d’une écho ». Comment les cartes ont-elles ensuite été battues? En route donc pour un voyage à travers la génération 3.0 ! Amélia vient d’être « raccordée » au réseau- entendre le Magpies- par la belle et populaire Dylan Crosby qui la kiffe grave. Dylan au prénom si équivoque. Amélia, séduite dès sa première teufe, bascule dans l’amour hypnoïde pour Dylan , celui dont parle Freud dans Pour introduire le narcissisme. Ce sera le prélude à l’inexorable glissement vers l’objet. D’abord comme objet du regard de l’Autre, lequel nous fait suivre la rampe étymologique chère à Lacan [iv], celle qui nous fait passer du pubis au public, selon l’helléniste J. de Vendryes et le linguiste Emile Benveniste qui sont sa ressource. [v] Objet de mise à l’épreuve ensuite : « NUMERO MASQUE. 2mains, ni culotte, ni soutif les novices, on checkera. Et mettez 1 jupe. RV même heure, même endroit ». Dans le même temps Amelia, à son insu et pour le pire, se désaccorde de l’amour maternel. Voici la haine de l’Autre qui prend le relais et à laquelle elle doit s’affronter, haine répercutée dans la fragmentation de son corps en autant de shoot de Ian, photographe et petit ami de sa meilleure amie Sylvia qui l'a piégée, puis dans la cinétique capiteuse de la vidéo de Zadie, sa pire ennemie symétrique en miroir. Les portables font jaillir et saillir les images puis la vidéo d’Amélia dénudée, diffusées sur le Net. Amelia est désormais épinglée, pour et par son amour saphiste. Grand I vient de changer de nature, le sujet Amalia s’appauvrit, se réduit devant ce surmoi ubiquiste, inflexible, à la méchanceté intraitable. Déjà, sans qu'il le sache, la volonté du sujet est traversée et accaparée par l’Autre, installé au plus intime de lui-même. [vi]Cela ne lui sera révélé bien trop tard, par-delà l’aveuglement de l’amour. Ces scènes virtuelles se manifestent comme autant de scènes sacrificielles produites par ces dispositifs technologiques qui ici déclinent, dupliquent, enrichissent le dispositif sadien. Derrière son image virtuelle démultipliée sur les écrans, le sujet s’apercevra à son détriment de l’image réelle, qu’il n’aurait jamais dû voir, quand elle émergera, à l’instant de sa chute mortelle, dans le regard terrifié de Sylvia, sa meilleure amie.
[i] Mc Creight Kimberly, Amelia, Paris, Ed du Cherche Midi, 2015, traduit par Elodie Leplat.
[ii] Pour la problématique du schéma optique, voir Lacan J., Le séminaire Livre 1, Les écrits techniques de Freud, transcription par Jacques-Alain Miller Paris, Seuil; Le séminaire Livre X, L’angoisse, transcription par Jacques-Alain Miller Paris, Paris, Seuil; « Remarques sur le rapport de Daniel Lagache », Ecrits, Paris, Seuil.
[iii] Lacan J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, transcription par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, p.316
[iv] Lacan J. « Clôture des journées d’étude des cartels de l’Ecole Freudienne de Paris »,Lettres de l’EFP, 18 avril 1978, Bulletin interne de l’EFP et « Préface à L’éveil du printemps »,Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.
[v] De Vendryes J., « Sur l’étymologie croisée », Bulletin de la société linguistique de Paris », 1955 p.1 et Benveniste E. « Pubes et publicus », Revue de Philologie, Paris, 1955, cités par Odile Valet, Le peuple, c'est au poil, "Des mots en politique", Paris, Bibliothèque de sociologie, juin 1998.
[vi] Lacan J. « Kant avec Sade », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.771.