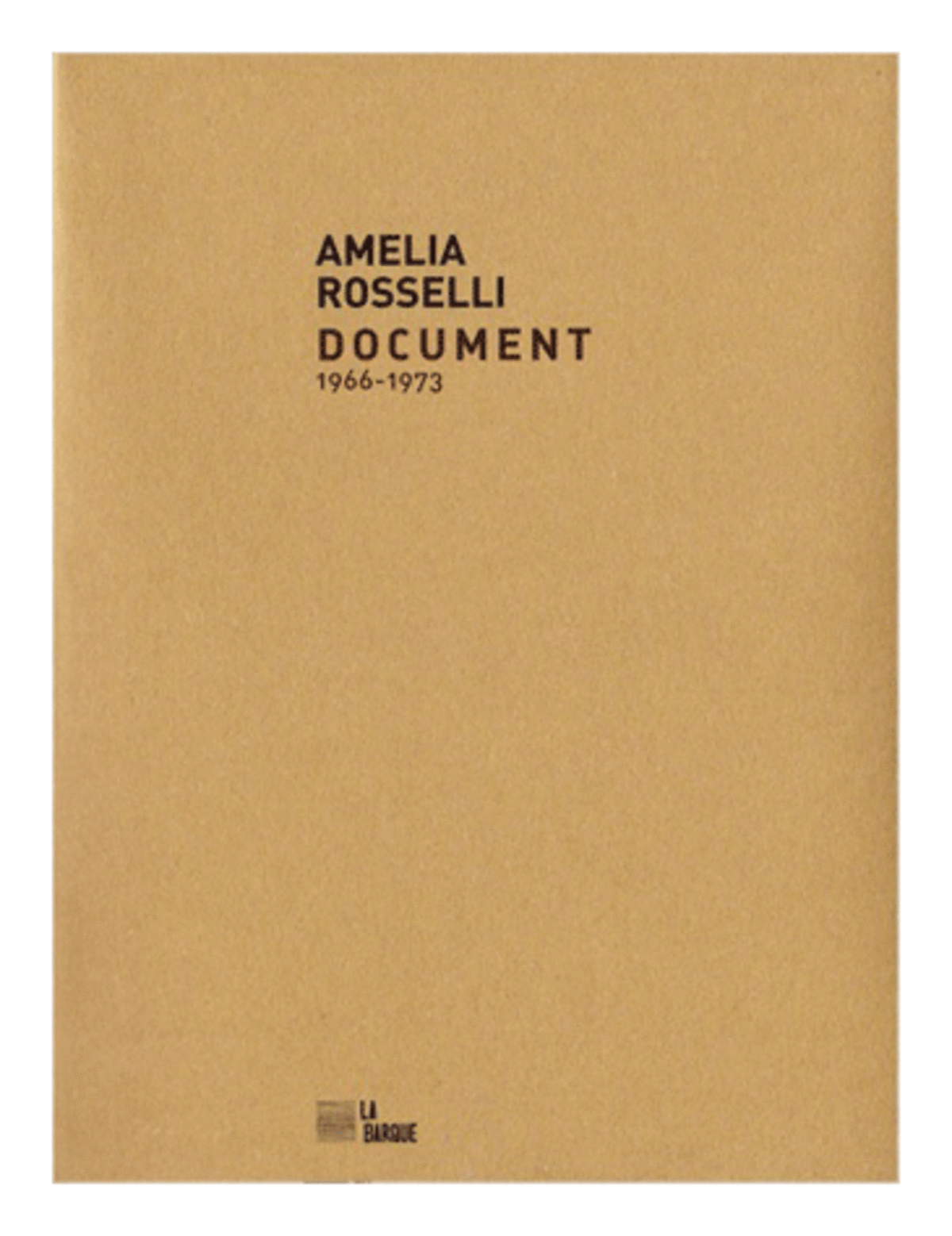
La conscience est aussi un ensemble de voix : pensées, souvenirs, éducation, interdictions, des films et des musiques, la famille, les ancêtres, les amours perdues, les discours politiques, la littérature, les critiques ou les conseils, les annonces publicitaires, celles des gares et des métros... Parfois ces voix nous assaillent ; Amelia Rosselli plus que beaucoup d'autres. Voix belliqueuses – voix « belliques » : « Je contemple les oiseaux qui chantent mais mon âme est / triste comme le soldat en guerre. »2. Ces voix pouvaient être celles de la CIA, celles de la persécution, celles de la contrainte et de l'angoisse, celles des morts qui utilisaient avant nous nos mots. Mais ces voix sont plus que cela encore : ce sont celles de l'énergie et des flux qui traversent les corps intimes, les corps extérieurs, les corps sociaux. C'est l'appétence, c'est l'être – en latin esse, le souffle : une polyphonie. Une polyphonie du moi ; un moi ouvert à toutes les variations, à toutes les contradictions ; moi non unifié, non défini, jamais fini.
C'est ce que reprochait, bien après sa parution qui lui ouvrit les portes de la reconnaissance, Rosselli au texte de Pasolini qui avait identifié ses écarts de langue – décrochages, court-circuits, – à des lapsus. Le lapsus dévoile ce qui se joue dans le théâtre de l'inconscient. Le théâtre d'un moi unifié. Or, chez la Rosselli, il n'y a pas un moi, une voix, mais des voix, il n'y a pas de théâtre de l'inconscient, mais des machines. Ces lapsus, disait-elle, n'en sont pas. Peut-être parce qu'avant d'être poétesse, Amelia Rosselli est musicienne. Avant que d'être sens, le poème est sons. C'est par la musique d'abord que se construit l'univers rossellien (de la tentation d'une forme de transcendance et du « semi-mysticisme platonicien » des années 60 au « document » de 1976) : « J'aspire à la panmusique, à la musique de tous, de la terre et de l'univers, dans laquelle il n'y a plus de main individuelle qui la règle. (…) Nous finirons par ne plus peindre, par ne plus écrire, par ne plus faire de bruit et contempler les numéros avec félicité. »3. Quelques années auparavant elle avait rencontré et collaboré avec John Cage et Luigi Nono, avait suivi plusieurs années de suite à Darmstadt pendant l'Internationale Ferienkurse Für Neue Musik les cours de Stockhausen, Pierre Boulez et David Tudor avec qui elle entretînt une liaison de deux années (1959-61). En 1962, année charnière dans sa vie, elle se produisit à deux reprises dans une galerie d'art de la place d'Espagne à Rome avec, entre autres, Sylvano Bussotti, connu pour être un précurseur de la musique électroacoustique.Comme chez Cage, Stockahausen, Luciano Berio, et comme on le retrouvera plus tard chez Deleuze, c'est la machine productive qui fonctionne, surtout détraquée et sabotée. Aérodynamisme, mécanique, mathématiques4. Piano préparé. La Rosselli conçut elle-même un orgue que Farfisa commercialisa. Évidemment : construire son instrument, construire sa langue. C'est en tant que musicienne qu'elle devient poétesse. « Une problématique de la forme poétique a toujours été pour moi reliée à celle plus strictement musicale »5. Une musique libérée de la main individuelle, une musique qui révolutionne le jeu et l'écoute. C'est ce qu'il faut avoir en tête en abordant la poésie d'Amelia Rosselli : sa langue est volontairement déroutante. Elle cahote, elle n'est pas lisse, elle est même parfois cacophonique. Des éclats d'une beauté saisissante jaillissent soudain des scories. Les expressions sont viciées, les vers sont décapités, les répétitions sont lourdes, les ajouts de voyelles sont irritants. Joie du lecteur, torture du traducteur.
Amelia Rosselli n'a pas fait dans la facilité : d'abord musicienne, à peine commence-t-elle à entrevoir la possibilité d'en vivre, qu'elle préfère devenir poétesse. Quand tout la pousse à écrire en anglais, elle opte pour (adopte)l'italien. C'est la croisée mallarméenne du Sonnet en X. Point de fuite. Ou tentative de « s'en sortir sans sortir »... Le 11 février 1996, le lendemain d'un passage à la télévision, Amelia Rosselli, alors chez elle dans un petit appartement derrière la place Navone, acculée par des voix qu'elle ne supporte plus6, se défenestre. Elle a 66 ans.Née en 1930 à Paris, d'une mère anglaise, Marion Cave7, et d'un père italien qui n'est autre que Carlo Rosselli, elle passa son enfance, après l'invasion de la France par les Allemands,en Angleterre puis aux États-Unis. Trois langues bercent la petiteMelli (encore appelée ainsi par les proches de la famille pour la différencier de sa grand-mère, auteur aussi, qui portait le même nom) : le français, l'anglais et l'italien. Ce trilinguisme, que la Rosselli utilise pour écrire et qui supplante une langue maternelle fautive, la poétesse va même jusqu'à les mêler dans un Diario in Tre Lingue (1959), un journal en trois langues composé de remarques et de réflexions fragmentées. Inutile d'insister sur le traumatisme de la mort d'un père qu'elle cherchera à retrouver, par un transfert évident qu'elle reconnaissait elle-même, dans ses relations avec des hommes de vingt ou trente ans son aîné. Le fondateur de Giustizia e Libertà, lehéros anti-fasciste (salué à sa mort par Victor Serge), le bourgeois n'ayant pas reculé devant le combatpendant la guerre d'Espagne (sur le front Aragon), compagnon d'Umberto Marzocchi8 et de Camillo Berneri, blessé au Monte Pelato etassassiné pendant sa convalescence en France en 1937 avec le frère Nello dans une embuscade (à Bagnoles-sur-l'orneen Normandie) par des cagoulards français (dont Jean Filliol et Aristide Corre9 sur l'ordre de Mussolini), est pour sa fille un souvenir, un nom, mais surtout une langue. Une sonorité, impalpable par nature. Alors, quand la Rosselli élit l'italien plutôt que l'anglais ou le français, c'est d'abord comme langue de la patrie du père10, celle du père défunt : langue paternelle.Puis pour – ou plutôtpar – les qualités (entendons aussi « défauts ») intrinsèques à l'italien : une difficulté d'invention, de détournement des expressions, une facilité en revanche à exhumer des termes et des tournures anciennes ou vieillies, une certaine souplesse syntaxique qui multiplie les possibilités de focalisation et les nuances expressives. Langue à la fois de Carlo Rosselli mais aussi celle qui s'oppose à la langue maternelle en tant que voix innée, donnée. L'italien est la langue de l'exil. Celle de l'exilée. De l'étrangère dans son propre pays (quand elle rentre en 1946 et qu'elle décide de s'installer à Rome en 1950 dans ce pays qu'elle n'a jamais vu, c'est avec un fort accent dont elle se départira jamais). C'est dans ce soupirail, cette béance, ce non-lieu, – comme on voudra –, que se pose Amelia Rosselli. Son rapport au monde est donc fondé sur l'absence, la perte, l'« infini -1 ». Mais cette perte, malgré la douleur, n'est bientôt plus un état fautif : elle devient un autre mode d'appréhension du monde.Quand Amelia Rosselli abandonne la musique, elle abandonne en même temps l'Idéal (platonicien ou néo-platonicien) et le mythe de la totalité (celle, notamment d'une œuvre close). Avec l'écritureelle accepte (et peut-être est-ce inhérent à cette pratique) la fragmentation. Ce sont les recueils d'après Série Hospitalière : Appunti sparsi e persi (1983), Diario ottuso (1990)et, avant cela, les séries ouvertes de Documento. Elle ne prend pas position dans le tout d'une langue qu'elle pourrait interroger, transgresser, voire maltraiter, mais bien sur un territoire errant – une île (une presqu'île) –, une langue, sinon morcelée, au moins en construction. On pense (il y en a d'autres) à Gherasim Luca.
On a déjà beaucoup glosé sur cette langue : plurilinguisme, multilinguisme, triglossie, ydioma tripharium, etc. La langue paternelle n'est pas seulement celle du père ou de l'exil, c'est celle qu'on pétrie. Évidemment Amelia Rosseli est gorgée de la culture anglo-saxonne dans laquelle elle a été formée. Joyce, Pound, Plath sont les figures de la modernité qui l'influencent. Tout comme James Joyce ou Ezra Pound (à qui par ailleurs elle consacre des articles), elle est musicienne et revendique les moyens musicaux pour sa poésie. Traductrice de Sylvia Plath, elle partage avec elle non seulement – de manière fortuite et symbolique – la date de son suicide (le 11 février) mais aussi cette relation complexe au père. En plus de l'anglais, du français et de l'italien, il y a le latin et les dialectes. Enfin, les termes techniques et les néologismes. De cette diversité (qui est pour nous la preuve d'une absence d'unité linguistique) se retrouve de manière assez frappante, mieux qu'en français et en anglais, dans l'italien en général. La langue de la Rosselli est fondamentalement politique. Il n'y a pas, au moins pour Amelia Rosselli, un italien, mais bien des italiens. Le pays, unifié relativement récemment (le 17 mars 1861), est divisé en régions, et les régions en communes qui gardent chacune la fierté de son dialecte. La langue, comme la nation, n'est pas unifiée, elle n'épouse pas les contours de l’État qui s'adjuge une « langue officielle ». Peut-être une raison, même instinctive, du choix de l'italien par la poétesse. Son errance personnelle semble se retrouver dans ce flottement territorial. Pour Rosselli, et avant elle chez Pound, il s'agit d'une véritable géographie en tant qu'écriture du monde. Le son et la graphie sur le même plan. Géographie sémantique, géographie linguistique. En tant que « langue paternelle », l'italien n'est pas au fondement, il se construit pleinement avec les influences extérieures, le temps de l'écriture (et de la lecture) devenant immanence de la construction symbolique au monde (ce qui faisait dire à Proust que la vraie vie est la littérature). Stilnovo, latin, modernités, néologismes, dialectes, termes techniques, l'écriture tend donc à explorer les mécanismes induits de la langue, en tant que producteurs d'une position, ou plutôt d'une posture qui est, au sens large et fort du terme, politique.
Documento (1966-1973) paraît chez Garzanti, à Milan, en 1976. Après les Variations de guerre (1964) et la Série hospitalière (1969), qui sont marqués encore par le désir de clôture d'une œuvre autour d'une certaine unité, Documentreste ouvert et accumule sans autre ordre que l'ordre offert de la chronologie (même si un choix drastique a eu lieu, qui donnera naissance à Appunti sparsi e persi) des cycles qui, bien que poreux, sont faciles à distinguer.Poèmes longs, courts, nerveux, politiques, intimistes, abscons voire sibyllins, expérimentaux, limpides et saisissants, proches parfois même de l'épigramme (ce dont se souviendra Patrizia Cavalli), privés (poème épistolaire A Adriana), presque de la chronique quotidienne (Sciopero 1969, Il Cristo – Pasqua 1971). Tout en conservant une unité forte, le vers ne répond plus systématiquement aux procédés théorisés dans Spazi metrici : un flux plus libre multiplie les formes et varient les longueurs. Du plurilinguisme fondamental de Rosselli, la période veut que l'anglais prenne le dessus (l'écriture du recueil se confond avec celle des poésies anglaises de Sleep). Par sa longueur, sa variété, sa position médiane, Document est sans doute le recueil majeur de la Rosselli.
L'abondance créative est à son comble après sept ans sans publier (le recueil, une somme, compte 175 poèmes), et même si les audaces des débuts tendent à se raréfier, ou plutôt à se concentrer (dans des détails surprenants), le subterfuge d'une recherche d'absolu par le langage n'a plus lieu d'être. Le silence grandit avec le bruit des voix intérieures qui polluent quotidiennement l'espace mental de la poétesse. Les traces laissées de ce parcours (de véritables documents), de cette vie mentale, ne nous permettent pas de reconstituer avec exactitude la vie ou la pensée d'Amelia Rosselli : elles nous permettent de déconstruire notre propre système langagier. Ce sont les voix qui traversent le corps. « Écrire, c'est peut-être amener au jour cet agencement de l'inconscient, sélectionner les voix chuchotantes, convoquer les tribus et les idiomes secrets, d'où j'extrais quelque chose que j'appelle MOI »11. Travail de l'écrivain de faire remonter ces voix. Voix intérieures (Hugo), voix des civilisations (Homère), et voix d'Artaud, de Michaux, de Bruchner, voix balbutiantes de Ghérasim Luca, voix des discours tout faits de l'homme de la rue, pilier de comptoir, ménagère dépressive, professeur, policier, fonctionnaire, désœuvré, pauvre des taudis comme riche des ghettos, banquier ou altermondialiste, lecteur ou éditeur. Par le document, elle ne cherche pas l'indice, le code, la classification, l'ordre, mais elle pose des balises, des amers, elle présente la réalité d'un objet. Le document rossellien n'est pas loin de celui de Bataille. Il présente plus qu'il ne représente. Il montre (monstre) plus qu'il glose ou interprète.

(photo de Dino Ignani)
Pour le traducteur qui y passe des mois, des années, qui farfouille dans les vieux dictionnaires étymologiques, qui va écouter les dialectes d'Italie, qui replonge dans son latin de Bas-Empire, qui repère à la faveur d'un hasard la clef d'une orthographe hermétique, ou qui se pâme d'aise et de frustration devant des néologismes intraduisibles, il y a souvent, à la relecture du poème, le fou rire de celui qui se dit : « On va se foutre de moi, jamais personne ne me prendra au sérieux... et pourtant c'est bien ce qui est écrit ! ». Les traductions en sortent édulcorées : on préfère sauver les apparences. C'est que les poèmes de la Rosselli ont aussi des beautés de « sens » (des significations fortes) qu'il est plus facile de vendre. Fulgurances et épiphanies. Joyce. Le texte pourrait être truffé de notes, et – comme c'est déjà le cas – faire l'objet de longues études universitaires, fastidieuses et absconses. Un autre point (nous ne pourrons pas être exhaustif ici) est l'enrichissement de cette langue. Cette manière d'écrire engage à l'enrichissement du lexique, des formes syntaxiques, et à une ouverture généreuse à l'autre en général. Historiquement, au-delà des références directes (Rimbaud, Dino Campana, les imagistes, son ami Rocco Scotallero, etc) elle réactualise les expériences renaissantes autour de Dante et de Pétrarque ou, un peu plus tard, de la Pléiade. L'utilisation de termes dialectaux, scientifiques, l'invention de néologismes fantaisistes ou savants, rappellent les préceptes de Du Bellay et de Ronsard. Aujourd'hui les métissages se font par les anciennes colonies : l'anglais en Inde, le France dans les îles. Amelia Rosselli, quelque part, peut représenter un italien d'Angleterre ou d'Amérique. Un italien d'ailleurs de tout. Et, évidemment, la traduction en est amenée à changer de principes.
À intellectualiser l'écriture de la Rosselli, on en oublierait presque la teneur généreusement et gratuitement absurde. La folie (quoiqu'on veuille bien mettre dans ce mot) est dans l'œuvre comme dans la vie de la poétesse. Il faut être aussi frais devant Rosselli qu'on l'est devant Artaud. La schizophrénie est là, qui rumine et éclate. Qu'on lise Storia di una malattia. En traduisant, en publiant (en lisant en écrivant) Amelia Rosselli, on ne divulgue pas seulement une des poésies les plus émouvantes et innovantes de la seconde moitié du XXe siècle, on renoue avec une poésie exigeante mais quotidienne, une poésie du détraquement de la langue et de la pensée, c'est-à-dire une poésie, dans le sens fort du mot, révolutionnaire.
------
------
On retrouvera cet article aux adresses suivantes :
http://rodolphe-gauthier.blogspot.fr/2015/04/langue-paternelle-postface-document.html
http://www.rodolphe-gauthier.com/amelia-rosselli-langue-paternelle-2.php
------
1 « Si parlava francese anche in casa, tranne che con mio padre, fidele all'italiano. » L'« ydioma tripharium » di Amelia Rosselli, Manuela Manera, in « Lingua e Stile », XXXVIII, dicembre 2003, p.235.
2 Poème 7 des Variations.
3 Musica e pittura, dibattito su Dorazio in Scrittura plurale, pp. 38 et 42 (la citation date de 1966).
4 Invoqués dans Spazi metrici, texte fondamental de la théorie poétique de la Rosselli.
5 Cette phrase ouvre le texte de Spazi metrici.
6 On le sait car elle a appelé des amis à l'aide, qui arriveront trop tard.
7 Activiste au Labor Party, elle aurait rencontré son futur mari alors que celui-ci était venu en Angleterre vers 1923 se renseigner sur le travaillisme anglais.
8 Qui écrira un petit livre sur la section italienne pendant la guerre d'Espagne intitulé Carlo Rosselli e gli anarchici.
9François Méténier serait l'organisateur de cet assassinat.
10 Amelia Rosselli compte parmi ses cousins Albeto Moravia qui avait, depuis la mort de Carlo Rosselli, eut des relations tendues avec la famille.
11 Deleuze, Guattari, Mille Plateaux, p.107, Les éditions de Minuit, 1980.



